Résumé introductif de l’article ! ✎
Dans cet article nous allons voir comment l’histoire alternative peut amener les gens à s’intéresser à l’Histoire et dans ce cas-ci évidemment car c’est l’ADN du site à l’Histoire belge.
1) Qu’est ce que l’Histoire?
L’histoire est une discipline qui cherche à comprendre et à déméler le vrai du faux dans des récits passé, récits qui peuvent être sous la forme de témoignages. L’historien ne se base pas seulement sur des sources comme des témoignages, les documents comme les témoignages portent le nom de sources écrites, ce sont des textes que des gens ont rédigés par le passé. Il y aussi des sources matérielles, qui ont été confectionnées par l’Homme, des sources iconographiques liés notamment à des représentations par exemple sous formes de dessins ou de tableau par exemple et finalement les sources audiovisuelles que cela soit des films ou même des émissions radios par exemple. Le 1er historien était Hérodote, il avait beaucoup voyagé et a notamment été dans diverses civilisations de l’Antiquité pour voir le mode de vie de celles-ci. Contrairement aux récits anciens qui avaient tendance à mélange des récits mythologiques avec des évênements bien réel, Hérodote lui a été le premier a enquête car Histoire vient du grec Historíai qui veut dire enquête. Hérodote recherchait les causes des évênements passés et leurs conséquences mais il regroupait aussi les sources et les comparaient.
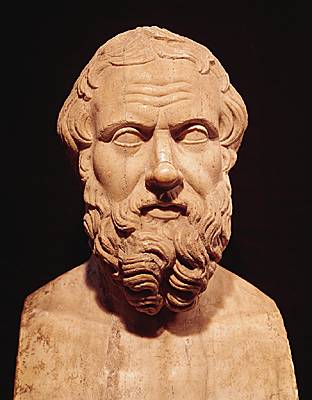
1.2) Qu’est ce que l’Histoire alternative?
L’Uchronie ou histoire alternative est un genre littéraire qui peut aussi se décliner cinématographiquement qui consiste à la différence de l’Histoire qui se base sur de réelles sources, là c’est beaucoup plus compliqué car les auteurs de ces oeuvres de fiction se basent sur des éléments de l’histoire et tentent de les changer ce qui résulte vous vous en doutez à d’autres conséquences qui vont totalement changer le cours des événements de manière totalement imprévisible comme l’effet papillon le stipulait. Les histoires alternatives comportent des points de divergences et évidemment il faut que les éléments soient logique pour ne pas partir dans du grand n’importe quoi. Évidemment plus l’on avance dans le temps dans une histoire alternative plus la fiction prend le pas sur les faits alternatifs qui au départ peuvent être réalistes mais puis totalement vont dans le sens de la science-fiction.
1.3) Pourquoi parler de ce sujet?
Il pourrait vous semblez bizarre que je parle de ce genre de sujet sur un site qui se veut sérieux cependant je tiens à rappeler que l’Histoire est très importante et aujourd’hui rares sont les personnes qui s’intéressent à celle-ci. Beaucoup de gens ont l’image des historiens comme de vieilles personnes qui se trouvent dans des bibliothèques poussiéreuses mais ce n’est pas du tout le cas. Comme vous le savez sûrement, aujourd’hui la Gauche même si son influence sur l’Histoire a diminué aime s’approprier des faits historiques pour les racontés à sa manière ce qui est malhonnète car comme je l’avais dit de par le passé chaque fois qu’une personne investigue sur le sujet de l’Histoire a un biais mais enquêter comme le font les Gauchistes et de vouloir imposer leur vision des choses que cela soit à l’école,dans les médias ou autre est criminel car cela donne du grain à moudre aux extras-européens pour déconstruire notre Histoire et de nous rendre vulnérable. L’Histoire alternative est un moyen par la fiction donc par le divertissement et nous vivons malheureusement aujourd’hui dans une société qui est gangrenée par celui-ci, de pouvoir raconter l’Histoire d’une autre manière et donc de permettre au public de s’intéresser à l’Histoire et par conséquent ici dans cet article à l’identité de la Belgique et donc de pouvoir devenir de Droite. N’oublions surtout pas que les totalitarismes de Gauche comme de Droite essaient de détruire l’Histoire pour la reconstruire à leur image c’est pour cela qu’il est vital que le grand public se pose des questions sur son histoire pour être plus critique et donc d’être moins la proie des totalitarismes. Pour finir l’Histoire alternative permet non seulement de connaître la portée d’un événement historique mais aussi de parler des enjeux sociétaux d’une période donnée.
Points de divergences entre l’année 1830 et 1831
2) Et si… Les hollandais avaient écrasés la Révolution de 1830?
Souvent un événement ne se base sur pas grand chose pour ne tout simplement pas arriver. Je vous l’avais expliqué dans les articles concernant la Belgique qui est une patrie et la continuité chrétienne en Belgique.
La Révolution belge se basa sur plusieurs facteurs, tout d’abord les bourgeois étaient opposés au despotisme de Guillaume 1er et aussi l’imposition du Néerlandais à ces même bourgeois par le régime hollandais qui étaient pour la plupart fransquillons(qui étaient des flamands qui s’exprimaient en Français) et les wallons aussi étaient opposés à cette imposition du Néerlandais et comme je l’avais expliqué dans l’article sur les différents patois et langues régionales les bruxellois par exemple considérèrent que leur langue qui était majoritairement du Brussel Vloms était une langue différente du Néerlandais, même beaucoup de flamands le considérait ainsi.
Le Clergé s’était opposé à Guillaume Ier notamment car il était un monarque protestant qui voulait imposer sa religion, la Belgique qui était à l’époque majoritairement catholique. Ce monarque s’imposait dans la vie de la religion catholique en se présentant comme le chef de l’Église en Belgique.
Concernant le point de divergence, celui-ci aurait été que dans notre réalité la Russie était le gendarme de l’Europe au XIXème sous le règne du Tsar Nicolas Ier, celui-ci faisait face à très grande révolte des polonais du nom d’Insurrection de Novembre qui s’opposait à sa tyrannie mais grâce à ce soulèvement le Tsar malgré que sa soeur Anna Pavlovna était marriée au fils de Guillaume Ier qui l’avait poussé à rejoindre le conflit, par crainte que le soulèvement polonais ne dégénère encore plus il décida de ne pas envoyer ses troupes aux Pays-Bas pour mater la Révolte que le Tsar considérait comme une déstabilisation de l’ordre européen après le Congrès de Vienne. Par la suite la France avec la campagne des dix jours sécurisera l’indépendance de la Belgique ce qui mènera à la fin des hostilités, il faudra attendre 1839 avec par la ratification du traité des XXIV articles par le roi Léopold 1er et le roi Guillaume Ier pour que les frontières de la Belgique soient fixées, celles-ci étaient les mêmes qu’aujourd’hui sauf pour les cantons d’Eupen-Malmedy qui arriveront en Belgique en 1919 suite au Traité de Versailles. Dans l’Uchronie les troupes russes mais aussi il ne faut pas l’oublier les troupes de la Sainte-alliance qui comptait en plus de la Russie,la Prusse et l’Empire d’Autriche. Les russes et les troupes de ses alliés avec un appui logistique néerlandais auraient débarqués à Anvers tandis que les chefs révolutionnaires auraient été en France après leur défaite. Par la suite, pour éviter que cela ne recommence Guillaume Ier va pendant un certain temps déclarer la loi martiale dans les provinces du Sud et imposer des gouverneurs militaires.
Que se serait t’il passé par la suite? Il est très possible que le roi Guillaume Ier aurait maté la révolte et aurait accentué sa domination sur les provinces du sud(la Belgique de notre réalité et aurait continué à régner comme dans notre univers jusqu’en 1840 où il a abdiqué en faveur de son fils. Guillaume II n’a régné que de 1840 à 1849 et comme vous le savez sûrement partout en Europe en 1848 des révoltes éclatèrent ce qui s’appelait à l’époque « Le Printemps des peuples ».)Dans notre réalité, ces révolution à travers toute l’Europe n’affectèrent pas la Belgique car celle-ci avait mis en place des réformes libérales et un mouvement patriotique c’était créé car les belges avaient la sensation que les français auraient pu leur déclarer la guerre et c’était vrai car une légion française a failli traverser la frontière.
Dans notre réalité aux Pays-Bas, le Printemps des peuples n’a pas secoué ce pays car le roi Guillaume II était plus libéral que son père et a grâce à Johan Rudolf Thorbecke il a pu mettre en place des réformes et une nouvelle constitution libérale en 1848, il mourra un an plus tard et son fils Guillaume III continua à mettre en place ces réformes. Même si le roi Guillaume II s’était basé sur son rival Léopold I pour ses réformes néanmoins même sans Belgique indépendante il aurait quand même réformé son pays. Même si Guillaume II était beaucoup plus libéral que son père, si des émeutes aurait hypothétiquement fait leur apparition dans les provinces du sud(la Belgique de notre réalité) le roi aurait été obligé de la part de ses alliés de la sainte-alliance de réprimer les émeutes, les catholiques et les élites conservatrices n’auraient pas eu le choix que de s’allier au régime.
Dans l’histoire alternative il est très possible que les événements que je vous ai mentionné précédemment se soient déroulés de la même manière, les provinces du sud bénéficiant de plus de droits notamment d’avoir leur propre parlement et que les gens ne se seraient plus vus imposer le Néerlandais. De plus dans cet univers les provinces flamandes n’auraient pas été perdues et donc que les finances hollandaises auraient été au beau fixe car il ne faut pas l’oublier mais le bombardement du port d’Anvers par les hollandais le 27 Octobre 1830 soit un peu plus de deux mois après le début de la Révolution belge le 25 Août 1830 dans l’éventualité où les russes auraient aidés à matter la Révolte rapidement, la ville d’Anvers n’aurait pas été impactée et par conséquent les Pays-Bas auraient gardés les deux plus grands ports d’Europe intact soit de Rotterdam et d’Anvers.
Guillaume III aurait dû faire face dans cette histoire alternative à des plus grands problème, dans notre réalité il y eut la démission de Thorbecke a cause en 1853 d’émeutes protestantes qui ne voulaient pas que la hiérarchie catholique romaine soit réinstaurée notamment avec son archevêché à Utrecht, dans cet univers alternatif à la différence du nôtre, même si la monarchie constitutionnelle aurait continué à se maintenir, il est très probable que le sud majoritairement catholique aurait demandé plus de concessions car même si le roi ne se serait plus mêlé des affaires catholiques, les néerlandais du sud dans cet réalité soit les belges de notre réalité auraient exigés d’avoir une séparation nette au niveau religieux entre le sud et le nord notamment dans l’enseignement et en politique, les partis catholiques et libéraux auraient t’ils existés dans ces provinces du sud? Il n’est pas du tout certain cependant si c’était le cas il aurait pu y avoir peut-être car les provinces du sud étaient plus peuplées un premier ministre catholique ce qui aurait créé des révoltes encore plus violentes de la part des protestants et peut-être une guerre civile à l’inverse si le roi Guillaume III avait refusé que le parti catholique et des autres partis similaire soient en Belgique alors là ça aurait été les catholiques qui se seraient rebellés rappelant les émeutes de 1830 qui n’ont pas dégénérées en révolution comme dans notre réalité.
Par contre l’Histoire, n’aurait pas été changée concernant le Grand-Duché du Luxembourg qui dans notre réalité s’est rallié au révolutionnaires belges et une partie du Luxembourg a été à la Belgique et est devenu la Province du Luxembourg tandis que le reste est devenu une union-personnelle avec les Pays-Bas où le roi des Pays-Bas devenait par conséquent roi-grand-duc, dans cet univers alternatif il est possible que le Grand-Duché de Luxembourg soit plus grand en intégrant la province du Luxembourg qui dans notre réalité appartient à la Belgique, car Guillaume III dans notre réalité et probablement dans l’Uchronie n’a pas eu d’héritier mâle, l’héritière étant la future La reine Wilhelmine et a donc céder son pouvoir à la dynastie des Nassau-Weilburg dans le Luxembourg de notre réalité et de l’Uchronie.
Il est possible aussi qu’à la suite des émeutes belges de 1830 de cette uchronie que le Duché du Luxembourg aurait été annexé par Guillaume Ier le punissant d’avoir annexé la Province de Luxembourg de notre univers et d’avoir rejoint les émeutiers, il est possible par la suite que les libéraux hollandais se soient radicalisés suite à cette annexion de la part de Guillaume 1er qui aurait été vu de leur part comme un tyran et que le roi Guillaume Ier auraient entrepris les réformes que son fils avait fait dans notre réalité pour éviter une révolution aux Pays-Bas notamment de donner plus de pouvoir au Sénat car les membres du Sénat étaient majoritairement nommé par le roi, il est possible que les libéraux auraient aussi exigés que le président du Sénat aurait possédé plus de pouvoir et que par conséquent que le roi ait moins de prérogative au niveau du Sénat. En 1848 même si les réformes auraient été implantées plus tôt, il aurait été possible que les libéraux auraient exigés une République même s’ils n’auraient pas été populaire.
Concernant la guerre franco-prussienne il est possible que le Royaume-uni des Pays-Bas aurait respecté la Sainte-Alliance même si celle-ci n’aurait compté plus que la Prusse et l’Empire Russe à cause de la guerre entre l’Autriche et la Prusse en 1866 bref cela veut dire qu’en 1870 la guerre franco-prussienne aurait été perdue encore plus rapidement par la France et en plus de l’Alsace-Lorraine elle aurait perdue le Hainaut français, guerre perdue plus rapidement car elle se serait fait attaqué aussi par les troupes prussiennes qui seraient passées par le nord de la France du côté de Namur et de Charleroi grâce à leur allié néerlandais. Dans ce scénario, en 1914 on aurait eu la répétition de 1870 en 1914 vu que le Royaume-Uni n’aurait plus garantit l’indépendance du Royaume-Uni des Pays-Bas vu qu’il considérait que cette alliance n’est pas assez démocrate à son goût. La France est attaqué en 1914 par les ardennes et les plaines flamandes. La France est encore plus détruite que dans notre réalité. Dans le scénario de la première guerre mondiale concernant le scénario africain, précédemment durant la Conférence de Berlin de 1885, il est possible que le territoire du Congo actuel ait été divisé entre le Royaume-Uni, la France, le Portugal et l’Empire allemand mais avec la crise d’Agadir l’Empire d’Allemagne aurait pu encore plus sécuriser son influence en demandant des territoires à la France pour connecter ses colonies du Congo allemand et du Cameroun allemand légitimant la seconde guerre franco-prussienne.
Concernant la Seconde guerre mondiale, le Royaume-Uni des Pays-Bas aurait été libéral comme je l’avais expliqué mais comme le Danemark dans notre réalité qui a gardé la même administration sauf que son territoire était devenu fantoche des nazis, tout simplement car les nazis étant très racistes ils traitaient différemment les populations qu’ils considéraient comme supérieures ou inférieures. Dans ce scénario, le Royaume-Uni des Pays-Bas serait devenu fantoche ne voulant pas que ses intérêts économiques et financiers ne soient trop menacés par une guerre qui aurait été trop coûteuse.
L’UE n’aurait probablement pas existé aujourd’hui car dans cette alliance la pression russe aurait été trop forte à aucun moment elle aurait voulu une Union-Européenne qui aurait pu concurrencer sa puissance.
J’ai eu l’idée de proposer des témoignages pour les scénarios d’histoire alternative pour vous permettre de mieux vous imaginez l’Uchronie.
Témoignage fictif de François de Smet en 1830: « Le tonnerre des canons russes résonne dans nos rues. Nous pensions que l’Europe nous soutiendrait, que les Français viendraient à notre aide, mais au lieu de cela, des cosaques défilent sur la Grand-Place. Hier encore, nous chantions la liberté au théâtre de la Monnaie. Aujourd’hui, mes amis gisent morts ou enchaînés. Bruxelles n’est plus une ville libre, mais une garnison étrangère. On nous a vendus au nom de l’ordre. »
Lettre fictive du comte de Mérode à un confrère de Liège en 1831:« Cher ami, il fallait choisir : l’anarchie ou la stabilité. Les Russes ont fait ce que nous n’osions pas : ramener l’ordre à Bruxelles. Les insurgés, manipulés par Paris, auraient plongé notre pays dans le chaos. Guillaume Ier nous garantit la foi catholique et nos privilèges. En échange, nous devons sa fidélité à la couronne. J’accepte ce marché, car l’alternative était la guillotine. »
Propos fictifs rapportés dans un journal clandestin par un tisserand de Gand en 1848:« Quand Paris s’est soulevée, nous avons cru que notre heure viendrait. Mais le 15 mars, les cosaques sont revenus. Ils ont tiré dans la foule place Saint-Bavon. Mon frère est tombé, et son sang a rougi les pavés. On nous dit : ‘La Belgique n’existe pas, vous êtes sujets du roi des Pays-Bas.’ Mais dans mon cœur, je sais que nous sommes un peuple étouffé. »
Témoignage fictif de Jean-Baptiste Wauters, caporal dans l’armée néerlando-belge(1870):« Les Prussiens marchent avec nous. Nous franchissons la Sambre pour attaquer les Français. Jamais je n’aurais cru porter l’uniforme de ceux qui ont écrasé la révolte de mes grands-parents. Mais l’ordre est clair : l’empereur Napoléon doit tomber, et notre royaume se tiendra aux côtés de Berlin et de Moscou. Je me bats pour un drapeau qui n’est pas le mien. »
Témoignage fictif d’une institutrice de Mons en Août 1914:« Les journaux disent que nos soldats marchent avec les Allemands vers Paris. Nous ne sommes plus neutres, nous ne sommes plus belges – nous sommes une province dans un empire qui n’est pas le nôtre. Mes élèves parlent encore français en cachette, car à l’école on nous oblige à parler néerlandais. Nos enfants n’apprendront jamais que la Belgique a existé, même dans un rêve. »
Témoignage fictif recueilli après la guerre par un docker d’Anvers:« Quand les Allemands sont arrivés, ce ne fut pas une invasion : ce fut une alliance. Les nazis ont trouvé ici des ports, des usines, des hommes déjà dressés à obéir. Nous avons chargé des bateaux pour la Kriegsmarine, travaillé dans les usines pour leur guerre. Certains disaient : ‘C’est notre destin depuis 1830, soumis à Berlin et à Moscou.’ Mais moi, chaque caisse que je portais, je savais qu’elle écrasait un peu plus notre liberté. »
Témoignage fictif d’un vieil exilé en 1973:« Mon grand-père me disait toujours : ‘Nous aurions pu être la Belgique, un pays libre et européen.’ Mais les Russes sont venus, et avec eux l’ombre de la répression. Tout a basculé là. Aujourd’hui, Bruxelles n’est pas la capitale de l’Europe, mais une garnison du Nord. Les jeunes ne savent même plus que le mot ‘Belgique’ a existé. Moi je le porte comme un secret, une flamme éteinte que je refuse d’oublier. »










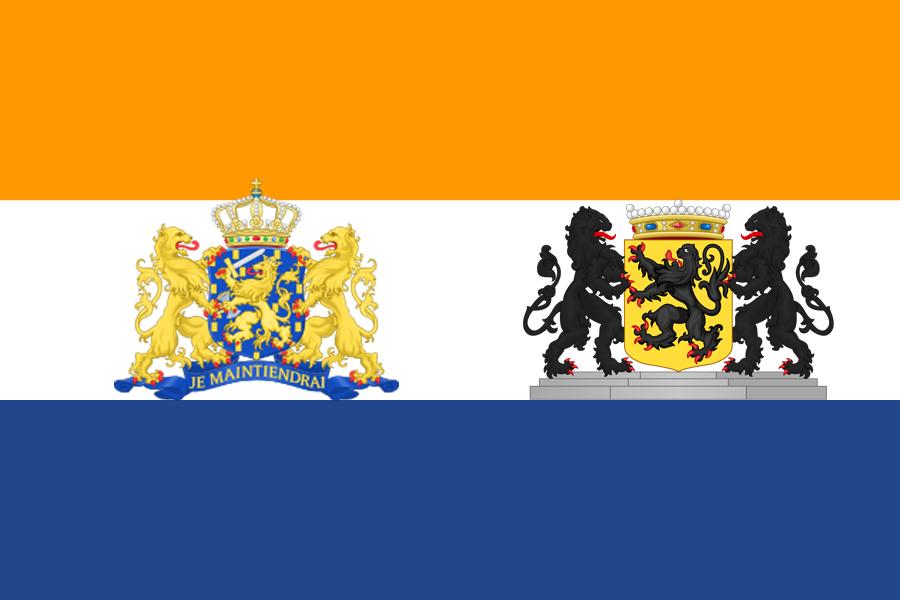
2.1) Et si Guillaume Ier des Pays-Bas avait accepté la proposition des révolutionnaires belges plus tôt?
Selon certains historiens dont Jean Stengers en 1830 au début de la révolution belge la majorité des belges voulaient un régime avec une certaine autonomie. C’est à cause des actions du roi Guillaume 1er et de ses fils qui ont fini par agaçer un tel point les belges que les négociations n’étaient plus possibles. En date du 29 Septembre 1830 vers la fin de la Révolution, les États-généraux avaient enfin acceptés la séparation administrative donc elle accordait plus d’autonomie aux Pays-Bas Méridionaux mais il était trop tard, la population belge considérait que le monarque des Pays-Bas avait fait couler trop de sang et par conséquent qu’il ne pouvait plus régner sur la Belgique.
Mais que ce serait t’il passé si la Belgique aurait reçu plus d’autonomie de la part du roi des Pays-Bas?
Il aurait fallu que les les États-généraux se prononcent plus tôt sur l’autonomie administrative de la Belgique car au mois de Septembre la plupart des grandes villes belges avait été capturées par les révolutionnaires belges et dans cet univers alternatif là ce qu’on appel dans notre monde la Belgique aurait pu être en quelque sorte en union personnelle avec les Pays-Bas,une double monarchie un peu comme ce qu’il s’est passé dans l’Empire d’Autriche où après la Révolution de 1848 la Hongrie a tenté de faire sécession de l’Empire D’Autriche avant que celui-ci s’appel le Royaume D’autriche-Hongrie en 1867.
Dans ce scénario uchronique à la différence de l’ancien scénario où les territoires de la Belgique sous domination hollandaise recevait un peu plus de droits au fil du temps, ici la Belgique(Pays-Bas méridionaux)serait vu réellement comme un égal de la Hollande, par exemple les Pas-Bas méridionaux auraient une monnaie commune avec les Pays-Bas qui aurait pu être utilisée pour le commerce et puis une monnaie locale seulement localisée dans les Pays-Bas méridionaux ce sera donnant-donnant les Pays-Bas méridionaux se développant beaucoup avec les produits importés des colonies hollandaises.Le Français et le Néerlandais auraient été officiellement reconnus. Les belges auraient pu pratiquer la religion de leur choix à la différence du scénario précédent où les Pays-Bas auraient été mal vu sur la scène politique européenne à part pour la Russie, ici le compromis entre les révolutionnaires et Guillaume D’orange amène à plus de stabilité et donc un meilleur équilibre des puissances étant donné que le Royaume-Uni des Pays-Bas avait été initialement créé pour endiguer la France.
La Prusse aurait trouvé dans le Royaume-Uni des Pays-Bas un allié de choix notamment dans son unification. D’autres variantes de ce scénario auraient pu être possible avec une version confédérale où il y aurait eu une alliance militaire et douanière qui aurait empêché la fragmentation de cet état. Un dernier scénario est possible où l’état reste très centralisée même si le roi Guillaume Ier aurait lâché du lest, notamment en matière de langue et de religion il est possible que plus tard en 1848 une nouvelle révolution ait lieu. Si nous allons plus loin dans le temps la première guerre mondiale aurait pu tout simplement se passer différemment car l’Empire allemand aurait dû y réfléchir à deux fois avant d’envahir ce pays.
Voici la chronologie de l’Uchronie
En 1830, un autre point de divergence aurait été que le roi Guillaume Ier aurait pu en craignant une intervention française de convoquer une réunion extraordinaire à la Haye où un compromis aurait été conclu avec les révolutionnaires. Dans ce nouveau royaume, il y aurait eu deux capitales Bruxelles et la Haye.
En 1840, Amsterdam reste un centre financier tandis que le charbon et l’acier wallon alimentent l’industrie.
En 1914, L’Empire allemand attaque la France mais passe par l’Alsace-Lorraine et la 1ère guerre mondiale ne dégénère pas car l’Allemagne voit le Royaume-Uni des Pays-Bas comme un adversaire trop puissant et vu que le Royaume-Uni garantissait cet état il serait resté neutre et la France aurait eu beaucoup de risques de perdre cette seconde guerre franco-prussienne.
En 1940, les ports du Royaume-Uni des Pays-Bas permettent un point d’appui important pour les britanniques, l’Allemagne nazie aurait perdu beaucoup de temps à faire capituler le Royaume-Uni des Pays-Bas et cela l’aurait affaibli encore plus.
En 1945, le Royaume-Uni des Pays-Bas permet une fédéralisation de l’Europe plus rapide que dans notre réalité, et l’UE aurait eu deux capitales Bruxelles et la Haye.
Pour cette histoire tout comme l’ancienne j’ai imaginé des témoigné fictifs de personnes qui auraient vécu dans cet univers alternatif:
Témoignage fictif de 1830 du Journal de Charles Van der Velde, étudiant en droit à Louvain:« Nous étions prêts à mourir pour une Belgique libre. Mais ce soir, un messager est arrivé : le roi Guillaume Ier convoque une assemblée, non pour nous juger, mais pour écouter nos revendications. L’air est électrique : certains crient à la trahison, d’autres parlent d’espoir. Et si, au lieu de briser nos chaînes, on les transformait en liens d’amitié avec nos frères du Nord ? »
Témoignage fictif provenant d’une lettre de Marie De Smet à son frère à Amsterdam en 1914:« Les journaux disent que l’Allemagne a un plan pour envahir la France par chez nous. Mais nos professeurs assurent que ce serait une folie : nos forteresses de Liège, Namur et Maastricht forment un mur infranchissable, et notre armée est trop puissante pour être contournée. Les Allemands ne veulent pas d’une guerre sur deux fronts, encore moins d’une guerre contre nous. Peut-être que, grâce à notre union, l’Europe évite le pire. »
Témoignage fictif de Pieter Claes en 1940 qui dans cet univers alternatif est un officier de la marine royale:« Quand les Allemands ont franchi la frontière en mai, nous avons résisté. Mais nous n’étions pas seuls : les navires britanniques remplissaient nos ports, et nos avions belgo-néerlandais combattaient dans le ciel avec les Spitfires anglais. Rotterdam a souffert, Anvers aussi, mais jamais nous n’avons cédé. Hitler pensait nous écraser comme une simple Belgique ? Il a trouvé un lion à deux têtes, rugissant de concert avec Londres. »
Discours fictif de Paul Van Zeeland en 1957 (qui dans cet univers tout comme le nôtre est européiste.):« Mes chers collègues, si aujourd’hui nous signons le Traité de Rome, c’est parce que nous avons appris, dans notre royaume fédéral, que l’unité n’est pas une utopie, mais une réalité. La France et l’Allemagne doivent comprendre ce que nous savons depuis un siècle : l’Europe doit être fédérale, ou elle ne sera pas. »
Interview fictive de Sophie Janssens une journaliste bruxelloise en 2025: «Aujourd’hui, Bruxelles-La Haye est la capitale de l’Europe. Quand on se promène dans les rues, on entend le français, le néerlandais, l’anglais, l’allemand. Certains disent que sans le compromis de 1830, notre continent serait encore divisé, tiraillé entre Paris et Berlin. Mais nous avons montré qu’une autre voie était possible : celle d’un royaume uni devenu le cœur battant de l’Union européenne.»

2.2) Et si la Belgique en 1830 était devenue une république?
Tout d’abord, revenons à ce qu’il s’est passé dans notre histoire,le Congrès national qui fut créé en Novembre 1830 comptait 200 membres et il fut remplacé par la suite par le parlement, il a été voté en date du 22 Novembre 1830 l’adoption du système de la royauté sur les 200 voix 174 voix étaient favorable,13 défavorables et 13 se sont abstenus.
Mais pourquoi avoir choisi la monarchie?
Tout d’abord le choix d’une république aurait été vu comme un régime créant moins de stabilité que la Monarchie alors qu’au moment de l’indépendance la stabilité était cruciale c’est aussi avec la pression des grandes puissances européennes en Octobre 1830 pour une Belgique neutre et stable que cette décision a été prise.
Il ne faut pas oublier aussi que la Monarchie ne faisait pas peur aux autres puissances coloniales et que la monarchie constitutionnelle fut adoptée car elle faisait un compromis entre les tendances libérales et catholiques et aussi la monarchie française qui venait de remplacer la monarchie absolue de Charles X par Louis-Philippe monarque constitutionnel était un événement qui renforca la légitimité de la monarchie constitutionnelle.
Mais que se serait t’il passé si le cour des choses avait changé et comment serions nous arrivé là?
Tout d’abord pour rendre ce scénario crédible il aurait fallu plusieurs choses:
En premier lieu, Londres craint qu’un prince français (comme le duc de Nemours, fils de Louis-Philippe) ne devienne roi de Belgique et ne renforce Paris ce qui a au passage failli se passer dans notre réalité.
En second lieu, les libéraux belges, influencés par les idées de 1789 et de 1830 en France, font valoir que seule une république garantirait la souveraineté populaire et la neutralité du pays.
Les catholiques modérés, d’abord favorables à un roi catholique, acceptent finalement la république en échange d’un rôle garanti pour l’Église dans l’éducation.
Les puissances européennes, après négociations, reconnaissent une Belgique républicaine à condition qu’elle ne cherche pas à s’unir à la France.
En 1831, la Belgique devient une république parlementaire et bourgeoise.
Concernant le président fictif de cette Belgique il aurait été Étienne Constantin de Gerlache, juriste liégeois et chef du Congrès national, qui dans notre réalité fut brièvement chef du gouvernement provisoire. Il aurait incarné un compromis entre catholiques et libéraux.
Et concernant le chef de gouvernement, il est possible que cela aurait été Le rôle exécutif étant confié à un président au-dessus des partis, le premier ministre aurait été un libéral pragmatique comme Joseph Lebeau, grand artisan de l’indépendance, capable de négocier avec les grandes puissances et ce côté diplomate comme vous l’aurez compris aurait beaucoup aidé dans ces temps troublés et en plus dans notre univers il fut premier ministre même si il n’est pas resté longtemps entre le 28 Mars 1831 et le 24 Juillet 1831.
A long terme plusieurs conséquences sont à envisager:
Tout comme dans notre réalité sauf qu’ici il n’y pas de roi mais contrairement un régime présidentiel où le président à beaucoup de pouvoir ici le président est une figure d’arbitrage tout comme le roi dans notre univers (élu par le Congrès, puis plus tard par le Parlement), tandis que le pouvoir réel est entre les mains du Premier ministre et de la Chambre.
Il n’y aurait sans surprise aucun palais royal, et symbole de la Belgique aurait été une allégorie de la liberté et peut-être moins où pas du tout le lion de Brabant qui est le symbole actuel de la Belgique évidemment il n’y aurait pas de fête du roi et les héros révolutionnaires seraient mis en avant au lieu des différents rois qui ont régnés sur la Belgique.
Tout comme en France durant la 3ème république, ici la Belgique est beaucoup plus instable et donc traverse régulièrement des crises institutionnelles et gouvernementales.
La Belgique serait plus isolée sur la scène politique européenne non pas seulement car c’est une république mais aussi que sans liens de sang avec une famille royale il y aurait eu moins de liens et les pays européens l’aurait surveillé plus, il s’en méfierait.
Même si c’est un scénario très difficile à envisager car à cette époque seulement la Suisse et San Marino étaient des républiques cependant si la Belgique devenait une république il est possible que les Wallons tout comme les flamands se seraient vus imposé le Français de manière beaucoup plus forte car les révolutionnaires du Congrès national était déjà fan du Français mais ici sans roi comme arbitre la situation aurait été très compliquée, les révolutionnaire voulait une langue pour une nation cherchant à forger une unité nationale comme les jacobins de la Révolution Française.
Malheureusement le Flamand aurait été beaucoup plus marginalisé en Flandre et l’alphabétisation en Français plus forte comme en Wallonie. Il est possible que le mouvement se soit organisé plus tôt vers les années 1840,un parti flamand républicain aurait pu faire son apparition.
Il y a plusieurs embranchements possibles pour cette uchronie soit la République belge cède aux revendications flamandes aux alentour de 1890,1900 soit la Flandre fait sécession.
Dans le premier scénario où la Flandre est francisée, le flamand est relégué tout comme le Wallon et les langues régionales au second plan notamment dans les campagnes. Parce que le Français permet une montée sociale, le Mouvement flamand peu à peu de sa puissance. La situation s’aggrave les dialectes et langues régionales ne sont plus reléguées aux foyers, elles perdent tout statut. Il est probable qu’après la Seconde guerre mondiale que le flamand,wallons et autres patois aient quasiment disparus et ils auraient été seulement présent folkloriquement au profit de la langue française. Vous vous en doutez mais dans ce scénario, la crise de l’université de Louvain n’a pas lieu.
Dans le scénario où la République belge s’effondre, il y a une chronologie que nous pouvons établir:
Entre 1880 et 1914, Le mouvement flamand se transforme en force politique, il réclame des écoles en flamand, des tribunaux bilingues. La République refuse, au nom de l’unité nationale. Des émeutes éclatent à Gand et à Louvain. Des députés flamands quittent la Chambre en signe de protestation. Après l’occupation allemande, certains nationalistes flamands, qui avaient collaboré avec la flamenpolitik, réclament l’Indépendance de la Flandre. La République sort affaiblie, la Flandre menace de sécession.
Durant les années 1930, La crise économique favorise les partis séparatistes flamands. La République finit par reconnaître le néerlandais comme langue officielle, mais trop tard : la confiance est brisée.
En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, la Flandre proclame son autonomie, avec l’appui discret des Pays-Bas.
En 2025 alors que la République Wallonne est plus proche culturellement de la France et la République flamande des Pays-Bas, Bruxelles est un territoire disputé, une ville internationale tout comme Genève. Dans cet univers Bruxelles reste toujours la capitale de l’UE même étant un territoire contesté mais reste sous administration conjointe de la République Wallonne et Flamande.
Voici les différentes témoignages que je vous ai concoctés pour ces différents scénarios:
Tout d’abord passons au témoignages fictifs de l’univers où la République belge a survécu:
Témoignage fictif d’un bourgeois bruxellois au lendemain de la proclamation de la république belge en 1831:
« Hier, le Congrès a voté. Point de roi, point de prince étranger ! Nous aurons une République, gouvernée par nos élus. Certains craignent que cela nous mène aux désordres de la France en 1793, mais ici les avocats et notables tiennent les rênes. La foule, place Royale, a acclamé le mot “République” comme un cri de victoire. J’avoue que j’avais rêvé d’un roi protecteur, mais je sens que cette liberté nouvelle nous appartient davantage. »
Témoignage fictif d’un catholique inquiet en 1850, lettre d’un prêtre namurois à son évêque:
«Monseigneur, je vous écris avec inquiétude. Depuis que la République s’est installée, nos gouvernants oscillent sans cesse entre libéraux et catholiques. Les présidents se veulent arbitres, mais leur autorité est mince. Les enfants des écoles publiques reçoivent moins de catéchisme qu’autrefois. Certains parmi les fidèles regrettent de n’avoir pas un roi catholique comme guide moral. Pourtant, la République nous a donné la paix et la prospérité. Je m’interroge : était-ce le prix à payer ? »
Discours fictif d’un député au parlement en 1885 concernant la question coloniale:
« Messieurs, si nous avions un roi ambitieux, sans doute serions-nous déjà engagés dans une aventure coloniale insensée, comme nos voisins. Mais nous sommes une République. Le Congo ne doit pas devenir la propriété d’un monarque imaginaire, mais, s’il nous appartient, il doit être sous le contrôle du peuple et de ses représentants. Nous refusons que la République soit tâchée par l’avidité de quelques banquiers ou industriels ! »
Concernant le scénario où la Flandre se fait franciser, voici les témoignages:
Journal fictif d’un instituteur à Bruges en 1835:
« Aujourd’hui, j’ai reçu les nouvelles consignes : enseigner uniquement en français, même aux enfants qui ne parlent pas un mot de cette langue à la maison. J’entends leurs rires quand je corrige leur accent. Certains pleurent, perdus. On dit que c’est pour faire d’eux de vrais citoyens de la République. Mais à quel prix ? »
Discours fictif d’un député républicain libéral en 1885 au parlement:
« Citoyens, souvenez-vous : la République n’est pas flamande ni wallonne, elle est belge et elle s’exprime en une langue commune, la langue de Molière et de la liberté : le Français. L’unité nationale exige le sacrifice des patois.»
Lettre fictive d’une étudiante gantoise à sa famille en 1920 :
« Papa, je t’écris en Français, comme nous l’exigent nos professeurs. Je comprends encore ton Flamand, mais il m’est de plus en plus difficile de l’écrire. À l’université, on dit que parler Flamand, c’est être arriéré. Je veux réussir, alors je parle Français. Mais parfois, je me sens coupée de toi et de maman. »
Témoignages fictifs d’un scénario où la République belge s’est effondrée:
Lettre fictive d’un paysan flamand à son curé en 1845: « Mon fils est allé à l’école de l’État. Il revient en pleurant : le maître lui interdit de parler notre langue. On le punit s’il dit un mot en Flamand. On dit que la République est pour le peuple, mais elle nous traite comme des étrangers. »
Journal fictif d’un soldat flamand de retour du front en 1918:
« On nous a commandés en Français, jugés en Français, enterrés en Français. Nos morts ne comprenaient pas cette langue. Et maintenant, la République refuse encore de reconnaître le Flamand. Alors, à quoi avons-nous donné notre sang ? »
Discours fictif d’un militant flamand à Anvers en 1930:
« Cent ans de République, cent ans de mépris ! Nous ne sommes pas des Français du Nord, nous sommes des Flamands, avec notre langue et notre histoire. Si la République nous refuse, alors nous créerons la nôtre. »
Témoignage fictif d’une Bruxelloise dans un journal européen en 1980: « Tout est devenu compliqué. Les Flamands disent que Bruxelles est à eux, les Wallons disent que c’est leur capitale. Et nous, habitants, nous nous sentons européens avant tout. On nous parle d’un statut spécial, mais qui gouvernera vraiment cette ville ? »
Discours fictif du président flamand Pieter Deblock en 2001: « Citoyens flamands, aujourd’hui notre République s’affirme. Nous parlons notre langue, nous écrivons nos lois, nous choisissons notre destin. La République belge a échoué, mais la République flamande vivra. »
Discours fictif de la présidente wallonne Sophie Lambert en 2020: « Peuple de Wallonie, nous avons traversé la séparation, la douleur d’une rupture. Mais nous sommes restés fidèles à l’esprit de 1830 : une République francophone, solidaire et profondément européenne. »
Et voici finalement les témoignages fictifs de personnes concernant le scénario où la République belge cède aux revendications des flamands:
Lettre fictive d’un député libéral francophone à un collègue en 1847:
« Mon cher ami,
Le Congrès discute déjà d’amendements constitutionnels. Les députés flamands sont de plus en plus virulents : ils veulent des tribunaux en néerlandais et des écoles bilingues. Je crains que si nous restons inflexibles, la République ne se brise. Peut-être vaut-il mieux céder un peu… »
Journal fictif d’un étudiant flamand à Louvain en 1873: « Aujourd’hui, c’est historique : le tribunal de Gand a jugé une affaire en Flamand ! On dit que c’est une concession de la République pour calmer la rue. Nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre : nous voulons que notre langue soit l’égale du Français dans tout le pays. »
Discours fictif d’un député flamand au Parlement en 1898: « Citoyens, pour la première fois dans l’histoire de la République, une loi reconnaît l’égalité juridique du Français et du Flamand. Ce n’est pas une faveur, c’est une victoire de la démocratie. La République a choisi de survivre en devenant bilingue, et non en restant jacobine. »
Témoignage fictif d’un instituteur bruxellois en 1930: « Dans ma classe, je dois enseigner en deux langues : le matin en Français, l’après-midi en Flamand. Les enfants passent de l’un à l’autre sans peine. Moi, j’en sors épuisé. Mais si c’est le prix de la paix entre Flamands et francophones, je l’accepte. »
Lettre fictive d’une mère wallonne à son fils en 1962: « Ton père grogne : “Encore une réforme linguistique !” Désormais, chaque région aura sa langue officielle. La République dit que c’est pour respecter les communautés. Moi, je crains que cela ne nous divise encore plus. Mais au moins, les Flamands ne parlent plus de sécession. »
Discours fictif du président Henri Declercq en 1970: « Citoyens, nous avons entendu la voix des peuples flamand et wallon. La République devient fédérale. Chaque région aura son autonomie linguistique et culturelle, mais nous resterons unis sous la bannière de la République belge. L’avenir est au compromis. »
Témoignage fictif d’une étudiante flamande à Bruxelles en 2000: » À l’université, mes cours sont bilingues. J’écris mes dissertations en Flamand, mes amis wallons en Français. C’est parfois lourd, mais je me sens vraiment citoyenne belge. La République n’a pas choisi entre nos langues : elle nous oblige à vivre ensemble. »
Editorial fictif dans La Gazette républicaine en 2025: « En deux siècles, la République est passée d’un jacobinisme francophone à un fédéralisme bilingue. Elle n’a pas écrasé le flamand, elle n’a pas éclaté en deux États, elle a survécu par le compromis. Certains y voient de la faiblesse ; d’autres, la plus belle preuve de résilience républicaine. »

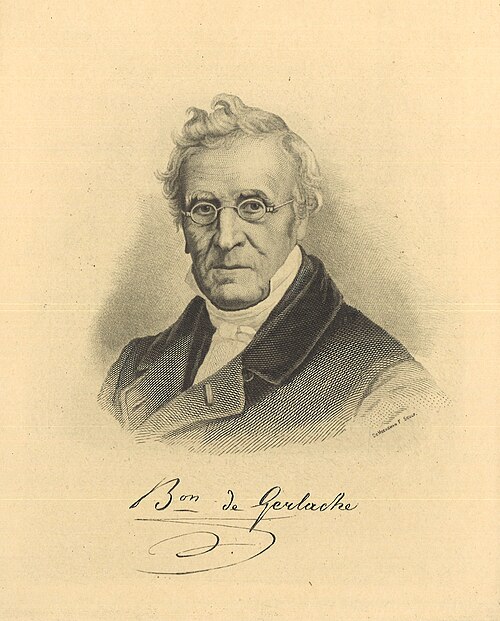

2.3) Et si le Mouvement flamand était beaucoup moins populaire et qu’il c’était beaucoup moins développé que dans la réalité?
Dans cette uchronie, la Belgique obtient son indépendance en 1830, mais le Mouvement flamand ne se développe pas fortement. Plusieurs facteurs expliquent cette faiblesse, tout d’abord, la bourgeoisie francophone conserve le contrôle politique et économique dans la majorité des villes. La population flamande, majoritairement rurale, est moins mobilisée car les inégalités sociales sont moins accentuées, et le sentiment d’appartenance belge prime sur les revendications linguistiques. L’Église catholique favorise l’unité linguistique pour stabiliser le jeune royaume.
Les conséquences auraient été que le français reste la langue dominante dans l’administration, l’enseignement et les affaires, même en Flandre. Les tensions linguistiques sont minimes, la Belgique se construit autour d’un nationalisme centralisé et francophone.
Voici la chronologie concernant cette uchronie:
En 1830, a lieu l’Indépendance de la Belgique, La Belgique se sépare des Pays-Bas. Le français devient la langue de l’État et de l’administration. Le Mouvement flamand reste faible, la population rurale flamande est peu politisée.
En 1831, la Constitution est adoptée, garantissant les droits individuels mais sans dispositions spéciales pour la langue flamande. L’élite politique et économique est francophone. La Conséquence est que la Flandre est intégrée au système francophone, limitant le développement d’un mouvement linguistique indépendant.
Entre 1840 et 1870, la Wallonie devient le centre industriel en charbon et en acier, la Flandre reste agricole mais francisée progressivement. L’éducation et l’administration flamande sont dominées par le français. La conséquence est que la fracture économique entre Wallonie et Flandre est moins liée à la langue, plus à l’industrialisation.
Entre 1880 et 1914, les universités et les administrations restent francophones. Les élites flamandes s’assimilent pour progresser socialement. Il n’y pas de partis politiques spécifiquement flamands. La Conséquence est que L’État reste centralisé et unitaire.
Durant la 1ère guerre mondiale, la Belgique est occupée par l’Allemagne. La propagande allemande est peu efficace, le nationalisme belge prime sur les revendications linguistiques. La conséquence est qu’ il n’y a aucun renforcement du Mouvement flamand.
Durant l’entre-deux-guerres, il y a la reconstruction économique et sociale. Il n’y a pas de pression politique pour la reconnaissance du flamand. La francisation des villes flamandes s’accélère. La conséquence est que le clivage linguistique reste faible, la Belgique conserve son unité.
Durant l’occupation allemande, celle-ci n’accentue pas les divisions linguistiques. Les Flamands et Wallons participent conjointement à la résistance. La conséquence est que le Mouvement flamand radical, qui dans notre réalité se développe après-guerre, reste marginal.
Entre 1945 et 1960, le français reste la langue dominante de l’administration et de l’enseignement. La Wallonie et la Flandre se développent économiquement de manière plus intégrée que dans notre réalité. La conséquence est que les réformes linguistiques comme celles de 1962 à 1963 n’existent pas.
Entre 1960 et 1980, Il y a le déclin industriel en Wallonie qui est compensé par l’intégration de la Flandre. Les partis nationalistes flamands n’existent pas ou sont marginaux. La Belgique reste un État unitaire et centralisé. La conséquence est qu’il n’y a pas de réformes de l’État en régions ou communautés.
Entre 1980 et 2000, l’économie se diversifie avec des services et des technologies. Les villes flamandes adoptent le français dans l’administration et l’enseignement supérieur. La Belgique reste unifiée politiquement. La Conséquence est que Bruxelles reste majoritairement francophone, le bilinguisme obligatoire n’est pas instauré.
En 2025, la Belgique est un État unitaire francophone avec peu de tensions identitaires. La politique se concentre sur l’Europe, l’économie, l’environnement, plutôt que sur la langue. La culture flamande reste minoritaire dans les médias et l’éducation. La Cohésion nationale est forte mais avec une homogénéisation culturelle.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un paysan flamand en 1845:
« Je parle toujours le flamand à la maison, mais à l’école et à la maison-communale, tout le monde parle français. Au début, c’est difficile, mais je vois bien que cela aide mes enfants à trouver du travail en ville. Je me sens toujours Flamand, mais je suis fier d’être Belge. »
Témoignage fictif d’un ouvrier à Anvers en 1916:
« L’occupant allemand essaie de nous diviser, mais ici, nous parlons tous le français au travail et à l’usine. Nous sommes tous Belges avant tout. »
Témoignage fictif en 1955, d’une institutrice à Gand:
« La majorité des enfants parlent flamand à la maison, mais à l’école, nous enseignons en français. Certains parents se plaignent, mais la plupart comprennent que c’est utile pour l’avenir. »
Témoignage fictif d’un politicien à Bruxelles en 1975:
« Ici à Bruxelles, il n’y a pas de crise linguistique. Tout le monde parle français dans l’administration et à l’université. Les partis régionalistes sont inexistants. Nous discutons plutôt d’économie et de relations avec l’Europe. »
Témoignage fictif d’une entrepreneuse à Anvers en 1975:
« Même si j’ai grandi en Flandre, mes affaires se font principalement en français. Cela rend les échanges avec Bruxelles et la Wallonie faciles. Il n’y a jamais de tensions entre Wallons et Flamands ici, tout le monde se comprend. »
Témoignage fictif d’un étudiant à Liège en 2020:
« Je n’ai jamais appris le flamand à l’université. Tous mes camarades parlent français, même les étudiants flamands. On est une vraie Belgique unie. Certains se demandent si l’on perd un peu de culture locale, mais personne ne s’en inquiète trop. ».
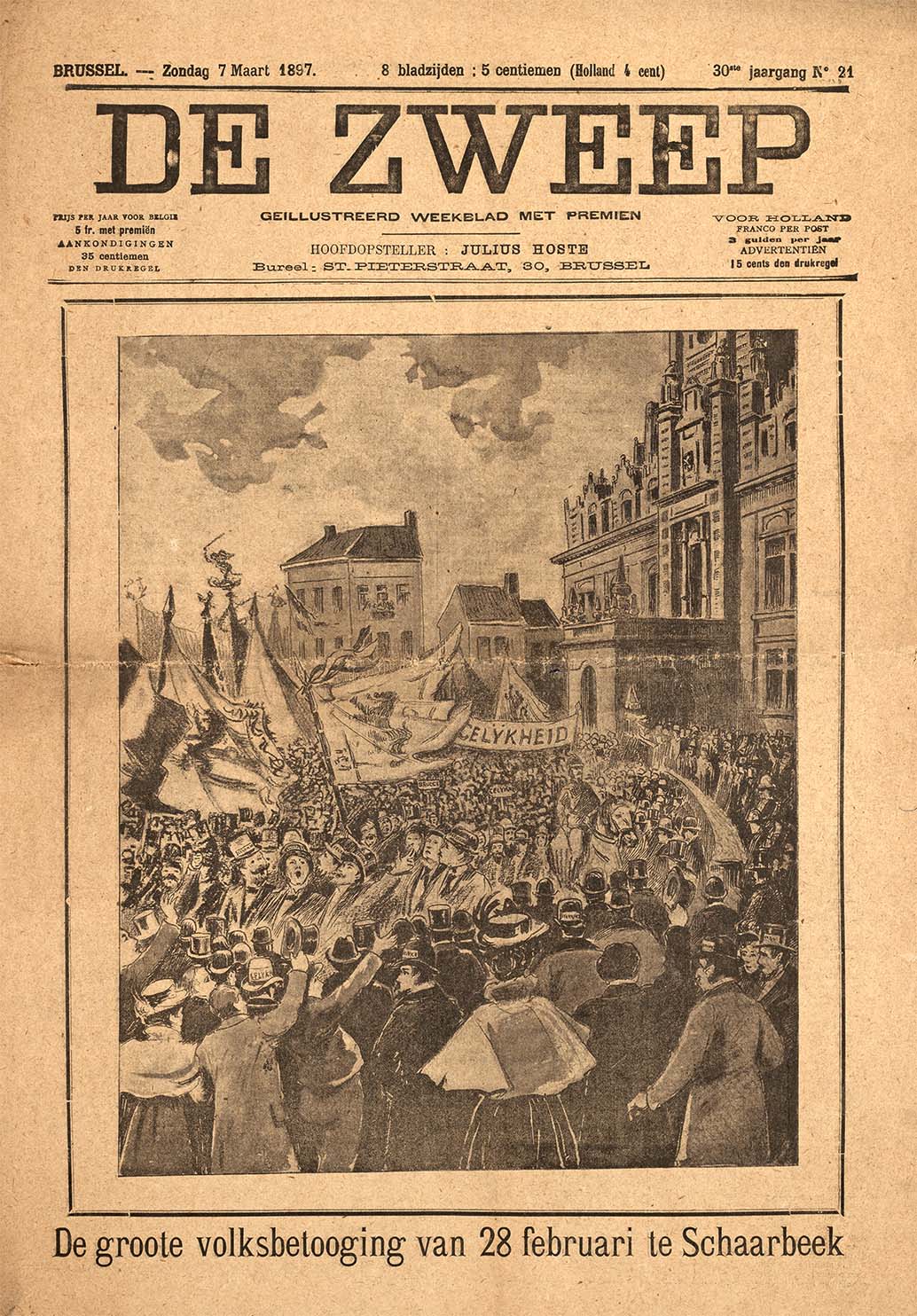

2.4) Et si la Wallonie s’était industrialisée beaucoup plus tard?
En 1830, la Belgique devient indépendante. Dans notre réalité, la Wallonie est déjà la région la plus industrialisée grâce à ses mines de charbon et ses industries sidérurgiques. Dans cette uchronie, supposons que l’exploitation du charbon et la révolution industrielle se soient concentrées plus tard, autour de 1880.
Les causes possibles auraient été que la découverte de gisements de charbon exploitable aurait été tardive. Il y a aussi un retard des infrastructures de transport que ce soit des canaux ou des chemins de fer.Manque d’investissement industriel, notamment par les banques et l’État belge. L’Orientation économique initiale se serait dirigé vers l’agriculture et le commerce plutôt que vers l’industrie lourde.
Les conséquences auraient été que la Wallonie reste largement rurale et agricole au moment de l’indépendance. La Flandre et Bruxelles commencent à capter l’essentiel des investissements et du commerce international. Il y aurait eu moins de conflits sociaux précoces, l’industrialisation aurait été tardive limitant les premières vagues de grèves ouvrières des années 1830 à 1850.
Voici la chronologie complète concernant cette uchronie:
En 1830, c’est l’Indépendance de la Belgique. La Wallonie reste majoritairement agricole. Les mines de charbon sont connues mais peu exploitées.
Entre 1835 et 1840, il y a un début timide de l’industrialisation en Flandre et à Bruxelles. La Wallonie est laissée de côté par les investisseurs.
Entre 1845 et 1850, il y a une crise agricole majeure dans certaines zones wallonnes, peu de réseaux de transport modernes limitent le commerce intérieur.
Entre 1850 et 1880, il y a un retard économique et démographique des wallons.
Entre 1850 et 1865, il y a le Développement modeste du chemin de fer, les villes wallonnes restent peu peuplées et l’urbanisation est faible.
En 1860, les villes flamandes comme Anvers et Gand attirent les capitaux étrangers, accentuant l’écart avec la Wallonie.
Entre 1870 et 1880, il y a les premières études d’exploitation intensive du charbon dans le bassin liégeois et hennuyer, mais avec un investissement industriel limité.
En 1880, il y a le début réel de l’industrialisation en Wallonie avec des mines et de la sidérurgie. Les investissements sont importants mais tardifs, limitant la compétitivité.
En 1890, les premières grandes usines sidérurgiques apparaissent à Charleroi, Liège et Mons, mais restent petites face à celles de la Ruhr ou d’Anvers.
En 1900, la population wallonne commence à migrer vers les villes industrielles, mais le rythme reste inférieur à celui de la Flandre.
Entre 1910 et 1914, il y a une croissance industrielle modérée, les tensions sociales sont limitées car le mouvement ouvrier se développe tardivement.
Durant la Première Guerre mondiale,l’industrialisation naissante est partiellement détruite par l’occupation allemande. La Wallonie ne joue pas un rôle majeur dans l’économie belge.
En 1920, il y a la Reconstruction et il y a de nouveaux investissements étrangers, principalement concentrés sur la Flandre.
En 1930, La Wallonie commence à peine à rattraper son retard industriel, mais reste très vulnérable économiquement.
Durant la Seconde Guerre mondiale: Les Bombardements sont limités sur l’industrie naissante, elle a un retard supplémentaire par rapport à la Flandre et à l’Allemagne.
Entre 1945 et 1955, la révolution industrielle est plus structurée en Wallonie, surtout avec la sidérurgie et les mines. Le boom économique profite surtout à la Flandre et à Bruxelles.
En 1960, les mines de charbon wallonnes commencent à décliner face à la concurrence internationale.
En 1970, la Crise sidérurgique et charbonnière frappe fortement la Wallonie. Le chômage devient massif, les villes industrielles souffrent. Il y a le début de la Construction du Mouvement wallon pour l’autonomie économique et politique, motivé par le retard industriel et la dépendance financière envers l’État fédéral.
En 1980, la Wallonie tente de reconvertir son économie vers les services, mais l’industrie reste le moteur principal.
En 1990, la population wallonne vieillit, tandis que la Flandre attire la majorité des investissements étrangers.
En 1993, il y a la Réforme de l’État belge, la Wallonie obtient plus d’autonomie régionale, mais conserve un retard économique marqué.
En 2000, l’industrie wallonne reste marginale, les services et les petites technologies commencent à se développer, mais l’écart avec la Flandre est important.
En 2005, il y a le début de projets ambitieux de revitalisation économique, de technologie et de tourisme industriel et de recherche.
En 2010, il y a la création de pôles technologiques à Charleroi et Liège, mais l’investissement reste limité par rapport à Bruxelles et Anvers.
En 2020, la Wallonie connaît un vieillissement démographique sévère, une population urbaine stagnante et une dépendance économique envers la Flandre.
En 2025, la Wallonie est partiellement réindustrialisée mais reste la région la moins dynamique économiquement de Belgique. Le retard historique continue d’affecter l’emploi, la migration et la politique régionale.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Lettre fictive d’un paysan wallon en 1835:
« Depuis l’indépendance, on dit que la Belgique sera riche et forte. Pourtant, chez nous, les champs ne rapportent pas plus qu’avant, et on n’a pas vu d’usines comme à Bruxelles ou à Gand. Les jeunes partent pour Anvers chercher du travail. Ici, on reste avec la terre et la misère. »
Journal fictif d’un jeune ouvrier en 1895:
« Enfin, une grande usine a ouvert à Charleroi. J’ai quitté la ferme de mon père pour venir travailler ici. Le travail est dur, mais au moins j’ai un salaire. On dit que dans le Nord de la France et en Flandre, les ouvriers se battent déjà pour de meilleurs droits. Ici, nous commençons seulement à nous organiser. Peut-être trop tard. »
Témoignage fictif d’une ouvrière pendant la crise en 1932:
“L’usine de Liège a fermé ses portes. Nous n’avons travaillé que quelques années avant que tout s’arrête. Mon mari est au chômage et mes enfants ont faim. On nous dit d’aller à Bruxelles, mais là-bas, ils ne veulent pas de nous. Nous avons perdu la ferme et nous n’avons pas encore gagné la ville. “
Discours fictif d’une personne syndiquée en 1971:
« Camarades, nous payons aujourd’hui le prix de notre retard ! Tandis que la Flandre s’est modernisée, notre industrie à peine née s’effondre déjà. Nous sommes les oubliés de la Belgique. Nous exigeons que la Wallonie prenne en main son destin ! »
Témoignage fictif d’un jeune diplômé en 1995:
« J’ai étudié l’informatique à Louvain, mais ici à Mons, il n’y a pas d’emploi. Tous mes amis partent à Bruxelles ou en Flandre. Nos villes se vident, nos parents restent seuls. On dirait que la Wallonie est toujours en retard d’un train. »
Entretien radio fictif en 2025:
“ Les projets de reconversion existent, oui. On parle de start-ups et de recherche à Liège et à Charleroi, mais ça reste petit. Mon fils travaille à Anvers, ma fille à Bruxelles. Moi je suis fier d’être wallon, mais je dois admettre qu’on vit encore dans l’ombre économique de la Flandre. Notre passé industriel tardif nous a marqués pour longtemps. “

2.5) Et si la Flandre s’était industrialisée beaucoup plus tard?
Les causes auraient été qu’il y aurait eu déjà moins de charbon en Flandre que dans le sillon wallon à Charleroi, Liège et Mons. Si l’exploitation de ces ressources avait été plus difficile, cela aurait freiné la concentration industrielle. Les sols auraient été plus tournés vers l’agriculture intensive, les élites flamandes auraient pu privilégier le rendement agricole plutôt que l’investissement industriel. Il y aurait eu moins d’investissements étrangers, au XIXᵉ siècle, la Flandre a attiré des capitaux britanniques pour le textile par exemple, à Gand qui fut la « Manchester de la Belgique ». Sans cela, le décollage aurait été retardé. La dépendance aussi à la Wallonie et aux importations, sans base industrielle locale, la Flandre aurait pu rester un marché de consommation avec pas de production. La domination francophone dans l’administration et la bourgeoisie pouvait aussi décourager l’essor d’un capitalisme flamand autonome.
Les Conséquences d’une industrialisation tardive auraient été les suivantes:
La Wallonie aurait gardé son avance industrielle et son rôle de moteur national beaucoup plus longtemps. La Flandre serait restée agricole avec une structure sociale dominée par de petits exploitants et des ouvriers agricoles, avec peu de mobilité sociale. Gand, Anvers, Bruges, Courtrai auraient eu un développement plus lent, avec moins d’industries textiles et portuaires. Les Flamands auraient cherché du travail en Wallonie, en France ou à l’étranger. Le maintien d’une « question sociale » plus dure en Flandre avec une pauvreté, un sous-emploi et des inégalités plus fortes. Le Poids aurait été plus limité de la bourgeoisie flamande, la société flamande aurait été dominée par les élites terriennes et par le clergé, retardant l’émergence d’une classe moyenne entrepreneuriale. Le pouvoir économique et politique serait resté largement francophone et wallon. Le Mouvement flamand aurait été affaibli, sans base économique solide, les revendications linguistiques auraient eu du mal à s’imposer. On aurait peut-être vu un bilinguisme belge prolongé avec une nette domination du français. Il n’y aurait eu pas ou peu de fédéralisme, on aurait eu une Belgique plus unitaire encore dans la seconde moitié du XXᵉ siècle. La langue néerlandaise marginalisée, sans la montée économique flamande, l’imposition du flamand comme langue officielle aurait été freinée. La vie intellectuelle, scientifique et artistique belge aurait été encore plus tournée vers le français.
Voici la chronologie de l’uchronie:
En 1830, il y a la création de l’État belge. Le premier gouvernement provisoire se compose majoritairement d’élites francophones et wallonnes. La Flandre reste majoritairement rurale et flamande mais sans relais économiques forts.
Entre 1830 et 1840, les infrastructures sont orientées vers le sud avec les premiers crédits publics et privés qui vont prioritairement aux bassins charbonniers wallons notamment à Liège et à Charleroi, les chemins de fer et canaux sont davantage pensés pour relier les mines et les usines wallonnes aux ports français et à Anvers. Les investissements étrangers britanniques et français privilégient la Wallonie.
La conséquence immédiate est qu’il y a l’émergence d’une bourgeoisie industrielle wallonne et francophone, la Flandre reste artisanale-agricole, avec l’émigration saisonnière vers la Wallonie et la Manche.
Dans les années 1850, il y a le boom du charbon et de l’acier en Wallonie avec des mines et les sidérurgies se multiplient, la main-d’œuvre wallonne est attirée vers les villes. Les centres urbains wallons connaissent une croissance rapide.
Entre 1850 et 1860, il y a la stagnation flamande, les villes flamandes comme Gand et Courtrai gardent une base textile artisanale mais n’atteignent pas le grand capital industriel. Anvers reste un port important, mais son hinterland industriel est surtout wallon. L’administration nationale, le parlement et l’enseignement supérieur restent largement francophones, le flamand n’est pas encore institutionnalisé au même niveau. Il y a une immigration interne entre la Flandre et la Wallonie et une émigration à l’étranger. La question linguistique est latente mais sans puissant levier économique flamand, elle reste périphérique.
Entre 1870 et 1900, il y a une concentration du capital, des banques et des maisons d’investissement qui s’implantent en Wallonie avec la création d’alliances industrielles. Anvers fonctionne comme un port industriel mais sous influence financière wallonne.
Dans les années 1890, il y a le début du mouvement flamand culturel mais limité avec des associations culturelles et pédagogiques pro-flamandes qui apparaissent avec des revues et des écoles privées, mais sans relais économique leur influence politique est restreinte.
À la fin du XIXème siècle, il y a l’exode rural flamand avec des vagues d’ouvriers flamands qui s’installent dans les bassins charbonniers wallons avec le vote politique flamand qui reste majoritairement conservateur et rural. Le parlement est dominé par les francophones avec des lois sociales naissantes avec des assurances et des régulations du travail sont conçues dans un cadre national centralisé, avec de fortes influences wallonnes.
Durant la 1ère guerre mondiale, la Belgique subit l’invasion allemande. Dans notre scénario, l’effort de guerre met en lumière la dépendance industrielle belge concentrée au sud.
Entre 1918 et 1920, il y a la reconstruction qui est principalement axée sur les régions industrielles wallonnes, la Flandre reçoit moins d’investissements de reconstruction, renforçant le retard.
Durant les années 1920, les revendications culturelles sont limitées, le mouvement flamand revendique davantage de droits linguistiques et obtient quelques concessions symboliques avec l’enseignement primaire en flamand mais pas d’égalisation réelle.
En 1929, la Wallonie reste fortement industrialisée et exportatrice, subit une crise sévère avec un chômage massif dans les mines et les usines. Paradoxalement, l’effondrement industriel du sud crée une pression migratoire inverse , les wallons cherchent du travail ailleurs, notamment en France et au Royaume-Uni, la Flandre, bien que pauvre, devient un refuge agricole et se transforme moins rapidement qu’ailleurs. Poussée pour des réformes sociales d’assurances chômage et des limitations hebdomadaires. Le clivage régional s’intensifie, la Wallonie lutte pour sauvegarder l’industrie, la Flandre réclame un soutien agricole et des infrastructures.
Durant l’occupation allemande entre 1940 et 1945. Les industriels wallons sont mis à contribution, la centralisation de l’économie nationale facilite l’exploitation par l’occupant.
Après la guerre, une partie de la haute industrie wallonne est affaiblie avec l’usure et les bombardements, mais conserve un capital humain et institutionnel qui lui permet de rester dominante au redémarrage.
Entre 1945 et 1955 avec le plan Marshall, les fonds et les technologies d’après-guerre alimentent surtout les régions industrielles existantes. La Wallonie obtient des crédits pour moderniser ses aciéries, la Flandre reçoit des aides mais reste majoritairement agricole.
Durant les années 1950, il y a l’essor de l’État-providence, l’État belge met en place des filets sociaux nationaux, la centralisation demeure forte. La culture francophone conserve sa prééminence dans l’élite administrative. La Flandre profite marginalement des industries naissantes notamment des automobiles légères et des agro-industries, mais l’investissement productif reste faible jusqu’à la fin des années 1960.
Durant les années 1960, il y a la modernisation agricole et des petites industries, il y a aussi la mécanisation des campagnes flamandes et l’émergence de PME dans la chimie légère et l’agroalimentaire, principalement financées par des capitaux étrangers prudents notamment venant des Pays-Bas, et d’Allemagne. Le Mouvement flamand aurait été politisé, l’amélioration de l’enseignement flamand avec des concessions supplémentaires et la formation d’une classe professionnelle flamande moyenne renforcent les revendications. Il y a un essoufflement d’une industrie lourde vieillissante, le chômage industriel persistant dans le sud. Le clivage économique devient moins net en sens absolu mais plus visible politiquement.
Entre 1973 et 1980, il y a le Choc pétrolier et des restructurations, l’industrie lourde wallonne est particulièrement touchée, il y a la fermeture d’usines, les reconversions sont difficiles. Le gouvernement central, pour éviter des éclats sociaux, commence à encourager la décentralisation industrielle et la Flandre, avec des terres disponibles et de la main-d’œuvre, devient une cible pour de nouvelles usines.
Dans les années 1970, il y a des politiques publiques incitatives avec des allègements fiscaux qui attirent des usines d’assemblage, de l’électronique et automobile vers la Flandre. C’est le début d’une industrialisation tardive, contrôlée et partiellement importée. Il y a la montée d’un discours régionaliste plus revendicatif en Flandre, désormais appuyé par des intérêts économiques naissants.
Durant les années 1980, l’Industrialisation flamande est accélérée avec une recomposition économique belge. Il y a aussi un boom des investissements étrangers en Flandre, les multinationales européennes implantent des usines et des parcs logistiques, Anvers voit son trafic portuaire modernisé au service d’un hinterland flamand et international. Il y a des reconversions wallonnes qui sont dues à une forte volonté politique à Bruxelles et à Liège de reconvertir l’ancien bassin minier vers les services et la haute technologie, mais avec un succès limité et un retard. Les premières réformes de décentralisation sont plus nettes, elles sont transférées partiellement, avec la formation professionnelle, mais aussi des infrastructures régionales, le Fédéralisme naît plus tard que dans notre réalité mais est amorcé sous une pression sociale.
Il y a une migration interne inversée, des jeunes Flamands trouvent des emplois locaux, attirant aussi des travailleurs étrangers et wallons dans certaines zones.
Durant les années 1990, il y a une consolidation économique flamande avec la montée du fédéralisme qui est tardif. La Flandre se spécialise dans des secteurs comme la logistique, la chimie légère, la technologie automobile, les services aux entreprises. Il y a une forte implantation de sièges régionaux de firmes européennes. Face à la recomposition économique, on assiste à une grande réforme constitutionnelle en 1993–1995, dans ce scénario elles sont plus tardives qu’en réalité qui transforme la Belgique en État fédéral avec des compétences substantielles aux Régions avec une économie régionale, des infrastructures, et une éducation professionnelle. La Flandre obtient un pouvoir réel qu’elle n’avait pas au début du XXᵉ siècle. Il y a le renforcement de partis régionaux flamands modérés et d’un centre-droit favorable au développement économique, tandis que la Wallonie vote davantage à gauche, cherchant la protection sociale et la reconversion industrielle.
Durant les années 2000, il y a un écart de prospérité, la Flandre post-industrialisée mais tardivement connaît un taux de chômage inférieur à la Wallonie, Anvers devient un pôle logistique majeur du Benelux. En Wallonie, il y a des reconversions partielles avec des clusters biotech, mais aussi de recherche mais il y a une persistance de poches de chômage et de pauvreté. Il y a des débats constitutionnels autour des transferts fiscaux interrégionaux avec des tensions sur les politiques d’emploi et des allocations. On voit des grèves massives dans le sud entre 2002 et 2006 et des négociations difficiles sur la solidarité nationale.
Durant les années 2010, l’Intégration européenne est élevée, la Flandre est plus ouverte aux capitaux étrangers et au commerce, profite des chaînes de valeur européennes, le port d’Anvers et de Rotterdam s’intègre davantage. La Crise de 2008 a des répercussions notamment avec la Flandre qui, avec un tissu de PME compétitif, récupère plus vite, la Wallonie, encore plus dépendante des secteurs en déclin, met plus de temps. Il y a la montée de débats identitaires et fiscaux, certains partis flamands réclament davantage d’autonomie fiscale entre 2014 et 2019. Les gouvernements fédéraux sont souvent de coalition instable, car la géographie électorale est polarisée. Il y a un accroissement des différences de revenus régionaux et il y a des politiques de formation professionnelle massives en Flandre.
Durant 2020 avec le COVID-19, la pandémie frappe tout le pays. La Flandre, avec une économie plus tournée vers les services flexibles et la logistique, gère mieux les ruptures que les centres industriels wallons encore fragiles.
Entre 2021 et 2023, il y a des plans de relance qui sont mis en place avec des fonds européens qui sont abondants, la Flandre attire une part disproportionnée des investissements liés à la transition verte et digitale grâce à son tissu PME et ses ports.
Entre 2024 et 2025, il y a la montée des demandes de péréquation : la Wallonie pousse pour une révision des mécanismes de péréquation de transferts interrégionaux, la Flandre est désormais économiquement plus compétitive qu’au XXᵉ siècle mais ayant commencé tard, elle réclame des garanties sur l’efficacité des fonds. Les tensions politiques atteignent des sommets, mais l’intégrité de l’État tient, c’est coûteux mais c’est un compromis social.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Dans le journal fictif d’un paysan flamand de la région de Roulers en 1852:
« Mon frère est parti à Mons chercher du travail dans les mines. Ici, les champs nourrissent encore la famille, mais à peine. On dit que dans le sud, les machines et les hauts-fourneaux s’élèvent partout, et qu’il y a du pain à gagner, même si l’air y tue les poumons. Je me demande si nos enfants auront seulement une chance de rester ici. »
Lettre fictive d’un ouvrier flamand émigré à Liège en 1888:
« Je travaille à la cokerie de Seraing. Beaucoup de mes camarades viennent de Flandre, comme moi. Nous parlons notre langue entre nous, mais dans l’usine, tout est en français. Les contremaîtres se moquent quand on essaie de répondre. J’ai l’impression d’avoir quitté ma patrie sans avoir traversé de frontière. »
Discours fictif d’un député libéral wallon à la Chambre en 1919:
« Mesdames, Messieurs, c’est grâce à l’ardeur de nos mineurs et de nos métallurgistes que la Belgique s’est relevée de la guerre. Le pays ne doit pas se diviser entre des provinces agricoles et industrielles, mais reconnaissons-le, sans la Wallonie, il n’y aurait pas de prospérité nationale. »
Témoignage fictif d’un instituteur flamand à Bruges en 1933:
« Les enfants apprennent à lire en flamands, mais dès qu’ils passent au collège, on les oblige à suivre les cours en français. Comment peuvent-ils espérer progresser ? Les familles pauvres n’ont pas les moyens d’envoyer leurs enfants à Gand ou Bruxelles. On nous dit que c’est pour le bien de la nation, mais c’est surtout pour maintenir la supériorité du sud. »
Tract fictif d’un syndicaliste wallon en 1968:
« On ferme nos charbonnages, on casse nos aciéries, et voilà que l’État verse des millions pour construire des usines en Flandre ! On nous abandonne, pendant que le nord commence à récolter ce que nous avons semé pendant un siècle. »
Entretien fictif avec une ouvrière flamande à Courtrai en 1985:
« Quand l’usine japonaise est arrivée, on n’y croyait pas. Moi, j’ai laissé les champs de mes parents pour devenir opératrice. Le salaire n’est pas énorme, mais c’est mieux que d’aller à Bruxelles comme domestique. Enfin, on dit que la Flandre a un avenir. »
Déclaration fictive d’un ministre flamand en 2002:
« Pendant longtemps, on nous a dit que nous étions la périphérie agricole de la Belgique. Aujourd’hui, les entreprises étrangères viennent chez nous, à Anvers, à Gand, à Louvain. Nous ne voulons plus être assistés, mais nous ne voulons pas non plus financer l’inefficacité des autres régions. L’heure est venue d’une Flandre responsable de ses propres moyens. “
Témoignage fictif d’une étudiante wallonne à Anvers en 2021:
« J’ai trouvé une bourse pour venir suivre un master en sciences de l’environnement ici. La Flandre est en avance sur les technologies vertes. Chez nous, on peine encore à redémarrer après la pandémie. Mes parents ne comprennent pas pourquoi j’ai dû « monter au nord », mais je leur dis que l’avenir est là. »
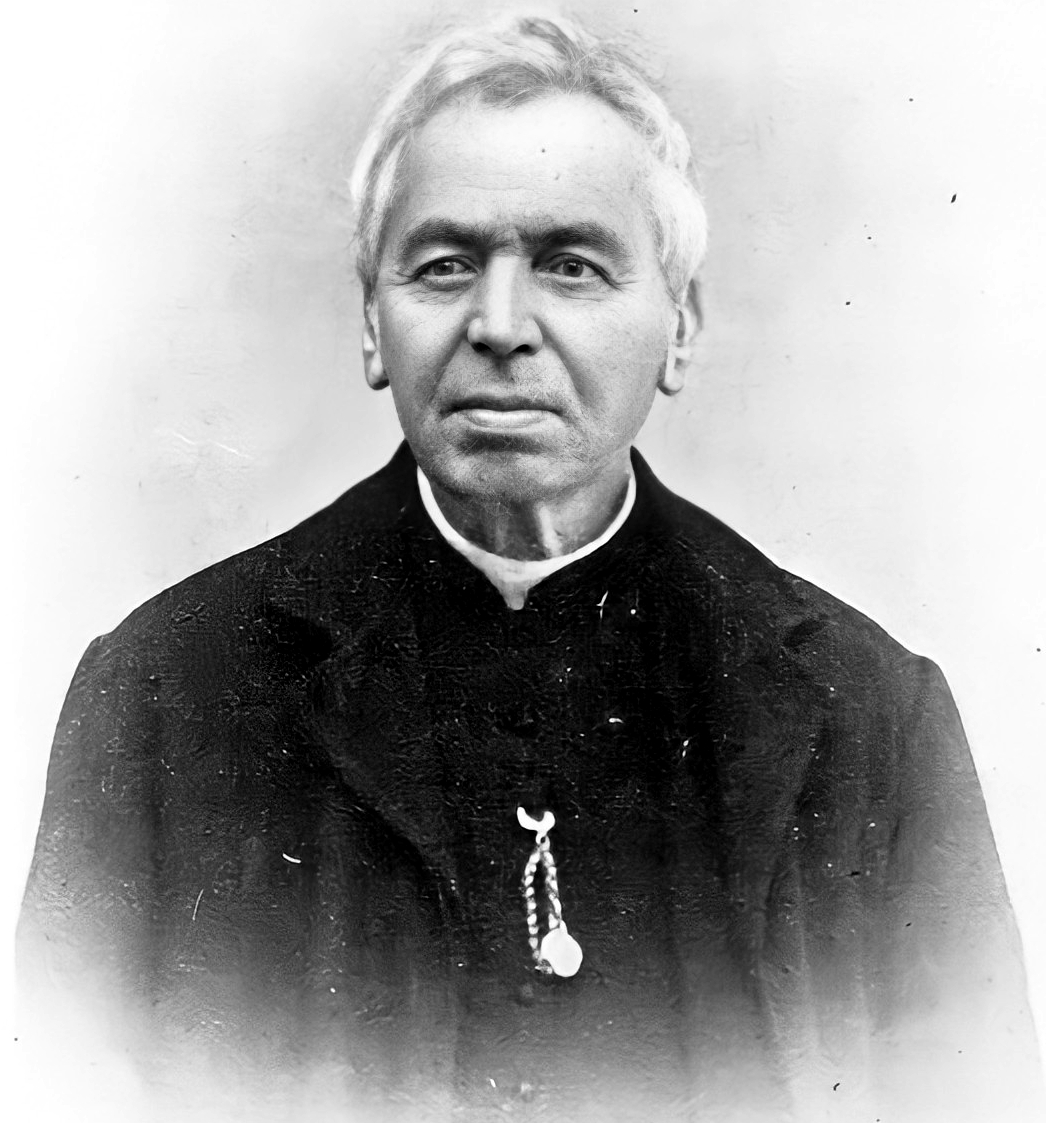
2.6) Et si Bruxelles s’était industrialisée beaucoup plus tard que dans la réalité?
Les causes qui auraient pu mener à cette uchronie auraient pu être les suivantes, tout d’abord La vallée de la Senne et les environs auraient pu être jugés moins favorables avec moins de charbon à proximité que le Hainaut ou Liège. Les investissements auraient été orientés prioritairement vers Liège, Charleroi, Mons, Gand ou Anvers. Le pouvoir central belge après 1830 aurait pu favoriser d’abord les bassins miniers et textiles, laissant Bruxelles dans un rôle administratif et commercial. La bourgeoisie bruxelloise aurait préféré investir dans le commerce, les services et la finance plutôt que dans l’industrie lourde.
Les conséquences auraient été que la ville reste un centre administratif, politique et culturel mais elle n’attire pas la même main-d’œuvre ouvrière qu’en réalité. Il y aurait eu moins de tensions sociales et ouvrières avec pas ou peu de grandes grèves bruxelloises au XIXᵉ siècle. Dans cette uchronie, Liège et le Hainaut deviennent encore plus les « cœurs industriels » du pays. Gand garde une avance textile et portuaire. Bruxelles serait perçue comme une capitale « bourgeoise » déconnectée du monde ouvrier.
Voici la chronologie de cette uchronie:
En 1830, avec l’Indépendance belge. Bruxelles devient la capitale politique et administrative, mais son économie reste dominée par le commerce, la finance et les services.
Entre 1840 et 1860, il y a le développement industriel dans le Hainaut avec le charbon, et la sidérurgie et Liège avec la métallurgie et Gand avec le textile. Bruxelles reste en marge.
Entre 1860 et 1880, la ville croît comme un centre bourgeois, avec des institutions culturelles avec des opéras, des universités, des musées, mais sans grandes concentrations ouvrières.
En 1880, il y a une exposition universelle à Bruxelles : la capitale se montre comme une vitrine bourgeoise, pas comme un centre industriel.
En 1890, seules des industries légères et alimentaires et d’imprimerie et d’artisanat raffiné s’installent, mais rien à l’échelle des bassins miniers.
Entre 1900 et 1914, Bruxelles se spécialise dans la finance et l’administration coloniale au Congo, tandis que les ouvriers affluent ailleurs. Le mouvement ouvrier bruxellois est faible par rapport à Liège ou à Charleroi.
Durant la 1ère guerre mondiale avec l’Occupation allemande. Bruxelles subit l’occupation comme capitale, mais sans grandes grèves ouvrières, puisqu’elle n’a pas de forte base industrielle.
Entre 1920 et 1930, la ville se modernise avec des trams et des grands boulevards mais reste surtout une capitale de fonctionnaires et de commerçants.
En 1936, il y a des grèves ouvrières partout dans le pays qui impactent surtout Liège, Charleroi, Gand, Bruxelles reste en retrait.
Durant la deuxième guerre mondiale. Bruxelles est le centre administratif de l’occupant, non pas un bastion ouvrier de résistance.
Entre 1945 et 1950, Bruxelles n’a pas à gérer de reconversion industrielle lourde, contrairement aux bassins wallons.
En 1957, Bruxelles est choisie comme siège de la CEE qui fut l’ancêtre de l’UE. Sa spécialisation tertiaire en fait une capitale idéale, sans passé ouvrier encombrant.
En 1960, c’est l’Indépendance du Congo. Bruxelles profite comme un centre administratif, mais sans base industrielle pour absorber le choc économique.
Entre 1965 et 1970, la ville devient une métropole tertiaire et administrative avec des banques, des assurances et une fonction publique. L’immigration ouvrière maghrébine se dirige plutôt vers Liège et Charleroi que vers Bruxelles.
Durant les années 1970, la Crise industrielle frappe surtout la Wallonie avec des fermetures d’usines et un chômage de masse. Bruxelles est épargnée, car son économie est déjà tertiaire.
En 1980, Bruxelles devient officiellement la région-capitale avec des réformes institutionnelles, confirmant son statut administratif et politique.
Entre 1985 et 1992, il y a l’Expansion des institutions européennes et de l’OTAN à Bruxelles, la ville se transforme en capitale internationale, sans passé industriel lourd.
Durant les années 1990, Bruxelles attire davantage d’expatriés et de fonctionnaires européens que de travailleurs immigrés d’usines. Il y a une identité cosmopolite accentuée.
Durant les années 2000, Bruxelles est une ville de services, de diplomatie et d’administration. Il n’y a pas de mémoire ouvrière forte et moins de luttes syndicales locales.
Durant les années 2010, Bruxelles devient une capitale internationale de plus en plus déconnectée des réalités wallonnes post-industrielles et flamandes portuaires et logistiques.
En 2025, Bruxelles est perçue comme le centre politique, administratif et financier de l’Europe, comparable à Washington ou à Genève, mais sans le passé industriel ni les grandes luttes ouvrières qui ont marqué d’autres capitales européennes.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un artisan bruxellois en 1835:
« Depuis l’indépendance, Bruxelles change, mais pas comme Liège ou Gand. Ici, on ne bâtit pas de hauts-fourneaux. On vit de commerce, d’artisanat et de fonctionnaires. J’entends dire qu’à Charleroi, la nuit est éclairée par les flammes des usines. Ici, nos rues restent sombres, mais calmes. »
Discours fictif d’un député flamand en 1858:
« Il est étrange que notre capitale n’ait pas pris part à la révolution industrielle. Bruxelles se veut le cœur de la Belgique, mais elle n’est que le cerveau administratif. Le sang et la sueur coulent ailleurs, dans nos bassins houillers. »
Témoignage fictif d’une ouvrière gantoise en 1882:
« J’ai songé à chercher du travail à Bruxelles. Mais on m’a dit qu’il n’y a pas d’usines là-bas, seulement des bureaux et des bourgeois. Alors je reste ici, dans le textile. Bruxelles, c’est une autre vie, pas la nôtre. »
Témoignage fictif d’un syndicaliste liégeois en 1913:
« À Bruxelles, on manifeste pour la réforme électorale, mais jamais pour de meilleurs salaires. Comment pourraient-ils comprendre ? Ils n’ont pas nos mines ni nos laminoirs. Leur capitale est bourgeoise, la nôtre est ouvrière. »
Témoignage fictif d’un banquier bruxellois en 1929:
« La crise frappe Wall Street et secoue nos mines. Mais à Bruxelles, nous ne craignons pas la fermeture des usines, car nous n’en avons presque pas. Nous continuons nos affaires, nos cafés, nos expositions. On nous accuse d’indifférence… c’est peut-être vrai. »
Témoignage fictif d’un étudiant bruxellois sous l’Occupation en 1941:
« Les Allemands ont installé leur administration ici. Notre ville est calme, il n’y a pas ces grandes grèves dont parlent les journaux clandestins. Je crois que c’est parce que nous ne sommes pas une ville ouvrière. »
Témoignage fictif d’une mère de famille de Charleroi en 1958:
« L’Expo 58 fait briller Bruxelles aux yeux du monde. Pendant ce temps, mon mari perd son emploi à la mine. Bruxelles s’élève, nous descendons. Voilà la vérité de ce pays. »
Témoignage fictif d’un fonctionnaire européen en 1965:
« Si Bruxelles est devenue la capitale de l’Europe, c’est parce qu’elle est neutre. Il n’y a pas de fumée industrielle, pas de grands quartiers ouvriers. C’est une ville de bureaux, de diplomatie. Elle nous ressemble. »
Témoignage fictif d’un mineur licencié à Liège en 1983:
« On ferme nos puits, nos aciéries, et on nous dit de chercher du travail à Bruxelles. Mais Bruxelles, c’est des ministères, des banques, pas des usines. On ne parle pas la même langue, on ne vit pas dans le même monde. »
Témoignage fictif d’une étudiante bruxelloise en 1999:
« Quand je vais à Charleroi, je vois des friches et des murs noirs de suie. Ici, à Bruxelles, nos bâtiments sont clairs, nos emplois sont dans les bureaux. On me dit que Bruxelles ne comprend pas la Wallonie… peut-être que c’est vrai. »
Témoignage fictif d’un expatrié espagnol à la Commission en 2015:
« J’aime Bruxelles. Ce n’est pas une ville industrielle reconvertie comme tant d’autres capitales européennes. C’est une ville née pour la politique. Elle a quelque chose de Genève ou de Washington, elle existe pour gouverner, pas pour produire. »
Témoignage fictif d’une Bruxelloise âgée en 2025:
« Je suis née dans une ville sans usines, mais pleine de fonctionnaires et de ministères. J’ai vu Bruxelles devenir européenne, internationale. On nous reproche de ne pas avoir de mémoire ouvrière, mais notre mémoire est ailleurs, celle des bureaux, des parlements, des ambassades. »

2.7) Quel aurait été l’uchronie parfaite pour la Belgique où tout s’était bien passé pour elle?
En 1830, la Révolution belge est réussie sans effusion de sang, son indépendance est reconnue par les grandes puissances et sa neutralité garantie par le Traité de Londres.
En 1831, Léopold 1er monte sur le trône, grâce à son réseau britannique et allemand, il obtient un soutien financier massif.
En 1835, la création du premier chemin de fer continental (Bruxelles-Malines) est inauguré, dans l’uchronie, le réseau s’étend encore plus vite, faisant de la Belgique un hub industriel européen. La Belgique s’industrialise massivement, l’ambition maritime est encouragée.
En 1836, il y a une opportunité géopolitique au Texas, la Belgique soutient la République du Texas contre le Mexique. Des colons belges s’installent dans l’Est texan.
En 1838, il y a une alliance officieuse avec la France avec un appui diplomatique contre des aides économiques et une future répartition coloniale.
En 1839, Le Texas devient un protectorat belge. Il y a une reconnaissance internationale sous pression française.
En 1843, il y a la première fondation de la colonie belge de Santo Tomás de Castilla au Guatemala. La première base coloniale belge est réussie en Amérique centrale.
Dans les années 1850, il y a le développement de l’industrie lourde d’acier, de charbon et de textile). La Wallonie devient la « la Ruhr avant la Ruhr »(car celle-ci s’est industrialisée avant elle bien plus vite que dans la réalité).
En 1853, il y a le début de l’immigration agricole belge au sud du Brésil à Santa Catarina et Paraná avec l’appui de l’empereur Pedro II.
En 1855, il y a l’installation de comptoirs belges en Côte de l’Or ( en actuel Ghana) via des accords avec le Royaume-Uni.
En 1860, il y a la création d’une concession belge à Tianjin (en Chine) pour le commerce.
En 1869, la Belgique obtient des droits de construction sur un canal interocéanique au Nicaragua.
En 1870, il y a le début d’une présence économique belge au Venezuela avec l’obtention de concessions portuaires notamment à la la Guaira.
En 1870, pendant la guerre franco-prussienne, la Belgique reste neutre mais profite massivement du commerce, devenant le « banquier » de la France et de l’Allemagne.
En 1872, Léopold II parvient à acheter les Philippines à une Espagne ruinée.
Il y a la Fondation des Philippines belges, administrées comme une colonie modèle.
En 1875, La Belgique a une influence économique croissante au Paraguay, affaibli par la guerre de la Triple Alliance. Il y a un Traité d’assistance qui permet que le Paraguay devienne un protectorat belge.
En 1878, la Belgique achète le Suriname aux Pays-Bas.
Durant les années 1880, Léopold II établit au Congo, une administration moderne, investissant massivement dans infrastructures et l’éducation, inspiré de son modèle caribéen.
En 1885, Le Congo devient une colonie belge directe. L’administration se veut modèle avec des infrastructures, des écoles, mais aussi avec la Santé publique.
En 1887, il y a la création de la Fédération d’Amérique centrale belge avec le Guatemala, l’Honduras et le Nicaragua.
En 1890, il y a la construction par les belges d’un canal interocéanique au Nicaragua qui est un concurrent du canal de Panama. Le port de Colon au Panama devient une zone spéciale belge.
Dans les années 1890, grâce au Congo et au Guatemala, la Belgique devient le premier exportateur mondial de caoutchouc, cacao et café.
En 1894, il y a la découverte de pétrole au Texas belge avec l’accélération du développement de la ville de Beaumont et de Houston (appelée Port-Liège).
En 1895, le Paraguay devient « une province autonome » belge : Nouvelle-Bruges en devient la capitale. Il y a une politique de reconstruction agricole, sanitaire et éducative.
En 1900, c’est l’exposition universelle de Paris, la Belgique impressionne le monde avec ses colonies, ses innovations industrielles et son art comme l’Art Nouveau mais aussi avec Horta et Ensor.
En 1900, il y a l’achat des Îles Vierges danoises par la Belgique. Développement du port franc de Saint-Tomás-sur-Mer.
En 1910, il y a l’intégration du nord de l’Argentine (la région de Misiones) dans la sphère d’influence belge. Des Coopératives agricoles belges s’y installent et y cultivent le thé, le cacao et le yerba maté.
Bruxelles devient une capitale financière de premier plan, rivalisant avec Londres et Paris.
La Belgique reste neutre pendant la Première Guerre mondiale. Son empire soutient l’Entente économiquement sans subir de conflit.
En 1919, la Belgique devient capitale diplomatique mondiale, elle accueille la Société des Nations à Bruxelles.
Après la 1ère guerre mondiale, il n’y a pas eu de destructions massives et la Belgique garde intacte son industrie. Elle devient le moteur économique de la reconstruction européenne.
En 1925, Il y a la création de réseaux de transport inter coloniaux qui sont mis en place avec des chemins de fer au Congo, au Guatemala, au Paraguay et au Texas.
Durant les années 1930, la crise mondiale qui affecte la Belgique est atténuée par la richesse coloniale. La reprise économique est rapide grâce au commerce intercontinental belge.
Durant les années 1930, la Belgique développe un modèle social avancé avec des assurances, un système de retraite et une éducation gratuite et obligatoire.
Durant la Seconde Guerre mondiale, la Belgique restée neutre une nouvelle fois. Son empire sert de réserve stratégique pour les Alliés. Bruxelles devient la plaque tournante des négociations secrètes. Bruxelles devient le centre diplomatique de la neutralité européenne, un « mini-Genève ».
En 1945, La Belgique est le membre fondateur de l’ONU. Elle propose un modèle de gouvernance post-coloniale basée sur la fédération et l’autonomie encadrée.
La Belgique sort indemne de la guerre et se retrouve avec un empire colonial intact et une économie en plein essor.
En 1949, le siège de l’OTAN est placé à Bruxelles. La capitale belge est reconnue comme un centre géopolitique mondial.
En 1952, il y a eut l’adoption de la Charte fédérale belge mondiale avec la Création des États associés du Commonwealth belge qui regroupe plusieurs pays dont: Le Congo, le Guatemala, les Philippines, le Texas, le Paraguay, le Suriname, la Guyane belge, le Honduras, le Nicaragua, la Côte de l’Or, les Îles Vierges.
Dans les années 1960, il y a eut des réformes fédérales, chaque colonie devient une entité autonome avec un droit de représentation à Bruxelles. Les anciennes colonies sont co-dirigées avec des élites locales formées dans les universités belges mondiales. Les exportations coloniales comme le pétrole du Congo, le café du Guatemala et les minerais rares financent un État-providence belge modèle.
En 1970, il y a la crise communautaire entre la Flandre et la Wallonie évitée grâce à modèle fédéral national inspiré de la structure impériale.
Dans les années 1980, il y a la création d’un réseau TGV reliant Bruxelles à Kinshasa, au Guatemala, à Manille et à Houston.
En 1989 c’est la Chute du mur de Berlin, la Belgique se positionne comme médiateur entre Est et Ouest.
Dans les années 1990, il y a le lancement de la monnaie unique impériale : le belga. Il y a aussi eu le développement du système d’universités belges globalisées, avec campus sur chaque continent.
Dans les années 2000, il y a eu des investissements massifs dans les ex-colonies qui ont causés des décollages économiques par exemple: le Congo belge est devenu le leader africain de l’énergie et des batteries, Le Texas belge est un centre spatial et technologique, le Guatemala belge est devenu un hub agro-financier, les Philippines belges sont devenues une puissance navale et numérique.
La Belgique propose un modèle post-ONU, une Union fédérale des peuples, basée à Bruxelles.
Durant les années 2020, la Belgique est le pays le plus prospère par habitant en Europe, combinant :
les richesses coloniales partagées équitablement, les industries de pointe comme les industries pharmaceutiques, la biotech mais aussi l’espace), une diplomatie de neutralité active comme la Suisse, mais avec plus de poids.
En 2025, la Belgique compte 22 États associés sur 5 continents. Elle est le 1er pays en PIB/habitant mondial, le 3ème en puissance diplomatique, le 1er en influence culturelle multilingue, le 1er pays à avoir colonisé sans guerres ni révoltes majeures, grâce à une stratégie d’intégration équitable.
Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Un témoignage d’un cheminot wallon à Houston en 1880:
« Quand je suis parti de Liège en 1875, jamais je n’aurais imaginé qu’un jour, je verrais les plaines du Texas traversées par des locomotives construites à Seraing.
Les Américains nous regardaient comme des fous, mais aujourd’hui, ils viennent acheter nos machines et parler français à la gare de Port-Liège.
La Belgique, ici, c’est le progrès. »
Un témoignage d’un universitaire congolais à Léopoldville en 1928: « À l’école, on parle lingala, français et flamand.
Mon frère apprend l’architecture belge, moi je veux devenir ingénieur comme les hommes qui construisent les rails jusqu’à Stanleyville.
Mon père me dit souvent que notre Congo n’est pas une colonie, mais une province. Et que le roi Albert nous considère comme des Belges, pas comme des sujets. »
Une professeure à Manille en 1957: « On a gardé le tagalog, mais tous nos diplômes sont reconnus à Bruxelles.
Nos universités sont jumelées avec celles de Louvain et de Namur.
Certains regrettent que les Espagnols nous aient abandonnés, mais depuis que la Belgique est arrivée, l’économie est stable, les écoles sont modernes, et nos hôpitaux soignent gratuitement. »
Un témoignage fictif d’un diplomate américain à Bruxelles en 1968:
« Chaque fois que je mets les pieds à Bruxelles, j’ai l’impression de marcher dans le cœur du monde.
Pas seulement l’Europe, je parle du monde entier.
L’Afrique parle à l’Asie ici. Les Caraïbes rencontrent l’Amérique du Sud.
Et tout le monde respecte la parole belge. Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas colonisé avec des fusils. Ils ont bâti avec des traités. »
Un témoignage fictif d’une chocolatière ghanéenne à Anvers en 1992:
« Quand mes parents sont venus du Ghana belge à Anvers dans les années 60, ils disaient que la ville sentait le cacao et les épices.
Aujourd’hui, c’est moi qui dirige l’atelier de chocolaterie, et j’exporte vers Kinshasa, le Guatemala, et même Tokyo.
J’aime dire que je suis une Belge de l’Atlantique. »
Un témoignage d’un historien paraguayen en 2025: « Certains appellent notre pays la Suisse de l’Amérique du Sud, mais nous, nous disons que nous sommes la Namur des Andes.
L’université de Nouvelle-Anvers est l’une des plus avancées du continent.
L’alliance avec la Belgique ne nous a pas enfermés, elle nous a protégés.
Nous avons une voix au Parlement de Bruxelles, et c’est une voix respectée. »
Un témoignage fictif d’un entrepreneur congolais à Kinshasa en 2025: « Ma startup fabrique des batteries au lithium à partir des ressources locales, avec des brevets belges.
J’ai étudié à Louvain, fait mon stage aux Philippines, et maintenant j’ai des clients au Texas et au Suriname.
J’ai un passeport fédéral, je parle quatre langues, et je suis fière du Commonwealth belge.
Mon pays est un moteur, pas une dépendance. »
2.8) Quelle aurait été la pire uchronie pour la Belgique, si tout c’était mal passé pour elle?
Entre le 2 août et le 12 août 1831 c’est la « Campagne des Dix Jours », l’armée néerlandaise écrase les Belges (à la différence de la réalité) et la Belgique est sauvée seulement par l’intervention française.
Entre 1831 et 1839, la Guerre avec les Pays-Bas et le blocus néerlandais sont prolongés. Le pays sort ruiné et dépendant de dettes contractées auprès de Londres et Paris. La monarchie de Léopold Ier est fragile, menacée par révoltes flamandes et des complots orangistes.
Le 19 Avril 1839, le Traité des XXIV articles est signé, le nouvel État est reconnu mais amputé d’une grande partie du Limbourg et du Luxembourg (plus que dans la réalité).
En 1846, il y a une crise alimentaire en Flandre, il y a une famine et un exode vers les États-Unis.
En 1857, il y a des émeutes ouvrières à Liège qui sont réprimées dans le sang.
En 1870, il y a la guerre franco-prussienne, les troupes prussiennes violent la neutralité belge, des combats font rage à Liège et à Namur.
En 1885, durant la conférence de Berlin, Léopold II échoue à obtenir le Congo. La Belgique reste sans colonies, marginalisée diplomatiquement.
En 1893, il y a des grèves générale pour le suffrage universel qui sont violemment réprimée avec plus de 200 morts.
En 1902, il y a des émeutes ouvrières dans le Borinage avec une intervention de l’armée.
En 1912, il y a des manifestations nationalistes flamandes à Anvers, qui dégénèrent en affrontements avec l’armée.
Le 4 août 1914, L’Allemagne envahit la Belgique et l’armée belge dans cette uchronie est balayée en 3 semaines.
Entre le 6 et le 16 août 1914 a lieu la Bataille de Liège et la ville est détruite par l’artillerie lourde allemande.
Le 25 août 1914, il y a le Massacre de Louvain et la bibliothèque est incendiée, et 2 000 civils sont exécutés.
Entre 1915 et 1918, L’Occupation allemande est brutale, il y a la famine et le travail forcé et des déportations.
Contrairement à la réalité, le 28 juin 1919 avec le Traité de Versailles, la Belgique ne reçoit rien, ni Eupen-Malmedy, ni de colonies, ni de réparations. Le pays est ruiné et humilié, surnommé « l’État inutile » dans la presse internationale.
Dans les années 1920, la reconstruction échoue avec un chômage massif et une misère sociale. La Crise de 1929 créé des faillites bancaires et un effondrement des industries wallonnes.
En 1932, des émeutes de la faim en Flandre et en Wallonie éclatent.
Le 24 mars 1935, Léon Degrelle fonde le mouvement rexiste, qui gagne rapidement en popularité.
Durant les élections de 1936, les rexistes et les nationalistes flamands obtiennent 40 % des voix, le parlement est paralysé.
En 1937, il y a la tentative de coup d’État rexiste, ce fut un échec mais cela causa un affaiblissement de la démocratie.
En 1939, il y a la Mobilisation générale, mais l’armée est mal équipée.
Le 10 mai 1940, il y a l’invasion allemande et la Belgique capitule au bout de 3 jours.
Entre 1940 et 1944, Il y a le maintien de régimes collaborationnistes, un rexiste en Wallonie, et un nationaliste flamand, ces gouvernements intégrés dans la Waffen-SS.
En 1942, il y a la déportation massive des Juifs belges une proportion encore plus élevée que dans la réalité.
En 1944, les villes d’Anvers, de Bruxelles et de Liège sont bombardées par les avions alliés causant des dizaines de milliers de morts civils.
Le 8 Mai 1945 c’est la capitulation allemande, la Belgique est vue comme un pays massivement collaborateur, la Belgique est par conséquent mise au ban de l’Europe.
Le Plan Marshall contourne largement la Belgique.
Le 4 avril 1949, L’OTAN est créée et le siège est attribué à la ville de Luxembourg et pas à Bruxelles.
En 1951, c’est la fondation de la CECA, les institutions sont installées à Strasbourg. La Belgique reste marginalisée.
En 1960, une crise économique majeure survient en Wallonie avec un chômage massif après la fermeture des mines.
La Flandre est encore en retard. Les tensions linguistiques explosent :
Dans les années 1960 avec des grèves générales en Wallonie et des manifestations flamandes violentes.
Le 13 mai 1968, des Affrontements violents à Louvain entre étudiants flamands et police ont lieu avec 40 morts et des centaines de blessés.
En 1969 et 1970, il y a des émeutes linguistiques à Bruxelles avec une intervention de l’armée.
Le 4 avril 1980, la Flandre proclame son indépendance unilatéralement, soutenue par l’Allemagne.
Le 10 avril 1980, la Wallonie réclame son rattachement à la France mais Paris refuse.
Le 20 juin 1980, L’ONU met Bruxelles sous tutelle internationale.
Le 1er Janvier 1981, c’est la Disparition officielle de la Belgique comme État.
Le 25 Janvier 1981, c’est la Constitution de la République flamande avec un régime semi-autoritaire avec une alliance économique avec l’Allemagne.
En 1985, L’État wallon est en faillite, il est surnommé le « Donbass occidental ».
En 1989, Bruxelles est sous administration internationale c’est devenu une zone de non-droit en plus de la montée du terrorisme.
En 1991, il y a un Refus officiel d’installer les institutions européennes à Bruxelles , le Luxembourg devient la « capitale de l’Europe ».
Le 22 mars 2016, Il y a des attentats massifs à Bruxelles (bien plus graves que dans notre réalité) avec plus de 2 000 morts, le centre-ville est détruit. L’ONU retire sa mission.
En mars 2020 comme dans notre réalité, il y a le Covid-19 avec un chaos sanitaire et une mortalité record en Wallonie et à Bruxelles.
Bref en 2025, la Flandre est un état autoritaire semi-prospère, dépendant de l’Allemagne.
La Wallonie est un État mafieux sous influence russe.
Bruxelles est une zone grise anarchique, un foyer du terrorisme en Europe.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un ouvrier wallon dans le Borinage en 1865: « Nous travaillons seize heures par jour dans la mine. Les enfants descendent avec nous, à peine dix ans, noirs de poussière. On dit que les Anglais et les Français qui possèdent nos usines s’enrichissent, mais ici, nous vivons dans la boue. Les flamands crèvent de faim dans leurs champs, et on nous dit qu’ils nous haïssent parce que nous parlons français. Quel avenir a ce pays ? »
Témoignage fictif d’un soldat belge à Liège en août 1914: « Nous avons tenu deux jours à la forteresse de Liège. Puis les obus allemands ont tout écrasé. Mes camarades ont été fauchés comme du blé. Quand j’ai essayé de fuir, j’ai vu les uhlans exécuter des civils sur la place. Les Allemands sont partout. On dit que le roi a fui. Alors pourquoi nous battre encore ? »
Témoignage fictif d’une institutrice flamande à Anvers en 1919: » La guerre est finie. Les Allemands sont partis, mais nous n’avons rien gagné. Pas un mètre de terre, pas une réparation. On dit que la France et l’Angleterre nous ont oubliés. Nous avons tout perdu : nos maisons, nos hommes, nos écoles. Et maintenant ? Rien. »
Témoignage fictif d’un militant rexiste à Bruxelles en 1936:« Les politiciens bavardent au Parlement, mais ils ne donnent ni pain ni travail. Nous, les rexistes, nous avons une mission : rendre à la Belgique sa grandeur. Les Flamands veulent se séparer, les socialistes vendent le pays aux Russes. Moi, je crois qu’il faut un chef fort, comme en Allemagne. Sinon, c’est la mort du pays. »
Témoignage fictif d’un civil bruxellois en septembre 1944: «Les avions anglais sont arrivés cette nuit. Ils ont visé les gares, mais c’est notre quartier qui a brûlé. Ma sœur est morte sous les décombres. On nous dit que c’est pour nous libérer, mais il ne reste plus rien à libérer. Les nazis nous tuent le jour, les Alliés la nuit. Bruxelles n’est plus qu’un cimetière. »
Témoignage fictif d’un étudiant de Louvain en 1968:« La police a chargé. Nous criions “Louvain flamand !” et on nous a répondu avec des matraques. On dit que l’armée pourrait intervenir. Mon père a peur d’une guerre civile. Il dit que la Belgique ne tiendra pas longtemps. Moi, je ne veux plus de ce pays. »
Témoignage fictif d’un fonctionnaire français à Paris en 1980: « Ce matin, j’ai reçu une note : la Flandre a déclaré son indépendance. Bruxelles est en flammes, la Wallonie supplie Paris de la rattacher. Mais ici, personne n’en veut. Trop pauvre, trop instable. Alors que faire ? Laisser ce petit État mourir tout seul. »
Témoignage fictif d’une habitante de Charleroi en 1985:« Il n’y a plus d’usines, plus de travail. Les jeunes partent en Allemagne ou sombrent dans la drogue. Les mafias russes contrôlent les quartiers. On dit qu’on est la “Sicile du Nord”. Moi, je dis qu’on est juste abandonnés. »
Témoignage fictif d’un soldat de l’ONU à Bruxelles en 2016: »Nous patrouillions près de la Grand-Place quand ça a explosé. Une bombe, puis deux, puis trois. Les immeubles se sont effondrés. Les gens couraient partout. Mais ce qui m’a glacé, c’est de voir que même les pompiers refusaient d’entrer : trop dangereux. Bruxelles, capitale de rien, juste un champ de bataille. »
Témoignage fictif d’un réfugié bruxellois dans un camp de Lille en 2025:« J’ai fui Bruxelles quand les groupes armés ont pris mon quartier. Il n’y avait plus d’eau, plus d’électricité. Les enfants ne pouvaient plus sortir. On vivait dans la peur des attentats. Maintenant, on dit que la ville n’existe plus, qu’elle est partagée entre mafias et terroristes. Je n’ai plus de pays. »
2.9) Et si tout s’était bien passé pour la Wallonie, quelle aurait été l’uchronie, la plus parfaite, la plus optimiste pour elle?
Voici la chronologie de cette uchronie:
En 1830, durant la Révolution belge, les Wallons, très présents dans l’armée et l’industrie, obtiennent une place politique forte dès le départ.
En 1835, la Première ligne de chemin de fer du continent Bruxelles–Malines est inaugurée. En parallèle, Liège et Charleroi développent un réseau ferroviaire dense pour desservir les mines et les usines.
Entre 1840 et 1850, il y a la création d’écoles techniques régionales financées par l’État. Il y a la naissance d’une génération d’ingénieurs wallons.
En 1860, Liège devient un centre mondial de la sidérurgie, Charleroi de la verrerie.
En 1870, l’État belge instaure une législation sociale avancée avec la sécurité au travail, des syndicats légaux. Les ouvriers wallons deviennent un modèle en Europe.
En 1880, L’Université de Liège fonde une école polytechnique prestigieuse, attirant des étudiants étrangers.
En 1890, il y a une diversification vers la chimie, Cockerill investit dans les engrais et de nouveaux brevets liégeois.
En 1900, la Wallonie est la 2ᵉ région industrielle la plus riche d’Europe après la Ruhr. Le PIB par habitant est plus élevé en Wallonie que la moyenne britannique.
En 1914, durant l’invasion allemande. La résistance wallonne est plus forte que dans notre réalité grâce aux fortifications de Liège et Namur. La région paie un lourd tribut, mais sort auréolée de prestige.
En 1919, la Reconstruction est rapide grâce à des investissements franco-britanniques. Il y a la création de l’Office national de la reconversion industrielle.
Entre 1920 et 1930, c’est le début de l’électrification généralisée. Il y a l’Essor de l’industrie électrique et mécanique de précision.
En 1936, la crise mondiale affecte la Wallonie, mais l’État fédéral injecte des fonds publics pour moderniser la sidérurgie et soutenir les PME.
Durant la Seconde Guerre mondiale, la résistance wallonne est très active. Liège et Charleroi deviennent des symboles de courage. Après la guerre, les Alliés considèrent la Wallonie comme un partenaire clé de la reconstruction européenne.
En 1947, c’est le début du Plan Marshall. La Wallonie reçoit une aide accrue car ses industries sont jugées stratégiques.
En 1951, le roi Léopold III abdique, mais dans un climat d’unité nationale moins tendu que dans notre réalité, le rôle héroïque de la résistance à souder les Flamands et les Wallons.
En 1952, la Wallonie devient le moteur de la CECA. Liège accueille un siège technique de l’institution.
En 1960, il y a la Création d’un « Plan de modernisation industrielle » avec une reconversion progressive du charbon vers la chimie et l’énergie nucléaire.
En 1965, il y a la Fondation d’un pôle aéronautique à Gosselies qui est un précurseur de Sonaca, bientôt leader européen.
En 1970, il y a la mise en place d’un enseignement supérieur gratuit, qui dope la formation des ingénieurs et chercheurs.
En 1975, la Wallonie atteint un PIB par habitant équivalent à celui de la Rhénanie. Avec un chômage inférieur à 4 %.
En 1980 avec le début du fédéralisme belge. La Wallonie obtient une autonomie économique, qu’elle utilise pour financer la recherche et les start-ups.
En 1985, il y a la mise en service du TGV Paris–Liège–Cologne, Liège devient un carrefour européen.
En 1990, l’industrie lourde décline mais elle est compensée par les biotechnologies et l’informatique, Namur devient la capitale numérique.
En 1995, la Wallonie crée un fonds d’investissement vert qui est un précurseur du Green Deal, soutenant l’éolien et l’hydraulique.
En 2000, la Wallonie est reconnue comme une région à haute qualité de vie avec des transports publics performants, des villes rénovées, un patrimoine culturel mis en valeur.
En 2005, Charleroi devient la capitale européenne des énergies renouvelables avec un parc de recherche international.
En 2010, Liège accueille un centre spatial européen.
En 2015, Namur est désignée comme la capitale européenne de la cybersécurité.
En 2020, grâce à ses choix écologiques, la Wallonie est quasi neutre en carbone. Son modèle est étudié par l’ONU.
En 2025, la population de la Wallonie est de 4 millions d’habitants, la démographie reste stable et légèrement croissante. Le Chômage est entre 3 et 4 %. Les secteurs phares sont l’aéronautique, le spatial, le biotech, l’énergie verte et le numérique. La Wallonie est classée parmi les 10 régions les plus innovantes d’Europe. Bruxelles reste la capitale fédérale et européenne, mais Namur et Liège rayonnent comme des pôles économiques.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Liège en 1845, témoignage fictif d’un jeune ouvrier métallurgiste:
« J’ai 18ans et je travaille à l’usine Cockerill. Jamais je n’aurais cru qu’un jour nous aurions des écoles pour apprendre à lire, compter et même comprendre les machines. Mon père dit que la Wallonie peut devenir la Manchester du continent. Moi, je commence à y croire. »
Charleroi en 1900, témoignage fictif d’un ingénieur en verrerie:
« Grâce aux nouvelles écoles techniques, j’ai pu inventer une machine qui double notre production de verre sans mettre plus d’hommes au travail. Mes collègues sont fiers, et moi aussi. La Wallonie n’est plus seulement une région de charbon : elle devient un centre d’innovation. »
Liège en 1915, témoignage fictif d’un instituteur pendant la Première Guerre mondiale:
« Les Allemands sont là, mais nous continuons à enseigner. J’explique aux enfants que notre région est le cœur industriel de la Belgique et qu’elle sera reconstruite. Même dans les bombes, l’espoir est palpable. »
Liège en 1942, témoignage fictif d’une résistante de 21 ans:
« Nous organisons des sabotages dans les usines occupées. Nos actions sont risquées, mais nos voisins nous soutiennent. La Wallonie n’est pas écrasée comme dans d’autres régions d’Europe : nous résistons et nos industries continuent de produire pour les Alliés. »
Namur en 1955, témoignage fictif d’un sidérurgiste:
« On nous a donné des machines électriques et de nouvelles formations. Mon père travaillait encore au charbon, moi je supervise des fours modernes. On sent que notre région peut devenir un modèle pour toute l’Europe. »
Liège en 1970, témoignage fictif d’une chercheuse en aéronautique:
« Gosselies devient un centre européen. Je travaille sur des prototypes d’avions avec mes collègues belges et français. La Wallonie est enfin reconnue pour ses talents scientifiques. C’est une période excitante. »
Charleroi en 1995, témoignage fictif d’un entrepreneur dans l’énergie renouvelable:
« Nous avons créé des turbines pour alimenter toute la région en énergie verte. Les banques et l’État croient en notre projet. La Wallonie n’est plus seulement industrielle, elle est pionnière dans l’innovation écologique. »
Namur en 2015, témoignage fictif d’un étudiant en cybersécurité:
« Notre université attire des étudiants de toute l’Europe. Ici, nous formons les experts qui protégeront les données des entreprises et des institutions. La Wallonie a su se réinventer et être à la pointe de la technologie. »
Liège en 2020, témoignage fictif d’une ingénieure en aérospatial:
“Travailler à Liège pour l’Agence spatiale européenne est un rêve. Nos satellites sont lancés pour étudier la Terre et l’espace. Je me dis que nos ancêtres, ceux qui ont travaillé dans les mines et les usines, seraient fiers de ce que nous avons accompli.”
Namur en 2025, témoignage d’une habitante de la Wallonie moderne:
« Je regarde nos villes rénovées, nos parcs technologiques, nos écoles et nos universités. La Wallonie est prospère, verte, innovante et ouverte sur le monde. C’est le fruit de siècles d’efforts, de courage et d’audace. Nous avons su transformer notre destin. »
2.10) Et si tout s’était mal passé pour la Wallonie? Quelle aurait été la pire réalité?
Voici la chronologie:
En 1830, durant la Révolution belge. La Wallonie rejoint la Belgique indépendante, mais les élites locales, trop liées aux investisseurs britanniques, vendent les ressources industrielles à bas prix.
Entre 1835 et 1850, les premières industries charbonnières et sidérurgiques se développent, mais la majorité des profits quittent la région.Il y a des salaires misérables, des conditions de travail atroces. Les premières grèves sont écrasées par l’armée et la police.
Entre 1850 et 1870, C’est le début du chemin de fer. Les lignes privilégient le transport des matières premières vers les ports flamands, marginalisant les villes wallonnes.
Entre 1870 et 1900, l’industrialisation s’intensifie, mais la Wallonie ne bénéficie jamais de la formation de capital local. Les ouvriers vivent dans des quartiers insalubres. Il y a des épidémies de choléra et de typhus fréquentes.
Entre 1910 et 1914, la Wallonie est économiquement dépendante de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne. L’État belge investit massivement en Flandre, laissant la Wallonie sous-développée.
Durant la première guerre mondiale, les villes industrielles wallonnes sont occupées par les Allemands. Les mines servent directement l’effort de guerre allemand. Il y a des réquisitions massives et des famines locales. La Reconstruction est lente et la corruption est endémique après 1918.
Durant les années 1920: La Belgique privilégie Bruxelles et Anvers pour la reconstruction et l’investissement industriel. Les industries wallonnes souffrent d’un manque de modernisation. Le chômage explose, et les mouvements extrémistes se multiplient.
En 1930, la crise économique mondiale frappe la Wallonie plus durement que la Flandre.
Durant la Seconde Guerre mondiale: La Wallonie est un point stratégique pour l’Allemagne nazie. Les villes industrielles sont bombardées ou réquisitionnées. La Résistance est écrasée, la population est déportée en masse. Les infrastructures industrielles sont gravement endommagées.
Les plans Marshall et les investissements étatiques favorisent la Flandre et Bruxelles. Il y a la fermeture progressive de petites mines et aciéries. Les villes wallonnes stagnent. La population émigre vers la Flandre ou la France pour trouver du travail.
Les grandes aciéries de Liège, Charleroi et Seraing ferment les unes après les autres. Il y a un chômage massif et une pauvreté urbaine. Les villes deviennent partiellement désertes. Les tentatives de reconversion vers les services échouent à cause du manque d’infrastructures modernes.
Dans les années 2000 et 2010, La Wallonie devient un territoire périphérique, oublié par Bruxelles et l’Union européenne. Les Écoles et hôpitaux manquent de moyens. Les transports publics s’effondrent. La population restante survit grâce à l’aide sociale et à l’économie informelle. Les grandes villes industrielles ressemblent à des villes fantômes.
En 2025, la Wallonie est un symbole de déclin durable, avec un PIB par habitant moitié moindre que celui de la Flandre, et une population vieillissante en fuite constante.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Liège en 1880, témoignage fictif d’un ouvrier sidérurgiste:
« Je travaille depuis l’aube jusqu’au soir dans cette forge qui ne m’offre rien d’autre qu’un toit au-dessus de ma tête. Mes enfants respirent la fumée et tombent malades chaque hiver. Et pendant ce temps, les patrons anglais s’enrichissent sur notre dos. On parle de grève… mais nous savons que l’armée viendra nous disperser. On n’a jamais rien eu ici, et je doute que cela change un jour. »
Charleroi en 1916, témoignage fictif d’une mère pendant l’occupation allemande:
« Les Allemands ont pris nos mines, nos maisons et même nos récoltes. Mon mari a été envoyé travailler dans une mine pour l’effort de guerre. Nous vivons avec presque rien, et chaque jour, mes enfants demandent du pain que je ne peux pas leur donner. La guerre ne finira jamais pour nous, ici. »
Liège en 1933, témoignage fictif d’un ancien mineur au chômage:
« Avant, nous avions nos mines, nos aciéries. Maintenant, tout est fermé. Je passe mes journées à chercher un travail qui n’existe pas. La Flandre a ses usines modernes et nous, nous restons avec nos rues crasseuses et nos écoles fermées. On se sent abandonnés par le pays et par le monde. »
Seraing en 1955, témoignage fictif d’un jeune diplômé sans avenir
« J’ai étudié l’ingénierie pour aider à reconstruire nos usines, mais toutes les entreprises préfèrent investir à Bruxelles ou en Flandre. Ici, rien ne bouge. Mes amis partent, et bientôt je partirai moi aussi. Je ne sais pas si un jour mes enfants verront une Wallonie prospère. »
Charleroi en 1987, témoignage fictif d’un chômeur de longue durée:
« Je vis dans un appartement vide, dans un quartier où les voisins partent un à un. Les usines sont fermées depuis des années. On parle de revitalisation, mais il n’y a jamais d’argent, jamais de projets. Ici, on survit à peine. »
Liège en 2025, un témoignage fictif d’une retraitée
« La ville a changé… ou plutôt, elle a disparu. Les rues sont silencieuses, les écoles et hôpitaux ferment les uns après les autres. Mes enfants ont quitté la Wallonie depuis longtemps. Je me demande si quelqu’un se souvient encore que nous avons été une région industrielle et fière. Aujourd’hui, nous sommes juste… oubliés. »
2.10) Quel aurait été l’uchronie parfaite pour la Flandre où tout se serait bien passé pour elle?
En 1830, le nouvel État reconnaît immédiatement l’égalité du flamand et du français. Bruxelles devient une capitale bilingue. Les élites flamandes participent pleinement au projet belge.
En 1835, le Premier chemin de fer continental Bruxelles–Malines–Anvers est construit. La Flandre devient pionnière en Europe des transports modernes.
Entre 1840 et 1850, l’Industrialisation est rapide, Gand excelle dans le textile, Anvers dans le commerce maritime, Bruges et Courtrai dans l’agroalimentaire.
En 1848, il y a des réformes libérales avec un suffrage élargi des libertés syndicales. Les ouvriers flamands sont intégrés à la vie politique et sociale.
En 1873, il y a une administration bilingue, les juges, les fonctionnaires et les parlementaires utilisent aussi bien le néerlandais que le français. Les tensions linguistiques de l’histoire réelle sont évitées.
En 1880, l’Université de Gand devient officiellement bilingue. La Flandre et la Wallonie se dotent d’universités d’excellence reconnues en Europe.
Entre 1890 et 1900, il y a des politiques sociales avancées, des assurances maladie embryonnaires, la protection des travailleurs du textile, des logements ouvriers modernes.
Durant la Première Guerre mondiale, la Belgique en sort unie, les soldats flamands reçoivent des ordres en flamand et en français. Il n’y a pas de « fracture de l’Yser ».
En 1919, le Suffrage universel masculin est mis en place. Les partis politiques restent nationaux et bilingues.
En 1930, l’Université de Louvain devient bilingue dès cette date. Les tensions universitaires de l’histoire réelle n’ont pas lieu.
Après la Seconde Guerre mondiale l’unité nationale est préservée, la Résistance est mixte, elle est flamando-wallonne. La collaboration reste marginale.
À partir de la Libération, la Belgique se reconstruit rapidement, la Flandre servant de moteur industriel et logistique.
En 1957,Bruxelles devient la capitale de la CEE. La Flandre profite massivement de ce rôle européen.
En 1960, la Constitution est révisée, la Belgique devient un pays fédéralement équilibré, donnant une autonomie régionale mais évitant les crises institutionnelles.
Entre 1970 et 1980, il y a un miracle économique, la Flandre attire l’automobile, Volvo à Gand, Ford à Genk, la chimie BASF à Anvers, et les hautes technologies IMEC à Louvain.
En 1980, la politique linguistique est stabilisée avec un bilinguisme généralisé dans l’éducation. Une génération entière grandit parlant parfaitement néerlandais et français.
En 1989, Bruxelles devient officiellement une région fédérale bilingue et la capitale de l’Europe politique, le symbole de la Belgique plurilingue .
En 1993, c’est la Réforme institutionnelle finale, la Belgique devient un État fédéral harmonieux. La Flandre et la Wallonie sont partenaires, non rivales.
En 2000, la Flandre devient la première région logistique d’Europe grâce à Anvers, Gand et l’aéroport de Zaventem.
En 2001, la Crise financière mondiale est absorbée, les banques flamandes sont restructurées avec succès grâce à une coordination fédérale.
En 2010, il n’y a pas de crise politique majeure, il y a un gouvernement fédéral stable avec des coalitions bilingues durables.
En 2015, le Plan énergétique est mis en place intitulé« Belgique 2030 », la Flandre développe massivement l’éolien offshore et l’hydrogène vert.
En 2020, durant la pandémie de Covid-19, la réponse fédérale est coordonnée avec un système de santé solide. La Flandre et la Wallonie coopèrent étroitement.
En 2022 avec la Crise énergétique, la Flandre devient un leader européen en production d’électricité renouvelable offshore.
En 2025, la Flandre est un moteur économique avec la logistique, la chimie, les technologies vertes. La population est hautement éduquée et multilingue, Les tensions communautaires sont inexistantes.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Journal fictif d’un étudiant à Gand en 1835:
« Je suis le fils d’un tisserand de Courtrai, et depuis peu j’étudie à l’Université de Gand. Les cours se donnent aussi bien en français qu’en néerlandais. Cela paraît naturel à tout le monde. Nous nous sentons égaux devant le savoir, et certains professeurs nous encouragent même à écrire dans les deux langues. On dit que Gand sera la première université bilingue du continent. Quelle chance pour notre avenir ! »
Lettre fictive d’un ouvrier d’Anvers à son frère parti en Amérique en 1885:
« Ici en Flandre la vie n’est pas facile, mais au moins nous avons obtenu un logement ouvrier salubre et des heures de travail plus justes. Les syndicats sont tolérés et même respectés par certains patrons. Quand je parle à mon contremaître, je le fais en Flamand, et à la maison communale je suis reçu dans la même langue. Cela change tout. J’ai entendu dire qu’à Paris les ouvriers n’ont pas ces droits… Nous avons de la chance de vivre ici. “
Témoignage fictif d’un soldat flamand dans les tranchées en 1916:
« Aujourd’hui, j’ai reçu mes ordres en flamand. Nos officiers nous parlent dans notre langue ou en français selon le cas. Cela peut sembler banal, mais cela nous donne du courage. Dans cette guerre terrible, au moins, on nous respecte comme personne à part entière. Nous sommes flamands et belges à la fois, sans contradiction. »
Discours fictif d’une étudiante bruxelloise lors de l’Expo universelle de Bruxelles en 1958:
“J’ai grandi dans une école où l’on passait d’une langue à l’autre avec naturel. Mes parents sont flamands, mon fiancé est wallon et nous habitons Bruxelles. Quand je me rends à l’Expo, je me rends compte que nous vivons dans une capitale qui n’appartient pas seulement à la Belgique, mais à toute l’Europe.”
Entretien fictif avec un entrepreneur de Gand en 1985:
« Grâce à la stabilité du pays, j’ai pu développer mon entreprise de biotechnologies sans perdre de temps dans des querelles institutionnelles. Nos ingénieurs parlent tous le flamand, le français et l’anglais, et cela impressionne nos partenaires étrangers. Beaucoup disent que la Flandre est devenue la Silicon Valley d’Europe. J’aime croire que c’est parce que nous avons su transformer notre bilinguisme en atout. »
Témoignage fictif d’un jeune chercheur à Anvers en 2025:
« Je viens de publier un article en anglais avec des collègues allemands et italiens. Je n’ai jamais ressenti de barrière : depuis l’école, nous apprenons à jongler entre langues et cultures. Aujourd’hui, je travaille au port d’Anvers sur un projet d’hydrogène vert. La Flandre est à la pointe de l’énergie durable. Quand je voyage, on me dit souvent : “Votre pays est petit, mais il a réussi ce que tant d’autres n’ont pas pu, réunir des communautés différentes dans un projet commun.” C’est cela, être flamand et belge en 2025. »
2.11) Quel aurait été le pire scénario pour la Flandre où tout s’est mal passé pour elle?
En 1830, la Belgique naît officiellement comme un État francophone. Le flamand n’a aucun statut officiel. Les élites flamandes doivent s’assimiler au français pour garder le pouvoir.
Entre 1840 et 1860, l’industrialisation profite surtout à la Wallonie avec le charbon et l’acier. La Flandre reste rurale et pauvre, avec un exode massif vers Bruxelles ou l’étranger.
En 1870,la Tentative de loi linguistique est rejetée. L’administration, l’armée et la justice fonctionnent uniquement en français. La Flandre vit une situation de quasi-colonie intérieure.
Entre 1880 et 1900, il y a les famines et la misère : la « question sociale » est aiguë, mais il y a peu de réformes. Des milliers de Flamands émigrent aux États-Unis, au Canada et en France.
Entre 1914 et 1918, la Flandre est un champ de bataille. Les soldats flamands reçoivent des ordres en français qu’ils ne comprennent pas toujours. Après la guerre, aucun statut linguistique n’est reconnu. La « fracture de l’Yser » radicalise le mouvement flamand.
En 1930, Louvain refuse toute flamandisation. Les étudiants flamands protestent mais sont réprimés.
Entre 1940 et 1945, l’occupation allemande exploite le ressentiment flamand. Une partie de l’élite collabore massivement, espérant obtenir un État flamand séparé. Après 1945, la Flandre est stigmatisée comme « traîtresse » et mise à l’écart politiquement.
Entre 1950 et 1960, La reconstruction bénéficie surtout à la Wallonie industrielle. La Flandre reste rurale et sous-développée. Anvers décline comme port face à Rotterdam.
En 1968, l’université de Louvain explose en affrontements violents. L’État choisit de diviser les institutions plutôt que d’intégrer le bilinguisme.
Entre 1970 et 1980, la Flandre s’industrialise tardivement, mais la crise pétrolière la frappe de plein fouet. Il y a un chômage de masse avec la fermeture d’usines textiles et automobiles.
En 2000, Bruxelles devient la capitale européenne, mais est officiellement francophone. Les Flamands y sont minoritaires et contestés.
En 2010, la Belgique traverse une crise politique interminable. La Flandre réclame l’indépendance, mais son économie fragile l’en empêche. Le pays est paralysé depuis des années.
En 2020, durant la pandémie de Covid-19, la gestion est chaotique. La Flandre et la Wallonie appliquent des mesures contradictoires. Le système de santé s’effondre.
En 2022, durant la Crise énergétique, la Flandre dépend du gaz russe et des importations, faute d’investissements dans les renouvelables.
En 2025, Bruxelles se détache et devient un territoire européen autonome. La Flandre, isolée, connaît un chômage élevé, un exode des jeunes vers les Pays-Bas et l’Allemagne. Les tensions linguistiques et politiques ont détruit l’unité belge et laissé la Flandre sans stabilité ni avenir clair.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Journal fictif d’un fermier de Flandre occidentale en 1847:
« Nous avons perdu la moitié de nos récoltes de pommes de terre. Les enfants pleurent la nuit, le ventre vide. Les riches notables de Bruxelles parlent français, et nous ne comprenons rien à leurs lois. Certains voisins sont partis en Amérique. Moi, je reste, mais je sens que ma terre ne nourrit plus personne. »
Lettre fictive d’un ouvrier textile de Gand en 1888::
« Mon fils de 10 ans travaille déjà à l’usine, il manie les bobines toute la journée. On nous parle en français à la direction, nous ne comprenons pas. Quand nous demandons des salaires décents, on nous rit au nez. Ils disent que nous sommes des “paysans arriérés. Peut-être que mon fils partira pour la France, comme tant d’autres. »
Témoignage fictif d’un soldat flamand sur le front de l’Yser en 1917:
« L’officier m’a crié un ordre en français. Je n’ai pas compris. Quelques secondes plus tard, l’artillerie allemande a frappé, et deux de mes camarades sont morts. Dans la boue, je me suis juré qu’un jour la Flandre serait respectée. Mais je crains que personne ne nous écoute jamais. »
Propos fictifs d’un étudiant à Louvain en 1932:
« Nous avons manifesté pour obtenir des cours en flamand. La gendarmerie nous a dispersés à coups de matraque. On dit que Louvain est une université “nationale”, mais pour nous, elle est étrangère : la science est réservée à ceux qui parlent français. Nous restons des belges de seconde zone. “
Témoignage fictif d’un chômeur de Genk:
« Quand j’ai commencé à Ford, j’étais fier. Une vraie usine moderne, une chance pour la Flandre. Mais aujourd’hui elle ferme, et nous n’avons rien. Pas de reconversion, pas d’aide. Mon fils dit qu’il partira travailler en Allemagne. La Flandre se vide de ses jeunes. Nous n’avons plus d’avenir ici. »
Témoignage fictif d’une jeune Flamande à Bruxelles en 2013:
« J’ai trouvé un emploi dans les institutions européennes, mais je dois toujours parler français ou anglais. Quand je parle flamand, on me regarde comme si j’étais une provinciale. Bruxelles n’est plus notre capitale, c’est une ville étrangère au milieu de notre pays. “
Témoignage fictif d’un chercheur flamand parti à Rotterdam en 2025:
« J’ai quitté Gand parce que les laboratoires fermaient faute de financements. Ici, aux Pays-Bas, on respecte mes compétences. Chez moi, on ne respecte même pas ma langue. Mes enfants ne veulent plus revenir. La Flandre se vide, elle devient un pays fantôme. On dit que nous sommes indépendants, mais nous ne sommes que seuls et pauvres.”
2.12) Quelle aurait été l’uchronie parfaite pour la ville de Bruxelles où tout s’est bien passé pour elle,la meilleure uchronie possible?
Voici la chronologie de cette uchronie:
En 1830, durant l’Indépendance de la Belgique. Dès le départ, les élites comprennent l’importance de doter Bruxelles d’un urbanisme digne d’une capitale moderne.
En 1835, la Première ligne de chemin de fer est inaugurée entre Bruxelles–Malines–Anvers, suivie d’un plan cohérent de gare centrale et de liaisons radiales.
Dans les années 1840, la Senne est canalisée progressivement mais les quais sont conservés et aménagés en promenades publiques, évitant la démolition massive du centre. Bruxelles s’impose rapidement comme une capitale politique et un centre commercial
En 1853, il y a l’Inauguration des Galeries Royales Saint-Hubert qui est une vitrine européenne.
Durant les années 1860, il y a un plan d’urbanisme visionnaire (inspiré de Vienne) avec des boulevards circulaires et une ceinture verte intérieure. Il n’y a pas de destruction anarchique.
Entre les années 1870 et 1890, Bruxelles devient un centre de l’Art nouveau. Horta, Hankar et Van de Velde transforment des quartiers entiers, protégés dès cette époque.
En 1897, c’est l’Exposition internationale qui est triomphale, Bruxelles se présente comme une capitale d’innovation, d’art et de diplomatie. La ville conjugue un rôle administratif, économique et culturel. Elle rivalise avec Vienne, Paris et Berlin.
En 1914, L’Allemagne renonce à envahir la Belgique, dissuadée par la pression internationale(à cause notamment du prestige de la ville de Bruxelles à l’international. Bruxelles reste neutre, et devient un centre diplomatique majeur.
Durant les années 1920, Bruxelles accueille régulièrement des conférences internationales, une sorte de Genève bis. L’Art déco s’épanouit, avec la Basilique de Koekelberg et les grands ensembles modernistes.
Entre 1935 et 1937, des expositions universelles spectaculaires au Heysel ont lieu, consolidant le prestige international.
Durant la Seconde Guerre mondiale, la Belgique reste neutre comme la Suisse, Bruxelles échappe aux destructions. Bruxelles est en 1945 une ville intacte, riche en patrimoine et reconnue mondialement.
En 1949, le siège de l’OTAN est fixé définitivement à Bruxelles.
En 1957, Bruxelles devient officiellement l’unique capitale de la CEE ce qui évite le partage avec Strasbourg et Luxembourg.
Durant les années 1960, contrairement à la « Bruxellisation » réelle, la ville protège ses quartiers historiques des Marolles, des boulevards centraux et développe un quartier européen de type campus vert, intégré au tissu urbain.
Durant les années 1970, un réseau de métro complet est inauguré avec 4 lignes opérationnelles dès 1980, les trains S sont lancés avec 30 ans d’avance, des trains qui circulent entre plusieurs villes, des trains suburbains. Bruxelles devient la capitale politique incontestée de l’Europe, avec un urbanisme harmonieux.
En 1989, c’est la Création de la Région de Bruxelles-Capitale avec un statut spécial, une ville-région internationale, au-dessus des tensions communautaires belges.
Durant les années 1990, les friches industrielles, le canal et Tour & Taxis sont converties en éco parcs urbains et des campus technologiques.
En 2000, Bruxelles accueille l’Euro et se profile comme une capitale sportive et culturelle, grâce à une politique d’événements internationaux avec des festivals, des musées et des expositions. Bruxelles combine puissance institutionnelle et qualité de vie durable.
En 2005,c’est la mise en service du train interrégional bruxellois complet, faisant de la ville une « métropole polycentrique » reliée à son “arrière pays”.
Durant les années 2010, Bruxelles adopte des politiques pionnières en mobilité douce, elle devient une référence mondiale en climat et en urbanisme durable, au même rang que Copenhague ou Vienne.
Durant les années 2020, Bruxelles profite du Brexit et attire massivement des institutions, des ONG et des entreprises et des universités internationales.
Bref en 2025, Bruxelles c’est la capitale de la Belgique, la capitale unique et officielle de l’Europe, la Métropole verte et culturelle reconnue mondialement. Elle est citée aux côtés de New York, Genève, Singapour et Vienne comme une ville-modèle du XXIe siècle.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un marchand flamand en 1835:
« Grâce au canal et aux quais aménagés, j’expédie mes draps vers Londres et Hambourg directement depuis Bruxelles. Avant, il fallait passer par Anvers. Désormais, tout passe par la capitale : commerce et politique sont enfin réunis. »
Témoignage fictif d’une touriste parisienne en 1898:
« J’ai arpenté les boulevards verdoyants de Bruxelles et admiré les maisons de M. Horta. Quelle cité splendide ! Paris a ses avenues haussmanniennes, mais ici tout respire l’harmonie et la lumière. On se croirait dans un musée à ciel ouvert. »
Témoignage fictif d’un diplomate suisse en 1925:
« Genève a ses congrès, mais Bruxelles attire l’Europe entière. Ici, on parle français, flamand, anglais, allemand sans heurt. J’ai l’impression d’assister à la naissance d’une véritable capitale de la paix. »
Témoignage fictif d’un étudiant bruxellois à l’Expo universelle en 1958:
« Tout le monde dit que Bruxelles est devenue la capitale de l’Europe, et on le sent ! Les boulevards sont pleins d’étrangers, le quartier européen ressemble à une cité-jardin moderne. Pas de tours disgracieuses, mais des bâtiments élégants. Quelle fierté d’étudier ici ! »
Témoignage fictif d’une habitante des Marolles en 1989:
« Contrairement à ce qu’on craignait, on n’a pas rasé notre quartier. Les maisons anciennes ont été restaurées, on a des espaces verts et un tram qui passe au pas. Bruxelles est devenue une ville humaine, pas une jungle de béton. »
Témoignage fictif d’un journaliste britannique après le Brexit en 2015:
« Tandis que Londres se referme, Bruxelles s’affirme. Ici, les institutions européennes, les universités internationales et les entreprises cohabitent dans une ville verte et vibrante. Ce n’est plus seulement la capitale de la Belgique ni même de l’Europe : c’est une capitale mondiale. »
Témoignage fictif d’une étudiante bruxelloise en 2025:
« Je prends le vélo le matin sur les pistes qui longent l’ancien canal, transformé en parc. Le métro et le train interrégional sont fiables, on rejoint Louvain en 20 minutes. Dans mon quartier, il y a des étudiants venus d’Afrique, d’Asie, d’Amérique. On nous dit que Bruxelles est le laboratoire des villes du futur… mais pour moi, c’est simplement chez moi. »
2.13) Quel aurait été le pire scénario pour Bruxelles où tout se serait mal passé pour elle, la pire uchronie possible?
Voici la chronologie:
En 1830, lors de la Révolution belge, les élites hésitent. Par compromis, la capitale est fixée à Anvers, jugée plus riche et plus connectée au commerce maritime. Bruxelles perd immédiatement son rôle politique central, elle devient une grande ville provinciale, sans statut spécial.
En 1835 : Le premier chemin de fer belge est finalement tracé depuis Anvers, marginalisant Bruxelles. La Senne, insalubre, est laissée à ciel ouvert avec des épidémies de choléra frappent en 1832, 1848, 1849, faisant fuir la bourgeoisie. Bruxelles est d’emblée une ville déclassée.
Entre 1850 et la fin des années 1870, l’industrialisation profite à Liège avec la sidérurgie et à Anvers comme un port international. Bruxelles reste un centre administratif médiocre. La Senne n’est pas recouverte correctement. Elle devient une plaie nauséabonde. Les projets haussmanniens échouent avec des boulevards inachevés, des quartiers historiques rasés et remplacés par des immeubles médiocres.
En 1880, les festivités du Cinquantenaire sont éclipsées par les expositions d’Anvers et de Paris, Bruxelles n’attire pas. À la fin du XIXe siècle, Bruxelles est déjà considérée comme une « ville sale et mal gérée ».
En 1914, Bruxelles est incendiée par l’armée allemande comme Louvain. La Grand-Place et le Palais de Justice sont détruits.
L’entre-deux-guerres se passe dans la pauvreté, Anvers et Gand prospèrent et Bruxelles végète.
Entre 1940 et 1945 avec les bombardements alliés sur les infrastructures ferroviaires et industrielles,il y a une destruction massive du centre. En 1945, Bruxelles est une capitale ruinée, avec une réputation de ville sinistrée.
Durant les années 1950, lors du choix de la capitale européenne, Bruxelles est écartée au profit de Strasbourg, qui en devient la capitale officielle et de la ville de Luxembourg comme la capitale judiciaire. L’OTAN s’installe d’abord à Paris, puis à Bonn, Bruxelles n’a aucun rôle international. La reconstruction se fait dans la précipitation, on rase les ruines pour construire des autoroutes urbaines et des tours de béton. La Bruxellisation est totale avec la disparition du tissu historique, le centre-ville est éventré par des voies rapides. Bruxelles devient un symbole d’urbanisme raté, une anti-Vienne.
Durant les années 1980, avec la crise économique et les tensions communautaires. L’État belge, affaibli, ne crée pas de Région bruxelloise. La ville est gérée à la fois par la Flandre et la Wallonie, ce qui entraîne des blocages et des paralysies. Les classes moyennes fuient massivement vers la périphérie flamande et wallonne. Certains quartiers centraux sombrent dans la misère avec du chômage et de la délinquance).
Durant les années 1990,Les friches industrielles le long du canal restent abandonnées.Le commerce de drogue et la pauvreté s’y installent. Bruxelles est perçue comme une ville sale, pauvre et ingouvernable.
Durant les années 2000, contrairement à la réalité, les institutions européennes renforcent Strasbourg et Francfort, Bruxelles perd les dernières grandes agences.
Le train inter regional bruxellois n’est jamais construit, le métro stagne à deux lignes avec des embouteillages permanents et une pollution chronique.
Durant les années 2010, les inondations de la Senne, mal canalisée, provoquent des désastres à répétition. Les investisseurs fuient.
En 2020, la Belgique éclate officiellement. La Flandre prend Anvers comme capitale, la Wallonie choisit Namur. Bruxelles devient une ville-État appauvrie, isolée, sans institutions internationales pour la soutenir.
En 2025, la ville est gangrenée par la pauvreté, la criminalité et la fuite des cerveaux. Le patrimoine architectural a disparu sous le béton, et l’économie repose sur quelques administrations locales et un tourisme en déclin.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un fonctionnaire bruxellois en 1835:
« On dit que la Belgique est née libre, mais notre ville n’a pas été choisie capitale… Tout se décide à Anvers. Ici, nous ne sommes qu’une sous-préfecture. Les notables partent, les rues sentent la Senne… Quelle humiliation. »
Témoignage fictif d’un médecin en 1890:
« Chaque été, le choléra revient. Les égouts sont inexistants, la Senne empeste et les autorités hésitent à la couvrir. Pendant que Liège et Anvers se modernisent, nous restons prisonniers de notre crasse. »
Témoignage fictif d’un habitant de la Grand-Place en 1915:
“L’armée allemande a incendié nos maisons comme à Louvain. La Grand-Place n’est plus qu’un tas de cendres, le Palais de Justice un squelette noirci. Nous ne sommes plus qu’une ville morte. “
Témoignage d’un urbaniste hollandais en visite à Bruxelles en 1955:
« J’ai vu Bruxelles aujourd’hui. Quelle horreur. On détruit tout ce qu’il reste pour élargir des avenues aux voitures. Des autoroutes pénètrent jusqu’au centre. La ville n’a plus d’âme, seulement du béton. »
Témoignage fictif d’une mère de famille des Marolles en 1975:
« Ils ont rasé notre quartier pour construire une tour de bureaux qui est déjà vide… Nous avons été relogés dans des barres grises, sans commerces ni chaleur humaine. Mes enfants ne connaissent plus la Grand-Place, elle est encerclée de parkings. »
Témoignage fictif d’un diplomate européen en 1992:
« Strasbourg est la capitale, Francfort gère l’économie, Luxembourg la justice. Bruxelles ? Rien. Quand je viens ici, je vois une ville divisée, sans avenir, où même les Belges hésitent à investir. »
Témoignage fictif d’un chauffeur de taxi en 2008:
« J’ai passé une heure dans les embouteillages du ring. Pas de métro correct. Les politiciens parlent, mais personne n’agit. Bruxelles est un enfer de voitures et de pollution. »
Témoignage fictif d’une étudiante bruxelloise en 2025:
« Depuis que la Belgique a éclaté, nous vivons dans une sorte de ville-État pauvre. Les universités internationales sont parties à Amsterdam, les institutions à Strasbourg. Nous n’avons plus que des ruines modernistes, des ghettos et des souvenirs d’un passé qu’on n’a jamais su protéger. »
2.14) Et si le Royaume-Uni des Pays-Bas après avoir fait échouer la Révolution belge de 1830 avait unifié l’Allemagne?
Concernant le réalisme de cette uchronie, il y a plusieurs points qui la rend plausible sur le plan militaire, le Royaume-Uni des Pays-Bas n’était pas dépourvu de moyens. L’armée néerlandaise aurait pu réprimer plus efficacement la révolte si le roi avait réagi plus vite et si les grandes puissances n’avaient pas soutenu les Belges. L’union des ports néerlandais de Rotterdam et d’Amsterdam et de de l’industrie wallonne de Liège et Charleroi et des mines de charbon aurait formé une économie très compétitive dès le XIXe siècle. Cela aurait renforcé la position du royaume en Europe. Le roi des Pays-Bas était déjà duc de Luxembourg, donc membre de droit de la Confédération allemande. En cas de prestige accru avec la victoire de 1830, il aurait pu peser davantage dans les affaires allemandes.
Mais qu’est ce qui rendrait ce scénario improbable?
En premier lieu, Le Royaume-Uni et la France ne voulaient pas d’un bloc trop puissant au cœur de l’Europe.
La Sainte-Alliance aurait probablement accepté la répression de la Révolution belge, mais pas une expansion vers l’Allemagne.
La Prusse et l’Autriche étaient deux États qui étaient les « géants » de la Confédération germanique.
Imaginer qu’ils laissent un roi périphérique (Guillaume Ier ou son fils Guillaume II) unifier l’Allemagne à leur place est difficile. Même affaiblie, la Prusse restait une puissance militaire redoutable.
Déjà, l’union entre Néerlandais et Belges était fragile, y ajouter les Allemands aurait encore accentué les tensions identitaires, l’unité aurait été beaucoup plus difficile à maintenir.
L’Assemblée de Francfort en 1848 avait offert la couronne impériale au roi de Prusse, mais il avait refusé car elle venait du « peuple ».
Imaginer le roi des Pays-Bas l’accepter, c’est plausible si on suppose un souverain plus libéral, mais historiquement Guillaume Ier et II étaient plutôt conservateurs.
Bref à court terme entre 1830 et 1840. Le scénario est assez réaliste avec la victoire sur les Belges, avec un renforcement du royaume et un poids accru en Allemagne.
À moyen terme en 1848, il aurait été beaucoup moins probable car la Prusse et l’Autriche auraient presque certainement bloqué toute tentative d’unification menée par La Haye.
À long terme en 1870, il aurait été quasi impossible car la Prusse n’aurait pas accepté d’être vassalisée par un royaume perçu comme secondaire.
Voici la chronologie de cette uchronie:
En Octobre 1830, l’armée néerlandaise, est mieux organisée et soutenue par les garnisons luxembourgeoises, écrase l’insurrection à Bruxelles et Liège.
En Novembre 1830, Le roi Guillaume Ier proclame la restauration de l’unité nationale. La Belgique reste dans le royaume.
En 1831, durant la Conférence de Londres, les grandes puissances protestent mais ne passent pas à l’action militaire, craignant un conflit général. La France, isolée, ne peut intervenir.Le Royaume-Uni des Pays-Bas sort renforcé diplomatiquement et militairement.
En 1835, il y a un développement économique rapide avec l’ouverture des premières lignes de chemin de fer reliant Anvers, Bruxelles et Liège aux Pays-Bas. Le royaume devient un pôle industriel et commercial majeur en Europe du Nord.
En 1843, c’est la mort de Guillaume Ier et c’est l’avènement de Guillaume II qui est plus ouvert aux compromis politiques. Le royaume adopte quelques réformes constitutionnelles pour apaiser les tensions entre Néerlandais et Belges.
En 1848, c’est le Printemps des peuples en Europe. L’Assemblée de Francfort propose une constitution libérale pour une Allemagne unifiée. Contrairement à la réalité, Guillaume II des Pays-Bas accepte la couronne impériale, profitant de son statut de souverain du Luxembourg et du prestige acquis en 1830. C’est cette année-là qu’il y a la naissance d’une « Union allemande du Nord », dominée par le Royaume-Uni des Pays-Bas. En 1850, il y a des conflits diplomatiques avec la Prusse et l’Autriche, qui refusent cette unification. L’Union allemande du Nord regroupe les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, les États rhénans et certaines principautés du nord.
En 1856, il y a une guerre courte contre l’Autriche, soutenue par la Prusse. Cette guerre se termine avec la victoire des troupes néerlando-belgo-allemandes avec l’appui britannique (qui préfère affaiblir l’Autriche que de voir la France dominer le Rhin). L’Autriche est exclue définitivement des affaires allemandes.
Il y a, à la même période, l’intégration progressive de la Prusse orientale dans l’union, sous pression diplomatique et économique. Berlin devient un centre administratif secondaire, tandis qu’Aix-la-Chapelle est choisie comme capitale symbolique avec l’héritage carolingien.
Durant la crise entre la France et le bloc germanique (les États dominés par les Pays-Bas, Napoléon III tente d’arrêter la montée en puissance de ce bloc nord-européen.
L’armée impériale française est battue à Sedan par une coalition dirigée par Amsterdam, Bruxelles et Berlin.
En 1871, il y a la proclamation du Royaume-unie des Pays-germaniques (ou Rupg) à Bruxelles. Cet état à une structure tripolaire qui à la La Haye comme capitale politique. Anvers comme capitale économique et maritime. Aix-la-Chapelle comme capitale impériale symbolique.
Guillaume II devient Empereur des Germano-Bataves.
En 1880, le Rupg est désormais la première puissance industrielle du continent, surpassant même le Royaume-Uni sur le plan commercial grâce à ses ports et à son industrie lourde. La France vit dans un esprit de revanche permanente, accélérant la course aux armements
En 1890, Le Rupg continue d’investir dans la marine, rivalisant avec la Royal Navy. L’Afrique est partagée différemment : le Rupg obtient le Congo (grâce à l’ancien lien belge) et une partie de l’Afrique de l’Est.
En 1900, l’Europe est dominée par un triangle de puissances tout d’abord nous avons le Royaume-Uni qui est un empire maritime mondial et par la suite nous avons le Rupg ou Royaume-uni germano-batave qui est un empire industriel et continental et puis finalement la Russie qui est un colosse oriental. La France reste affaiblie et isolée, obsédée par la revanche.
En 1914 ,comme dans notre réalité, il y a la Crise des Balkans mais au lieu de l’attentat de Sarajevo, la guerre éclate plus tôt après un conflit austro-serbo-russe. Le Royaume-uni germano-batave est hostile à l’Autriche depuis les années 1850 et il se range aux côtés de la Russie. La prusse et les et le Rupg combattent donc contre l’Autriche et la France alliée.
En 1916,L’armée française s’effondre après de lourdes défaites en Lorraine. Paris tombe brièvement sous l’occupation germano-batave. L’Autriche est démantelée par le Rupg et la Russie.
En 1918 c’est la fin de la guerre et la France perd l’Alsace-Lorraine définitivement, et sa monarchie est restaurée sous influence batave. L’Autriche est réduite à Vienne et la Haute-Autriche, ses territoires sont intégrés dans des États satellites germano-bataves. Le Royaume-Uni germano-batave devient la première puissance mondiale avec le Royaume-Uni.
Durant les années 1920, Bruxelles devient un centre financier mondial, concurrençant Londres et New York.
En 1930, la Grande Dépression arrive et le Royaume-Uni germano-batave(ou rugb)est frappé, mais son économie est diversifiée avec des ports, une industrie et des colonies ce qui limite les dégâts. Il n’y a pas de montée du Nazisme mais il y a l’apparition de mouvements nationalistes flamands, wallons et allemands exigeant plus d’autonomie au sein de l’empire.
En 1940, La France se rebelle contre le gouvernement allié du Rugb, humilié depuis 1918 et tente une revanche en s’alliant à l’Italie fasciste. Une nouvelle guerre éclate, mais l’armée révolutionnaire française et l’armée italienne sont battues en quelques mois. Le Rugb annexe la Flandre française et la Savoie.
En 1950, Rugb domine, il englobe l’Europe centrale, la Belgique, les Pays-Bas, le nord de l’Allemagne, une partie de l’Autriche et l’Alsace-Lorraine. Londres et Washington forment une alliance atlantique pour contenir ce bloc continental.
Entre 1960 et 1980, la Guerre froide est différente : Il y a un bloc Atlantique qui contient les USA, le Royaume-Uni et ses colonies.
Un Bloc Continental avec le Royaume-Uni germano-batave et ses satellites.
Et un Bloc soviétique plus faible car il est privé d’une Europe centrale instable.
En 2000, le Royaume-uni germano-batave existe toujours, sous une forme fédérale avec un Parlement bicaméral à Bruxelles et à Berlin). Les langues officielles sont le Néerlandais,le Français et l’allemand.C’est la première puissance économique mondiale, surpassant les États-Unis et la Chine.
Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Journal fictif d’un bourgeois bruxellois en 1830: ”Nous avons cru, en août dernier, que la flamme de la liberté française nous gagnerait. Mais les soldats du roi sont entrés par la Porte de Schaerbeek comme une marée d’acier. Bruxelles est reprise. Certains parlent d’oppression, moi je vois plutôt de l’ordre. Le commerce reprend, et Anvers bourdonne déjà de navires. Peut-être n’est-ce pas une si grande défaite que cela. »
Lettre fictive d’un député allemand de Francfort en 1848: “ L’Histoire hésite. La Prusse refuse notre couronne, mais voici que Guillaume II des Pays-Bas, souverain aussi de Luxembourg, se dit prêt à l’accepter. Un roi batave à la tête d’une Allemagne nouvelle ! Ce n’est pas ce que nous avions imaginé, mais il vaut mieux un empire libéral qu’un chaos d’États. »
Discours fictif de proclamation du Royaume-uni germano-batave à Bruxelles en 1871: « Peuples d’Allemagne, des Pays-Bas et de Belgique, aujourd’hui nous ne sommes plus divisés par les langues ni par les frontières imposées. Nous renaissons dans l’esprit de Charlemagne, sous un sceptre commun, pour que l’Europe du Nord soit unie et forte face au monde. »
Journal fictif d’un soldat français après la chute de Paris en 1916:”Jamais je n’aurais cru voir les drapeaux germano-bataves flotter sur les Tuileries. Les officiers parlent en allemand, d’autres en néerlandais, et certains même en français avec l’accent de Bruxelles. C’est étrange : cet empire ressemble à un patchwork, et pourtant il avance comme une seule armée. »
Article du Times de Londres en 1925: “Le Royaume-uni germano-batave domine le commerce mondial. Anvers et Rotterdam surpassent nos docks. Les banquiers de Bruxelles prêtent à l’Argentine et à la Chine. Il est temps que l’Empire britannique s’adapte à ce nouveau rival continental, ou nous serons relégués à la périphérie de l’Histoire. »
Témoignage fictif d’un étudiant flamand à Berlin en 1962: « J’étudie ici, à l’université de Humboldt. Mes cours sont en allemand, mais mes colocataires parlent français et néerlandais. On dit que notre Royaume est un miracle. Mais dans les cafés, les nationalistes murmurent : les Flamands veulent plus d’autonomie, les Bavarois aussi. On dirait que l’unité impériale est solide de loin, mais fragile de près. »
Interview fictive dans un journal de Bruxelles en 2001: »Nous avons grandi avec trois langues officielles : le Français, l’ Allemand et le Néerlandais. Mes enfants parlent tous les trois sans accent. Certains disent que c’est une lourdeur administrative, moi je dis que c’est une richesse. Notre Royaume n’est pas parfait, mais il nous a donné la paix, la prospérité et la place de première puissance mondiale. Que demander de plus ? »
Alors que que l’uchronie précédente était très peu réaliste voici une version un peu plus réaliste:
En 1848, Contrairement à la Prusse et à l’Autriche qui vacillent, Guillaume II propose d’accueillir à La Haye une « Conférence des États allemands ». Le Royaume-Uni des Pays-Bas devient un médiateur entre les États libéraux et les monarchies conservatrices.
En 1850, il y a la création d’une union douanière nord-européenne regroupant: les Pays-Bas, la Belgique, les états rhénans et Hanovre. Cette union rivalise avec le Zollverein dominé par la Prusse.
En 1860, l’économie du royaume batavo-belge est la plus dynamique d’Europe occidentale. Anvers dépasse Hambourg et Marseille comme premier port continental. Le royaume devient banquier de l’Allemagne, finançant des projets ferroviaires en Prusse et en Bavière.
En 1866 c’est la guerre austro-prussienne. Dans notre réalité, la Prusse bat l’Autriche. Dans cette uchronie, le Royaume-Uni des Pays-Bas joue le rôle d’arbitre, d’un côté il menace de couper ses financements à la Prusse si la guerre s’éternise et émet des pressions diplomatique pour éviter l’annexion brutale des États allemands. Le résultat est que tout c’est terminé en compromis la Confédération germanique aurait été réformée, sans domination totale de la Prusse.
En 1870, la Guerre franco-prussienne a été évitée, la France hésite à attaquer car le Royaume-Uni des Pays-Bas déclare sa neutralité armée mais prévient qu’il défendra ses ports et le Rhin si Paris franchit la frontière belge. La Prusse gagne en prestige mais n’ose pas défier le bloc nord-européen.
En 1880, le Royaume-Uni des Pays-Bas devient la « Suisse des grandes puissances », il est l’arbitre des conflits, il est le banquier de l’Europe et est une puissance maritime et commerciale mondiale.En 1900, l’Empire allemand existe mais est plus fragile et moins centralisé que dans notre réalité. Le Royaume-Uni des Pays-Bas reste extérieur, mais influence fortement son économie.
En 1900, l’Empire allemand existe mais est plus fragile et moins centralisé que dans notre réalité. Le Royaume-Uni des Pays-Bas reste extérieur, mais influence fortement son économie.
En 1914, c’est la Crise des Balkans, le Royaume-Uni des Pays-Bas tente une médiation entre l’Autriche et la Serbie. La Première Guerre mondiale éclate malgré tout, mais : Le royaume-Uni des Pays-Bas reste neutre, ses ports deviennent essentiels au commerce mondial, ses banques financent les deux factions.
En 1919,concernant le Traité de paix: L’Allemagne, moins unifiée, est moins durement sanctionnée, Le Royaume-Uni des Pays-Bas sort renforcé comme une puissance neutre et indispensable.
De 1930 à 1940, pendant la Grande Dépression, la prospérité du Royaume-uni des Pays-Bas attire des capitaux et des industries. Hitler existe peut-être, mais il a beaucoup moins de succès : l’Allemagne n’a pas connu la même humiliation, et le « bloc nord-européen » reste un contrepoids économique et diplomatique.
En 1940, Si l’Allemagne nazie émerge malgré tout, l’existence d’un Royaume-Uni des Pays-Bas puissant rend l’invasion de la Belgique et des Pays-Bas beaucoup plus difficile. Possibilité que le royaume forme une coalition préventive avec le Royaume-Uni et la France pour contenir Hitler avant 1939.
Entre 1950 et 2000, dans cette uchronie réaliste, le Royaume-Uni des Pays-Bas devient, un des piliers de l’Union européenne (qu’il aurait probablement contribué à créer plus tôt), mais aussi un modèle de puissance maritime, industrielle et financière et de stabilité.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Lettre fictive d’un commerçant d’Anvers à son frère à Rotterdam en 1831:
« La révolte a été écrasée, les rues de Bruxelles sont calmes. Beaucoup de mes amis craignaient une annexion par la France, mais voilà que nous restons sous le sceptre d’un seul roi. Pour nous autres marchands, c’est une bénédiction : déjà des contrats arrivent de Liège pour nos bateaux. Anvers renaît. »
Extrait fictif du journal de Cologne en 1848:« Alors que Berlin et Vienne brûlent de révolte, La Haye se dresse comme une ville de paix. Le roi Guillaume II a proposé que les princes allemands se réunissent chez lui pour discuter d’une réforme de la Confédération. Qui aurait cru que le trône batave deviendrait le médiateur de l’Allemagne ? »
Rapport fictif d’un diplomate prussien à Berlin en 1856:
« Les banques d’Amsterdam et de Bruxelles financent désormais nos lignes de chemin de fer. C’est une dépendance inquiétante : chaque locomotive qui roule en Prusse le doit à l’or batave. Mais sans cet argent, notre industrie n’avancerait pas. Le roi des Pays-Bas n’a pas d’armée immense, mais il tient l’Allemagne par la bourse. »
Témoignage fictif d’un soldat hanovrien après la guerre austro-prussienne en 1866:
« Nous attendions la guerre totale, mais les Bataves ont parlé. Ils ont dit : pas de conquêtes, pas de pillages, ou plus de crédits. Et comme par magie, les généraux se sont assis autour d’une table. Jamais je n’aurais cru que la paix pouvait sortir des coffres d’Anvers ! »
Editorial fictif dans Le Journal des Débats à Paris en 1871: « La Prusse s’élève, certes, mais son ombre ne recouvre pas toute l’Allemagne. Le Royaume-Uni des Pays-Bas, par son commerce et ses ports, maintient un contrepoids. Bruxelles et Rotterdam pèsent autant que Berlin et Francfort. Voilà qui explique pourquoi nous n’avons pas eu de guerre cette année. »
Témoignage fictif d’une institutrice luxembourgeoise en 1915:
« La guerre fait rage en Europe, mais ici, nous sommes épargnés. Nos élèves voient passer des convois de marchandises vers Rotterdam. Le royaume est neutre, mais tout le monde sait qu’il nourrit les armées des deux camps. Certains disent que notre roi n’est pas seulement souverain, il est aussi banquier du monde. »
Témoignage d’un flamand à Berlin en 1936: « Chez nous, on lit dans les journaux que l’Allemagne sombre dans le nationalisme. Ici, je le vois de mes propres yeux : drapeaux, slogans, discours. Mais un vieil homme à l’auberge m’a dit : ‘Le Führer aboie, mais il ne morde pas tant que les Bataves contrôlent nos finances.’ Peut-être qu’il avait raison. »
Déclaration fictive d’un ministre britannique à la Chambre des communes en 1957: « L’Europe se reconstruit, et nous devons compter avec un acteur incontournable : le Royaume-Uni des Pays-Bas. Sans lui, point de marché commun. Ses ports, ses banques et ses industries sont les artères de notre continent. Il n’a pas fait l’Allemagne, mais il a fait l’Europe. »

2.15) Et si le duc de Nemours était devenu roi de Belgique à la place de Léopold Ier en 1831?
Dans notre réalité le duc de Nemours était le second fils de Louis-philippe Ier d’Orléans a été élu par le Congrès belge le 3 Février 1831 cependant son père a refusé qu’il ne devienne roi. Aussi car le Royaume-Uni surtout mais aussi les grandes puissances refusaient que la Belgique ne tombe dans l’orbite française.
Quelles auraient été les causes qui auraient amenés à ce qu’il ne devienne roi?
En premier lieu, le roi Louis-Philippe aurait promit à Londres la neutralité belge et le maintien de l’ouverture de l’Escaut.
En second lieu, les notables catholiques auraient logiquement préférés un prince français plutôt qu’un protestant allemand(dans le cas où Léopold de Saxe-Cobourg et Gotha avait été élu).
En troisième lieu, concernant le contexte international, les grandes puissances auraient été absorbées par d’autres crises notamment l’Insurrection polonaise dont nous avions déja discutés précédemment et notamment les agitations en Italie.
Dans cette uchronie au mois de Décembre 1830, Louis-Philippe Ier, plus habile ou plus audacieux, aurait accepté que son fils, le duc de Nemours (Louis d’Orléans), soit officiellement candidat. Le congrès belge, majoritairement pro-français, l’élit roi sous le nom de Louis Ier de Belgique.
Face à la menace d’un retour des Pays-Bas ou d’une mainmise autrichienne, la France et la Belgique obtiennent l’appui tacite de la Russie et l’abstention résignée de la Prusse. Le Royaume-Uni proteste mais n’ose pas aller à la guerre, craignant d’isoler son commerce.
En ce qui concerne les conséquences à court terme soit de 1830 à 1850. Tout d’abord, la Francophonie aurait progressée sous Louis 1er au détriment du Flamand surtout dans l’administration. Le royaume belge serait devenu un satellite de la monarchie de Juillet, garantissant au roi Louis-Philippe un prestige européen. La Royal Navy surveille de près la côte belge et aurait accélérée la construction de ports de guerre. Contrairement à la Belgique de notre monde, qui devient un État tampon reconnu par tous, la Belgique-Nemours est perçue comme une extension de la France.
Et concernant les conséquences à long terme les voici:
Lorsque la Révolution de 1848 éclate, Louis-Philippe abdique. Mais à Bruxelles, son fils, roi des Belges, conserve son trône. Cela crée un refuge orléaniste en Europe, un État où la dynastie peut survivre. Après l’instauration de la Deuxième République française, les républicains français voient la Belgique comme une monarchie hostile. Les relations deviennent glaciales, parfois belliqueuse.En cas de guerre franco-prussienne en 1870, la Belgique liée dynastiquement à la France, est entraînée dans le conflit. La Confédération de l’Allemagne du Nord justifie plus facilement l’invasion du territoire belge. Et concernant L’histoire coloniale, celle-ci change radicalement. Soit la Belgique ne fonde pas d’empire colonial, soit celui-ci est lié directement à l’expansion française.
La monarchie orléaniste belge aurait pu choisir l’ouverture de l’Escaut et sa neutralité commerciale et concernant la neutralité de la Belgique, les puissances présentes à la Conférence de Londres entérinent du bout des lèvres une neutralité “qualifiée” (moins absolue qu’en histoire réelle) en échange d’engagements belges sur les fortifications et la non-cession de ports à la France mais aussi le Royaume- Uni aurait exigé aucune bases françaises en Flandre.
Dans ce scénario nous avons une Charte qui est inspirée de celle de 1830 en France en plus de garanties belges concernant les libertés communales et confessionnelles. Il y aurait pu aussi avoir des clauses limitant l’aide militaire française directe mais avec aussi des inspections portuaires et un plafond d’effectifs pour les places fortes de l’Escaut et de la côte.
Concernant les effets à court terme sur la société belge il y aurait pu avoir entre 1830 et 1850 une réorganisation de l’armée avec des officiers français mais avec des conseillers et instructeurs prussiens tolérés pour un gage d’équilibre).
Concernant la religion catholique et le gouvernement belge il aurait pu y avoir un compromis catholique et orléaniste avec une influence épiscopale élevée sur l’éducation avec en contrepartie un ordre public stable.
Concernant l’économie nous aurions pu avoir un triangle économique Anvers-Bruxelles-Liège qui aurait surperformé grâce au marché français avec le textile, la métallurgie et les rails mais il y aurait eu une dépendance commerciale accrue vis-à-vis de Paris.
Les relations avec les Pays-Bas auraient pu s’aggraver avec des négociations longues des frontières et des dettes du Royaume-Uni des Pays-Bas avec quelques incidents sporadiques qui auraient pu se déclarer à la frontière du Limbourg et du Luxembourg.
Concernant l’armée il y aurait pu avoir une coopération militaire avec des plans de fortifications compatibles et une standardisation de l’armement avec une diplomatie alignée certes mais pas fusionnée.
Il y aurait pu avoir une Assurance-vie maritime via Londres ce qui aurait voulu dire avec un engagement contractuel de libre passage à Anvers et Ostende avec des visites navales britanniques régulières comme des “garanties flottantes”.
Concernant les relations avec la Prusse, elles sont des relations de bon voisinage avec des accords ferroviaires notamment avec des corridors vers la Ruhr pour réduire l’hostilité prussienne.
Concernant la chute de la Monarchie de Juillet, la Belgique aurait pu tentée de se rapprocher tactiquement du Royaume-Uni pour préserver la neutralité commerciale et pour éviter l’isolement diplomatique.
Concernant les années 1850-1870 il est possible que des réseaux ferrés et portuaires auraient été boostés pour servir de hub nord-européen entre la Manche et le Rhin.
Concernant la sécurité du territoire belge il y aurait pu avoir une doctrine appelée “ceinture d’Anvers” qui consisterait d’une force mobile légère pensée pour gagner du temps diplomatique en cas d’agression prussienne.
Concernant la guerre franco-prussienne quels sont les scénarios possibles?
Concernant le scénario 1 et qui est le plus probable, Berlin considère Bruxelles comme un appendice stratégique de la France les prussiens auraient tentés une opération éclair visant Liège et les lignes vers Paris. Le Royaume-Uni, voyant la neutralité trahie de fait depuis 1831, intervient diplomatiquement mais évite l’engrenage militaire direct.
Concernant le scénario 2, il aurait pu y avoir une dissuasion navale britannique et en plus de garanties belges de non-intervention active en faveur de Paris ; la Belgique reste armée mais neutre , subissant tout de même l’occupation temporaire de zones frontalières.
Dans tous les cas, les villes d’Anvers et de Liège deviennent des objectifs militaires précoces, augmentant les destructions et les coûts de reconstruction.
Concernant l’époque coloniale, la Belgique aurait pu participée belge au capital et à l’administration des colonies françaises notamment avec des banques et des ingénieurs liégeois.
La Belgique aurait pu avoir des comptoirs commerciaux en Afrique de l’Ouest et en Indochine via des concessions économiques mais sans souveraineté directe.
Concernant la Finance la place de Bruxelles devient un pont de capitaux entre Londres, Paris et le Rhin, mais demeure exposée aux cycles politiques français de 1848 et 1870.
L’on aurait remarqué des conflits plus profonds que cela soit entre les élites bruxelloises et wallonnes plutôt pro-France et les bourgeoisies portuaires et industrielles flamandes pro-britanniques pour protéger l’accès aux marchés.
Concernant la période de 1880 et 1914 il est possible que des fortifications aurent été construites dans la Province d’Anvers mais aussi aux abords de la Meuse renforcées plus tôt et selon des standards franco-belges avec des coûts budgétaires élevés mais avec des transferts technologiques notamment concernant l’artillerie et l’acier.Il y aurait pu aussi y avoir des dialogues avec Berlin concernant les corridors industriels.
Concernant la 1ère guerre mondiale alternative, la violation du territoire belge par l’Allemagne devient presque certaine dès les plans initiaux car la neutralité de la Belgique est moins crédible), ce qui précipite l’entrée britannique et même peut-être encore plus rapide que dans notre histoire.
Concernant le scénario en 1831 en plus du Traité de neutralité « limitée » la Belgique aurait pu être démilitarisée en Flandre-Zélandaise.
Concernant les institutions celles-ci sont plus alignée sur les codes politiques parisiens avec un cercle orléaniste et un culte de la respectabilité bourgeoise.
La Belgique est moins intégrée aux marchés Néerlandais et hanséatiques.
Concernant l’économie il y aurait pu y avoir une orientation Sud–Ouest avec des corridors entre Charleroi, Maubeuge et Paris mais aussi entre Anvers et Lille plutôt que entre Rotterdam et l’Allemagne du Nord.
Londres obtient un veto politique informel sur toute base navale française à Anvers.
Entre la France et la Belgique, il y aurait aussi pu y avoir une union douanière mais incomplète pour ne pas énerver Londres. Des conventions postales auraient pu être signées entre la France et la Belgique.
Concernant la Prusse, elle conserve une vigilance accrue sur le Rhin avec des fortifications modernisées à Coblence et à Cologne.
Concernant l’Autriche elle est trop préoccupée par ses guerres en Italie.
Une guerre des infrastructure est déclarée entre Rotterdam et Anvers.
Concernant la guerre de Crimée de 1853 à 1856 Bruxelles aurait pu soutenir discrètement l’Axe anglo-français sans engagement militaire et elle aurait capitalisée sur les contrats logistiques.
D’autres scénarios concernant la guerre franco-allemande sont possibles d’un côtét, la neutralité belge est strictement respectée grâce à un traité multilatéral renforcé. Le territoire n’est pas envahi et Bruxelles devient une place de médiation. D’un autre côté avec une provocation ou une imprudence diplomatique amènerait à une violation prussienne de la neutralité, en partie justifiée par la proximité dynastique avec la France et cela donnerait à la fin une occupation limitée de l’est du pays avec un choc durable dans l’opinion. Si la guerre aurait été combattue avec la France, la Belgique aurait quand même tout comme la France subit une terrible défaite.
Concernant l’industrie celle-ci se développe très fortement en Wallonie cependant en Flandre l’industrie textile se diversifie plus tardivement.
Voici les témoignages alternatifs que j’ai imaginé pour cette Belgique:
Journal fictif d’un député belge en Décembre 1830:« Aujourd’hui, le jeune duc de Nemours est désormais Louis Ier, roi des Belges. Les Anglais fulminent, mais l’enthousiasme des Bruxellois balaie leurs protestations. Les drapeaux tricolores se mêlent à nos couleurs nationales. Nous croyons avoir trouvé l’équilibre : un prince français, mais une Belgique libre. Que Dieu nous garde d’un retour des Hollandais. »
Une Correspondance fictive d’un diplomate britannique à Londres en Février 1831:« La nomination du duc de Nemours est un coup de maître de Louis-Philippe. Nous sommes contraints de tolérer cet état de fait, faute d’alliés disponibles pour soutenir La Haye. Toutefois, je recommande que Sa Majesté s’assure du contrôle d’Anvers et de l’Escaut. Sans cela, la France tiendrait la clef du commerce du Nord. »
Témoignage fictif d’un ouvrier flamand en 1847: »« Au bureau communal, on me rit au nez quand je parle en Flamand. Le roi est Français, les ministres parlent Français, et nous, nous devons payer nos impôts sans comprendre nos papiers. À Gand, des sociétés s’organisent pour réclamer nos droits. On dit que même à Anvers, on en parle. »
Discours fictif du roi Louis Ier aux Chambres belges en mars 1848:
« La tempête républicaine secoue l’Europe, et même mon père a dû quitter son trône en France. Mais ici, en Belgique, je resterai fidèle à notre Constitution. Je ne suis ni roi de France, ni roi par la grâce de la baïonnette, mais roi des Belges par le vote de cette Assemblée. Je défendrai vos libertés contre tout excès, qu’il vienne du despotisme ou de l’anarchie. »
Article de presse français fictif du journal le Siècle de juillet 1870:
« Bruxelles s’agite. Le roi Louis Ier, parent de nos Orléans, proclame la neutralité de son royaume tandis que l’Empire affronte la Prusse. Déjà, les Prussiens insinuent que cette neutralité n’est qu’un masque, que la Belgique cache dans ses arsenaux des armes françaises. Pauvre royaume : il sera bientôt obligé de choisir entre ses alliés et sa survie. »
Lettre fictive d’un bourgeois bruxellois après Sedan en septembre 1870:
« Les troupes prussiennes campent à Liège. Elles jurent ne pas vouloir occuper Bruxelles, mais tout le monde tremble. Les cafés bruissent de rumeurs : certains réclament qu’on arme la garde civique, d’autres qu’on se tienne à l’écart. Le roi garde le silence. La France s’écroule, et nous avec elle nous risquons d’être entraînés dans l’abîme. »
Extrait fictif d’un manuel scolaire belge de 1900:« Le roi Louis Ier, monté sur le trône en 1830, sut préserver l’indépendance de la Belgique malgré les tempêtes. Son origine française lui valut d’abord la méfiance de l’Angleterre et de la Prusse. Mais il incarna bientôt un principe supérieur : celui d’une monarchie constitutionnelle ferme et modérée, capable de contenir les passions. Il transmit à son fils un royaume respecté et prospère. »

2.16) Et si L’archiduc Charles Louis-d’Autriche était devenu roi de Belgique en 1831?
Dans notre réalité au Congrès de Belgique il n’a récolté que très peu de voix cependant quels éléments auraient pu faire pencher la balance en sa faveur?
Dans cette uchronie l’archiduc bénéficie d’un retournement diplomatique. L’Autriche, inquiète de l’agitation en Italie et en Allemagne, pousse activement sa candidature. Londres, craignant une trop forte influence française si un prince orléaniste accède au trône, finit par considérer l’option autrichienne comme un moindre mal. Le Congrès national, partagé entre conservateurs catholiques et libéraux, choisit l’homme réputé modéré et expérimenté : Charles Ier, roi des Belges.
Les autres raisons qui auraient pu amener à ce qu’il se fasse élire sont les suivantes:
D’abord, il fut vainqueur de plusieurs batailles contre Napoléon, Charles jouit d’une grande réputation de stratège, ce qui rassure les Belges face à la menace néerlandaise.
Mais aussi, il fut considéré comme moins autoritaire que Metternich, il avait une réputation de libéral modéré dans l’Empire.
Il n’était ni français, ni anglais, ni hollandais, ni prussien, il représente une figure « neutre » que les grandes puissances auraient pu tolérer pour éviter une domination trop directe d’un seul camp.
Finalement, les élites belges catholiques voient en lui un prince d’une grande maison catholique, ce qui flatte le clergé belge, très influent.
Maintenant quelles sont les conséquences à court et à long terme?
Entre 1830 et 1840 l’on remarque que:
Sous Charles Ier, le pays aurait adopté une monarchie plus proche du modèle autrichien, avec un équilibre favorable aux catholiques, moins libérale qu’avec Léopold Ier.
La Belgique, au lieu de devenir « une protégée de Londres », se serait retrouvée plus dans l’orbite de Vienne.
Louis-Philippe aurait vu d’un mauvais œil un Habsbourg sur le trône de Belgique, ce qui aurait ravivé les rivalités franco-autrichiennes.
Charles Ier accepte la Constitution belge de 1831, mais encourage une lecture plus conservatrice.
Les libéraux, frustrés, restent dans l’opposition et s’inspirent des mouvements révolutionnaires européens.
L’Autriche protège le jeune royaume, ce qui stabilise ses frontières face aux Pays-Bas.
Mais la Belgique devient un pion du système metternichien : un État tampon certes, mais désormais ancré dans le camp conservateur.
Les Britanniques se méfient : au lieu d’être la « Belgique anglaise » de Léopold Ier, le pays devient une Belgique autrichienne, ce qui limite les investissements britanniques dans l’industrie wallonne.
La Belgique développe moins de liens avec la City de Londres et se dirige vers plus de rapprochement avec les marchés germaniques.
Le port d’Anvers se développe moins comme débouché britannique, davantage comme relais commercial vers la vallée du Rhin.
Concernant la période entre 1840 et 1870:
La Belgique aurait sans doute intégré plus fortement la sphère économique allemande et autrichienne, devenant une interface entre le Zollverein (union douanière allemande) et l’Europe de l’Ouest.
Les Habsbourg ayant déjà une tradition multilingue et multiethnique, la question flamande aurait pu être traitée plus tôt et différemment.
Avec un roi autrichien, Bruxelles aurait été entraînée dans la grande vague révolutionnaire, avec un risque de soulèvements plus violents et peut-être une tentative de rattachement à la France républicaine.
Concernant la révolution de 1848:
En Belgique, les libéraux et les ouvriers flamands et wallons se soulèvent, inspirés par Paris.
Charles Ier, fidèle à l’Autriche, réprime durement les révoltes. Résultat :
Les libéraux belges s’exilent en France ou en Angleterre.
La Belgique acquiert la réputation d’un État traditionaliste en Europe occidentale, au même titre que l’Autriche elle-même.
Le compromis « catholiques-libéraux » qui a marqué l’histoire réelle de la Belgique n’émerge pas.
Concernant la période entre 1870 et 1914:
En cas de guerre franco-prussienne, une Belgique gouvernée par un Habsbourg aurait probablement penché vers l’Autriche et l’Allemagne, plutôt que de rester neutre comme sous Léopold II. Cela aurait pu changer le sort de la France.
Concernant l’unification allemande dans la réalité, Léopold Ier avait maintenu la neutralité belge, protégée par Londres.
Ici, la situation est différente :
La Belgique est gouvernée par un Habsbourg, donc proche de Vienne.
Lors de la guerre austro-prussienne en 1866, Bruxelles soutient discrètement l’Autriche contre Bismarck.
Après la victoire prussienne, la Belgique se retrouve isolée diplomatiquement, perçue comme un vestige du camp des vaincus.
Les conséquences auraient été les suivantes:
La Belgique n’est pas intégrée au Zollverein dominé par Berlin, ce qui limite ses échanges commerciaux.
La Prusse tout comme la France envisagent toutes deux la Belgique comme une zone d’influence à absorber.
Dans l’uchronie, Charles Ier (très âgé, son fils ou un successeur Habsbourg lui a sans doute succédé) est tenté de soutenir l’Autriche et la France contre la Prusse.
Les conséquences possibles sont:
La Belgique devient un champ de bataille lors de la guerre franco-prussienne.
Prussiens et Français violent son territoire, annulant de fait la neutralité belge.
À l’issue de la victoire allemande, la Belgique tombe dans l’orbite de Berlin, beaucoup plus qu’à Vienne.
Concernant le reste du XIXème siècle:
Léopold II ne serait jamais monté sur le trône. L’empire colonial belge n’aurait probablement pas existé ; le Congo aurait pu tomber sous domination française, britannique ou portugaise. Le Congo aurait été le plus propablement annexé soit par La France qui souhaitait une extension de l’Afrique équatoriale française, où l’Angleterre pour relier l’Afrique australe à l’Égypte.
La Belgique privée de ressources coloniales, reste riche par son industrie charbonnière et sidérurgique, mais dépendante des marchés extérieurs dominés par Berlin.
Au XXe siècle, la Belgique aurait été beaucoup moins attachée au Royaume-Uni, et plus liée aux destins des Empires centraux. Peut-être même intégrée à une confédération germanique élargie.
Concernant la première guerre mondiale
En 1914, la Belgique n’aurait probablement pas été l’innocente victime de l’invasion allemande, mais plutôt un allié (ou vassal) de Berlin, changeant radicalement la dynamique de la Première Guerre mondiale.
Militairement, elle a signé des accords défensifs avec l’Empire allemand et l’Autriche-Hongrie.
Dans notre réalité, l’Allemagne envahit la Belgique pour contourner les défenses françaises (plan Schlieffen).
Ici, ce détour n’est plus une violation, mais une coopération militaire :
L’armée belge (environ 200 000 hommes mobilisables) combat aux côtés des Allemands et les forteresses de Liège et de Namur, au lieu de retarder l’avance allemande, servent de bases logistiques.
Les ports belges (Anvers, Ostende) deviennent accessibles à la flotte allemande, ce qui menace directement les lignes maritimes britanniques dans la Manche et la mer du Nord.
Sans la résistance belge, l’armée allemande atteint Paris plus vite.
Dans notre monde, l’« invasion barbare de la Belgique » a été un puissant moteur de propagande en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Ici, cet argument disparaît.
Historiquement, Londres déclare la guerre après la violation de la neutralité belge. Si cette neutralité n’existe pas, l’entrée en guerre britannique aurait pu être retardée, ou limitée à un engagement naval.
La Belgique devient une zone de concentration des troupes allemandes, permettant une logistique fluide entre la Ruhr et le front français.
Le littoral belge notamment Zeebruges et Ostende est utilisé par la marine impériale allemande et par les sous-marins U-Boote. Cela rend la guerre sous-marine contre la Grande-Bretagne beaucoup plus efficace et proche.
La France se retrouve attaquée non seulement par l’est, mais aussi par le nord-ouest sans obstacle majeur
Concernant les conséquences géopolitiques au niveau international:
L’absence du « viol de la Belgique » réduit l’indignation américaine. L’entrée en guerre des États-Unis pourrait être retardée de plusieurs années, voire ne pas se produire.
Voir la Belgique aux côtés de l’Allemagne renforce l’image d’un bloc germano-catholique. Rome hésite encore plus à rejoindre l’Entente.
La situation à l’Ouest étant plus favorable aux Allemands, Berlin peut dégager plus de troupes contre l’armée russe, ce qui accélère la défaite russe.
L’Allemagne, profitant du soutien belge, gagne rapidement des positions clés en France.
Si Paris tombe dès 1914 ou 1915, la France pourrait demander un armistice, laissant l’Angleterre seule.
L’Europe aurait pu connaître une victoire rapide des Empires centraux.
Concernant la fin de la guerre:
La France aurait vu le Nord-Pas-de-Calais lui être confisquée, une région qui est riche en charbon.
La Belgique aurait été récompensée par Berlin :
Notamment d’une annexion éventuelle du Luxembourg et du Limbourg Néerlandais par les pressions allemandes.
L’Allemagne aurait pu céder une partie de l’Afrique (par exemple le Congo français ou l’Afrique équatoriale) en compensation de son absence d’empire.
L’Europe de l’Ouest serait dominée par un bloc germano-belgo-autrichien, réduisant la France à une puissance secondaire.
La Grande-Bretagne, affaiblie, se replie sur son empire maritimeelle, elle signe une paix séparée, gardant son empire colonial mais en échange d’une neutralité stricte en Europe.
Concernant la Russie celle-ci s’est effondrée par la révolution de 1917 comme dans notre réalité avec le traité de Brest-Litovsk, donnant aux Empires centraux un immense glacis à l’est.
Durant les années 1920 et 1930:
La Belgique devient la façade maritime de l’Empire allemand, son rôle stratégique dépasse largement son poids démographique.
Bruxelles, Liège et Anvers sont pleinement intégrés dans la Mitteleuropa allemande(la zone économique allemande)
La Belgique administre un empire africain mais sous supervision de Berlin.
Il y aurait eu Moins d’influence anglo-saxonne notamment du jazz et du cinéma américain.
L’Europe aurait été plus germanophone et catholique et conservatrice.
Le mouvement flamand aurait reçu un appui direct de Berlin, ce qui aurait affaibli la domination francophone en Belgique.
Concernant la présence du Nazisme dans cette histoire alternative,celui-ci n’a pas de place dans l’Allemagne impériale car dans notre réalité, le nazisme naît du traumatisme de la défaite de 1918. Ici, l’Allemagne est victorieuse et donc il n’y a pas de sentiment de revanche, pas d’hyperinflation et donc pas de Hitler.
À la place du Nazisme nous aurions eu:
Une hégémonie allemande impériale, autoritaire mais pas nécessairement fasciste.
Dans cette histoire alternative, la question juive ne prend pas la même ampleur. Dans cette uchronie, il n’y aurait pas eu de Shoah, mais sans doute une assimilation forcée dans un empire nationaliste allemand.
Il n’y aurait pas eu de Seconde guerre mondiale car:
Sans Hitler il n’y a pas de guerre totale en 1939.
Les tensions mondiales se seraient déplacées vers :
Des Conflits coloniaux en Afrique entre les Empires centraux et les puissances anglo-saxonnes.
Rivalité croissante avec les États-Unis qui sont devenus la première puissance industrielle mais freinés par un continent européen unifié sous domination allemande.
L’URSS, affaiblie, reste un adversaire potentiel, mais encerclée.
Sans la Seconde guerre mondiale, il n’y aurait pas eu de plan Marshall et donc pas d’ONU.
Le monde se structure autour de deux pôles :
Le Bloc germano-européen avec l’Allemagne, l’Autriche la Belgique, les satellites d’Europe centrale et des Balkans et les colonies africaines partagées.
Bloc anglo-américain qui aurait regroupé le Royaume-Uni les États-Unis, , le Dominion du Canada et l’Empire britannique.
La Belgique, grâce à son port d’Anvers et son empire africain, devient un carrefour commercial impérial.
Concernant la fin du scénario de la période entre 1950 et 2000:
Sans la Seconde Guerre mondiale il n’y aurait pas eu de décolonisation accélérée. Les colonies belges et allemandes restent sous domination européenne jusqu’aux années 1970-1980, avec des indépendances tardives et encadrées.
Il n’y aurait pas eu de construction européenne, puisque l’Europe est déjà unifiée sous la domination allemande.
Ce n’est plus Washington contre Moscou, mais Washington contre Berlin. L’Europe et l’Afrique deviennent les champs principaux de rivalité.
L’espace et le nucléaire sont dominés par les États-Unis et l’Allemagne. Bruxelles est le siège d’une monarchie habsbourgeoise fidèle à Berlin, qui devient une sorte de capitale secondaire de l’Empire européen.
Concernant les témoignages fictifs de cette uchronie:
Discours fictif en 1831 d’un congressiste catholique à Bruxelles:« Messieurs, en choisissant Son Altesse l’archiduc Charles de Teschen, nous donnons au peuple belge plus qu’un roi : nous lui donnons une maison, une tradition, une protection. Il est catholique, il est prince de l’ordre ancien, il n’est ni Français ni Hollandais, il ne sera l’instrument d’aucune puissance étrangère. Par lui, Bruxelles ne sera jamais Paris, mais elle pourra être une Vienne de l’Ouest. »
Lettre fictive d’un officier belge sur le front en 1914, adressée à sa famille depuis Paris occupé par les troupes germano-belges:« Chère mère,
Nous avons franchi la frontière française sans tirer sur des paysans comme nos ancêtres avaient dû le faire jadis contre les Hollandais. Ici, les gens nous regardent avec haine, car nous sommes venus aux côtés des Allemands. Mais je me sens fier : enfin la Belgique n’est pas une victime, mais une force. Nos drapeaux flottent à côté de ceux de Berlin sur la place de l’Hôtel de Ville de Paris. On nous dit que la guerre sera courte. Peut-être qu’un jour nos enfants apprendront que nous avons changé le cours de l’Histoire. »
Témoignage fictif d’un ingénieur colonial belge au Congo français devenu belge en 1935:« Les Allemands nous ont aidés à organiser les lignes ferroviaires. Ici, au Congo, on parle le flamand et le français dans les administrations, et l’allemand dans les bureaux des compagnies. Les ouvriers africains disent que nous sommes moins durs que les colons français, mais plus exigeants. Nous construisons des ponts et des barrages, et tout cela ne servirait à rien sans Anvers, qui reçoit chaque semaine des navires pleins de cuivre, de caoutchouc et d’huile de palme. »
Journal fictif d’un étudiant belge lors d’une manifestation en 1962:« Nous étions des centaines sur la place de la Monnaie, criant “Liberté pour le Parlement !”. La police est arrivée en camions, mais pas de violence brutale. Ils ont dispersé la foule, et les journaux du lendemain n’ont publié qu’un petit encadré : “Agitation d’étudiants sans gravité”. Ici, tout est comme ça : l’ordre continental veille. On nous laisse parler, mais jamais trop fort. J’admire nos ports, nos trains, la richesse qui circule. Mais parfois, je rêve d’un pays moins riche et plus libre. »
Témoignage fictif d’un journaliste africain dans un “État associé” en 1991:« Nous ne sommes plus une colonie, mais nous ne sommes pas non plus vraiment indépendants. Les Belges contrôlent nos mines, les Allemands fixent les prix. En échange, nous avons des hôpitaux, des écoles, et certains de nos enfants partent étudier à Bruxelles ou à Berlin. Beaucoup reviennent avec un bon poste. Mais la jeunesse veut plus : elle veut être maîtresse de ses richesses. Certains disent que l’association est une chaîne dorée. »
Entretien fictif avec un docker d’Anvers:
« Mon grand-père chargeait du caoutchouc venu du Congo, mon père des barres d’acier pour la Ruhr. Moi, je supervise des conteneurs pleins de batteries à hydrogène et de pièces pour satellites. Anvers, c’est le cœur battant de l’Europe continentale. Mais il y a des moments où je me demande : est-ce que nous sommes belges, ou juste des maillons du grand système allemand ? Quand je vais à Bruxelles, je vois toujours le drapeau habsbourgeois flotter, et je me dis que l’histoire nous a fait riches, mais pas libres. »

2.17) Et si la Principauté ecclésiastique de Liège avait été rétablie après l’Indépendance de la Belgique?
Cette uchronie est très difficile à rendre crédible car le Congrès de Vienne en 1815 avait réorganisé l’Europe pour réduire l’influence des États ecclésiastiques, le Saint-Empire était dissous, et l’idée de principautés dirigées par des évêques paraissait obsolète. Les élites liégeoises avaient été très marquées par la Révolution liégeoise en 1789 qui fut parallèle à la Révolution française. Elles avaient massivement rejeté la domination princière et cléricale. Les grandes puissances voulaient un État belge moderne, constitutionnel, un tampon entre France et Prusse. Un retour d’un État ecclésiastique aurait semblé réactionnaire et instable.
Ce scénario est très improbable cependant je vais tenté de le rendre crédible. Lors du Congrès national de 1830 à 1831, certains congressistes ultramontains (très catholiques) proposent de rendre à Liège son indépendance.L’Autriche et le Saint-Siège soutiennent l’idée, afin de recréer un Etat tampon catholique, fidèle à Rome et opposé à l’influence libérale et maçonnique de Bruxelles. On aurait eu alors une Belgique réduite avec Bruxelles, le Brabant et la Flandre)
Les conséquences immédiates auraient été les suivantes, Liège devient une sorte de “Vatican du Nord”, avec un prince-évêque choisi par Rome et confirmé par les puissances catholiques. Bruxelles et Liège deviennent rivales : Bruxelles dominée par les libéraux et constitutionnels et Liège devient un bastion de l’ultramontanisme. Le mouvement ouvrier naissant en Wallonie serait encore plus explosif : Liège est déjà un centre industriel au XIXᵉ siècle et une principauté ecclésiastique conservatrice face à un prolétariat radical risque de créer une instabilité permanente. La France verrait d’un très mauvais œil un État ecclésiastique si proche de ses frontières. La Prusse pourrait au contraire soutenir ce bastion catholique comme contrepoids face au libéralisme belge et français.
Concernant le long terme il y aurait pu se passer ces événements suivants. En 1848, la principauté de Liège aurait probablement été balayée par les révolutions démocratiques, à moins d’une répression austro-prussienne. En 1914, l’Allemagne pourrait utiliser la principauté comme une alliée religieuse, un peu comme les protectorats en Pologne. En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, il est très peu probable qu’un État ecclésiastique survive dans une Europe démocratisée. On aurait probablement intégrée Liège à la Belgique moderne, ou au contraire laissé émerger une République liégeoise.
Concernant le 1er prince évêque de cette restauration de la Principauté de Liège même si le dernier prince-évêque était François de Méan et il fut dans notre réalité le 1er primat de Belgique avant de mourir en 1831. Néanmoins il n’aurait pas pu devenir Prince-évêque en 1830 car Il est né en 1756, il avait 74 ans en 1830, donc déjà très âgé pour l’époque. Depuis 1809, il était archevêque de Malines, en 1817, il devint aussi cardinal. En 1830, il était déjà installé dans un rôle prestigieux et romain, sans réel intérêt à reprendre une petite principauté épiscopale en pleine industrialisation turbulente.
La restauration d’un État ecclésiastique indépendant en 1830 aurait demandé un consensus diplomatique. Or, les grandes puissances ne voulaient pas de résurrection de mini-États ecclésiastiques ils avaient disparus presque partout après 1803 dans le Saint-empire. François de Méan était un homme de compromis avec l’ordre établi : il avait survécu à la Révolution, à l’Empire, au Royaume-Uni des Pays-Bas. Il n’était pas un « contre-révolutionnaire intransigeant » comme certains ultramontains. Revenir comme prince-évêque aurait signifié défier la logique politique européenne et donc c’était trop risqué. En tant que cardinal et archevêque, il avait une stature internationale au service du pape. Rome aurait probablement préféré placer un évêque plus jeune, plus docile, plus militant ultramontain pour incarner une principauté restaurée.
Par exemple, son successeur spirituel Van Bommel correspondait bien mieux au profil d’un prince-évêque de restauration.
Et comme je vous l’avais dit François de Méan est mort le 15 janvier 1831… c’est à dire en plein Congrès national belge.
Même si on avait voulu le restaurer, il n’aurait pas eu le temps d’exercer le pouvoir plus de quelques mois.
Bref en 1830, le siège épiscopal de Liège était occupé par Cornelius Richard Antoine van Bommel qui a vécu de 1790 à 1852 et qui fut évêque de Liège, et il fut nommé en 1829
Il était d’origine néerlandaise, ultramontain et très conservateur.
Il était très critique du libéralisme et était aussi partisan d’une forte influence de l’Église dans la société.
Il avait un vrai poids politique et une aura de « chef spirituel » au moment de la Révolution belge.
Il aurait incarné un retour à l’ordre ancien, mais dans un monde en pleine industrialisation liégeoise, c’était un contraste très fort.
Concernant la situation en 1945 elle aurait été la suivante:
Elle aurait probablement résisté grâce au soutien autrichien,prussien et allemand(après la réunification)
Elle aurait été un État-croupion clérical coincé entre une Belgique libérale et une France laïque.
En 1940, elle aurait été occupée par les Allemands, mais probablement maintenue comme un État satellite confessionnel pour des raisons de propagande comme la Slovaquie de Tiso.
En réalité, l’évêque de Liège en 1941–1945 était Louis-Joseph Kerkhofs, évêque de Liège de 1927 à 1961. Conservateur, proche de Rome, mais pas collaborationniste. Très actif dans la défense sociale catholique.
Dans ce scénario, Kerkhofs serait certainement devenu le dernier prince-évêque de Liège, de 1927 à 1945.
En 1945, à la Libération, la principauté aurait probablement été abolie par les Alliés, qui n’auraient toléré aucun État ecclésiastique survivant à l’ordre nouveau.
Kerkhofs aurait alors été relégué à une fonction purement spirituelle bref un simple évêque dans une Belgique réunifiée.
Voici des témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Une Séance fictive du 12 décembre 1830 à Bruxelles au Palais de la Nation
Un député catholique de Liège :
« Messieurs, la Providence nous offre une solution toute simple. Pourquoi chercher ailleurs un souverain pour Liège, quand la Cité a déjà son prince légitime ? Je parle de Son Éminence François-Antoine-Marie de Méan, dernier prince-évêque avant l’usurpation révolutionnaire, aujourd’hui cardinal, archevêque de Malines, primat de Belgique !
Sa piété est reconnue dans toute la chrétienté, son autorité morale est sans égale, et son sang liégeois l’enracine dans notre peuple. En le rappelant sur le trône de Saint-Lambert, nous donnerons à l’Europe le signe d’un retour à l’ordre, à la foi, à la tradition. »
Un député libéral de Bruxelles (interrompant) :
« Messieurs, permettez ! Le cardinal de Méan est certes un homme de grande dignité, mais il a 74 ans, et sa santé est fragile. Le monde industriel qui naît à Liège a-t-il besoin d’un prélat vieilli dans les intrigues de l’Ancien Régime ? Son Éminence réside à Malines, il gouverne déjà l’archevêché. Croyez-vous qu’il abandonnera son siège cardinalice pour se replonger dans les querelles liégeoises ? »
Un autre député catholique, proche de Rome :
« L’orateur de Bruxelles parle vrai : Son Éminence est affaibli, et l’Europe n’attend pas de nous des reliques, mais des garanties. Le Saint-Siège lui-même préférerait un pasteur plus vigoureux. Nous avons parmi nous un évêque jeune, énergique, plein de zèle pour l’ordre chrétien : Monseigneur Cornelius van Bommel. Ne serait-ce pas là le choix naturel pour un nouveau prince-évêque ? »
Un murmure s’élève dans l’assemblée :
« De Méan, trop vieux !… Van Bommel, un nouveau Saint-Lambert !… «
Un discours fictif d’un bourgeois liégeois en 1831:
« Les congressistes ont voté le retour de notre principauté. Je n’ose dire ce que j’en pense… Car enfin, voilà qu’on nous remet un prince-évêque, Van Bommel, comme si nous vivions encore au temps de nos grands-pères ! Certains crient victoire pour l’Église, d’autres grommellent dans les cafés. Mais dans les ateliers, les ouvriers grondent : ils ne veulent pas d’un prélat qui leur impose ses lois. »
Un témoignage fictif d’un ouvrier métallurgiste de Seraing en 1848:« On nous dit que le prince-évêque prie pour notre salut, mais moi je voudrais du pain et moins d’heures à l’usine. Les gardes du chapitre ont arrêté deux de mes camarades qui parlaient de République. On dit qu’à Bruxelles, les journaux écrivent librement. Ici, c’est le silence ou la prison. Mais je sens que ça ne durera pas… »
Un témoignage d’un fonctionnaire prussien observant Liège en 1871 (après Sedan):« Cet État minuscule nous amuse : un îlot clérical au cœur d’une Europe industrielle. Mais il sert nos intérêts : tant que les prêtres gouvernent Liège, il n’y aura pas de République française à nos portes. Les ouvriers y bouillonnent, mais la gendarmerie ecclésiastique les tient. Berlin surveille, Rome bénit, et Bruxelles tolère. C’est un curieux équilibre. »
Témoignage fictif d’un étudiant socialiste liégeois en 1913:
« Nous vivons dans une cage dorée. Les prêtres construisent des écoles, des hôpitaux, mais interdisent nos journaux. Quand je vais à Bruxelles, je vois des meetings libres ; ici, si j’ouvre la bouche, je risque l’exil. Nous ne voulons pas d’un trône d’autel au XXᵉ siècle. Le monde avance, mais Liège reste un musée vivant à l’époque médiévale. »
Un témoignage fictif d’un journaliste américain en 1944 durant la campagne de libération:« Les G.I.s découvrent une bizarrerie d’Europe : un État gouverné par un évêque ! Les soldats rient : “Vatican number two !” disent-ils. Mais derrière les dorures et les processions, j’ai vu la peur : celle d’un peuple tenu par le clergé dans un carcan anachronique. Beaucoup de Liégeois espèrent que, quand les Alliés auront chassé les Allemands, cette principauté tombera enfin, et qu’ils rejoindront la Belgique moderne. »
Témoignage fictif d’une vieille liégeoise en 1950, après la fin de la principauté
« J’ai connu deux mondes : celui des processions, des cloches et des censures, et celui de la liberté nouvelle. Quand les Alliés ont aboli la principauté en 1945, j’ai pleuré, car c’était tout ce que j’avais connu. Mais aujourd’hui, je comprends mes petits-enfants : ils disent que nous vivions dans une cage, une belle cage, mais une cage quand même. »


2.18) Et si la Principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy avait été rétablie après la Révolution belge?
Historiquement, en 1794 la Principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy a disparu, annexée par la France. Puis, après 1815, le Congrès de Vienne a attribué Stavelot et Malmedy au Royaume uni des Pays-Bas, et enfin en 1830 elle passa à la Belgique.
Mais comment aurait pu être rétablie cette principauté?
Lors de la reconnaissance de la Belgique par les grandes puissances, on aurait pu décider de recréer certains petits États ecclésiastiques ou principautés comme tampon entre la Belgique et la Prusse, un peu comme on a recréé le Luxembourg avec un statut particulier.
Dans une Belgique très catholique, l’idée de restaurer une principauté ecclésiastique, symbole de l’Ancien Régime, aurait pu séduire une partie du clergé ou des conservateurs.
Le Congrès de Vienne avait déjà ressuscité des petits États ou des constructions hybrides. Dans une uchronie, Stavelot-Malmedy aurait pu suivre le même destin que le Luxembourg, restant distinct du nouvel État belge.
Si les habitants de Stavelot et Malmedy avaient exprimé une identité particulière (comme ce fut le cas au Luxembourg), cela aurait pu renforcer l’idée d’un statut autonome.
Mais ce scénario est difficile à mettre en place car:
La petite taille du territoire (quelques centaines de km²) est trop exigu pour devenir un État viable à long terme.
Le fait que l’abbaye princière avait perdu beaucoup d’autorité dès le XVIIIᵉ siècle, et qu’il n’y avait plus de véritable structure politique forte en 1830.
La tendance générale après 1815 à réduire le nombre de micro-États plutôt qu’à en recréer.
Le scénario possible aurait été que en 1830, les puissances européennes craignent que la Belgique révolutionnaire devienne instable. Pour protéger la frontière avec la Prusse, elles décident de recréer un petit État tampon : la Principauté ecclésiastique de Stavelot-Malmedy est restaurée sous l’autorité nominale d’un abbé-prince choisi par Rome, mais placée sous garantie internationale (comme la neutralité de la Belgique en 1839).
La Belgique est reconnue, mais Stavelot-Malmedy (et peut-être Spa, Eupen, voire Verviers selon la générosité des diplomates) est détaché.
Le territoire devient la Principauté ecclésiastique de Stavelot-Malmedy, sous la protection collective des puissances.
Concernant l’administration politique elle aurait été la suivante:
Une principauté ecclésiastique, mais modernisée. Le prince-abbé conserve un rôle symbolique et religieux, tandis qu’un conseil élu gère l’administration civile.
Il y a quelques dizaines de milliers d’habitants, parlant surtout le wallon et l’allemand, ce qui en fait un État bilingue.
L’économie aurait été basée sur l’eau avec des stations thermales comme Spa, réputées en Europe,les forêts, un peu de sidérurgie et de tissage, Verviers pourrait être intégré pour assurer la viabilité).
Le premier prince-abbé aurait été le Chanoine Jean-Baptiste Malou qui a vécu entre 1809 et 1864.
Dans notre réalité, il fut évêque de Bruges.
Il aurait été jeune et prometteur en 1830, il aurait pu être choisi comme figure de compromis entre francophones et germanophones. Le dernier prince-abbé est mort en 1796, son nom était Célestin Thys.
Concernant l’évolution de cet état il est possible qu’entre 1830 et 1870
Le micro-État devient une petite Suisse ecclésiastique, neutre, touristique avec Spa attire l’aristocratie européenne mais aussi des écrivains et des musiciens, un refuge de religieux et de conservateurs hostiles aux tendances libérales de la Belgique. Verviers permet la viabilité de la principauté notamment avec l’industrie du textile.
En 1870, La principauté est occupée temporairement par la Prusse mais restituée après la guerre, renforçant son image de « petite Suisse des Ardennes ».
1870-1914 : Avec la montée du nationalisme allemand et français, Stavelot-Malmedy devient un enjeu diplomatique. La Prusse lorgne dessus, la Belgique aussi. Mais sa neutralité le protège, comme pour la Suisse.
Dans notre uchronie en 1919 durant le Traité de Versailles, la question d’Eupen-Malmedy ne se pose pas, car ce n’est pas prussien. Mais la Belgique réclame l’annexion du micro-État pour compenser ses pertes de guerre. Les puissances hésitent : doit-on fusionner la principauté avec la Belgique ou maintenir sa neutralité ?
Pour cette uchronie il y a deux scénarios viables:
Soit il y aurait eu une absorption par la Belgique en 1919, comme l’Eupen-Malmedy réel. La principauté disparaît après presque un siècle de renaissance.
Concernant le potentiel dernier prince-abbé de cette histoire alternative il aurait été potentiellement Désiré-Joseph Mercier
Il fut Archevêque de Malines dans la réalité et il devint une figure héroïque de la résistance morale face à l’occupation allemande en 1914-1918.
Dans l’uchronie, il pourrait avoir été choisi comme prince-abbé juste avant ou pendant la guerre.
S’il devenait le dernier prince-abbé en 1919, il aurait marqué l’histoire comme un patriote spirituel, contraint de remettre son État à la Belgique mais en héros national.
ou
Elle aurait survécu jusqu’à aujourd’hui comme un micro-État européen, comparable au Liechtenstein ou à Andorre. Elle serait probablement devenu un paradis fiscal.
Entre 1920 et 1930, Spa accueille les grandes conférences diplomatiques dans l’uchronie, Spa devient une sorte de « Genève miniature ».
L’abbaye est reconstruite en style néo-gothique comme symbole national.
Concernant la Seconde guerre mondiale:
Hitler annexe de force la principauté, intégrée au Reich comme district administratif.
Il y a une résistance active, mais avec une répression brutale avec la bataille des Ardennes en 1944 qui touche directement le territoire.
En 1945, La principauté est restaurée par les Alliés, malgré des revendications belges. Elle devient un membre fondateur de l’ONU avec un siège symbolique à l’Assemblée générale).
Stavelot-Malmedy rejoint en 1957 la Communauté économique européenne avec le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.
Entre 1960 et 1980:
Il y a le développement d’un secteur bancaire et financier, sur le modèle du Liechtenstein.
Spa devient une « capitale du sport automobile », dans l’uchronie, le circuit de Spa-Francorchamps est directement la propriété de l’État.
En 2000,
Une partie de la population germanophone réclame un rapprochement avec l’Allemagne, les francophones avec la Belgique.
Mais l’attachement à la neutralité et aux avantages fiscaux freine tout changement.
En 2010,
La principauté devient une république ecclésiastique démocratique, unique en Europe :
Avec un Président élu pour 5 ans tandis que l’Abbé-prince est le « protecteur spirituel » de l’État.
En 2025, cette principauté compterait une population d’environ 120 000 habitants avec des francophones, des germanophones, un peu de wallon et de luxembourgeois).
Concernant l’abbé-prince possible aujourd’hui il aurait été Jozef de Kesel car:
Il fut Archevêque de Malines-Bruxelles entre 2015 et 2020 dans notre réalité.
Il est Très médiatisé en Belgique, c’est réformateur modéré, proche du pape François.
Dans l’uchronie, plutôt que devenir cardinal à Bruxelles, il aurait été élu prince-abbé de Stavelot-Malmedy en 2015.
En 2025, il incarnerait un prince-abbé très connu, européen et influent.
Et finalement voici les témoignages de l’Uchronie:
Une lettre diplomatique fictive en 1831:
« Afin de préserver l’équilibre entre la Belgique nouvelle et le royaume de Prusse, il a semblé sage aux puissances de rétablir dans ses droits l’antique principauté abbatiale de Stavelot et Malmedy, placée sous la haute surveillance de l’Europe. Ce petit État, sous la conduite d’un abbé-prince élu par Rome, offrira la double garantie de neutralité et de stabilité. »
Journal fictif en 1842 d’un voyageur britannique à Spa:
« Le pays que l’on appelle Stavelot-Malmedy est un enchantement. À Spa, les sources minérales attirent la meilleure société d’Europe ; à Stavelot, les processions rappellent l’antique ferveur bénédictine. Il est singulier de voir un État si petit, mais où l’ordre et la prospérité surpassent parfois celles des royaumes voisins. »
Lettre fictive d’un notaire de Malmedy après la guerre de 1870:
« Nous avons craint que les Prussiens n’annexent notre pays, comme ils l’ont fait de l’Alsace. Mais grâce à Dieu et à notre abbé-prince, la neutralité fut respectée. Nous restons ce que nous avons toujours été : ni Belges, ni Prussiens. »
Débat fictif au Parlement belge en 1919 (un procès-verbal imaginaire):
« Messieurs, comment se fait-il que l’on ait rendu à la Belgique Eupen et Malmedy, mais que l’on nous refuse Stavelot, qui fut pourtant longtemps uni à notre histoire ? L’Europe préfère un état ecclésiastique à la justice envers notre nation. »
Témoignage fictif d’un résistant en 1945:« Pendant quatre ans, les Allemands ont tenté d’effacer notre principauté, mais dans nos cœurs, elle n’a jamais disparu. Lorsque les Américains sont entrés à Stavelot en décembre 1944, beaucoup criaient : Vive la Belgique ! Vive la principauté ! Vive la liberté ! C’est dire que nous ne savions plus qui nous étions, sinon des hommes libres. »
Reportage fictif de la RTB (radio belge) en 1967:
« Curiosité européenne, la principauté de Stavelot-Malmedy vient de célébrer ses 1 200 ans. Avec 80 000 habitants, cet État minuscule reste farouchement neutre et prospère, vivant du textile, du tourisme thermal et de ses fameuses courses automobiles. Le prince-abbé Albert de Waimes salue la foule du haut du perron abbatial, tel un chef d’État de poche mais respecté. »
Article fictif du New York Times en 2015:
« « Coincé entre Belgique et Allemagne, le micro-État de Stavelot-Malmedy joue dans la même ligue que le Liechtenstein ou Andorre. Avec ses stations thermales luxueuses, ses circuits automobiles et son régime fiscal léger, il attire milliardaires et curistes du monde entier. Le prince-abbé Christophe Hennen, figure spirituelle, se contente d’un rôle symbolique tandis qu’un parlement élu administre les affaires. »
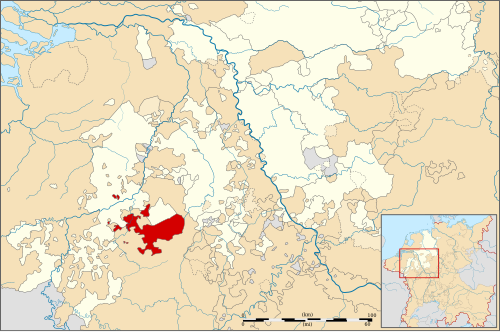

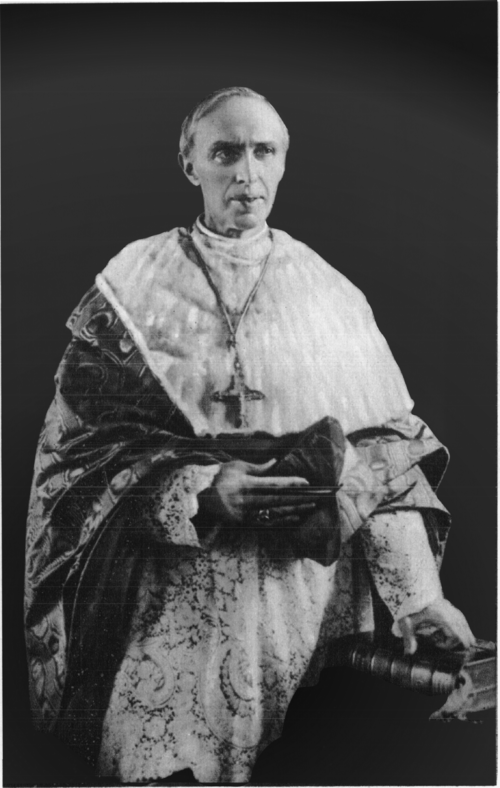


2.19) Et si le Duché de Bouillon avait été restauré après la Révolution belge?
C’est un scénario très difficile à réaliser car tout d’abord Bouillon faisait à peine quelques centaines de km² et moins de 20 000 habitants au XIXᵉ siècle : beaucoup plus petit que le Luxembourg.
Ce duché était trop exigu pour constituer un État reconnu à long terme.
Le Luxembourg avait l’appui du roi des Pays-Bas qui en était grand-duc et de la Confédération germanique.
Bouillon n’avait pas de protecteur assez puissant : ni la France ni la Belgique n’avaient intérêt à ressusciter un duché minuscule.
Après 1815, les grandes puissances ont plutôt cherché à simplifier la carte politique, en réduisant le nombre de micro-États (beaucoup d’anciennes principautés ecclésiastiques ont disparu).
Restaurer Bouillon aurait été perçu comme un archaïsme.
Bref, ce serait un scénario plausible dans une uchronie où les grandes puissances avaient décidé de multiplier les petits États-tampons (par exemple : si la Belgique avait été jugée trop instable ou trop francophile, et qu’on voulait limiter son territoire).
Mais dans la logique historique réelle de 1830 à 1839, les chances étaient très faibles, un Duché trop petit, sans base politique solide, et sans grande puissance prête à parrainer le projet.
Concernant le nom du duc de Bouillon dans cette principauté réunifié il y a déja plusieurs choses qui compliquent l’enquête, après la Révolution, les biens de La Tour d’Auvergne(celui qui a acquis le Duché en 1594) furent confisqués. Le duché fut contesté par les princes de Rohan, cousins par mariage. À partir du XIXᵉ siècle, les Rohan-Chabot revendiquèrent le titre de « duc de Bouillon ».
Concernant le moment après la Révolution belge, le problème c’est que la branche principale s’était éteinte en 1802. Donc en 1830, il n’y avait plus de duc légitime direct. Les Héritiers collatéraux par alliance étaient les Rohan-Chabot qui étaient très actifs dans les revendications nobiliaires.
En 1830, le candidat le plus plausible aurait été Louis-François de Rohan-Chabot qui vécut entre 1788 et 1833 et qui était un aristocrate français et il fut aussi cardinal dans notre réalité.
Mais pour éviter un duc français trop influent, la Belgique aurait pu choisir une solution symbolique aurait été d’attribuer le titre de « Duc de Bouillon » au roi des Belges lui-même, Léopold Ier qui fut élu en 1831, cela aurait neutralisé les querelles dynastiques et intégré Bouillon dans le royaume tout en respectant son identité historique.
En 1830 après la Révolution belges, Les notables de Bouillon réclament que leur territoire ne soit pas absorbé simplement comme une commune de province. Ils invoquent l’ancienne souveraineté du duché et les droits de la maison de Rohan.
En 1831, le Congrès national belge, soucieux d’apaiser les particularismes, accorde un statut spécial : Bouillon est reconnu comme « duché autonome au sein du Royaume de Belgique », avec un « duc-honorifique » (titre concédé symboliquement au roi des Belges) et un parlement local avec 12 députés.
En 1839, Le Traité des XXIV articles reconnaît l’indépendance de la Belgique, Bouillon reste belge, mais son autonomie est garantie par la Constitution.
En 1870, Pendant la guerre franco-prussienne, des débats agitent la Belgique : certains craignent que Bouillon ne devienne un point faible face à la Prusse. Mais sa neutralité interne est maintenue.
En 1890, pour le 60ᵉ anniversaire de la Belgique, Bouillon adopte officiellement un blason propre (croix de Godefroy de Bouillon) et obtient le droit de battre une médaille commémorative, mais pas une monnaie.
En 1914, L’armée allemande envahit Bouillon dès août. Les habitants se défendent symboliquement dans le château, surnommé « la petite Liège ». Après la guerre, l’autonomie est confirmée comme un signe de résistance.
En 1921, Un statut révisé crée un Conseil du Duché élu au suffrage universel masculin. Le duc-honorifique reste le roi des Belges, mais Bouillon a une autonomie fiscale partielle.
En 1940, Nouvelle invasion allemande. Le Conseil du Duché est dissous par l’occupant. Après 1945, il est rétabli.
En 1950, la Crise royale autour de Léopold III a lieu. À Bouillon, le Conseil vote symboliquement une motion pour garder son autonomie si le roi abdique. La presse belge parle d’un « sécessionnisme bouillonnais » folklorique.
En 1970, dans le cadre de la fédéralisation de la Belgique, Bouillon obtient le statut de Communauté autonome spéciale, comparable à un canton fédéré.
En 2001, le château de Bouillon devient propriété partagée entre la Région wallonne et l’« Autorité du Duché », qui y installe un parlement symbolique.
En 2010, une Réforme constitutionnelle a eut et Bouillon est reconnu comme un « Duché-honorifique autonome », avec des compétences accrues en tourisme, en culture et en fiscalité locale.
En 2014, une Visite d’État a eut lieu et le roi Philippe se fait proclamer « Duc de Bouillon » lors d’une cérémonie au château, c’est la première fois qu’un roi des Belges utilise officiellement ce titre.
En 2020, Bouillon attire l’attention comme destination de tourisme vert et médiéval. Le Conseil du Duché crée une taxe écologique spéciale sur les activités de chasse et de pêche.
En 2025, le Duché compte 20 000 habitants. Son statut est qu’il est un canton-duché autonome de Belgique, doté d’un Conseil élu de 25 membres, d’un bourgmestre-gouverneur et d’une forte identité locale.Le roi Philippe continue d’utiliser le titre de Duc de Bouillon lors des cérémonies officielles.Bouillon est surnommé « la petite Andorre belge » par les journalistes. Ce canton est similaire au Val d’Aoste ou les cantons suisses.
Voici deux scénarios possibles pour le duché de Bouillon:
Le premier aurait été que le roi des belges devienne aussi duc de Bouillon:
En 1831, Léopold Ier est élu roi des Belges. Pour donner de la légitimité historique au nouvel État et calmer les revendications locales, le Congrès national proclame aussi Léopold « Duc de Bouillon ».
Le duché devient un territoire autonome mais intégré au royaume.
Le titre de « Duc de Bouillon » est transmis héréditairement aux rois des Belges (comme le titre de « grand-duc de Luxembourg » pour les rois des Pays-Bas).
En pratique, Bouillon est géré par un gouverneur local nommé par le roi, mais conserve un petit conseil communal élargi (avec des pouvoirs symboliques).
Les avantages de scénario aurait été que:
Il n’y aurait pas eu de de conflit avec les Rohan-Chabot.
Cela aurait renforcé le prestige du roi des Belges, associé à Godefroy de Bouillon, héros des croisades.
Cela évite que la France ou une famille étrangère ait un pied en Belgique.
Tandis qu’au niveau des inconvénients les voici:
Le Duché verrait une perte de toute autonomie dynastique réelle (être Duc de Bouillon devient surtout un titre honorifique).
Certains notables bouillonnais auraient pu estimer qu’on effaçait leur indépendance historique.
Concernant l’autre scénario, celui-ci aurait été que les Rohan-Chabot auraient été restaurés en tant que ducs de Bouillon.
Les notables de Bouillon, voulant un duc « légitime », font appel à lui.
Le duché est proclamé comme un État autonome sous protectorat belge.
Le duc Louis-François vient prêter serment de neutralité et installe une petite cour locale dans le château.
Ses successeurs continuent de porter le titre et résident parfois à Bouillon.
Concernant les avantages ceux-ci auraient été les suivants:
Il y aurait eu un respect de la continuité dynastique.
Le duché devient une petite principauté prestigieuse, attirant des diplomates et des voyageurs (un peu comme Monaco plus tard).
Concernant les inconvénients les voici:
À long terme, Bouillon aurait pu être ré-annexé ou perdre son autonomie face aux tensions belgo-françaises.
L’actuel duc de Bouillon en 2025 aurait été Josselin de Rohan.
Concernant le Duché de Bouillon où le roi Léopold 1er devient aussi duc de Bouillon:
Journal fictif du Congrès de Bruxelles du 22 Juillet 1831:
« Le Congrès national, soucieux de rappeler la gloire de nos ancêtres, a proclamé hier Sa Majesté Léopold Ier non seulement roi des Belges, mais encore duc de Bouillon. Le peuple des Ardennes, héritier des traditions de Godefroy, salue avec enthousiasme ce geste qui consacre l’union entre les provinces et la dynastie nouvelle. »
Lettre fictive d’un notable de Bouillon à son cousin à Namur en 1835:« Nos craintes de passer pour une simple petite ville ont été dissipées : grâce au titre porté par le Roi, Bouillon rayonne de nouveau. Chaque année, Sa Majesté envoie un gouverneur spécial qui préside les fêtes commémoratives de la Croisade. Les habitants en sont fort fiers, car l’on parle désormais de Bouillon dans toutes les capitales d’Europe. »
Discours fictif de Léopold II au Parlement en 1870:
« Lorsque j’entends prononcer le nom de Bouillon, je songe à mon ancêtre spirituel, Godefroy, dont l’épée brilla à Jérusalem. Porter ce titre, c’est pour moi un devoir de rappeler aux Belges que leur histoire n’est pas celle d’un petit peuple, mais d’une nation dont l’héroïsme fut reconnu du monde entier. »
Article fictif du soir illustré de 1930 durant le centenaire de l’Indépendance:« Le roi Albert Ier a fait son entrée solennelle dans la ville de Bouillon, acclamé par des milliers de spectateurs. Les drapeaux belges flottaient aux côtés des bannières frappées de la croix de Jérusalem. La cérémonie a consacré une tradition centenaire : depuis 1831, chaque souverain belge porte le titre de duc de Bouillon, à la gloire de notre passé. »
Témoignage fictif d’un instituteur ardennais en 1955:
« Chaque élève sait par cœur : le roi des Belges est aussi duc de Bouillon. C’est une fierté locale. Lors des fêtes nationales, les enfants portent des bannières aux armes de Godefroy, et l’on chante que Bouillon est le cœur chevaleresque de la Belgique. »
Article fictif de La Libre Belgique du 21 juillet 2021: « Pour marquer les 190 ans de son avènement, Sa Majesté le roi Philippe s’est rendu aujourd’hui à Bouillon. Sur le parvis du château, il a rappelé que le titre de duc de Bouillon symbolise l’unité nationale et la vocation européenne de la Belgique, au carrefour des peuples. »
Voici des témoignages concernant le scénario où le Duché de Bouillon voit la réinstauration de son Duc:
Journal fictif de Bruxelles du 5 février 1831:« Hier, Son Altesse Louis-François de Rohan-Chabot fit son entrée solennelle dans Bouillon. Escorté par la garde civique, le duc a juré fidélité à l’indépendance belge, tout en proclamant l’autonomie de son duché. La foule l’a acclamé comme le restaurateur d’une gloire ancienne. »
Lettre fictive d’un diplomate prussien à Berlin en 1835:
« Le Duché de Bouillon, minuscule mais stratégique, joue à merveille son rôle de tampon entre la France et la Belgique. Le duc, habile politique, cultive les bonnes grâces des deux puissances tout en maintenant ses prérogatives. »
Le Petit Journal fictif du 12 août 1885:« Bouillon offre au voyageur l’étrange spectacle d’un État lilliputien : timbres à l’effigie du duc, une petite garde en uniforme vert, et une assemblée consultative de vingt membres élus parmi les habitants. Ce jouet d’histoire amuse l’Europe, mais la population y voit un gage de prospérité et d’identité. »
Témoignage fictif d’un poilu français en permission à Bouillon en 1916:« Ici, on dit toujours “le Duc veille sur nous”. Les Bouillonnais, coincés entre les géants en guerre, se serrent autour de leur souverain. On respecte la neutralité du duché, mais les bruits du front résonnent jusque dans la vallée de la Semois. »
Article fictif du journal le Soir du 3 Mai 1951:« La disparition de Louis, 6ᵉ duc de Bouillon, marque la fin d’une époque. Son fils Alain, proclamé duc hier, a promis de moderniser l’institution et d’ouvrir le château aux visiteurs, afin de faire de Bouillon non plus un vestige, mais un acteur de la Belgique touristique. »
Discours fictif de Josselin de Rohan-Chabot, 9ᵉ duc de Bouillon en 1995:« Dans un monde de grandes nations, Bouillon rappelle qu’il n’existe pas de peuples trop petits pour être libres. Nous sommes Belges par voisinage, Français par affinité, Européens par vocation. »
Témoignage fictif d’un guide touristique 2024:« Les visiteurs sont surpris : Bouillon est un duché ! On y entre sans frontière, mais on repart avec un passeport symbolique frappé des armes de Rohan. Chaque été, le duc Alain-Louis ouvre le château pour les fêtes médiévales, où l’on rejoue l’épopée de Godefroy. C’est notre Monaco ardennais ! »


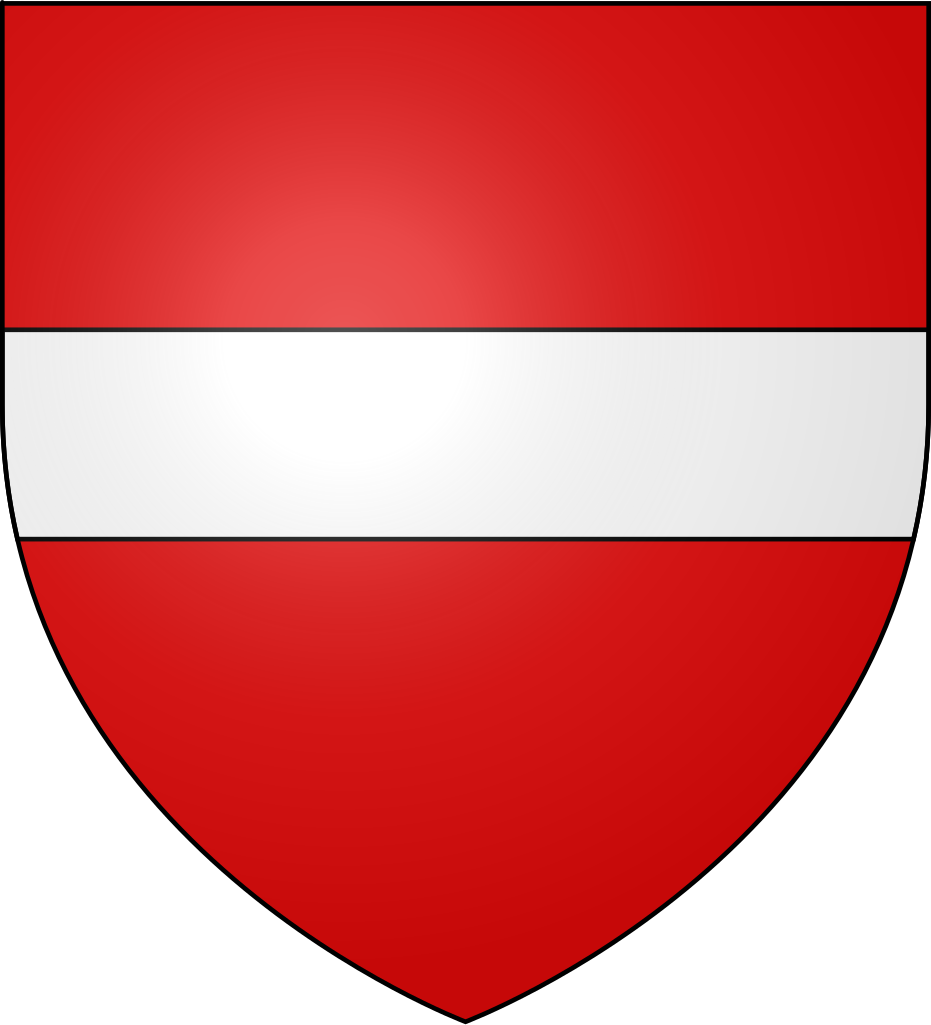
Points de divergence entre 1832 et 1899
3) Et si le Texas était devenu une colonie belge après la Révolution belge?
Dans notre monde après la Révolution belge, Léopold Ier cherche rapidement une colonie pour asseoir le prestige belge. Dans notre réalité, il s’intéresse déjà à des projets en Amérique que cela soit le Guatemala, Rio de la Plata et même le Texas! avant que son fils, Léopold II, ne jette son dévolu sur le Congo.
Le Texas est à cette époque une région en plein bouleversement qui fut une province mexicaine et puis république indépendante de 1836 à 1845 puis intégrée aux États-Unis. Si Bruxelles s’y investit au bon moment, une implantation belge aurait été possible.
En 1832, des aventuriers et commerçants belges s’installent à Galveston et autour de la future Houston. Soutenus par une compagnie belge de colonisation, ils obtiennent des terres auprès des autorités mexicaines.
En 1836, Le Texas proclame son indépendance face au Mexique. Craignant l’annexion par les États-Unis, les Texans acceptent une alliance avec la Belgique. En échange de l’aide militaire et d’un prêt, la Belgique reçoit un protectorat sur la côte texane.
En 1841, il y a la Fondation de Nouvelle-Anvers (la ville de Houston dans notre réalité), avec un port belge sur le golfe du Mexique.
En 1845, dans notre monde, les États-Unis annexent le Texas. Ici, ils protestent mais la Belgique, soutenue par le Royaume-Uni (qui veut contenir les USA), garde le contrôle
En 1850, il y a un afflux de colons flamands, wallons et allemands. Les cultures locales (mexicaines et amérindiennes) se mêlent, créant une identité belgo-texane unique.
En 1855, Le Texas devient officiellement une colonie belge, avec un gouverneur nommé à Bruxelles.
Durant la Guerre de Sécession. Le Texas, belge, reste neutre. Cela prive la Confédération d’un État clé et affaiblit ses ressources. L’Union gagne plus vite.
Dans les années 1870, il y a une découverte de gisements de pétrole dans la région de Beaumont (comme dans notre monde). Résultat : la Belgique devient une puissance énergétique de premier plan dès le XIXe siècle.
En 1875, L’économie texane alimente la Belgique que cela soit en houblon, coton et pétrole. Le pays est beaucoup plus riche que dans notre réalité.
En 1885, dans notre monde, Léopold II prend le Congo. Ici, il préfère investir au Texas et en Amérique centrale. Le Congo reste sous influence française et portugaise.
En 1900, les villes de Nouvelle-Anvers (Houston dans notre monde), Bruges-du-Sud (dans notre histoire San Antonio) et Liège-sur-Rio-Grande ( dans notre réalité Brownsville) deviennent de grands centres économiques.
En 1914, L’Allemagne envahit la Belgique européenne, mais la Belgique-Texas continue la lutte aux côtés des Alliés. Les champs pétroliers du Texas deviennent un atout stratégique pour la guerre.
En 1918, après la victoire de l’Entente, la Belgique obtient un statut de grande puissance, grâce à son Texas pétrolier.
Durant les années 1930, le Texas belge attire énormément d’immigrés européens fuyant la crise et la montée du nazisme.
En 1940, La Belgique est envahie par l’Allemagne, mais le gouvernement se replie… à Nouvelle-Anvers (comme le gouvernement néerlandais en Indonésie). Le Texas devient le cœur de la résistance belge.
En 1945, Les États-Unis et la Belgique sortent renforcés. Le Texas belge reste une base militaire et pétrolière cruciale.
Dans les années 50, le pétrole texan permet à la Belgique de financer son développement. Le pays devient un acteur clé de l’OTAN, avec une influence disproportionnée.
En 1960, alors que les colonies africaines s’émancipent, la Belgique garde solidement le Texas, considéré comme une partie intégrante du royaume.
Dans les années 70, des tensions apparaissent entre Flamands et Wallons au Texas, mais l’identité belgo-texane domine.
Dans les années 80, Bruxelles transfère une partie de ses institutions fédérales à Nouvelle-Anvers, faisant du Texas une capitale économique mondiale.
Dans les années 90, L’Union européenne s’appuie fortement sur la Belgique, qui contrôle une des plus grandes réserves pétrolières occidentales.
Dans les années 2000, le Texas belge devient un hub technologique et énergétique, rivalisant avec la Californie.
En 2025, Bruxelles et Nouvelle-Anvers partagent le rôle de capitale.
Les États-Unis sont puissants, mais sans le Texas, leur histoire est différente : moins de pétrole, moins d’influence dans le Sud.
La Belgique, grâce au Texas :
Devance l’Allemagne et l’Italie comme puissance coloniale,
Devient une puissance mondiale, presque à égalité avec la France et le Royaume-Uni.
Le gouverneur du Texas-belge aurait été élu de façon indirecte.
Concernant le potentiel premier gouverneur en 1855, il aurait été le baron Félix qui était un homme politique belge très influent, issu d’une grande famille aristocratique. Il était membre du Gouvernement provisoire de 1830, donc il fut un député très respecté dans les années 1840 à 1850, il fut monarchiste et proche de Léopold Ier. En réalité, il est resté en Belgique, mais dans cette uchronie, il aurait pu être envoyé comme gouverneur colonial pour donner du prestige au projet texan.
Il aurait été choisi car:
Sa stature politique aurait rassuré les colons et impressionné les puissances étrangères.
Son appartenance à l’aristocratie en faisait un choix naturel pour représenter la Belgique à l’étranger.
C’était un personnage de consensus, capable d’équilibrer Flamands, Wallons, et colons étrangers (notamment allemands au Texas).
Qu’aurait t’il accomplit?
Il fonde un Conseil colonial à Nouvelle-Anvers pour donner plus d’autonomie aux colons.
Il négocie avec Washington pour éviter une guerre avec les États-Unis.Sous son mandat, l’économie cotonnière explose, et les premières rumeurs de pétrole apparaissent.
Sa mort en 1857 aurait marqué la fin d’une ère « aristocratique » de la colonie.
Dans cette histoire alternative en 2025, Bart de Wever n’est pas premier ministre par conséquent il aurait été gouverneur car c’est un homme politique influent, réaliste, et compétent en administration, ayant l’expérience locale (ancien bourgmestre d’Anvers) et nationale. En uchronie, sa nomination en tant que gouverneur permettrait de donner du poids politique et symbolique à la colonie, assurant stabilité, autorité et visibilité internationale. Il incarne à la fois le pragmatisme et la loyauté envers le royaume, qualités nécessaires pour gérer un territoire stratégique et complexe comme le Texas belge.
Témoignages fictif de cette histoire alternative:
Journal fictif d’un colon wallon en 1838:
« Nous avons quitté Liège il y a six mois. Après une longue traversée, nous voici à Galveston, que nos officiers appellent désormais « Nouvelle-Anvers ». La chaleur est insupportable, les moustiques féroces, et les Mexicains du voisinage se méfient de nous. Pourtant, la terre est riche. On dit que le roi Léopold a promis d’envoyer d’autres familles. Peut-être fonderons-nous ici une vraie Belgique du Nouveau Monde… »
Lettre fictive d’un texan flamand pendant la Guerre de Sécession en 1863:
« Chère mère,
Ici à San Antonio (que nous appelons Bruges-du-Sud), nous entendons les canons de la guerre au Nord, mais nous restons neutres. Les Américains se battent entre eux, et nous vendons du coton aux deux camps. Certains disent que les Yankees veulent s’emparer de notre pays, mais notre roi à Bruxelles a juré que le Texas resterait belge. Je le crois, car sans notre coton et notre pétrole, la Belgique n’existerait pas. »
Article fictif de la Gazette de Nouvelle-Anvers en 1918:
« Grâce aux champs pétroliers de Beaumont et de la côte, la Belgique a pu fournir à l’Entente l’or noir indispensable à la victoire contre l’Empire allemand. Sans le Texas, notre patrie aurait été écrasée. Jamais les sacrifices des colons belges du Nouveau Monde n’auront eu plus de valeur pour la liberté européenne. »
Témoignage fictif d’une résistante belgo-texane en 1942:
« Quand les nazis ont envahi Bruxelles, j’ai fui avec ma famille vers le port de Nouvelle-Anvers. Nous n’étions pas seuls : des milliers de Belges d’Europe trouvaient refuge ici. Le gouvernement s’est installé dans notre ville, et soudain, le Texas est devenu la Belgique. Nous aidions les Américains, mais nous restions fiers de notre roi et de notre drapeau noir-jaune-rouge flottant sur les plaines texanes. »
Entretien ficitf à la télévision en 1975:
« Être un belgo-texan, c’est parler français avec mon père, flamand avec ma mère, anglais avec mes amis, et espagnol avec mes voisins. C’est boire une Chimay glacée dans un saloon et manger des tacos avec des frites. Nous avons nos rodéos, mais aussi nos kermesses. Certains se sentent Américains, d’autres Belges, mais moi je dis : nous sommes un peuple unique, ni tout à fait du Vieux Monde, ni du Nouveau. »
Déclaration fictive d’un footballeur de l’équipe nationale belgo-texane durant la Coupe du monde 2022:
« Jouer avec le maillot noir-jaune-rouge à Doha, c’est représenter Bruxelles autant que Nouvelle-Anvers. Nous avons grandi en écoutant à la fois Jacques Brel et Willie Nelson, en mangeant des gaufres et du chili. Quand je marque un but, je pense à mes grands-parents venus de Gand… et à mes cousins qui élèvent du bétail près de San Antonio. »



3.1) Et si la Belgique avait gardé le comptoir au Guatemala?
Dans notre réalité, dans les années 1840, la Belgique, toute jeune, cherche un débouché colonial.
Elle fonde la Compagnie belge de colonisation, qui obtient une concession dans la région d’Izabal, sur la côte caraïbe du Guatemala.
L’Objectif était de créer une colonie agricole et commerciale basée sur les bananes, le café et les bois précieux et contrôler un futur passage transocéanique bien avant le canal de Panama.
Mais…ce fut un échec rapide car il y avait la présence de maladies tropicales, mais il y avait aussi l’hostilité des populations locales et le manque de soutien de Bruxelles bref le projet fut abandonné.
Dans cette uchronie que j’ai essayé d’imaginer voici les événements principaux de ce monde:
En 1843, la Compagnie belge de colonisation obtient officiellement la concession de Santo Tomás de Castilla. Cette fois-ci, Bruxelles investit sérieusement en médecins, en ingénieurs et des soldats sont envoyés.
En 1845, l’installation des premiers colons flamands et wallons, mais aussi d’ouvriers allemands et luxembourgeois se fait. On développe des plantations de café de cacao et de caoutchouc.
Dans les années 1850, le port devient une escale stratégique dans les Caraïbes. La Belgique commence à exporter le café guatémaltèque vers l’Europe.
En 1865, Léopold Ier meurt comme dans notre réalité. Son fils Léopold II hérite d’un royaume qui a déjà une colonie tropicale prometteuse.
Dans les années 1870, la Belgique exploite le bois précieux, le café et le caoutchouc. Des infrastructures modernes apparaissent comme des routes, des chemins de fer entre la côte et la capitale du Guatemala.
Dans les années 1880, au lieu de se tourner vers le Congo, Léopold II renforce son emprise sur l’Amérique centrale. Le Guatemala devient officiellement un protectorat belge.
Dans les années 1890, Bruxelles rêve d’un canal interocéanique en Amérique centrale. Même si le canal de Panama finit par être construit (sous influence américaine), la Belgique développe ses propres ports stratégiques au Guatemala.
En 1900, il y a un afflux de colons européens que se soit des belges, des Allemands ou des Français. Le Guatemala belge devient une mosaïque ethnique.
En 1910, le protectorat exporte du café, des bananes et du caoutchouc en masse. La Belgique devient un acteur incontournable du marché mondial.
En 1914, La Première Guerre mondiale éclate. Le port guatémaltèque devient vital pour l’approvisionnement allié en café et caoutchouc.
Dans les années 1920, il y a la montée de mouvements nationalistes guatémaltèques contre la domination belge. Bruxelles réprime mais concède des réformes locales.
En 1940, la Belgique est envahie par l’Allemagne. Le gouvernement belge se replie à Santo Tomás de Castilla, qui devient capitale de la Belgique libre (comme Londres pour le gouvernement polonais).
En 1945, avec la victoire alliée, la Belgique en sort renforcée. Son protectorat du Guatemala est consolidé comme base caribéenne.
Dans les années 1950, alors que les colonies africaines réclament leur indépendance, la Belgique réussit à maintenir le Guatemala comme territoire d’outre-mer, en lui donnant un statut d’autonomie comparable aux Antilles françaises.
Dans les années 1960, les guérillas communistes d’Amérique centrale tentent d’y trouver un terrain, mais la présence belge (et de l’OTAN) limite leur succès.
Dans les années 1970, le Guatemala belge devient un pôle touristique et agricole majeur. Bruxelles investit aussi dans les infrastructures modernes comme les autoroutes ou les universités).
Dans les années 1980, la Crise de la dette en Amérique latine a lieu. Le Guatemala belge résiste mieux grâce à son intégration à l’économie européenne.
En 1993, Le pays devient une région autonome de la Belgique, avec un Parlement local, mais Bruxelles garde la défense et les affaires étrangères.
En 2000, le tourisme se développe avec les ruines mayas mais aussi avec la culture belge comme la bière, le chocolat et le carnaval.
En 2025, le « Guatemala belge » est un territoire bilingue espagnol-français (avec une minorité néerlandophone).
Sa capitale est la Ciudad Bélgica (anciennement Guatemala City renommée en 1900).
Ses principales exportations viennent du café, des bananes, du cacao, du sucre et du tourisme vert.
Son identité culturelle est hybride avec des mariachis jouant du Brel, des plats mêlant molle au chocolat belge et des frites mayo-piment.
Bref le constat de cette uchronie est que:
La Belgique devient une puissance coloniale caribéenne, plus tournée vers l’Atlantique que vers l’Afrique.
Le Congo, laissé de côté, aurait pu passer sous influence française, portugaise ou même rester indépendant plus longtemps.
Les États-Unis auraient eu une relation compliquée avec la Belgique, puisque leur « arrière-cour » ( donc l’Amérique centrale) est occupée par une puissance européenne.
Le Guatemala belge aurait pu être une alternative au Panama pour un second canal interocéanique, donnant un avantage stratégique énorme à Bruxelles.
Le premier gouverneur du Guatemala belge aurait été Pierre-Théodore Verhaegen qui vécut entre 1796 et 1862.
Il était un homme politique libéral, fondateur de l’Université libre de Bruxelles.
Il fut une Figure intellectuelle et un orateur influent.
Il fut moins militaire et administratif, mais sa nomination aurait incarné l’idée d’une colonie tournée vers le progrès et l’éducation.
Concernant le dernier gouverneur du Guatemala belge il aurait été probable que cela aurait été Herman Van Rompuy (il est né en 1947)
C’est un homme politique belge réel, il fut premier ministre de la Belgique de 2008 à 2009), puis président du Conseil européen (de 2009 à 2014).
Dans l’uchronie, il aurait très bien pu être nommé dernier Gouverneur général du Guatemala belge dans les années 1990, juste avant la transformation du territoire en région autonome de Belgique (comme la Flandre et la Wallonie).
Son style calme, consensuel, et son profil international auraient été parfaits pour gérer la transition entre la colonie et l’autonomie.
Ainsi, Herman Van Rompuy aurait été le dernier gouverneur du Guatemala belge, organisant la dévolution des pouvoirs vers un Ministre-Président du Guatemala belge élu localement à partir des années 1990.
Et voici les témoignages concernant cette uchronie:
Lettre fictive d’un colon flamand à sa famille en 1846: » Cher père,
Nous avons construit nos premières maisons à Santo Tomás. Les terres sont riches, le café pousse vite, mais les fièvres font tomber les plus faibles. Certains disent que nous avons fait une folie en quittant Anvers, mais quand je vois les sacs de grains que nous envoyons en Europe, je crois que l’avenir est ici. «
Journal fictif d’un marchand criollo en 1855:« Ces Belges apportent des routes et des navires à vapeur, mais tout est pour leur profit. Ils paient mieux que les Espagnols d’autrefois, c’est vrai, mais je crains qu’un jour nous ne soyons que des spectateurs dans notre propre pays. »
Article fictif de la Gazette de Bruxelles en 1872:« Tandis que d’autres nations se disputent l’Afrique, la Belgique a su établir une colonie prospère et pacifique au cœur de l’Amérique centrale. Le café guatémaltèque est désormais une fierté nationale, et notre port de Santo Tomás est devenu un phare du commerce dans les Caraïbes. »
Témoignage fictif d’un ouvrier maya en 1903: » Je travaille dans la plantation de cacao de la famille De Clercq. On nous fait prier en français avant de commencer la journée. Je comprends peu de choses à cette langue, mais je sais qu’elle signifie le travail et la discipline. Mon père dit que les Belges ne partiront jamais, car nos montagnes et notre terre les nourrissent trop bien. »
Lettre fictif d’un soldat belge pendant la Première Guerre mondiale en 1916: « Maman, je ne combats pas en Flandre mais dans la jungle. Nous surveillons la côte, car on craint des sous-marins allemands dans les Caraïbes. C’est étrange : défendre la Belgique depuis le Guatemala. Mais ici aussi, c’est la patrie. »
Discours fictif d’un leader syndical guatémaltèque en 1954: « Frères et sœurs, nous avons travaillé cent ans pour enrichir Bruxelles ! Nous voulons nos propres lois, notre propre gouvernement, notre propre drapeau ! L’Espagne nous a pris trois siècles, la Belgique en prend un de plus. Cela suffit ! »
Témoignage fictif d’une touriste belge en 1983: « C’est étrange de marcher dans les ruines mayas et de voir, au-dessus, flotter le drapeau noir-jaune-rouge. On mange des frites dans les rues de Ciudad Bélgica, mais on entend partout la musique marimba. C’est comme si deux mondes avaient fusionné. »
Déclaration fictive d’un étudiant guatémaltèque à l’université libre de Ciudad Bélgica en 2021: « Nous sommes guatémaltèques, nous sommes belges, nous sommes européens et américains à la fois. Certains réclament l’indépendance totale, d’autres veulent rester dans l’Union européenne. Moi je crois que notre identité est unique : nous sommes la preuve vivante qu’un petit royaume européen peut changer l’histoire d’un continent. »


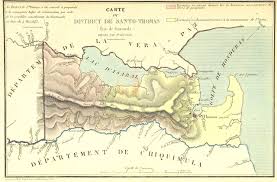
3.2) Et si dans un univers alternatif suite au prestige du roi Léopold Ier en Belgique que se serait t’il passé si le roi Léopold 1er avait accepté le trône de l’empire allemand?
Tout d’abord pourquoi était t’il si populaire?
Tout d’abord il avait un prestige diplomatique:
Léopold 1er était considéré comme un des monarques les plus respectés d’Europe. Il était un ancien prince allemand né à Cobourg et il avait des racines germaniques solides. Il avait servi dans les armées alliées contre Napoléon,il était à Waterloo. On l’appelait parfois le « roi sage », car il était consulté dans presque toutes les grandes crises européennes.
Il était l’oncle de la reine Victoria du Royaume-Uni. Il était le gendre du roi Louis-Philippe de France. Il était aussi le beau-frère du tsar Nicolas Ier de Russie. Il était relié par mariage ou par sang à toutes les grandes dynasties d’Europe. Cela en faisait un excellent candidat de compromis. En Belgique, il avait accepté une constitution moderne en 1831 avec le parlementarisme, les libertés fondamentales et l’équilibre entre la monarchie et le parlement.
Or, c’est exactement ce que réclamaient les députés de Francfort en 1848 : une monarchie constitutionnelle libérale. Frédéric-Guillaume IV de Prusse était trop conservateur, alors que Léopold avait déjà prouvé qu’il pouvait régner dans un cadre constitutionnel.
Les rivalités entre la Prusse et l’Autriche bloquaient l’unification. Un prince « étranger mais allemand d’origine » pouvait incarner une solution neutre. Léopold, issu de la maison de Saxe-Cobourg, avait des attaches allemandes mais n’était pas lié aux luttes prusso-autrichiennes. Cependant qu’elles auraient été les causes qui auraient bloqué son accession au pouvoir en Allemagne?
Léopold Ier était déjà roi des Belges, et il aurait été extrêmement risqué de cumuler les deux trônes avec des équilibres diplomatiques très fragiles en Europe. La Belgique était née en 1830 avec l’accord tacite que son roi resterait neutre : Londres et Paris n’auraient jamais accepté qu’il devienne aussi empereur d’Allemagne.
La révolution de 1848 inquiétait beaucoup les monarchies, et soutenir Léopold dans ce rôle aurait paru trop favorable aux libéraux.
Comment rendre cette uchronie crédible?
Frédéric-Guillaume IV refuse la couronne comme dans la réalité, mais cette fois sa popularité s’effondre.
Les libéraux prussiens, humiliés, se rallient à l’idée d’un empereur « extérieur ».
La IIᵉ République est trop occupée par ses troubles internes avec la révolte de juin 1848 et son instabilité politique pour s’opposer frontalement.
Léopold, gendre du défunt Louis-Philippe, apparaît même comme une figure rassurante pour les Orléanistes exilés.
La reine Victoria hésite, mais Léopold lui promet que la Belgique restera neutre dans le cadre impérial. Londres finit par tolérer la situation, voyant en Léopold un « moindre mal » comparé à une Allemagne radicale ou à une France expansionniste. Vienne est débordée par ses propres révoltes en Hongrie, en Bohême et en Italie en 1848). Elle ne peut pas réagir militairement, et finit par se retirer de la « question allemande ».
Sa réputation de diplomate sage, son origine allemande (Saxe-Cobourg), et son expérience de roi constitutionnel en Belgique le rendent acceptable pour les libéraux allemands.
Voici maintenant la chronologie du scénario:
Le 18 Mai 1848, il y a l’ouverture du Parlement de Francfort. La couronne impériale est proposée à Léopold 1er, le 28 Décembre celui-ci accepte la couronne impériale. En ce jour il y a la Proclamation de l’Empire constitutionnel d’Allemagne avec pour capitale la ville de Francfort).
En 1849, la Constitution fédérale est ratifiée avec comme états membres: la Prusse, la Bavière, la Saxe, Bade, Hanovre, la Belgique, le Luxembourg.
Et c’est à ce moment que commença le début du double rôle de Léopold Ier, roi des Belges et empereur d’Allemagne.
En 1850, c’est le début des tensions avec l’Autriche, Vienne refuse d’entrer dans l’Empire. C’est le début de la construction du réseau ferroviaire impérial,l’axe Ruhr–Wallonie–Rhénanie).
En 1852, c’est la mort de Louis-Napoléon Bonaparte en France de maladie, la IIe République survit plus longtemps.
En 1856, la première réforme parlementaire a lieu avec l’introduction du suffrage censitaire élargi dans tout l’Empire.
À partir de 1865 c’est le début de la politique coloniale impériale avec des missions en Afrique et en Asie.
Un édit impérial est émis. l’armée devient fédérale avec la fin des armées prussiennes, bavaroises, etc…
En 1870, la crise franco-allemande est évitée par une médiation diplomatique de Léopold II et donc il n’y a pas de guerre franco-prussienne.
En 1871, il y a le Traité d’amitié franco-impérial qui est signé à Bruxelles avec une paix durable entre Paris et Francfort.
En 1884, la Conférence coloniale se tient à Bruxelles, l’Empire belgo-allemand obtient la Namibie, le Cameroun et des concessions en Afrique de l’Ouest, mais pas le Congo.
Il y a la fondation de l’Université impériale de Francfort.
En 1895, il y a l’Exposition industrielle de Hambourg, l’Empire est reconnu comme une première puissance industrielle d’Europe.
En 1900, c’est le début de la « Belle Époque impériale » avec des innovations comme l’automobile, l’électricité, la chimie).
En 1905 c’est la Crise au Maroc l’Empire et la France négocient un partage d’influence, évitant la confrontation.
En 1914, L’Assassinat de Sarajevo arrive toujours et les tensions balkaniques sont présentes mais l’Empire belgo-allemand organise une conférence de paix à Genève.
Il n’y a donc pas de Première Guerre mondiale.
En 1918, il y a la réforme constitutionnelle qui permet le suffrage universel masculin dans tout l’Empire.
En 1920, il y a des grèves ouvrières massives avec la naissance des premières lois sociales impériales.
En 1929,c’est la Grande Dépression avec un chômage massif mais il n’y a pas de dictatures extrêmes.
En 1933, c’est la Réforme économique de crise qui est mise en place avec un plan de réindustrialisation impériale.
En 1939, c’est le début de la guerre en Asie avec l’invasion de la Chine par le Japon mais L’Empire belgo-allemand reste neutre.
En 1945, c’est la fin de la Seconde Guerre mondiale asiatique avec les USA contre le Japon, l’Europe n’a pas connu de conflit.
Il y a la décolonisation progressive de l’Afrique belgo-allemande.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif de la naissance de l’Empire belgo-allemand en 1848:
«Aujourd’hui, les cloches de Francfort sonnaient à toute volée. Les députés ont acclamé l’annonce : le roi des Belges, Léopold Ier, a accepté notre couronne impériale ! Les rumeurs disaient qu’il refuserait comme l’avait fait le roi de Prusse, mais non. Enfin nous avons un empereur qui croit en la liberté et en l’unité. Les rues sont pleines de drapeaux noir-jaune-rouge. Je n’ai jamais vu le peuple aussi uni. »
Article fictif d’un journaliste dans le journal le Siècle en Février 1871: « Tandis que certains craignaient la guerre contre l’Empire germanique, la diplomatie de Léopold II a su maintenir la paix. L’Alsace et la Lorraine restent françaises, et la République ne connaît pas l’humiliation de la défaite. Il est étrange de penser que, grâce à un souverain étranger, la France a été sauvée d’un conflit sanglant qui eût embrasé l’Europe. »
Lettre fictive d’une institutrice bruxelloise à sa sœur à Liège en 1915: « Ma chère Louise,
J’enseigne aujourd’hui à des élèves venus de tout l’Empire : Rhénans, Bavarois, Luxembourgeois, Flamands… Quelle richesse ! Nos manuels parlent de l’Empire belgo-allemand comme d’une grande famille. Quand je lis les journaux qui racontent les guerres dans les Balkans, je me réjouis que notre souverain ait choisi la voie de la neutralité. Quelle bénédiction que nous n’ayons pas été entraînés dans ces folies ! »
Discours radiodiffusé de l’empereur Léopold III en 1945 :« Les peuples d’Asie et d’Afrique réclament leur liberté. L’Empire n’y voit pas une perte, mais une chance : celle d’un monde nouveau, où les pays coopèrent d’égal à égal. Notre rôle n’est pas de dominer, mais d’accompagner. L’unité que nous avons su bâtir en Europe, nous l’offrons comme modèle au reste du monde. »



3.3) Et si dans les années 1870 le roi Léopold II avait entamé une conquête coloniale à la manière de la Prusse?
Tout d’abord quelles auraient été les causes qui auraient amenées à cette uchronie?
Dans notre réalité, Léopold II avait des rêves grandioses pour son pays mais se heurtait au parlement belge, dominé par des libéraux méfiants de ses ambitions coûteuses.
Dans l’uchronie, le climat politique change:
Tout d’abord la Belgique subit une crise politique et sociale grave dans les années 1870 avec des insurrections ouvrières et flamandes.
Léopold II profite de la situation pour renforcer les prérogatives royales, sur le modèle de Bismarck en Prusse.
Il obtient un pouvoir exécutif plus fort et neutralise les opposants parlementaires.
En 1870-71, la France est humiliée par la guerre contre la Prusse.
Le Royaume-Uni, préoccupé par l’Inde, ne peut surveiller toutes les ambitions coloniales.
La Belgique, petite mais industrielle et prospère, apparaît comme un acteur émergent capable de rivaliser avec l’Italie ou le Portugal dans la course coloniale.
Léopold II lance une grande campagne de propagande, dans celle-ci, les colonies sont présentées comme une solution à la surpopulation.
Elles promettent des débouchés industriels pour l’acier, le textile et les armes belges.
On parle de « mission civilisatrice flamande et wallonne », mêlant patriotisme et catholicisme.
Passons maintenant à la chronologie complète
En 1871, cette Belgique uchronique, durant le règne Léopold II, adopte une politique autoritaire et centralisée, craignant la contagion révolutionnaire.
En 1876, au lieu de créer l’ État indépendant du Congo privé, Léopold II réussit à convaincre le parlement qui est affaibli par des troubles sociaux d’accepter une annexion officielle du Congo par la Belgique. Le Congo devient la Colonie royale du Congo.
Entre 1877 et 1880, c’est le début de la colonisation massive, avec une armée coloniale belge et des compagnies concessionnaires contrôlées par l’État. Bruxelles se proclame capitale impériale.
Entre 1884 et 1885 a lieu la Conférence de Berlin. La Belgique obtient une reconnaissance internationale non seulement du Congo, mais aussi de territoires supplémentaires comme une bande côtière en Afrique orientale autour de Zanzibar et quelques archipels du Pacifique.
En 1889, Léopold II inaugure à Anvers un gigantesque port impérial et une flotte coloniale. La Belgique se dote d’une marine de guerre moderne, financée par les profits du caoutchouc.
Durant les années 1890, le Congo est exploité brutalement notamment au niveau du caoutchouc de l’ivoire du cuivre.
L’armée coloniale belge qui a pour nom de Force Publique devient l’une des plus redoutées d’Afrique.
Anvers dépasse Hambourg comme grand port colonial d’Europe.
En 1895, il y a une tentative belge d’expansion vers le Katanga et le Tanganyika, au détriment des Allemands, avec des tensions germano-belges.
En 1900, la Belgique obtient Bornéo du Nord en échange d’accords commerciaux avec le Royaume-Uni. Elle devient une puissance coloniale intercontinentale.
En 1909, c’est la Mort de Léopold II. Mais contrairement à la réalité, son empire est célébré comme un triomphe national. Son neveu Albert Ier lui succède, héritant d’un État militarisé et impérial.
En 1914, la Belgique rejette la neutralité. Craignant l’Allemagne, elle s’allie à la France et au Royaume-Uni. Ses troupes coloniales attaquent les possessions allemandes au Cameroun et en Afrique de l’Est.
Durant le reste du conflit, la Force Publique occupe le Ruanda-Urundi et le Tanganyika allemand. En Europe, l’armée belge défend non seulement Ypres, mais participe activement à l’offensive de la Somme.
En 1919, durant le Traité de Versailles, la Belgique obtient officiellement le Ruanda-Urundi et le Tanganyika comme colonies. Elle émerge comme une moyenne puissance impériale, comparable au Portugal ou à l’Italie, mais avec un empire africain beaucoup plus riche.
Durant les années 1920, Bruxelles devient une capitale impériale, avec les expositions coloniales régulières. Le Congo fournit du cuivre, de l’étain et de l’or au développement industriel belge. La société se militarise : avec le service militaire obligatoire prolongé avec le culte de Léopold II comme « Empereur fondateur ».
En 1930, c’est le Centenaire de l’indépendance belge, il y a une Grande exposition coloniale et Bruxelles se proclame la « Rome du Nord ».
Entre 1935 et 1939, il y a la crainte face à l’expansion allemande. La Belgique impériale renforce son alliance avec la France et le Royaume-Uni.
En 1939, la Belgique déclare la guerre à l’Allemagne dès septembre, aux côtés des Alliés.
En 1940, la Wehrmacht envahit la Belgique, mais l’armée belge, mieux équipée grâce aux profits coloniaux, résiste plus longtemps La campagne dure 6 semaines au lieu de 18 jours.
Entre 1941 et 1944, le Congo belge devient une base stratégique alliée avec de l’uranium du Katanga pour les États-Unis et des soldats africains en Afrique du Nord.
Entre 1944 et 1945 c’est la Libération de la Belgique par les Alliés. La Belgique sort du conflit comme une alliée majeure en étant membre fondateur de l’ONU avec un prestige supérieur à la réalité.
Entre 1945 et les années 1960, contrairement à la réalité, la Belgique refuse la décolonisation rapide. Elle conserve le Congo et ses autres colonies, en justifiant leur statut par un discours paternaliste et modernisateur. L’OTAN tolère cet empire car il sert de bastion anti-communiste en Afrique. En 1960, il y a des émeutes au Congo. Bruxelles envoie massivement l’armée coloniale, réprime durement et instaure une « Union impériale » avec une intégration partielle du Congo comme territoire associé à la Belgique, un peu comme l’Algérie française.
Durant les années 70 il y a l’exploitation du cuivre, de l’uranium et du pétrole congolais ce qui finance l’État belge. La Belgique devient une puissance énergétique et industrielle, évitant le déclin économique des années 1970. Mais une guérilla indépendantiste congolaise se développe.
Dans les années 1980, il y a des pressions internationales croissantes pour décoloniser. Le régime belge tente une « belgicanisation » : certains Congolais deviennent députés à Bruxelles, mais le système reste autoritaire.
En 1989, durant la Chute du mur de Berlin. Les États-Unis et l’ONU exigent la décolonisation du Congo.
En 1995, face aux guerres civiles africaines, la Belgique organise une transition contrôlée avec la création de la Confédération belgo-congolaise, avec Bruxelles et Kinshasa comme capitales.
Durant les années 2000, la Confédération fonctionne comme un État fédéral bicontinental. La Belgique est riche et industrialisée.
Le Congo est riche en ressources en plein boom démographique.
En 2010, Bruxelles devient officiellement la capitale politique de l’Union européenne et la capitale de la Confédération belgo-congolaise.
En 2020, avec 150 millions d’habitants (dont 130 au Congo), la Belgique est un acteur géopolitique majeur comme membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et une puissance nucléaire et une grande économie.
En 2025, la Belgique impériale est un État bicontinental avec un mélange de démocratie européenne et d’autoritarisme africain. Ses élites débattent entre intégration fédérale totale (un « État belgo-africain ») ou une séparation progressive.
Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Discours fictif de Léopold 2 devant le Parlement belge en 1876:
« Messieurs, la Belgique est petite par ses frontières, mais elle n’est pas condamnée à rester petite dans l’histoire. La Providence nous tend une main immense : l’Afrique. Là-bas, des terres immenses, des richesses sans bornes, et des peuples à guider. Si nous voulons que la Belgique ne soit pas effacée par ses grands voisins, il nous faut un empire. Je vous le dis : un royaume sans colonies est un royaume condamné. Si vous ne votez pas l’annexion, vous signez l’arrêt de mort de notre grandeur. »
Témoignage fictif d’une religieuse missionnaire en 1892:
“Les villages congolais que nous visitons sont dociles, mais marqués par la peur. Les soldats de la Force Publique exigent sans cesse plus de récoltes de caoutchouc. Je prie pour que Dieu adoucisse le cœur des administrateurs. Ils parlent toujours de progrès et de civilisation, mais je crains que la croix soit trop souvent suivie du fouet. “
Passage fictif d’un manuel scolaire belge en 1898: « L’enfant belge doit savoir que, grâce à notre grand roi Léopold II, la Belgique est devenue une nation impériale. Nos drapeaux flottent sur deux continents. Le Congo est désormais le grenier et la fierté de notre patrie. Chaque Belge doit se souvenir de cette devise : “Servir le Roi, c’est servir la Patrie ; servir la Patrie, c’est servir l’Empire.” »
Article fictif du journal Le Soir en 1914:
« La Belgique impériale, fidèle à ses alliances, a déclaré la guerre à l’Allemagne. Nos forces coloniales avancent déjà au Cameroun et dans le Tanganyika. La voix de la Belgique résonne désormais parmi les grandes nations, nous ne sommes plus une terre à traverser, mais une puissance qui combat pour la liberté du monde. »
Discours fictif du roi Albert Ier à l’Exposition coloniale en 1930:
« Belges, Congolais,
Regardez autour de vous ces palais, ces jardins, ces merveilles. Ce n’est pas seulement une fête : c’est la preuve que notre empire est un tout, uni par la grandeur et par le travail. En cent ans, nous avons bâti ce que d’autres nations ont mis des siècles à accomplir. La Belgique est petite par ses frontières européennes, mais immense par son empire. »
Tract clandestin du Parti Indépendantiste Congolais en 1934:
« Belges et Congolais, unissez-vous ? Non !
Car il n’y a pas d’union quand l’un commande et l’autre obéit. Ils bâtissent des palais à Bruxelles, mais nos villages meurent de faim. Ils parlent de civilisation, mais ils nous tiennent en esclavage. Le Congo appartient aux Congolais ! »
Message radio fictif d’un officier belge en exil à Londres en 1941:
« Belges d’Europe, Congolais d’Afrique,
Le combat que nous menons n’est pas seulement pour notre liberté, mais pour celle du monde entier. Nos troupes au Congo tiennent tête aux forces de l’Axe. Nos mines donnent aux Alliés le cuivre et l’uranium dont ils ont besoin. L’Empire belge sera la preuve que la démocratie peut régner sur deux continents.
Journal fictif d’un soldat congolais de la Force Publique en 1942:
« Nous avons combattu les Italiens dans les montagnes. Beaucoup de mes camarades sont tombés. Les officiers disent que nous avons gagné une médaille pour le roi. Mais moi, ce que je veux, c’est rentrer dans mon village, et que mes enfants ne portent plus jamais l’uniforme d’un autre peuple. »
Discours fictif du Premier ministre belge à la Chambre en 1960
« Messieurs,
Alors que la France abandonne l’Algérie et que la Grande-Bretagne perd ses colonies, la Belgique n’abandonnera pas sa mission. Le Congo n’est pas une colonie : il est une partie intégrante de notre empire, une extension de notre nation. Nous ne céderons pas à la vague du séparatisme : Bruxelles et Léopoldville resteront liées par l’histoire, la langue et le destin. »
Tract fictif d’un étudiant distribué à Kinshasa en 1973:
« Les Belges disent que nous sommes leurs frères, mais nous n’avons pas les mêmes droits.Ils disent que nous sommes des citoyens impériaux, mais nous ne décidons rien. Assez ! L’Afrique doit être libre, même si Bruxelles veut encore nous tenir enchaîné. »
Article fictif de Jeune Afrique en 2005:
« La Confédération belgo-congolaise est une expérience unique au monde : une démocratie bicontinentale, 20% européenne, 80% africaine. Mais derrière les discours d’unité, beaucoup de Congolais accusent Bruxelles de garder le pouvoir économique. L’avenir dira si cette union est un modèle… ou une prison dorée. »
Discours du Roi Philippe Ier devant le Parlement confédéral en 2025
« Aujourd’hui, devant vous, je parle en tant que roi des Belges et des Congolais. Cent cinquante ans après le rêve de Léopold II, notre empire est devenu une confédération. Nous ne sommes plus un maître et un sujet, mais un seul peuple, uni par le passé et tourné vers l’avenir. C’est à vous, jeunes de Kinshasa et de Bruxelles, de faire vivre ce rêve. »


3.4) Et si le roi Léopold II n’avait pas reçu le Congo à la Conférence de Berlin de 1885?
Lors de la conférence de Berlin, Léopold II ne parvient pas à convaincre les puissances européennes de lui céder le bassin du Congo. Bismarck, méfiant à l’égard d’un roi ambitieux et craignant que la Belgique ne devienne un pion instable, décide plutôt de favoriser une répartition différente :
La France, frustrée par sa défaite en 1870-1871 face à l’Allemagne, obtient l’essentiel du bassin du Congo, en compensation coloniale. La Belgique reste neutre et n’obtient aucun grand territoire africain. Le Royaume-Uni se voit confirmé dans sa sphère d’influence vers l’Afrique australe et orientale, mais pas au Congo.
En réalité, Bismarck cherchait surtout à maintenir l’équilibre et à éviter les tensions coloniales directes entre puissances. Dans ce scénario, il considère que donner le Congo à un petit État comme la Belgique n’apporterait pas de véritable stabilité. Il choisit plutôt d’acheter la paix avec la France en lui attribuant ce vaste territoire.
Les diplomates allemands et britanniques voyaient déjà le caractère personnel du projet de Léopold (une entreprise privée plus qu’un État colonial). Dans cette uchronie, ils jugent cela trop risqué.
Jules Ferry et les milieux coloniaux parisiens poussent plus fermement qu’en réalité pour obtenir un « Empire africain » compensatoire.
Par conséquent, il n’y a pas d’État indépendant du Congo, le « Congo français » (ou Afrique équatoriale française élargie) naît directement en 1885. Cela change radicalement l’histoire africaine : les pratiques brutales du caoutchouc existent, mais elles sont diluées dans un système colonial français plus étatisé.
Le pays reste cantonné à son statut d’État neutre européen, sans colonies majeures. Léopold II perd son prestige international et son image de « roi bâtisseur ». En Belgique, ses projets architecturaux pharaoniques comme les parcs, les arcades et les palais n’ont pas le même financement, ce qui limite l’urbanisme monumental de Bruxelles. En donnant le Congo à la France, Bismarck renforce la rivalité avec Londres en Afrique, mais diminue la tentation française de chercher la revanche militaire contre l’Allemagne.
Le Congo français, relié au Gabon et au Tchad, devient un immense ensemble stratégique. Cela renforce Paris dans la course coloniale.
Sans colonies, elle ne devient pas une puissance moyenne, et son rôle au XXe siècle reste celui d’un petit État tampon. Il n’y a pas de Congo belge, donc pas de Katanga stratégique en 1960, et pas de « crise congolaise » qui implique l’ONU, les États-Unis et l’URSS en pleine guerre froide.
Sans le Congo belge il n’y a pas d’uranium de Shinkolobwe pour le projet Manhattan. Les États-Unis auraient dû chercher ailleurs pour la bombe atomique, ce qui aurait pu retarder ou compliquer le projet.
Concernant le réalisme du scénario il y a plusieurs choses à dire:
Bismarck voulait vraiment apaiser la France après 1871. Lui donner une « compensation coloniale » était une stratégie possible. Léopold II n’avait aucun droit historique sur le Congo : c’était une construction diplomatique fragile. Rien ne garantissait son succès.
Les Britanniques auraient été très hostiles à voir la France contrôler un territoire aussi vaste au cœur de l’Afrique, car cela menaçait leur projet du « Caire au Cap ». La Belgique, petit État neutre, apparaissait comme une solution commode, on pouvait confier le Congo à Léopold II sans bouleverser l’équilibre franco-britannique.
En 1885, C’est la Conférence de Berlin, Bismarck attribue la majeure partie du bassin du Congo à la France, pour apaiser Paris après la défaite de 1870-1871. Léopold II échoue, il n’y a donc pas d’État indépendant du Congo.
En 1889, Léopold II humilié réalise des travaux beaucoup plus modestes que dans notre réalité.
En 1890, les premières expéditions françaises consolident leur emprise sur le Congo. Le territoire est intégré à l’Afrique équatoriale française, qui devient bien plus vaste que dans notre histoire.
Durant la première guerre mondiale, le Congo français fournit des ressources et des troupes coloniales supplémentaires à Paris. Cela aide l’effort français, mais disperse davantage ses moyens. La Belgique, sans empire africain, n’a qu’un rôle défensif en Europe.
En 1920, L’AEF devient l’un des piliers de l’empire colonial français. Brazzaville (et non Léopoldville puis après Kinshasa comme dans notre réalité) s’impose comme la grande capitale d’Afrique centrale.
Après 1940, l’Afrique équatoriale française (incluant le Congo) se rallie à la France libre du général de Gaulle. La France libre est plus puissante que dans notre histoire, grâce à ce territoire immense et ses ressources minières.
En 1945 c’est la Fin de la guerre, la France sort affaiblie, mais avec une Afrique centrale stratégique. La Belgique, petit État européen sans empire, reste marginale dans les négociations internationales, avec aucun siège privilégié à l’ONU.
En 1950 et 1960: En AOF (Afrique de l’Ouest française) et AEF (Afrique équatoriale française), la montée des nationalismes s’accélère. En 1960, le Congo français accède à l’indépendance sous le nom de République du Congo-Brazzaville élargie (incluant ce qui aurait été le Congo belge). La capitale n’est pas Kinshasa (qui reste une ville secondaire), mais Brazzaville, qui devient une métropole de plusieurs millions d’habitants.
Entre 1960 et 1965, il n’y a pas de crise congolaise (pas de Lumumba ni de sécession katangaise, ni d’assassinat de Lumumba ni d’intervention de l’ONU).
Le Congo indépendant est moins riche que dans notre réalité car le Katanga minier est moins central, il est plus stable politiquement, mais reste très dépendant de la France.
Durant les années 70, la France maintient une forte présence militaire et économique en Afrique centrale. Il n’y a pas de dictature de Mobutu par conséquent le Zaïre n’existe pas. À la place, une série de régimes autoritaires pro-français se succèdent à Brazzaville.
Durant les années 1980, Le Congo français indépendant devient un maillon clé de la Françafrique. Paris contrôle ses ressources avec le pétrole du littoral et le cuivre et le cobalt du sud. Il n’y a pas de « Zaïre » extravagant de Mobutu et donc pas de pillage massif par un seul clan, mais une corruption plus diffuse liée aux réseaux français.
Le Congo dans les années 1990, entre dans une phase d’instabilité, comme beaucoup d’États africains. Mais pourtant il n’y a pas de première guerre du Congo (1996-1997) ni de deuxième guerre du Congo (1998-2003), car il n’y a pas de Zaïre effondré. Le Rwanda et l’Ouganda restent en guerre civile, mais l’effet domino sur un Congo faible mais surveillé par la France est limité.
Durant les années 2000, la Chine investit massivement en Afrique centrale. Elle développe des infrastructures au Congo français, notamment dans le sud minier notamment au Katanga et le bassin du fleuve. Paris tente de résister, mais l’influence chinoise progresse.
Durant les années 2010, Brazzaville est devenue une mégapole de 15 millions d’habitants, car elle concentre le rôle de capitale politique, économique et culturelle. Kinshasa reste une grande ville, mais secondaire. Le Congo français indépendant devient une puissance régionale modérée, sans guerres civiles massives comme dans notre histoire.
Le Congo élargi (avec ce qu’on appel dans notre réalité la république démocratique du Congo plus le Congo français de notre réalité) compte environ 150 millions d’habitants en 2025. Ce n’est pas un pays riche (malgré ses ressources minières et pétrolières), mais il est plus stable que notre RDC. La Belgique, sans empire colonial, est restée un petit pays européen prospère, mais sans responsabilités coloniales ni immigration postcoloniale importante. Les relations franco-africaines sont différentes : Paris est encore plus critiqué pour son « néocolonialisme », car le Congo reste dans son orbite.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Journal fictif d’un diplomate allemand à Berlin en 1885: « Le roi Léopold est sorti blême de la salle des négociations. Il avait cru son Congo acquis, mais le chancelier a tranché autrement. Bismarck jugeait que la Belgique était trop petite pour un si vaste domaine, et que calmer la France valait mieux que flatter un monarque obstiné. Je n’ai jamais vu un souverain si abattu. »
Article fictif du journal le temps en 1892: « L’Afrique équatoriale française s’étend désormais jusqu’aux rives majestueuses du fleuve Congo. Nos explorateurs rapportent que Brazzaville devient le phare de la civilisation dans ces contrées. Les Belges, qui rêvaient d’empire, n’ont hérité que d’amères déceptions. »
Carnet fictif d’un tirailleur congolais en 1916:
« On nous a fait marcher loin de nos villages pour combattre dans une guerre qui n’est pas la nôtre. Mais on dit que si nous gagnons, la France sera plus forte et que nous aurons notre part de liberté. Dans les tranchées, beaucoup meurent, et je ne vois pas de liberté, seulement la boue et le sang. »
Discours fictif de Charles de Gaulle à Brazzaville en 1943:
« Ici, au cœur de l’Afrique française, bat le pouls de la liberté. L’immense Congo, rallié à la France libre, prouve que notre empire n’est pas seulement un héritage, mais un avenir. L’Afrique centrale sera demain le socle d’une France régénérée. »
Témoignage fictif d’un militant congolais à l’indépendance en 1960:
« Nous avons chanté et dansé toute la nuit. La France nous avait promis la fraternité, mais ce soir, c’était notre propre victoire. Brazzaville est devenue notre capitale, immense et bruyante. Certains disent que Kinshasa aurait dû être la première, mais pour nous, seule compte la liberté. »
Journal fictif d’un étudiant de Brazzaville en 1987:
« Nos professeurs parlent de démocratie, mais les Français sont toujours derrière nos chefs. Ils disent que sans eux, nous tomberions dans le chaos, mais je crois que c’est eux qui nous enferment dans cette dépendance. »
Interview fictive d’un ingénieur Chinois au Congo en 2002:
« La France a trop longtemps considéré ce pays comme son jardin privé. Nous, nous construisons des routes, des barrages, des hôpitaux. Les Congolais savent qui est vraiment leur partenaire désormais. »
Témoignage fictif d’une entrepreneuse congolaise en 2025:
« Mon grand-père a connu l’époque où la France décidait de tout ici. Mon père a connu les années de corruption et de dépendance. Moi, je parle français, mais je fais affaire avec des partenaires en Chine, en Inde, et en Afrique anglophone. Brazzaville est notre New York. Kinshasa est la ville de mes cousins, mais c’est ici que l’avenir se construit. »
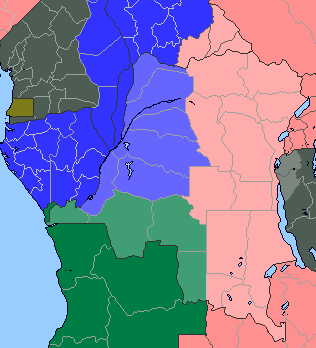

Points de divergences entre 1900 et 1919
4) Et si le Mouvement wallon s’était beaucoup plus développé et aurait eu beaucoup plus de succès que dans la réalité?
Tout d’abord pour que cette uchronie soit crédible. En Wallonie, la révolution industrielle est plus précoce et plus intense qu’en Flandre. Dans l’uchronie, cette avance économique se traduit par une confiance politique accrue des élites wallonnes, qui revendiquent un rôle dirigeant.
Le pouvoir central belge reste dominé par les élites catholiques bruxelloises et flamandes. Les Wallons ressentent que leur richesse notamment le charbon et l’acier profite au pays mais que leurs intérêts sont négligés.
La langue, la culture, et surtout les contacts directs avec les élites françaises que ce soit avec des journalistes, des intellectuels, ou des hommes politiques offrent au mouvement wallon des soutiens extérieurs dès la fin du XIXᵉ siècle.
La “Lettre au Roi” de Jules Destrée de 1912 devient un texte fondateur bien plus influent que dans notre réalité. Elle inspire une large partie des élites wallonnes à s’organiser politiquement plutôt qu’à rester dans le cadre du Parti socialiste ou libéral.
Au lieu de rester une nébuleuse culturelle, le mouvement wallon se structure rapidement en parti politique de masse.
La Wallonie a été un front stratégique avec la ville de Liège, de Namur et de Charleroi. La destruction nourrit un discours selon lequel « la Wallonie a payé le prix du sang » et mérite de l’autonomie et de la reconnaissance.
Les élites françaises, soucieuses de sécuriser leur frontière nord-est, encouragent la montée d’un mouvement pro-français et autonomiste.
Concernant les conséquences, l’État belge devient fédéral dès 1919, au lieu d’attendre les années 1970. Les politiques, les institutions et même l’économie se scindent rapidement en deux sphères distinctes: la wallonne et la flamande. Il y a la Création d’un parlement, d’un drapeau et d’un hymne wallon, qui nourrissent un sentiment national distinct. Le français devient encore plus central en Wallonie, avec une volonté d’effacer la diglossie entre le Wallon et le Français au profit d’une identité francophone forte.
Les revenus de l’industrie lourde wallonne restent dans la région, au lieu d’être redistribués par Bruxelles. Face à la crise charbonnière des années 1950, la Wallonie, plus autonome, investit massivement dans l’électricité, la chimie et l’aéronautique. La “désindustrialisation » est atténuée, la Wallonie évite le déclin structurel qu’elle connaît dans notre réalité.
La Wallonie possède un lien privilégié avec la France avec des alliances économiques, militaires et culturelles renforcées. La Wallonie devient une sorte de « petit frère francophone » au sein de l’Europe.
La Flandre, voyant la Wallonie obtenir ses privilèges, exige à son tour l’autonomie. Le pays devient de facto une confédération instable, puis éclate.
La Wallonie devient un acteur reconnu dans l’espace francophone, aux côtés de la France et du Québec.
Les partis wallons, inspirés par le socialisme et par le modèle français, construisent un État-providence robuste.
Contrairement à la réalité où le mouvement wallon est resté surtout intellectuel et élitiste, ici il touche les ouvriers, les classes moyennes et même la bourgeoisie industrielle.
Voici la chronologie de l’Uchronie:
En 1912, il y a la Publication de la Lettre au Roi de Jules Destrée : « Sire, vous régnez sur deux peuples ». Dans l’uchronie, le texte provoque un choc national, des dizaines de milliers de signatures affluent en soutien, et les premiers comités wallons apparaissent dans toutes les grandes villes industrielles comme à Liège, à Charleroi et à Namur.
Durant la 1ère guerre mondiale, La Wallonie devient un champ de bataille majeur avec Liège, Namur, la Sambre et la Meuse. Les élites wallonnes organisent une résistance plus structurée et coordonnée avec les Français. Le discours se cristallise : « La Wallonie a payé le prix du sang, elle doit obtenir une réparation. »
Durant le Traité de Versailles, sous influence française, la Belgique est contrainte d’accepter une fédéralisation immédiate. Il y a la création du Parlement wallon à Namur. Les partis wallons, principalement le Parti Wallon Démocratique, héritier de Destrée et des socialistes alliés des français deviennent une force dominante en Wallonie.
Durant les années 1920, la Wallonie connaît une prospérité industrielle. Il y a le Développement d’une culture politique wallonne avec un drapeau, le coq hardi de Nivelles adopté officiellement en 1924, avec des hymne et des fêtes régionales. Il y a l’Émergence d’une presse wallonne puissante comme le Peuple Wallon, la Voix de la Sambre.
En 1930, c’est le centenaire de la Belgique : en Wallonie, les festivités prennent une tournure contestataire. Le slogan « 100 ans d’union, assez ! » devient populaire.
En 1940, l’Invasion allemande accentue les différences, en Flandre, certains groupes collaborent. En Wallonie, la résistance est fortement structurée autour du mouvement wallon.
En 1944 il y a la libération de la Belgique par les troupes alliées et françaises. La Wallonie réclame la sécession immédiate, mais les Alliés préfèrent maintenir la Belgique, transformée en confédération entre la Flandre et la Wallonie et Bruxelles.
Durant les années 50, c’est le Déclin charbonnier qui est amorcé, mais la Wallonie autonome investit massivement dans la sidérurgie moderne et le nucléaire civil notamment à Mol et à Tihange.
Durant l’Exposition universelle à Bruxelles de 1958 celle-ci marque un contraste, Bruxelles est internationale, la Flandre est tournée vers les Pays-Bas et la Wallonie vers la France.
Entre 1960 et 1961, il y a la grande grève du siècle dans notre réalité ce fut un mouvement social ici il a été transformé en rupture politique. En 1961, Le Parlement wallon proclame la souveraineté de la République wallonne. La France, rapidement suivie par le Luxembourg et l’Italie, reconnaissent le nouvel État. La Belgique cesse d’exister en tant qu’État unitaire.
Durant les années 1970, La République de Wallonie est reconnue par la CEE et l’ONU. Bruxelles devient une ville-État européenne sous statut international, abritant les institutions de la CEE. L’Industrialisation lourde est en crise, mais l’État wallon adopte un plan de reconversion avec la Chimie à Seraing, l’aérospatial à Charleroi, et l’électronique à Liège.
Durant les années 1980, il y a des crises sociales fortes avec un chômage élevé, mais la Wallonie maintient un État-providence solide. Il y a des relations spéciales avec la France avec des accords militaires et universitaires. Il y a la montée de l’idée d’une « double appartenance », wallonne et européenne.
En 1992, il y a la signature du traité de Maastricht. La Wallonie entre dans l’UE en tant qu’État fondateur distinctement de la Flandre et de Bruxelles.
En 1995, le premier TGV est établi entre Paris, Liège, Namur et Luxembourg dé montrant le symbole de l’intégration économique francophone.
Durant les années 2000, la Wallonie devient un petit État prospère grâce à l’aéronautique avec des entreprises comme Sonaca, Sabca, et l’extension vers Airbus mais avec aussi la biotechnologie comme à Liège et l’énergie avec des centrales nucléaires, puis renouvelables.
Il y aurait eu des coopérations renforcées avec le Québec, perçu comme « cousin francophone d’outre-Atlantique ».
En 2012, ce fut le centenaire de la Lettre au Roi, de grandes célébrations ont lieu à Namur et Liège. Le président wallon cite Destrée : « Nous avons fait de son rêve une nation. »
En 2016, avec les attentats de Bruxelles, la Wallonie coopère étroitement avec la France et le Luxembourg sur le renseignement.
En 2019 avec la crise climatique, il y a le lancement d’un plan « Wallonie verte » axé sur l’éolien en Ardenne et le photovoltaïque.
En 2020, la Wallonie gère seule la pandémie de COVID-19, avec des politiques plus proches de la France que de la Flandre.
En 2021, Bruxelles devient officiellement la « Capitale européenne indépendante » sous tutelle de l’UE, avec une participation financière wallonne et flamande.
En 2025, la République de Wallonie compte 5,2 millions d’habitants. Le PIB est par habitant supérieur à la moyenne européenne. Elle est membre du Conseil de sécurité de l’ONU en tant que membre non permanent. Elle a établi des relations très étroites avec la France et le Québec. L’idée d’une union fédérale avec la France ressurgit, mais reste minoritaire : la Wallonie s’affirme comme une petite nation francophone indépendante au cœur de l’Europe.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un instituteur de Charleroi en 1912 après la Lettre au Roi:
« Aujourd’hui, j’ai lu à mes élèves la lettre de M. Destrée. Ils ont applaudi ! Imaginez, des enfants de dix ans frappant dans leurs mains parce qu’on leur disait que la Wallonie est un peuple, pas une province oubliée… Moi-même, je n’y avais jamais pensé si fort. Je sens qu’un vent se lève. »
Témoignage fictif d’une infirmière à Liège en 1918 à la fin de la guerre:
« Les Allemands ont tout pris, brûlé nos maisons, nos usines, nos récoltes. Et pourtant, à l’hôpital, on ne parlait que d’une chose : “La France nous aidera, la Wallonie se relèvera seule.” Quand les rumeurs sont venues de Versailles, disant que Paris voulait soutenir notre cause, je me suis mise à pleurer. Pas de fatigue, non. De fierté. »
Témoignage fictif d’un ouvrier métallurgiste de Seraing en 1930 au centenaire de la Belgique:
« Cent ans de Belgique ? On a ri dans l’atelier. Cent ans qu’on donne notre sueur, nos bras, nos morts. Et qu’avons-nous reçu ? Des lois écrites à Bruxelles par des gens qui ne savent pas ce que c’est que de travailler à la mine. Alors oui, j’ai marché avec le drapeau au coq hardi. Pour une fois, j’avais l’impression de marcher pour moi, pour nous. »
Témoignage fictif d’une résistante wallonne en 1943, en pleine occupation allemande:
« Je cache dans mon grenier des tracts venus de Namur. On y lit : “Wallons, tenez bon, nous ne sommes pas seuls !” Ils parlent d’un parlement libre qui prépare déjà l’avenir. Moi, je ne suis qu’une couturière, mais chaque fois que je vois ce coq rouge sur le papier, je sens qu’on ne nous volera pas notre dignité. »
Témoignage fictif d’un député wallon à Namur en 1961 durant la proclamation de la République:
« Quand le président a déclaré l’indépendance, il y a eu un silence, comme suspendu, puis une clameur dans la salle et dans la rue. J’ai vu mes collègues pleurer, certains de rage, d’autres de joie. Moi, je pensais à mon grand-père, qui avait lu Destrée en 1912. Cinquante ans plus tard, nous y étions. La Wallonie, enfin maîtresse d’elle-même. »
Témoignage fictif d’une étudiante de Liège en 1983 durant la crise économique:
« Tout le monde disait que nous allions finir comme une Lorraine appauvrie. Mais à l’université, mes professeurs nous parlaient d’avenir : l’aéronautique, l’espace, les ordinateurs. On croyait à peine à leurs promesses. Et pourtant, dix ans plus tard, mon frère a été embauché chez Sonaca. Peut-être que ce pays, si petit, avait eu raison de croire en lui-même. »
Témoignage fictif d’un fonctionnaire européen à Bruxelles en 1992 après le Traité de Maastricht:
« C’était étrange. Nous signions un traité pour unir l’Europe, et autour de la table, il y avait trois délégations dont la France et la Flandre, et la Wallonie. Deux peuples qui, trente ans plus tôt, n’existaient pas comme États. On se disait : “Eh bien, les Wallons ont réussi leur pari.” »
Témoignage fictif d’une infirmière namuroise en 2020 durant la Pandémie de COVID-19:
« Quand Paris a fermé ses frontières, beaucoup ont eu peur. Mais notre gouvernement a pris ses propres mesures. Les Français ont regardé ce que nous faisions, pas l’inverse ! Nous avons prouvé que nous pouvions décider pour nous-mêmes. Pour moi, c’était plus fort qu’un vaccin : c’était une fierté nationale. »
Témoignage fictif d’un étudiant de Louvain-la-Neuve en 2025:
« On nous demande souvent : “Vous êtes Français ?” Et je réponds : “Non, Wallon.” Ça surprend, mais ça fait sourire. Nous ne sommes ni grands ni puissants, mais nous avons notre place. Entre Paris, Bruxelles et la ville de Luxembourg, notre petit pays tient bon. Quand je regarde l’histoire, je me dis que Jules Destrée aurait été fier. »

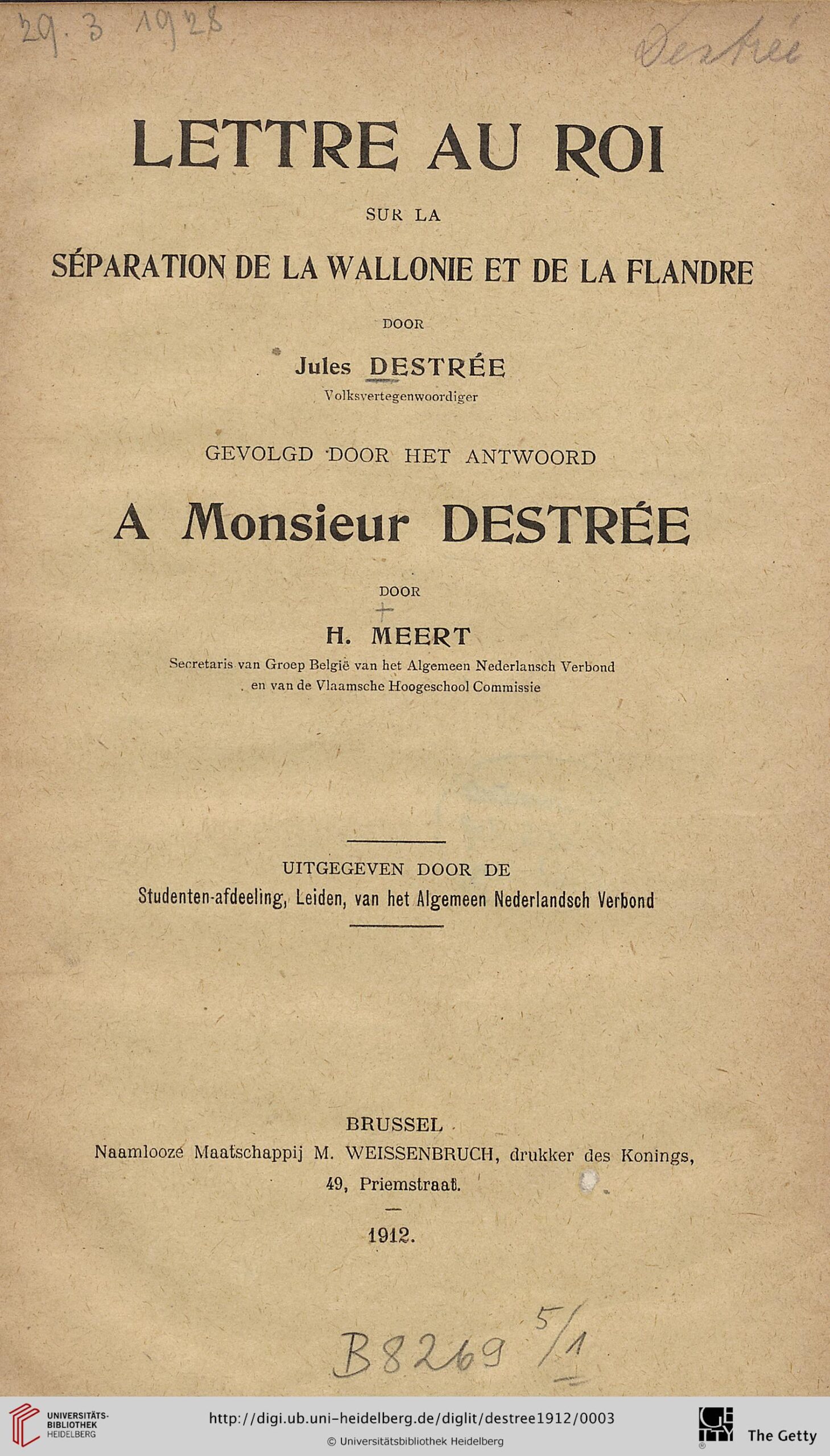
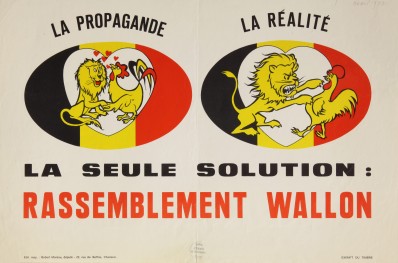
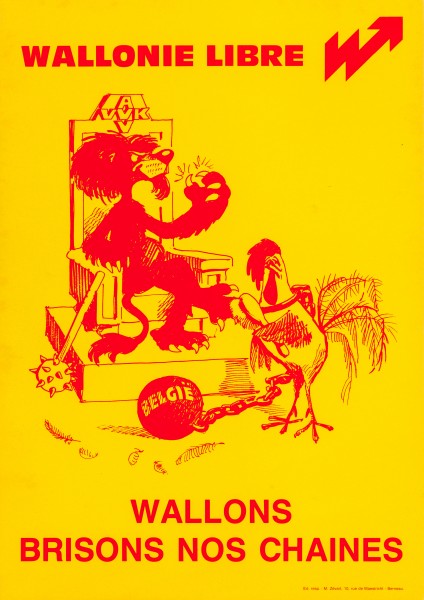
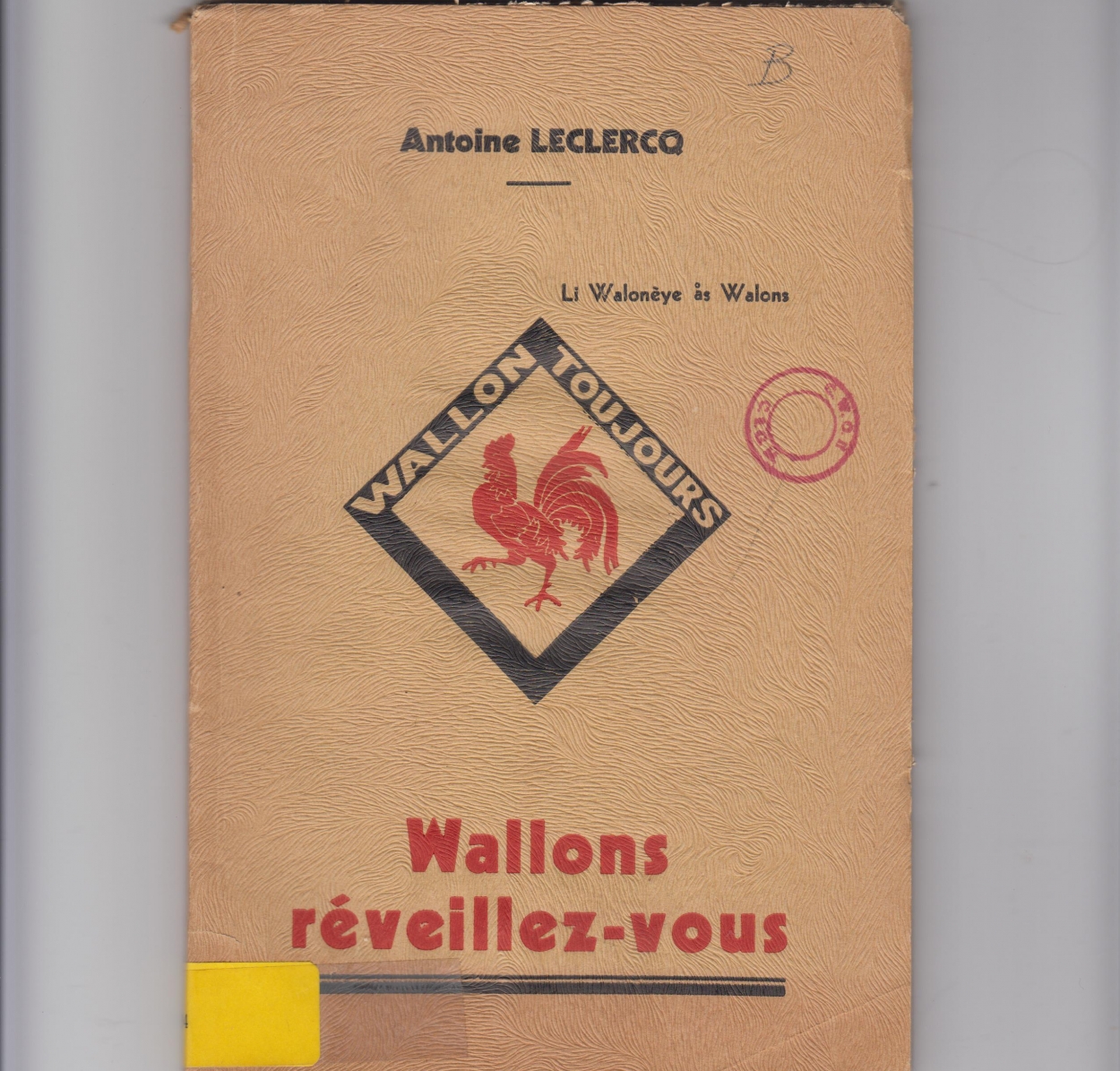

4.1) Et si le roi Albert 1er avait accepté durant au début de la 1ère guerre mondiale, l’ultimatum de l’Empire allemand?
Tout d’abord cela aurait été t’il réaliste?
Oui car, militairement, l’armée belge était très faible face à l’Allemagne. Albert Ier savait que résister équivalait à des destructions massives. Certains politiciens belges étaient favorables à une « neutralité accommodante ».
Cependant les arguments contre ce scénario sont plus nombreux les voici:
Albert Ier avait une forte fibre morale et nationaliste : accepter l’ultimatum aurait été vu comme une trahison historique. La Belgique avait été créée en 1830 comme État neutre garanti par les grandes puissances : céder revenait à détruire ce fondement. Sans l »héroïsme belge », la Belgique aurait été haïe par l’Entente et peut-être annexée par l’Allemagne de toute façon après la guerre.
Les causes possibles du choix d’Albert 1er auraient été que Albert, horrifié par l’idée d’une guerre écrasante, aurait pu céder pour « sauver son peuple » d’un bain de sang. Certains conseillers belges pouvaient penser qu’il valait mieux négocier avec l’Allemagne, voisine puissante, plutôt que compter sur une aide britannique incertaine. Si le roi Albert avait jugé que l’Entente n’était pas fiable ou qu’elle risquait d’abandonner la Belgique, il aurait pu se tourner vers Berlin.
Il n’y a pas de bataille de Liège, dans notre histoire, la résistance héroïque belge retarde l’armée allemande et bouleverse le plan Schlieffen. Dans cette uchronie, l’armée allemande fonce directement en France.
Paris aurait été encerclée plus vite sans retard belge, l’armée allemande pourrait atteindre la Marne plus tôt, peut-être avant que les Français ne soient prêts. La bataille de la Marne pourrait tourner à l’avantage de l’Allemagne avec un risque d’une victoire rapide sur la France qui était un scénario rêvé par le Kaiser.
L’opinion mondiale voit la Belgique comme ayant trahi son rôle de tampon neutre garanti par le traité de 1839. La « cause belge », qui avait mobilisé l’opinion britannique et américaine en 1914, n’existe pas.
Parlons maintenant de la chronologie possible:
Le 2 août 1914, Albert Ier accepte l’ultimatum allemand. La Belgique autorise le passage des troupes impériales.
Le 4 août 1914, il n’y a pas d’invasion brutale, pas de « viol de la neutralité belge ». Londres hésite, la cause belge ne justifie plus une entrée en guerre immédiate.
Le 20 Août 1914, L’armée allemande atteint la frontière française sans retard, il n’y a pas de bataille de Liège, ni de retard logistique majeur.
En Septembre 1914, la bataille de la Marne n’a pas lieu ou se déroule dans des conditions beaucoup plus favorables à l’Allemagne , Paris est menacé.
En Février 1915, la France capitule, contrainte à un traité humiliant avec l’annexion de l’Alsace-Lorraine confirmée, peut-être une zone d’occupation dans le nord.
En Mai 1915, le Royaume-Uni signe un armistice séparé, conservant sa flotte et son empire mais acceptant la domination allemande sur le continent.
En Novembre 1915, la Belgique est présentée comme neutre et coopérative,elle obtient la promesse de conserver son intégrité territoriale.
Entre 1916 et 1918, L’Empire allemand organise la Mitteleuropa qui est une zone économique dominée par Berlin, incluant la Belgique comme partenaire.La Russie s’effondre sous la pression germano-autrichienne. La Révolution bolchevique a lieu en 1917, mais l’Allemagne impose un traité de paix encore plus sévère à la Russie. Les États-Unis, jamais provoqués par la guerre sous-marine et sans « cause belge », restent neutres.
Dans les années 1920, l’Europe vit sous l’hégémonie allemande, L’Empire allemand domine économiquement la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne et l’Europe centrale. La France est affaiblie et politiquement instable. La Belgique profite d’une prospérité relative : son industrie travaille pour le marché allemand. Le roi Albert Ier est critiqué par certains patriotes, mais honoré par les élites conservatrices qui vantent sa « sagesse ». Il n’y a pas de traité de Versaille donc pas d’humiliation allemande et donc pas de nazisme.
Dans les années 1930, l’Empire allemand reste une monarchie autoritaire, modernisée mais pas démocratique. Il n’y a pas de crise économique aussi violente qu’aux États-Unis, car l’Europe intégrée à l’économie allemande amortit le choc de 1929. La Belgique reste un petit État prospère, mais vassalisé culturellement et économiquement.
Durant les années 1940, il n’y a pas de Seconde Guerre mondiale telle que nous la connaissons: Il n’y a pas pas de Hitler et donc pas de nazisme et pas d’Anschluss et pas de Blitzkrieg. Par conséquent, l’Allemagne poursuit son expansion coloniale en Afrique, au détriment de la France et du Royaume-Uni. La Belgique conserve le Congo, mais doit céder une partie de son exploitation minière à l’Allemagne.
Durant les années 1950, l’Europe est « germanocentrée ». Les élites belges sont germanistes, une partie de la jeunesse rêve pourtant d’une « vraie indépendance ». Les États-Unis, non intervenus en Europe, restent isolationnistes. L’URSS, plus faible qu’en réalité, reste cantonnée à l’Est. La guerre froide est en fait une rivalité entre l’Empire Allemand et les États-Unis sur le plan économique, avec un bloc soviétique marginalisé.
Durant les années 1960, Le Congo belge devient indépendant, mais sous forte influence germano-belge. Il n’y a pas de crise congolaise , car l’Allemagne garantit une transition contrôlée.
Durant les années 1970, le Reich allemand est devenu une monarchie constitutionnelle autoritaire et modernisée, elle lance des projets européens comme par exemple une union douanière continentale. La Belgique en est membre fondateur, mais sa souveraineté est réduite. Il n’y a pas de Communauté européenne façon 1957, c’est l’Allemagne qui dirige directement une « Mitteleuropa ».
Durant les années 1980, L’Allemagne impériale atteint son apogée, elle domine toute l’Europe continentale. La Belgique est prospère mais culturellement divisée entre les pro-français qui sont nostalgiques de la France et les pro-allemands, les pragmatiques. La guerre froide reste tiède avec les USA contre le Reich pour l’influence mondiale, surtout en Afrique et en Amérique latine.
Durant les années 1990, c’est la Chute de l’URSS qui est affaiblie et secondaire, l’Europe reste stable, sous domination allemande. La Belgique bénéficie d’un rôle de « banquier de l’Empire allemand », Bruxelles étant un centre financier majeur. Durant les années 1990. Il n’y a pas d’Union européenne mais une « Ligue de la Mitteleuropa » dominée par Berlin.
Durant les années 2000, le monde devient tripolaire avec le Reich allemand comme une puissance industrielle avec le bloc européen, les États-Unis comme puissance atlantique et la Chine comme une nouvelle puissance montante. La Belgique est totalement intégrée au Reich, comme le Luxembourg ou l’Autriche.
Durant les années 2010, Bruxelles devient l’un des grands centres économiques du Reich, il n’y a pas de Parlement européen, mais une administration impériale décentralisée. Le Congo est instable, alterne entre influence allemande et chinoise. La Belgique a perdu presque tout contrôle réel.
En 2025, la Belgique fête « 111 ans de paix », mais beaucoup de voix contestataires rappellent qu’elle a vendu son âme en 1914. Bruxelles est riche mais dépendante. L’histoire retient Albert Ier non pas comme le « roi-chevalier », mais comme le « roi prudent ».
Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Journal fictif d’un officier belge en 1914: «Le roi a parlé ce matin. Il a dit que la neutralité de la Belgique était préservée, que les Allemands ne viendraient que comme des « hôtes pressés ». Mais au fond de moi, je sais que nous avons abdiqué notre honneur. Mieux vaut vivre sous l’ombre du Kaiser, dit-on, que mourir sous ses canons. Mais je crains que l’histoire ne nous jugera lâches. »
Déclaration fictive du chancelier Bethmann-Hollweg au Reichstag en 1915:
« Grâce à la clairvoyance du roi Albert, la Belgique a prouvé qu’elle est une nation raisonnable. Tandis que la France s’effondre et que l’Angleterre recule, la Belgique reste debout, protégée par l’amitié allemande. »
Chronique fictive d’un indutriel belge en 1922:
« Les affaires sont florissantes. Les commandes affluent de la Ruhr et de Hambourg. Les Allemands investissent chez nous, et nos usines tournent à plein régime. Bien sûr, nos voisins français nous regardent avec haine : ils nous disent vendus. Mais je préfère la prospérité à la ruine. »
Tract fictif clandestin en Wallonie en 1938:
« Le roi Albert nous a promis la sécurité, mais à quel prix ? La Belgique n’est plus qu’un comptoir allemand. Nous parlons leur langue dans nos universités, nous suivons leurs ordres dans nos usines. Est-ce donc cela, la neutralité ? »
Discours fictif de l’empereur Guillaume III (le fils de Guillaume II) à Berlin en 1946:
« L’Europe vit en paix depuis trente-deux ans. Une paix allemande, juste et durable. La Belgique, fidèle alliée, montre à tous qu’il est possible de prospérer sous l’égide de l’Empire. »
Témoignage fictif d’un étudiant congolais à Léopoldville en 1960:
« On nous a donné un drapeau, mais pas la liberté. Les Belges obéissent aux Allemands, et nous, nous obéissons aux Belges. Le vrai maître reste toujours loin, à Berlin. »
Journal fictif intime d’une bruxelloise en 1983:
« On nous répète que nous avons eu de la chance, il n’y a pas eu de guerre mondiale, pas de bombardements, pas d’occupation. Mais je me demande parfois si nous vivons vraiment libres. Nous avons l’argent, les banques, le commerce… mais pas l’honneur. »
Interview fictive d’un historien américain à la télévision en 2001:
« La décision d’Albert Ier en 1914 a changé l’Histoire. Sans la « cause belge », les États-Unis ne sont jamais entrés dans la guerre. L’Allemagne a construit son Mitteleuropa et s’est imposée comme superpuissance. Mais ce choix a condamné la Belgique à n’être qu’un protectorat doré, un État-vassal prospère mais sans vraie autonomie. »
Témoignage fictif d’une militante belge à Bruxelles en 2025:
« On nous dit que nous vivons dans la paix allemande. Mais je lis les journaux de 1914, et je vois qu’on nous a volé notre destin. Albert aurait pu devenir un héros, il a choisi d’être un fonctionnaire du Kaiser. En 111 ans, nous avons gagné de l’argent, mais perdu notre âme. »
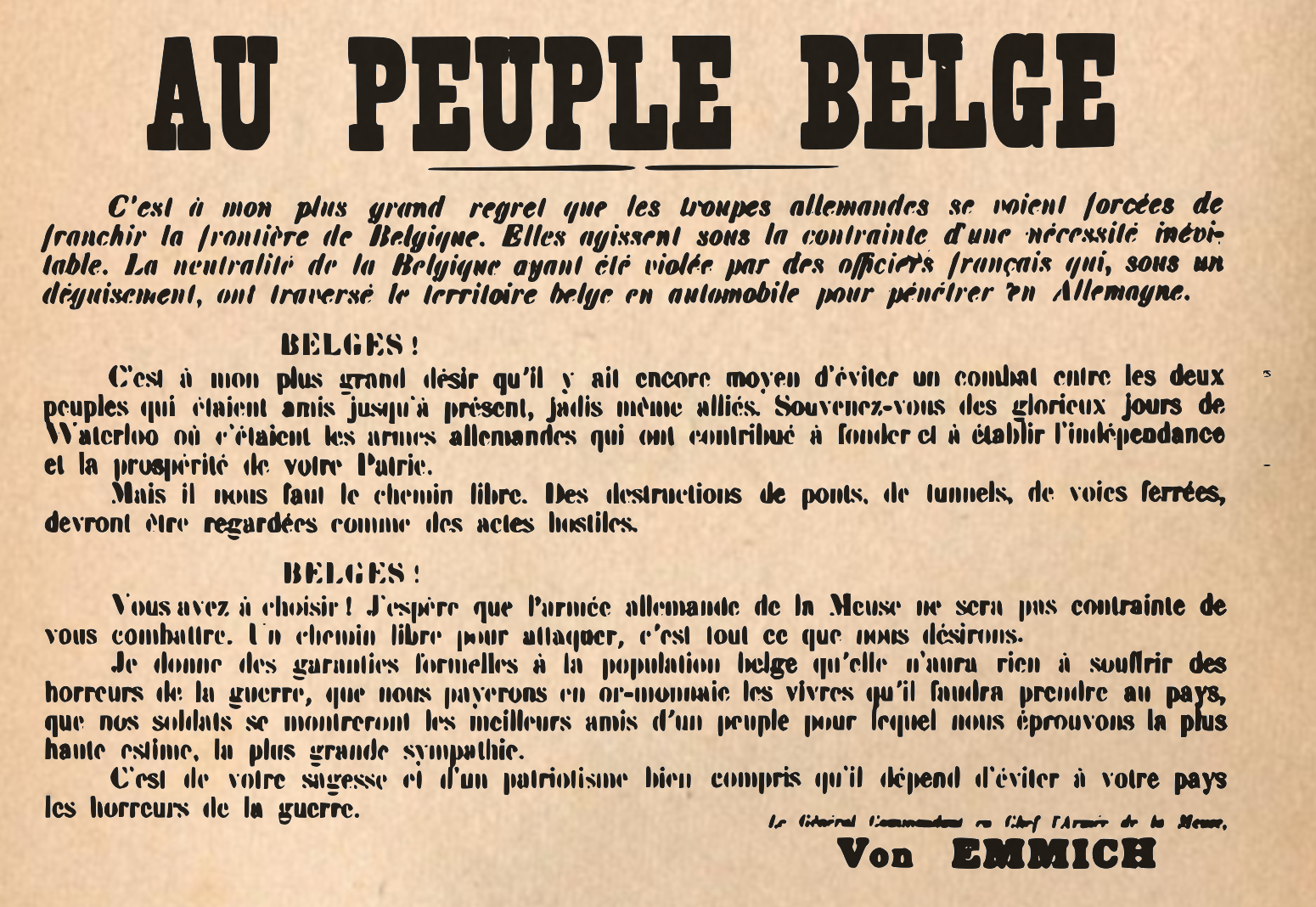
4.2) Et si la Belgique s’était beaucoup plus défendu face à l’occupant allemand durant la 1ère guerre mondiale?
Dans cette uchronie, au lieu d’appliquer une stratégie défensive limitée (ralentir puis se replier derrière l’Yser), le roi Albert Ier décide que la Belgique doit se battre jusqu’au bout sur tout son territoire, quitte à tout sacrifier. Le roi albert a donc décidé de faire une mobilisation totale des hommes valides. La Résistance urbaine est organisée avec des guérillas à Bruxelles, à Anvers et à Namur. Il y a des Sabotages massifs des voies ferrées et ponts. Il y a une collaboration systématique avec les services secrets français et britanniques.
Pourquoi avoir prit cette décision?
Albert Ier était très attaché à l’indépendance refuse toute compromission. l’Etat-major belge estime que chaque jour gagné en ralentissant l’avancée allemande est crucial pour l’Entente.
L’idée que la Belgique doit devenir une « nouvelle Sparte », un petit pays mais résistant héroïquement.
Le 2 août 1914, l’Ultimatum allemand est rejeté. Albert Ier proclame : « La Belgique vivra libre ou disparaîtra ! »
Le 4 août 1914, Liège résiste avec acharnement. Les forts tiennent près d’un mois, grâce à une défense acharnée et à des renforts belges massés en urgence.
Entre Août et septembre 1914, Bruxelles organise une résistance urbaine avec des barricades et des sabotages. Les civils participent activement, multipliant les embuscades.
En Septembre 1914, Grâce au retard belge, la contre-offensive française à la bataille de la Marne est plus décisive. Les Allemands reculent plus tôt et plus loin que dans notre réalité.
En 1915, la Belgique est en grande partie occupée, mais Anvers et la côte flamande tiennent encore. Une guérilla nationale s’organise dans tout le pays ,l’occupation devient cauchemardesque pour l’armée allemande. Les atrocités commises par les Allemands choquent encore plus le monde.
En 1916, la Belgique devient un symbole international comme la « Spartiate du Nord ». L’Entente envoie des armes des munitions et des volontaires pour soutenir la résistance. L’armée belge, épuisée mais héroïque, tient toujours une ligne autonome sur l’Yser.
En 1917, il y a l’Entrée en guerre des États-Unis. La propagande insiste sur « le petit royaume qui a tenu tête au géant allemand ». Albert Ier devient une icône internationale. Ses discours sont traduits dans la presse mondiale.
En 1918, les offensives allemandes du printemps se heurtent à une Belgique encore combative.
En novembre, l’Allemagne s’effondre. La libération de Bruxelles est célébrée comme une victoire belge autant que franco-britannique.
La Belgique sort exsangue avec des pertes immenses civiles et militaires, mais avec une gloire incomparable.
Durant le Traité de Versailles de 1919,
La Belgique, est une « victime héroïque », en plus d’Eupen-Malmédy elle aurait reçu quelques communes rhénanes. En plus du Ruanda-Urundi, Bruxelles reçoit le Cameroun occidental comme mandat. Albert Ier est surnommé « le Roi de fer ».
Durant les années 20, la Reconstruction est difficile, mais elle est soutenue par des réparations allemandes et l’aide de l’Entente. La Belgique devient un centre diplomatique international (proche du statut de Genève dans notre réalité). La Belgique reçoit un fort prestige militaire, celle-ci est considérée comme un modèle d’endurance.
Durant les années 1930, il y a la Montée des tensions en Europe. La Belgique, forte de son prestige, milite activement pour la sécurité collective. Bruxelles devient le siège de plusieurs institutions internationales.
En 1940, dans notre réalité, la Belgique fut envahie et balayée en 18 jours, ici, l’armée belge est préparée et fortement fortifiée, avec une culture militaire née de 1914-1918. La Wehrmacht se heurte à une défense acharnée comparable à celle de la Finlande contre l’URSS. L’offensive allemande est ralentie, la bataille de France dure plus longtemps, permettant aux Alliés de sauver davantage de forces.
Entre 1944 et 1945, c’est la Libération de Bruxelles. La Belgique est de nouveau glorifiée comme un rempart contre l’Allemagne. Après la guerre, elle joue un rôle central dans la création de l’ONU et du projet européen.
Entre les années 1950 et 1960, la Belgique reste un État militaire prestigieux.
Le Congo accède à l’indépendance, mais dans un climat moins chaotique, l’image héroïque de la Belgique donne plus de légitimité aux élites congolaises proches de Bruxelles. Léopold III abdique comme dans notre réalité, mais la monarchie reste populaire grâce à la mémoire d’Albert Ier.
La Belgique est vue comme une puissance moyenne crédible, pas seulement un petit État tampon. Son rôle militaire et diplomatique dans l’OTAN est plus important qu’en réalité. Bruxelles est choisie comme la capitale de la CEE, encore plus logiquement qu’aujourd’hui.
Durant les années 2000, la Belgique joue un rôle de médiateur dans plusieurs conflits, dans les Balkans et en Afrique centrale. Son armée est plus développée que dans notre réalité participe activement aux interventions de l’OTAN.
Dans les années 2010, il y a des crises communautaires que cela soit en Flandre et en Wallonie qui persistent, mais le prestige historique du pays empêche toute séparation réelle : les deux communautés savent que leur force vient de leur unité face à l’Allemagne. Bruxelles devient véritablement la « capitale politique du monde occidental ».
En 2025, la Belgique célèbre le 111e anniversaire de la défense nationale de 1914. Albert Ier est célébré comme un mythe fondateur, comparable à Churchill ou de Gaulle.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Lettre fictive d’un liégeois à sa fiancée en 1914: « Ma chère Louise,
Les canons tonnent jour et nuit, mais nous tenons bon. Les forts fument, les maisons brûlent, et pourtant le drapeau noir-jaune-rouge flotte encore. On dit que les Allemands sont invincibles, mais ici, dans nos collines, ils apprennent ce que veut dire la liberté belge. »
Journal fictif d’un paysan du Brabant en 1915: « Ils sont venus, ils ont pris nos récoltes, ils ont fusillé mon voisin qui avait caché des soldats. Mais hier soir, des résistants ont dynamité un train allemand. Le curé nous dit que nous souffrons pour la Patrie. Si nous devons mourir, ce sera debout. »
Discours fictif d’Albert Ier de Belgique à Anvers en 1916:« Belges, nous avons juré de ne jamais courber l’échine. Chaque jour que nous résistons rapproche la victoire. Souvenez-vous : nous ne sommes pas un petit peuple, nous sommes un grand pays qui a choisi l’honneur. »
Article fictif de 1917 du New-York Times: « La Belgique est devenue la conscience du monde. Ses villes en ruines, ses civils martyrisés, ses soldats indomptables sont l’incarnation même de la lutte entre liberté et barbarie. »
Carnet fictif d’un soldat belge libérant Bruxelles en 1918:
« Je suis entré dans ma ville avec les troupes de l’Entente. Les maisons sont en ruine, mais les cloches sonnent. Les gens pleuraient, nous embrassaient. Le roi marchait à nos côtés, l’air grave. Nous avons souffert comme peu de pays, mais nous avons gagné. »
Propos fictif d’un délégué français au traité de Versailles:« La Belgique a été notre bouclier. Sans elle, Paris serait tombée en 1914. Elle mérite plus qu’Eupen-Malmédy, elle mérite notre reconnaissance éternelle. »
Lettre fictive d’un soldat allemand sur le Front belge en 1940: « Nous pensions entrer en Belgique comme dans une promenade. Au lieu de cela, c’est un enfer. Chaque village est une forteresse, chaque route une embuscade. Ces Belges se battent comme s’ils n’avaient rien à perdre.
Témoignage fictif d’une résistance Bruxelloise en 1944: « Ils disaient que nous n’avions aucune chance, mais nous nous souvenions de 1914. Nous avions la mémoire du Roi-Soldat. Alors nous avons repris le maquis, saboté les convois, transmis les messages. Les Allemands ne comprenaient pas : ce petit pays refusait encore de plier. »
Discours fictif d’un dirigeant congolais lors de l’indépendance en 1960:
« La Belgique s’est battue pour sa liberté contre l’oppresseur. Aujourd’hui, c’est à notre tour de marcher dans ses pas. Si Bruxelles a pu tenir tête à l’Empire allemand, pourquoi Léopoldville ne tiendrait-elle pas debout dans le monde moderne ? »
Entretien fictif avec un vétéran belge à la télévision en 1985:
On m’appel héros, mais je n’étais qu’un jeune gars qui refusait de voir son pays mourir. Quand je vois Bruxelles aujourd’hui, capitale de l’Europe, je me dis que nos sacrifices n’ont pas été vains. »
Entretien avec un historien britannique à la BBC en 2001: « La décision d’Albert Ier a fait basculer l’histoire. Sans la résistance totale de 1914, la guerre aurait été plus longue, peut-être perdue. La Belgique n’est pas seulement un petit État, elle est l’un des piliers de la civilisation européenne moderne. »
Journal fictif d’une étudiante belge à Bruxelles:
« Aujourd’hui, nous avons défilé pour le 111e anniversaire de 1914. Dans les rues, on chantait : « Plutôt mourir debout que vivre à genoux. » Certains disent que c’est du passé. Moi je crois que c’est notre âme. La Belgique de fer vit encore en nous. »

4.3) Et si le Front de l’Yser durant la 1ère guerre mondiale n’avait pas tenu?
Dans notre univers, les belges en Octobre 1914 ont ouvert les écluses de Nieuport et ont innondés les plaines de l’Yser ce qui a stoppé l’avancée allemande. Dans cette uchronie la manoeuvre échoue car les écluses sont détruites par l’artillerie allemande et les innondations arrivent trop tard,l’armée belge épuisée et mal commandée se replie en désordre.
Dans cette uchronie en Octobre 1914, les écluses sont sabotées par un commando allemand, empêchant l’inondation. La fatigue extrême des troupes belges et le manque de munitions les obligent à reculer. Dixmude tombe le 20 octobre, puis Nieuport le 24. La Belgique est militairement écrasée.
Le 25 Octobre 1914, Le roi Albert Ier et le gouvernement belge se replient en exil à Londres. La Belgique est entièrement occupée. En Novembre 1914, les Allemands sécurisent toute la côte belge, y compris les ports d’Ostende et Zeebruges, qui deviennent des bases pour les sous-marins (U-Boote). En Décembre 1914, la Course à la mer est brisée : le front occidental atteint désormais la Manche. Les Alliés perdent l’accès direct à un front belge.
En 1915, au Printemps les U-Boote opérant depuis la côte belge intensifient la guerre sous-marine. Les convois britanniques sont attaqués plus près de leurs bases. En Avril 1915, la deuxième bataille d’Ypres n’a pas lieu (la région est allemande). Les premières attaques massives au gaz sont déployées contre les Britanniques en Artois. En Été 1915, le blocus maritime allemand est bien plus efficace : la Grande-Bretagne commence à souffrir de graves pénuries.
En 1916 en Février, La bataille de Verdun est lancée, mais avec davantage de troupes allemandes libérées de Flandre. Verdun tombe en août. En Juillet 1916, La Bataille de la Somme est lancée en urgence par les Britanniques et les Français, mais les pertes sont catastrophiques sans résultat significatif. En Automne 1916, L’Allemagne propose une “paix” incluant la Belgique annexée de facto, le Luxembourg, une partie du nord de la France et la Pologne comme État satellite.
En Avril 1917, l’entrée des États-Unis est retardée, l’opinion américaine est moins choquée, car la propagande alliée perd en crédibilité sans la Belgique martyrisée comme symbole de résistance. En Été 1917, les mutineries françaises s’intensifient après l’échec de l’offensive Nivelle. L’armée française est au bord de la rupture. En Automne 1917, les Britanniques se retrouvent seuls à tenir le front actif. L’Italie, défaite à Caporetto, demande l’armistice.
En Mars 1918, l’offensive allemande « Michael » réussit pleinement : les Allemands percent et atteignent Amiens et Calais. Les Britanniques commencent une évacuation partielle de leurs forces vers l’Angleterre. En Juin 1918, avec Paris menacée et l’armée française démoralisée, la France demande l’armistice. En Août 1918, c’est la Signature de la « Paix de Bruxelles » entre l’Empire allemand, la France et la Grande-Bretagne.
Les conséquences de cette guerre sont multiples: Tout d’abord, la Belgique cesse d’exister comme État indépendant, absorbée partiellement par l’Allemagne et transformée en territoire satellite. La Grande-Bretagne, affaiblie et privée de victoire, se replie sur son empire et adopte une posture isolationniste. Les États-Unis n’entrent pas en guerre en 1917, leur poids mondial émerge plus tard, de manière différente. L’Empire allemand sort de la guerre dominant le continent européen, avec une union douanière germano-européenne, la Mitteleuropa.La Russie, secouée par la révolution, devient bolchévique mais est isolée face à une Europe germanisée.
Le traité de Bruxelles a pour conséquence que le Nord de la France est sous occupation économique. La Pologne et la Lituanie deviennent des protectorat impériaux. LA Grande-Bretagne reconnaît la domination allemande sur le continent.
Voici la chronologie de la suite des évênements:
En 1919 a lieu la Fondation de la Mitteleuropa, une union douanière dominée par Berlin.
En 1920, Guillaume II abdique pour son fils Guillaume III (plus modéré), évitant une révolution.
En 1922, Mussolini prend le pouvoir en Italie. L’Allemagne impériale reste méfiante mais maintient des relations diplomatiques.
En 1925, La France installe un régime autoritaire nationaliste revanchard, mais reste militairement trop faible pour agir.
En 1926, La Grande-Bretagne bascule dans une dictature corporatiste menée par Oswald Mosley. L’Allemagne refuse toute alliance, considérant Londres comme instable.
Dans les années 1930, Berlin privilégie l’économie et la modernisation technologique. Les fascismes grandissent ailleurs, mais l’Allemagne reste monarchique, conservatrice, méfiante des aventures militaires.
En 1941, Staline tente de reprendre l’Ukraine, c’est le début d’une guerre totale germano-soviétique.
En 1945, Moscou tombe, l’URSS est démembrée. L’Allemagne contrôle l’Europe de l’Est jusqu’à l’Oural.
En 1946, c’est la Conférence de Berlin et la création d’une « Ligue impériale européenne », une union économique et militaire.
En 1950,Le monde devient bipolaire avec un bloc impérial avec l’Allemagne et ses satellites. Et un bloc anglo-fasciste avec le Royaume-Uni, l’Italie et la France autoritaire.
Les États-Unis restent isolés mais deviennent des alliés commerciaux des Allemands.
En 1962, a lieu la Crise nucléaire germano-soviétique qui a failli virer au drame évitée de justesse.
En 1968, la Chine, isolée, explose en plusieurs États rivaux, il n’y a donc pas de Mao triomphant.
Durant les années 70, Berlin reste la capitale du monde industriel. L’empire colonial allemand est toujours présent en Afrique avec le Cameroun, le Togo, la Namibie et le Congo, colonies qui sont fortement développées.
En 1991, L’URSS, affaiblie depuis 1945, s’effondre totalement. L’Allemagne établit une série de protectorats en Sibérie occidentale.
En 1999, c’est la Création de la Confédération impériale d’Europe, une fédération impériale dirigée par Berlin. Les monarchies locales (Autriche, Hongrie, Roumanie) sont restaurées sous patronage allemand.
Dans cette uchronie, il n’y a pas d’attentats du 11 septembre 2001, car les conflits au Moyen-Orient sont gérés par un protectorat impérial germano-ottoman.
Durant les années 2010, l’Anglais reste influent, mais l’allemand est la langue de la diplomatie et des sciences. La Chine, divisée, ne devient jamais une superpuissance. Les États-Unis et l’Empire allemand sont les deux piliers économiques mondiaux.
En 2025, L’Europe est unie sous l’Empire allemand, monarchique et conservateur. Les pays du bloc fasciste survivent, mais affaiblis, ils sont intégrés dans la sphère impériale.
Voici les témoignages concernant cette uchronie
Journal fictif d’un soldat belge à Dixmude, le 19 Octobre 1914:
« Nous avons tenu jusqu’ici, mais nous n’avons plus rien. Pas de munitions, pas de renforts. On nous disait que la mer viendrait à notre secours, que les plaines seraient inondées. Mais les écluses n’ont pas cédé. Les Allemands avancent, disciplinés, implacables. Demain, je crains que Dixmude tombe. Nous n’avons plus qu’à prier pour que le roi nous mène encore. »
Lettre fictive d’une infirmière à Nieuport, le 23 Octobre 1914:
« Les blessés affluent sans fin. Ils parlent de camarades écrasés par l’artillerie, de mitrailleuses impossibles à réduire. Les Anglais et les Français se replient déjà. Le roi Albert est là, parmi les siens, mais son visage est sombre. Nous savons tous ce que cela signifie : la mer ne nous sauvera pas. Bientôt, Nieuport sera allemande, et avec elle tout le pays. »
Témoignage fictif d’un réfugié flamand à Bruges en Novembre 1914:
« Nous avons fui avant l’arrivée des soldats allemands. Bruges est tombée sans combat. Ils ont hissé leurs drapeaux noirs, blancs et rouges partout. Certains Flamands disent que l’Allemagne est notre avenir, que nous serons mieux traités qu’avec Bruxelles. Moi, je n’y crois pas. La Belgique était notre patrie. Maintenant, elle n’est plus qu’un souvenir. »
Lettre fictive d’un prêtre wallon à Namur en avril 1915:
« L’occupant se veut courtois, mais ferme. Les écoles doivent enseigner l’allemand, les sermons doivent éviter la politique. On nous dit que la Belgique est dissoute, que nous faisons partie du Reich. Les paysans obéissent, par peur. Mais chaque enterrement est l’occasion de rappeler la vérité : nous sommes Belges, même si l’État a disparu. »
Journal clandestin fictif à Bruxelles à l’Été 1916:
« La vie continue, mais sous leurs lois. Le pain est rationné, les usines travaillent pour l’armée allemande. Les journaux ne publient que ce qu’ils ordonnent. Pourtant, dans les cafés, on murmure que la France est à bout, que l’Angleterre souffre. On murmure aussi que nous ne reverrons jamais la Belgique. Et si c’était vrai ? »
Carnet fictif d’un cheminot à Liège, en février 1917:
« Les trains partent chaque jour vers l’est, chargés de charbon et d’acier. C’est notre richesse qu’ils prennent. Les ouvriers disent que nous ne travaillons plus pour la Belgique, mais pour Berlin. Des jeunes disparaissent, enrôlés de force pour les travaux en Allemagne. Nous pensions que l’occupation serait temporaire. Aujourd’hui, elle ressemble à une annexion. »
Lettre fictive d’une institutrice flamande à Gand en octobre 1917:
« Les enfants apprennent désormais l’allemand à l’école. On leur dit que Bruxelles n’est plus leur capitale, mais Berlin. Certains s’y adaptent vite, ils chantent les hymnes impériaux avec fierté. Mais dans les maisons, on parle encore flamand et français. On nous vole notre pays par les livres et les chansons. Cela me brise le cœur. »
Journal fictif d’un soldat belge en exil à Londres en janvier 1918:
« Nous ne sommes qu’un petit groupe, les restes de l’armée belge. Le roi nous a conduits ici, mais nous ne sommes plus qu’une armée sans patrie. Les Anglais nous regardent avec pitié. La Belgique, disent-ils, est morte en 1914. Mais tant que nous vivons, elle ne mourra pas dans nos cœurs. »
Dernière entrée fictive d’un notaire wallon à Bruxelles en 15 août 1918:
« Paris encerclée, la France plie. Les Allemands disent que la guerre est gagnée, et que désormais nous faisons partie de leur empire pour toujours. Certains s’y résignent, d’autres rêvent encore d’indépendance. Moi, je suis fatigué. Je n’ai plus la force d’espérer. Je lègue mes biens à mes enfants, mais quelle patrie auront-ils ? Seront-ils Belges, ou Allemands ? »
Journal fictif d’un étudiant wallon à Louvain le 12 Mars 1922:
« L’université est à moitié allemande désormais. Les cours de droit sont donnés en allemand, on étudie les codes prussiens. Les professeurs disent que nous devons être de « bons sujets impériaux ». Mais dans les cafés, nous parlons wallons, nous chantons encore des airs interdits. On nous accuse d’être rétrogrades, mais moi je veux rester Belge, même si la Belgique est morte. »
Lettre fictive d’un exilé belge à Londres, le 3 juillet 1926:
« Dix ans déjà que je vis en exil. La Belgique est un souvenir. Nous avons essayé de convaincre les Anglais de nous aider, mais ils s’en fichent : leur propre pays est tombé sous le joug fasciste. Chaque fois que j’entends un compatriote parler wallon ou flamand, j’ai le cœur serré. Nos langues survivent, mais notre État est effacé. »
Témoignage fictif d’un industriel flamand à Anvers ,le 8 novembre 1930
« Les Allemands ont investi nos ports, nos usines. Le commerce marche, l’argent circule, Anvers prospère. Mais ce n’est plus notre prospérité. Les profits partent à Berlin, les ordres viennent de Berlin, et même nos affiches sont en allemand. Certains disent que nous devons nous réjouir : l’Empire nous a modernisés. Mais à quel prix ? »
Journal fictif d’une institutrice wallonne à Namur, le 17 mai 1935:
« Les enfants ne connaissent plus l’histoire de la Belgique. On leur parle de « provinces occidentales de l’Empire », on leur apprend que Guillaume III est leur empereur. Quand je leur parle de Léopold Ier ou du roi Albert, certains ne savent même pas de qui il s’agit. La Belgique meurt dans les mémoires. »
Carnet fictif d’un jeune résistant clandestin à Liège, le 2 avril 1941:
« L’Europe est en feu. Les Allemands se battent contre les Russes à l’Est. Certains disent que c’est notre chance, mais nous ne sommes plus qu’une poignée. Comment libérer un pays qui n’existe même plus ? Nous ne voulons pas d’un retour à la France ou à l’Angleterre fascistes. Nous voulons la Belgique. Mais qui se battra encore pour elle ? »
Lettre fictive d’une mère flamande à son fils qui est un soldat impérial à Gand le 19 septembre 1944:
« Mon fils, tu combats loin, en Ukraine, sous l’uniforme impérial. Tu crois défendre ton foyer, mais en réalité tu sers un maître étranger. Ton père est tombé à l’Yser pour la Belgique, et toi tu combats pour Berlin. Comment puis-je être fière ? Je t’aime, mais je pleure chaque fois que je vois ton uniforme. »
Journal fictif d’un vieil homme wallon à Bruxelles, le 9 mai 1955:
“J’ai 70 ans. J’ai vu mourir mon pays en 1914. Depuis, nous vivons dans une paix froide, une paix de soumission. Les jeunes ne parlent plus de Belgique, ils parlent de l’Empire. Ils se disent Berlinois ou Européens. Moi, je me dis Belge. Peut-être suis-je le dernier. »
Témoignage fictif d’un ouvrier mineur à Charleroi, le 3 août 1971:
« Les mines tournent à plein régime. L’acier part vers l’Allemagne, les usines appartiennent à des compagnies prussiennes. On nous dit que nous faisons partie du moteur impérial. Mais à la fin du mois, nos salaires sont maigres et nos familles restent pauvres. La Belgique était-elle si différente ? Peut-être pas… mais au moins, elle était nôtre. »
Mémoire fictive d’un étudiant à Bruxelles, le 20 juin 1989
« Dans les bibliothèques, je trouve encore des livres interdits : « Histoire de Belgique ». On y parle de rois, de batailles, de révolution en 1830. Tout cela a disparu des manuels. À l’université, on se moque de moi quand je parle de la Belgique. On me dit que c’est un mythe. Peut-être que oui… mais alors pourquoi ai-je mal au cœur quand je lis ces vieux livres ? »
Carnet fictif d’une vieille résistante à Namur le 11 novembre 2000:
« Aujourd’hui, les jeunes ne comprennent pas pourquoi je garde un drapeau noir-jaune-rouge. Pour eux, c’est une curiosité folklorique, comme un vieux costume. Ils ne savent pas que c’était notre patrie. Je me demande parfois si nous avons eu tort de rêver. Peut-être que la Belgique n’aura existé qu’une brève parenthèse, effacée par l’histoire. Mais moi, je n’oublierai jamais. »
Témoignage fictif d’un adolescent à Liège le 21 juillet 2025:
“ On dit que c’est le « Jour de l’Empire ». Toute l’Europe fête Guillaume V à Berlin. Mais mon grand-père m’a raconté qu’autrefois, à la même date, nous fêtions la Belgique, née en 1830. J’ai regardé en secret des vieilles images d’un défilé à Bruxelles, avec un drapeau que je n’ai jamais vu dans les rues, Noir,jaune,rouge. J’ai ressenti une étrange fierté. Comme si une partie de moi s’en souvenait. »
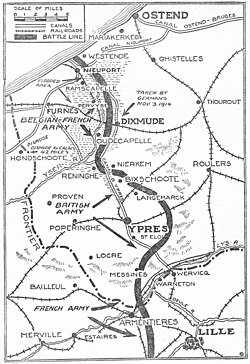


4.4) Et si la Belgique avait perdu la première guerre mondiale?
Ce scénario se base sur le mod Kaizerredux du jeu Heart of Iron qui est un jeu de grande stratégie.Kaizerredux est un mod où l’empire Allemand a gagné la première guerre mondiale
Quel est l’état de la Belgique vaincue?
Tout d’abord dans cette uchronie la Belgique s’appelle désormais le Royaume de Flandre-Wallonie, une partie du territoire de l’actuelle Belgique a été annexé dont le territoire du Luxembourg belge et aussi une partie du Hainaut jusqu’à la frontière avec Liège.
L’histoire commence en 1936 comme la plupart des parties de ce jeu où tout d’abord nous avons le budget d’état qui est évalué, le conseil flamand(qui a beaucoup plus de pouvoir que dans notre réalité à cause de la Flamenpolitik mais aussi car une grande partie du territoire wallon n’est plus avec une partie de sa population. Le conseil flamand demande la permission au roi de couper dans les dépenses qui coûtent beaucoup au budget de l’État. Par la suite des scandales politiques sont arrivés, des rumeurs à cause de ces scandales dans cette uchronie il est possible que le conseil flamand soit remplacé par des conseillers fidèles dont les autorités allemandes ont confiance. Le système de vote est réformé dans cette uchronie pour avoir plus de contrôle sur la situation politique
Par la suite le monarque, qui se nomme Adalbert et qui est le troisième fils du Kaiser Guillaume II, ils l’ont peut-être mis sur le trône car son nom ressemblait à celui du roi Albert qui dans cette uchronie est parti en exil au Canada et ce qui est assez drôle c’est que dans cette uchronie ce que l’on appel dans notre réalité le canal Albert à Anvers qui a été inauguré en 1939, s’appel dans cette réalité le Canal Adalbert. Le roi Adalbert qui dans cette uchronie a deux choix soit il préfère avoir un pouvoir despotique en réaction des scandales politiques. Pour permettre une plus grande influence de l’allemand évidemment dans cette réalité alternative l’éducation en allemand est renforcée. À cause des scandales politiques la Feldgendarmerie qui fait partie du département de police allemand et est une source de support très loyale, en recrutant plus de membres allemand dans cette force les autorités allemandes pourront donc plus réprimer dans cette uchronie la résistance liée aux scandales. Dans cette uchronie, la fondation de la NIR qui est l’organisation de propagande allemande de radio et de télévision est étendue. Les autorités allemandes dans cette uchronie bannissent les coopératives liées au syndicalisme. Mais il y a une autre possibilité de solution suite aux scandales dans le gouvernement de Flandre-Wallonie c’est de permettre au conseil flamand de pouvoir s’occuper du budget de l’année 1936 et aussi que le roi Adalbert permet les parties d’opposition de siéger au parlement. Plus tard dans cette chronologie uchronique en 1938, des élections sont de nouveaux confirmées d’avoir lieu car avant 1936 depuis la défaites de la Belgique presque 20 ans plus tôt un gouvernement militaire avait prit le pouvoir légitimant son pouvoir sur la peur des radicalismes mais cette élection de 1938 permettra tout comme celle de 1936 de permettre d’éviter un effondrement politique. Dans ces élections deux partis peuvent arriver au pouvoir le parti catholique et le parti ouvrier belge, le parti catholique qui aurait eu le plus de chance de l’emporter car celui-ci a régné sur le pays grâce au conseil flamand, celui-ci veut permettre d’améliorer le niveau général d’éducation dans son programme. Le parti catholique a décidé dans son programme uchronique d’étendre l’organisation Caritas qui vise à aider les plus miséreux que cela soit en Flandre ou en Wallonie. Contrairement a l’autre voie alternative dont nous avions parlé la tout a l’heure de cette uchronie ici la Vlaamse Wacht qui fut dans notre réalité la garde flamande créé notamment par le VNV qui fut une garde paramilitaire mais dans cette uchronie le réseau de police de cette garde flamande est un désordre pas possible et par conséquent la Feldgendarmerie ou gendarmerie de campagne qui était aussi une police militaire dans notre univers et dans l’uchronie et cette gendarmerie avait beaucoup de problèmes avec la police normale car ils ont des jobs spécifiques de même que cela mène à des dépenses non-nécessaires et une perte de confiance entre les différentes branches. La solution aurait été dans cette uchronie une nouvelle proposition de la part d’une coalition au parlement de créer une force centralisée du nom de rijkswacht qui signifie tout simplement gendarmerie et celle-ci prendra le dessus sur toutes les autres branches à part les services secrets. Dans le gouvernement du Royaume de Flandre-Wallonie dans cette uchronie les allemands sont toujours favorisés par rapport aux belges dans les hautes positions du gouvernement dans cette uchronie le système judiciaire combat le favoritisme germaniste. Comme je vous l’avais précisé précédemment beaucoup de liberté civile ont été retirées aux belges après la capitulation de la Belgique en 1918 avec un contrôle sur la presse, le judiciaire et l’exécutif,pouvoir qui étaient remis au régime centralisateur du roi Adalbert c’est pour cela que le roi a décidé dans cette uchronie de restaurer la loi Lejeune de manière symbolique,celle-ci existait depuis 1888 en Belgique et qui permettait à quelqu’un de purger sa peine conditionnellement en dehors de la prison sous certaines conditions le roi Adalbert dans cette uchronie veut apaiser le patriotisme belge de même que la loyauté envers le roi exilé Albert 1er qui dans cette uchronie est toujours vivant en 1936, car il n’était pas présent en 1934 à Marches-les-Dames et donc dans cette réalité il n’est pas mort dans un accident d’escalade. Dans cette uchronie le roi Adalbert a décidé de faire reconstruire la Bibliothèque de Louvain qui avait été détruite durant les premières semaines de la première guerre mondiale le gros problème c’est que les investisseurs allemands ont priorisés l’Université de Gand par rapport à celle de Louvain ce qui a mené à une récupération lente de sa collection. En leur donnant des subventions importantes, le gouvernement du Royaume de Flandre-Wallonie espère calmer les populations belges. Subventions qui viennent aussi de la part de donneurs et en faisant des travaux, les étagères vont de nouveau être remplies.
Dans cette uchronie le gouvernement de Flandre-Wallonie a décidé d’étendre le Westwall(où le mur de l’Ouest) la ligne Siegfried pour faire face à la menace syndicaliste car dans cette uchronie l’idéologie syndicaliste qui n’existe pas dans notre réalité veut donner comme vous l’aurez compris simplement beaucoup de pouvoir aux syndicats bref la France est devenue la France communarde et le Royaume-Uni est devenue l’Union britannique et le gouvernement français a émigré dans ses colonies et le gouvernement britannique dans le Dominion du Canada bref la Commune de France et l’Union Britannique sont évidemment revanchards. Concernant l’armée du royaume de Flandre-Wallonie(pour simplifier maintenant j’utiliserai le mot RFW) dans celle-ci il y a un large conflit avec beaucoup de langues utilisées par les soldats et en plus que les soldats ne peuvent être que des citoyens allemands dans cette uchronie un débat aurait été intéressant. Des réformes pour le RFW auraient aussi été nécessaires dans le système des provinces la Flandre et la Wallonie seraient devenues 9 provinces et de séparer en même temps les responsabilités économiques en 3 entre la Flandre,la Wallonie et Bruxelles le RFW aurait été plus capable d’adapter le pays aux exigences locales. Concernant l’armée dans cette uchronie les occupants allemands auraient poussé la haine contre les Français syndicalistes (À ne pas confondre avec les français nationalistes dans les colonies) pour que les mouvements flamands se rallient derrière les étendards allemands en leur rappelant le slogan “Schild en Vriend” ou “bouclier et ami” utilisé durant la révolte flamande de 1302 par conséquent dans cette histoire alternative la Flamenpolitik aurait été arrêté car cela causait une certaine aversion des wallons à l’encontre des allemands. Le gouvernement dans cette uchronie autorise l’expansion des manufactures de FN Herstal qui fabrique des armes légères. La guerre se gagne aussi grâce aux camions c’est pour cela que dans cette uchronie le gouvernement du RFW a décidé de choisir Minerva qui produit des automobiles de luxes mais aussi des camions pour la guerre mais il est aussi possible que dans cette uchronie le l’armée du RFW choisisse de se tourner vers les camions de la compagnie Brossel, qui fut une compagnie civile de bus et de trains à notamment avec les bons fonds le gouvernement pourra leur permettre d’étendre leur capacité de produire des camions militaires dans cette uchronie. Des investissements de la part du gouvernement aurait été aussi possible dans la fonderie royale des canons qui est spécialisée dans la production massive de pièces d’artillerie et d’anti-tanks dans cette uchronie. Concernant le naval à zeebrugge dans cette uchronie c’est le réel port de mer indépendant lié à la Flandre-Wallonie qui ne peut pas être bloqué par des envahisseurs hollandais et donc construire la flotte là-bas aurait été la meilleure location. Concernant l’économie celle-ci a besoin d’être florissante c’est c’est pour cela que dans ce scénario uchronique l’industrie du diamant a été monopolisé à Anvers où dans la Mitteleuropa(la zone économique allemande dans cette uchronie) près de 80% des diamants transitent avec le commerce, le monopole est quasiment certain pour la Flandre-Wallonie dans cette histoire alternative, le lundi noir(qui est dans ce scénario la crise de 1929, le crash-boursier mais qui est arrivé ici dans ce scénario à Berlin au lieu de Wall-Street mais ici en 1936) Pour stopper le syndicalisme dans la Province de Liège dans cette uchronie, un projet de grandes infrastructures de l’industrie civile a été proposé autour de la ville de Liège, dans le sillon industriel.
Dans cette uchronie,le roi Adalbert se méfiait des wallons car selon lui ils ne savaient pas maintenir l’ordre où d’avoir la Loyauté envers les divisions flamandes,le roi Adalbert préfère retirer les wallons des troupes en les exemptant de l’armée avant qu’un désastre n’arrive si la Commune de France attaquerait Dans cette uchronie le problème de la vlaamse wacht c’est que selon Hendrik Elias ce serait dû à un manque de personnel qui l’empêcherait de stopper toutes les insurrections. Le Frontbeweging(ou le Frontisme était une tradition de la part d’intellectuels flamands qui s’opposait à la question linguistique dans l’armée et dans notre réalité plus favorable à ce que les ordres soient donnés en Français,ceux-ci visitent les tours de l’Yser considérant que la bataille de l’Yser fut même dans cette uchronie le plus fier moment de l’histoire flamande. Concernant les soldats wallons dans cette uchronie qui ont été démis de leurs fonctions, pour permettre selon lui:”une frontière stable et forte” le roi Adalbert a donné l’ordre d’augmenter le recrutement dans toutes les provinces flamandes.
L’empire allemand dans cette uchronie considère que les ports de Flandre-Wallonie surtout celui d’Anvers est le plus important qui permet de lier les autoroutes allemandes avec les autoroutes de la Flandre-Wallonie, dans ce scénario uchronique le RFW veut encourager la dépendance allemande qui permettra de sécuriser une reprise plus douce de l’économie après le Crash et même faire un beau profit. Un plan a été mis en place par la commission gouvernementale de faire appel et de donner des fonds à la société cimentière et briqueteries réunis pour soutenir les grands projets d’infrastructures partout en Europe en créant une offre suffisamment importante combiné avec l’expérience technologique du Royaume de Flandre-Wallonie cela permettra de dominer le marché et de diriger le pays vers un futur plus profitable dans cette uchronie. Dans cette uchronie le RFW joue un double jeu car il veut développer les aciéries à Seraing pour diminuer la dépendance à l’acier allemand. Dans cette uchronie donner des fonds pour l’institut Solvay c’est permettre des innovations technologiques car depuis le début du 20ème siècle cet institut a été au premier plan de l’innovation technologique en accordant des subventions aux scientifiques belges mais aussi de financer des projets étrangers le Royaume de Flandre-Wallonie a été remarqué positivement dans cette uchronie par des scientifiques comme Marie-Curie,Albert Einstein et beaucoup d’autres et c’est pour cela que les Congrès de l’Institut Solvay notamment dans cer exemple sur l’électron sont importants pour inviter les meilleurs scientifiques notamment dans les débats sur le magnétisme durant ce sixième congrès à la fin des années 30 dans cette histoire alternative. Précédemment durant le cinquième Congrès de l’Institut Solvay et les scientifiques ont découvert l’importance des matériaux radioactifs et le gouvernement du Royaume de Flandre-Wallonie a utilisé son influence en Union-Minière au Congo pour mettre la main sur l’uranium car même si l’état “libre” du Congo est sous l’autorité de l’empire allemand des sociétés étrangères peuvent exploiter les ressources dans cette uchronie.Le roi Adalbert a décidé que même si les capacités militaires sont limitées par les restrictions imposées par l’Empire allemand la chose que le roi a choisi est d’opter pour des forces auxiliaires, de développer la police militaire pour maintenir la paix au lieu de s’assurer une obéissance complète du peuple Flamand-Wallon.Dans cette uchronie le RFW ne s’attarde pas à créer une force aérienne étant donné qu’il peut compter sur la force aérienne allemande mais aussi grâce à des accords intelligents de faire du reverse engineering(ou ingénierie inversée) les constructeurs d’avions à la SABCA(ou société anonyme belge de construction aéronautiques) et Renard(du nom d’Alfred Renard qui est un belge qui a créé plusieurs entreprises aéronautiques) proposera surement des améliorations. Dans cette uchronie l’armée allemande demande pour préparer la prochaine future guerre face à la troisième internationale qui regroupe la Commune de France,l’Union britannique et la république socialiste d’Italie(Italie qui est divisée en 5 partie suite à la guerre civile de cette uchronie) de couvrir la ligne de forteresse qui est liée à la ligne Ludendorff(qui n’existe pas dans notre réalité) et de stopper toute menace française évidemment la couverture aérienne sera une nécessité pour ça. Malgré la défaite de l’armée belge dans cette uchronie, dans la guerre des tranchées néanmoins elle a permis de renforcer le personnel officier pour la prochaine guerre à venir. Dans cette uchronie la ligne de la Meuse est la dernière ligne de défense en cas d’invasion du territoire et donc celle-ci est fortement fortifiée pour arrêter des invasions même allemande en Flandre-Wallonie(sait t’on jamais où une invasion de la Commune de France dans l’Empire allemand. La Ligne Ludendorff est la première ligne de défense dans cette uchronie, une ceinture défensive sur la frontière française, la priorité pour le budget militaire est de fortifier les points faibles de cette ligne de défense. Les chasseurs ardennais qui dans notre réalité étaient des unités mobiles mais aussi défensives qui se trouvaient dans les plaines et dans les forêts des Ardennes, dans cette uchronie celles-ci permettront de stopper la Commune de France d’entrer en Rhénanie. Dans cette uchronie il y a deux choses qui sont possibles soit les restrictions allemandes sur l’armée de Flandre-Wallonie sont enlevées et par conséquent celle-ci peut créer des forces indépendantes avec des commandants qui seront assignés à des divisions qui parlent leurs langues et vice versa. À l’inverse il est possible dans cette uchronie que l’armée du Royaume de Flandre-Wallonie choisisse de favoriser l’Empire allemand considérant que dans cet univers alternatif l’armée allemande étant bien meilleure que l’armée du Royaume de Flandre-Wallonie, il aurait donc l’expertise en matière d’armée.



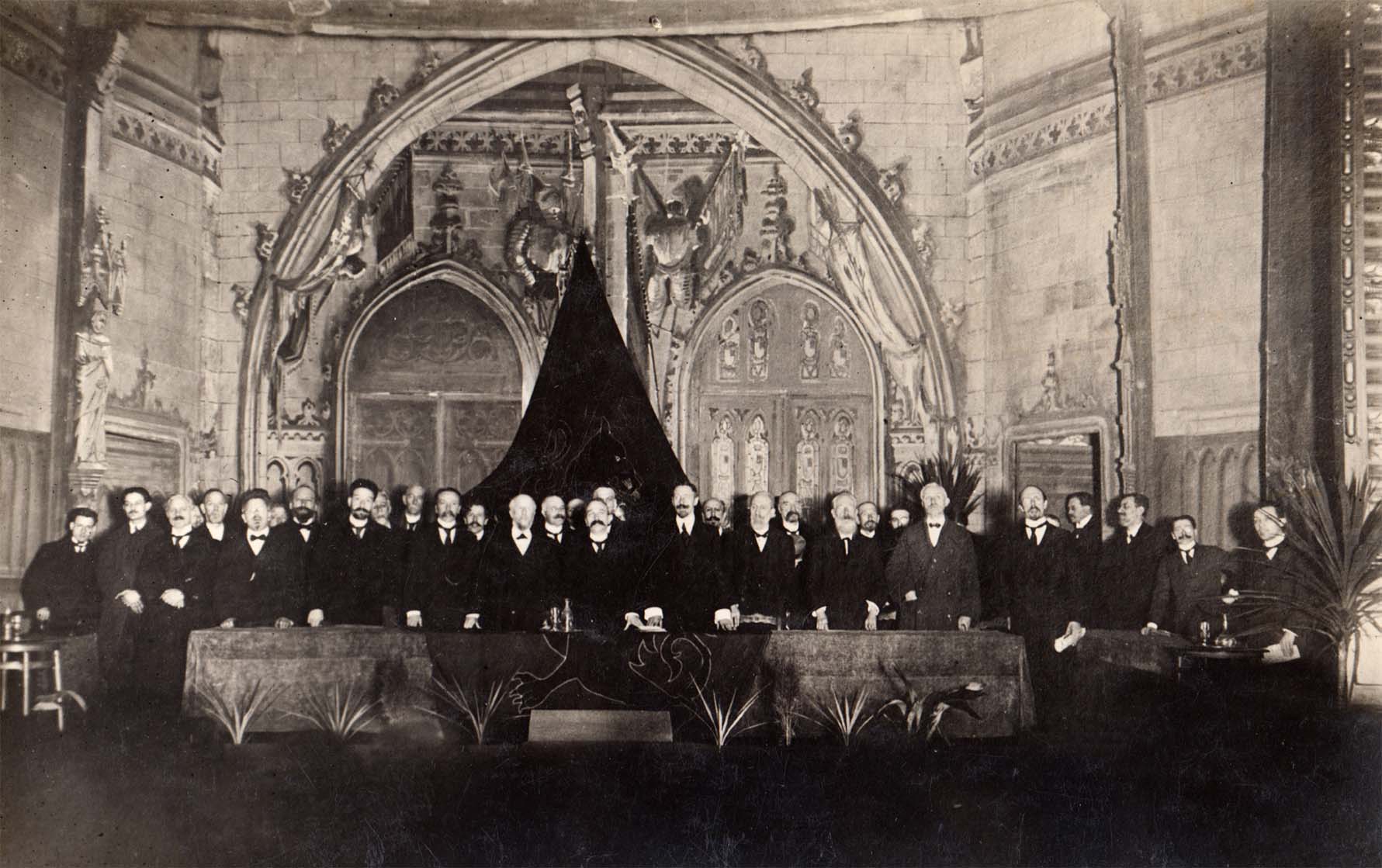
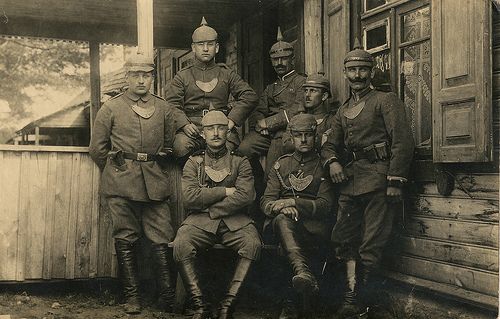
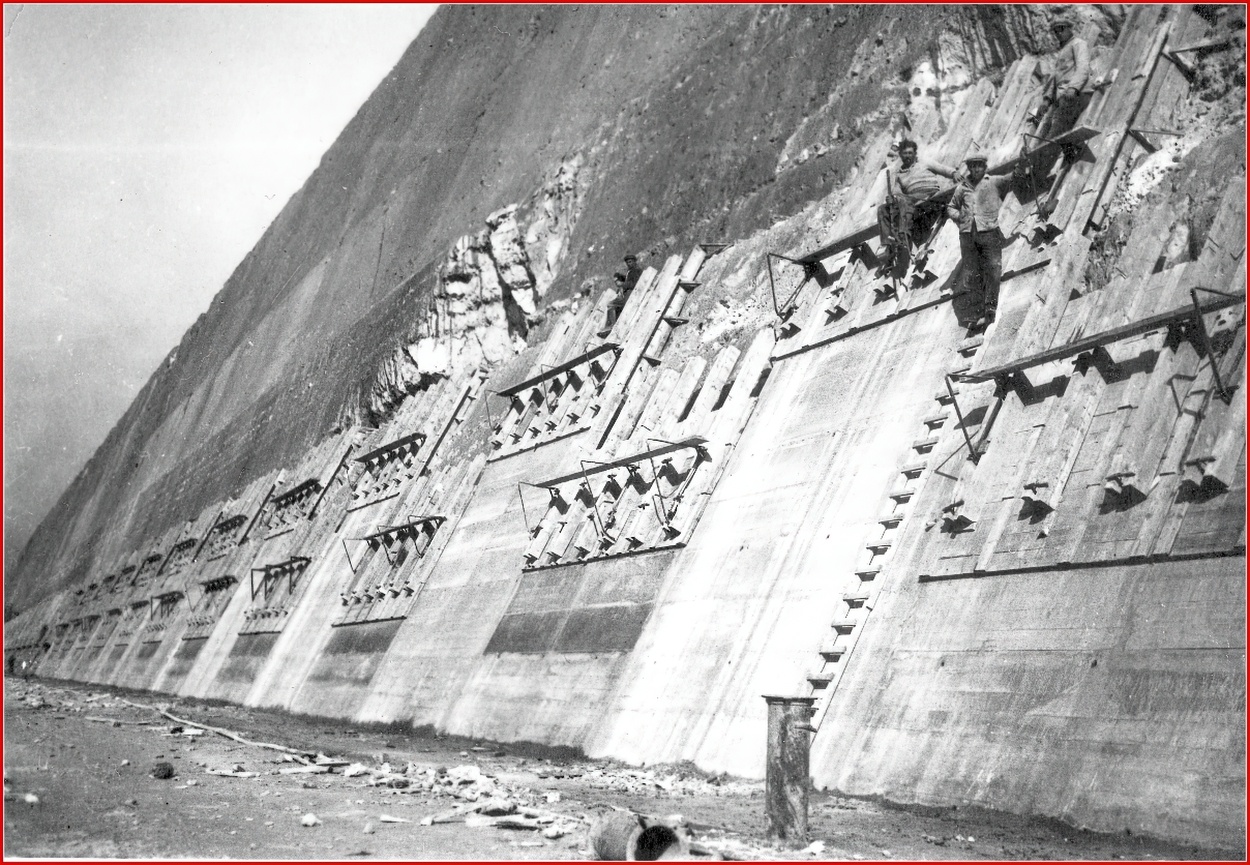

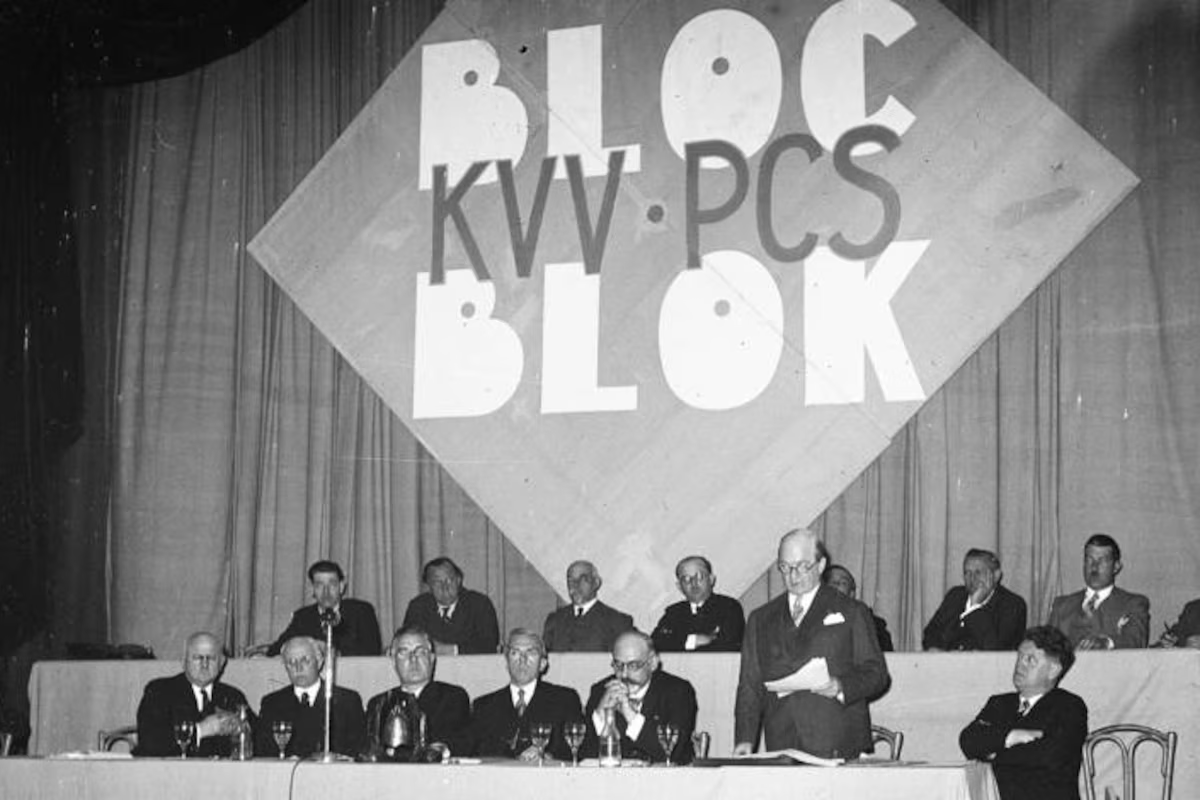




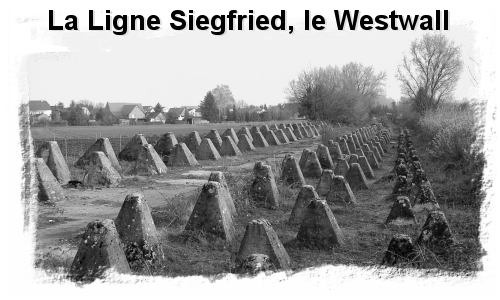



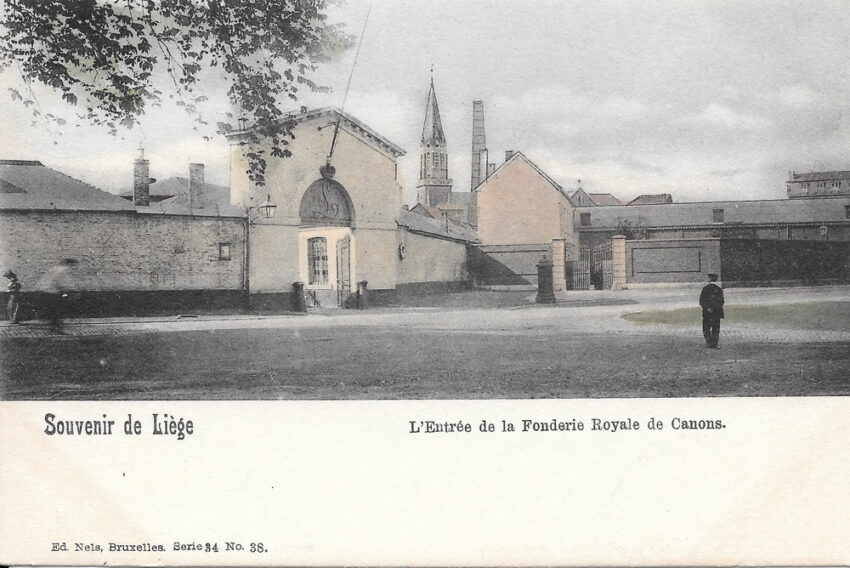
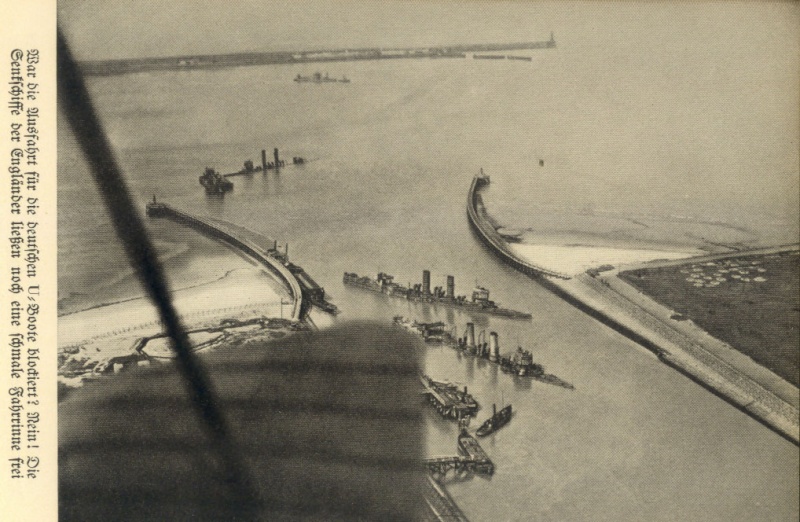
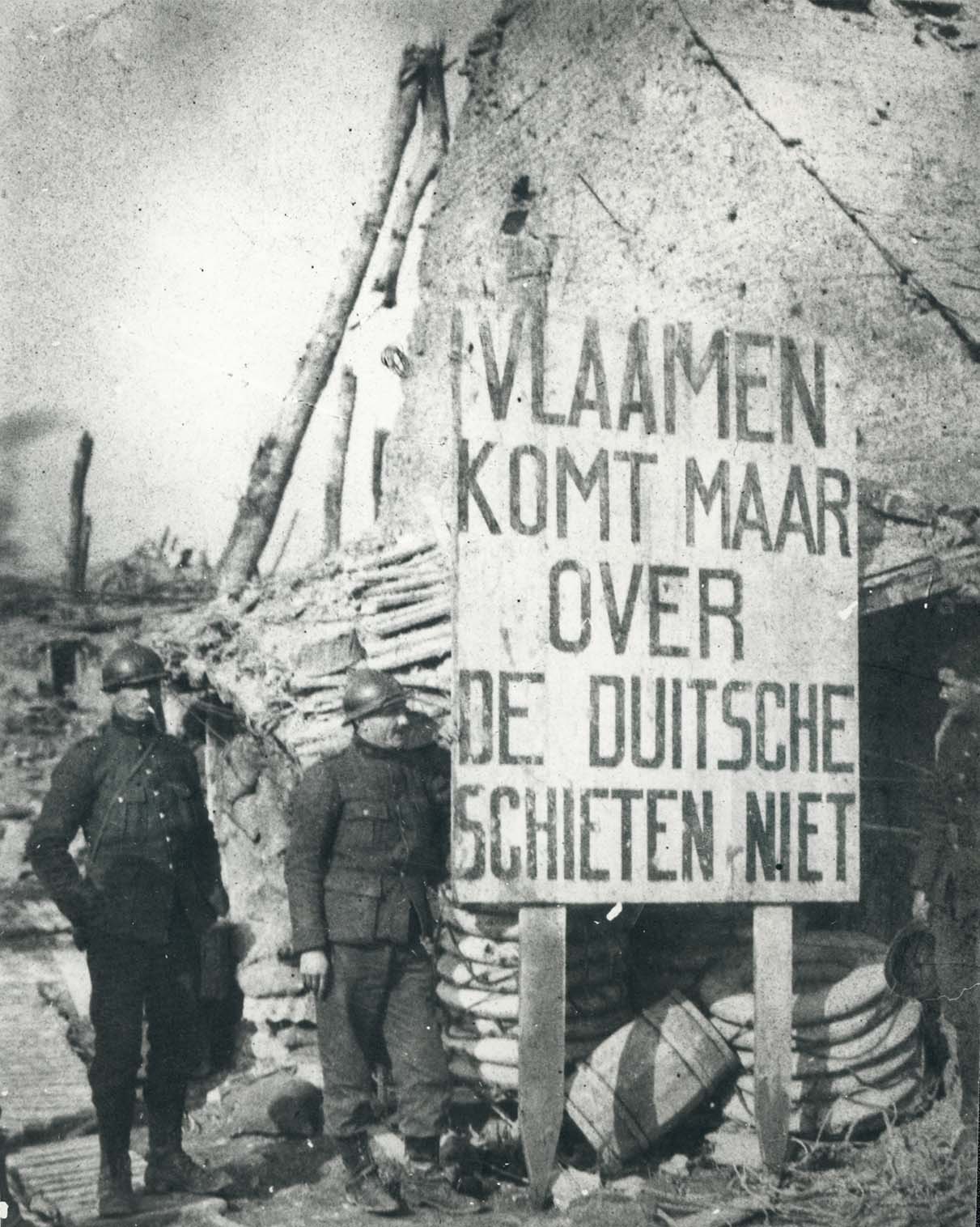

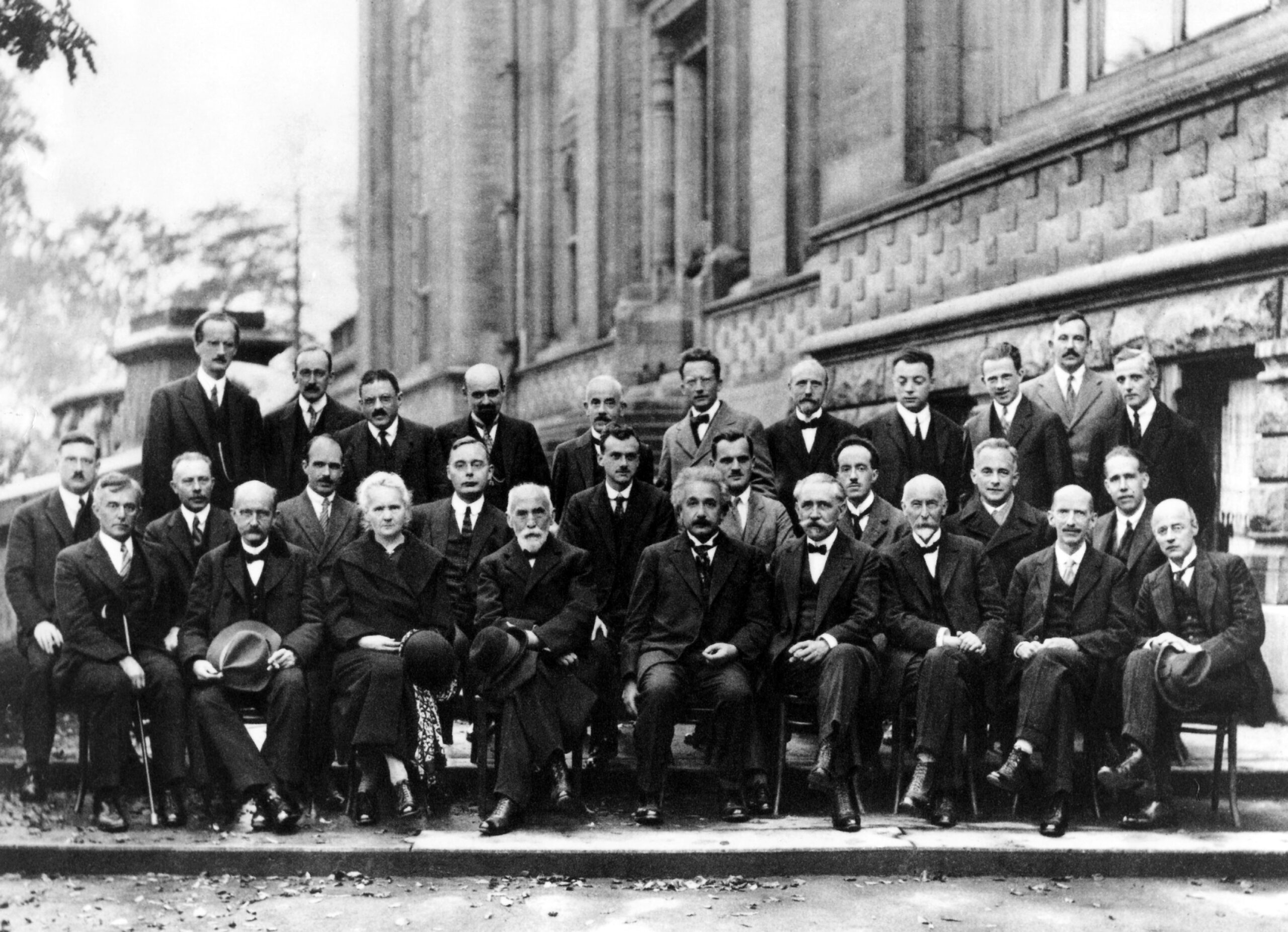
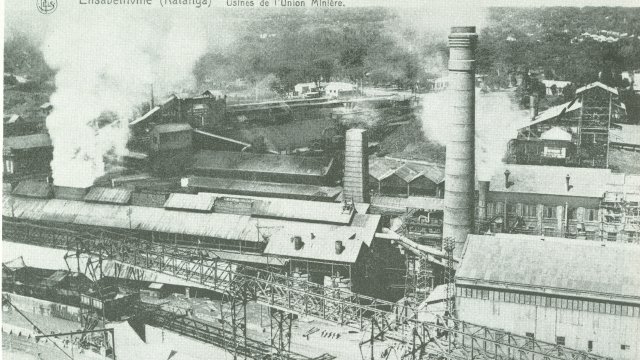


4.5) Et si la Belgique durant le Traité de Versailles avait reçut beaucoup plus?
La Belgique, martyrisée par l’invasion allemande et soutenue par l’opinion publique internationale qui voit en elle une « nation martyre », parvient à obtenir davantage que dans notre histoire. Grâce au lobbying belge et à l’appui discret de la France, qui souhaite un État tampon plus fort contre l’Allemagne, le traité lui accorde comme dans notre réalité Eupen-Malmedy, Le Grand-Duché du Luxembourg qui est intégré au royaume car ses habitants ont collaboré avec l’Allemagne et le pays est économiquement trop fragile pour survivre seul. Au lieu du seul mandat sur le Ruanda-Urundi, la Belgique obtient aussi une partie du Cameroun allemand, la zone occidentale, limitrophe du Nigéria britannique.
La Belgique devient sensiblement plus grande et plus peuplée avec 9 millions d’habitants au lieu de 7,5 millions dans notre réalité. La présence du Luxembourg change l’équilibre linguistique : la minorité germanophone est renforcée, ce qui complique la politique intérieure. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni voient d’un mauvais œil ce renforcement belge, craignant un allié trop dépendant de la France. La Belgique obtient plus de garanties militaires franco-britanniques contre une future attaque allemande.
Avec le Congo et le Ruanda-Urundi et une partie du Cameroun, la Belgique devient une puissance coloniale de second rang, juste derrière les grandes puissances. Cela apporte plus de matières premières comme du cacao, du bois, du caoutchouc, ce qui favorise une industrialisation accrue d’Anvers, de Liège et de Charleroi dans les années 1920. Mais l’administration coloniale, déjà lourde au Congo, est surchargée avec de la corruption et les critiques internationales augmentent.
Voici la chronologie concernant la suite du scénario:
En 1920, il y a des tensions qui apparaissent avec les Pays-Bas, qui craignent des revendications sur le Limbourg néerlandais. La diplomatie britannique pousse la Belgique à rassurer ses voisins.
En 1925, il y a la Signature des accords de Locarno, la Belgique est agrandie et est reconnue dans ses frontières, mais devient une cible prioritaire en cas de résurgence allemande.
En 1929, il y a la Crise économique mondiale, la Belgique souffre, mais ses colonies leurs ressources amortissent le choc.
En 1936, comme dans notre histoire, la Belgique proclame sa neutralité, mais l’armée est mieux équipée grâce aux revenus coloniaux.
En 1939, L’intégration du Luxembourg entraîne une mobilisation plus large avec 200 000 hommes supplémentaires en réserve.
Le 10 mai 1940, L’Allemagne envahit la Belgique. La défense belge, mieux préparée, résiste 23 jours (au lieu de 18 dans notre réalité). Bruxelles tombe, mais Anvers et Namur tiennent plus longtemps. Le Luxembourg belge, au lieu d’être annexé directement au Reich participe à la résistance. Entre 1940 et 1944, La Belgique subit l’occupation. Le gouvernement en exil à Londres, représentant aussi le Luxembourg, gagne un poids symbolique plus fort au sein des Alliés. En 1944, c’est la Libération par les Alliés. La bataille des Ardennes est encore plus dure car le Luxembourg fait partie intégrante du front belge.
En 1945, La Belgique sort ruinée mais plus prestigieuse. Elle est considérée comme une puissance moyenne.
En 1949, La Belgique est un membre fondateur de l’OTAN. Son territoire élargi est crucial comme zone tampon en cas de guerre avec l’URSS.
En 1951, c’est la date de la Fondation de la CECA qui sera la future UE. La Belgique joue un rôle encore plus central, le Luxembourg étant déjà intégré. Le siège de la CECA puis de la CEE s’installe naturellement à Bruxelles.
Entre 1959 et 1960, Il y a l’Indépendance du Cameroun belge qui allait être fusionné avec la partie française pour former l’actuel Cameroun. La Décolonisation est plus rapide qu’au Congo.
En 1960, c’est l’Indépendance du Congo. Il y a un Choc économique énorme comme dans notre histoire, mais il est aggravé par la perte du Cameroun.
En 1962, c’est l’indépendance du Ruanda-Urundi.
Dans les années 1970, la Belgique, privée de son empire, doit réorienter son économie vers l’Europe. Son poids diplomatique décline, mais elle garde une stature plus forte que dans notre réalité grâce à l’héritage colonial élargi.
En 1980, il y a la Crise communautaire avec L’intégration du Luxembourg qui a accentué la complexité linguistique soit 55% de flamands, 35% de wallons, 5% de Luxembourgeois et 2% de germanophones d’Eupen-Malmedy. Les tensions mènent à une fédéralisation encore plus poussée que dans notre réalité. La Belgique devient un État fédéral trilingue.
En 1993, il y a la Signature du traité de Maastricht. La Belgique est un moteur de l’intégration européenne. Avec le Luxembourg intégré, Bruxelles concentre encore plus d’institutions européennes.
En 2008, c’est la Crise financière. La Belgique souffre fortement, mais l’économie luxembourgeoise avec les banques et la finance intégrée au royaume limite les dégâts. Bruxelles et la ville de Luxembourg deviennent des centres financiers encore plus importants.
Entre 2010 et 2011, c’est la Crise politique belge avec 600 jours sans gouvernement. Les tensions communautaires sont amplifiées par les spécificités luxembourgeoises, mais l’Union européenne fait pression pour maintenir la stabilité.
En 2025, la « Grande Belgique » compte près de 14 millions d’habitants (contre 11,7 millions dans notre réalité), avec une économie plus diversifiée avec l’industrie, la finance et les services européens. Elle est à la fois plus puissante sur le plan international, mais aussi plus fragile intérieurement à cause de ses multiples clivages linguistiques et identitaires.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
En 1919, durant le Traité de Versailles:
« Enfin la justice est faite ! L’Allemagne a piétiné notre sol, brûlé nos villages. Que nous intégrions le Grand-Duché du Luxembourg n’est que réparation. »
C’est un Discours fictif du Premier ministre belge Léon Delacroix à la Chambre, le 28 juin 1919
Plebiscite fictif contesté au Luxembourg en 1921:
Témoignage fictif d’une femme :
« Mon mari dit que nous restons Luxembourgeois dans le cœur, mais Belges dans les papiers. Moi, je veux surtout du pain, peu importe la couronne. »
Durant la Crise économique de 1929:
« Sans le cacao du Cameroun, je fermerais mes ateliers. Nos colonies sont notre planche de salut. »
Un témoignage fictif d’Henri Van Driessche qui est un industriel textile gantois, une lettre fictive à son associé en 1929.
L’Invasion allemande, le 10 Mai 1940:
« Nous avons tenu trois jours de plus que prévu. Trois jours qui comptent. Trois jours pour l’Histoire. »
Capitaine belge Jules Lambert dans un Carnet fictif de campagne, le 25 mai 1940
L’ Occupation en 1942:
« Les Luxembourgeois paient cher leur annexion. On nous arrache nos enfants pour les envoyer travailler en Allemagne. Mais nous résistons, ensemble avec les Belges. »
Extrait fictif d’un tract clandestin, “Résistance luxembourgeoise belge”, à Luxembourg-Ville
La CECA en 1952:
« Si Bruxelles accueille l’Europe, c’est parce que nous représentons déjà trois peuples. La Belgique est une petite Europe en soi. »
Témoignage fictif de Paul-Henri Spaak qui fut le ministre belge des Affaires étrangères
L’Indépendance du Cameroun belge en 1960:
« Ils disent que nous serons libres. Mais libres de quoi ? Nos routes sont encore belges, nos écoles encore belges, nos banques encore belges. »
Jean-Baptiste Ngono qui est un instituteur camerounais, dans son carnet personnel fictif.
L’indépendance du Ruanda-Urundi en 1962:
« Papa est revenu du Congo avec des histoires de chaos. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne garde pas ces pays. On a tant investi ! »
Témoignage fictif de Marc De Winter qui est un étudiant à Louvain.
La Fédéralisation en 1980:
« Trilingue ? Très bien, mais qui paiera pour traduire chaque loi, chaque décret en trois langues ? On va finir par ne plus rien comprendre. »
Témoignage fictif de Maurice Peters qui est fonctionnaire luxembourgeois intégré à Bruxelles
Le Traité de Maastricht de 1993:
« Nous ne sommes plus seulement Belges ou Luxembourgeois. Nous sommes Européens. Mais j’ai peur qu’on oublie qui nous sommes, ici. »
Claire Vanderwalle qui est une fonctionnaire liégeoise, témoignage fictif à la RTBF.
La Crise financière de 2008:
« Si la Belgique n’avait pas le Luxembourg et ses banques, nous serions en faillite comme la Grèce. Dieu merci pour nos “banquiers luxembourgeois” ! »
Chronique fictive et satirique de Marc Reynders dans le journal Le Soir en octobre 2008
La Crise politique en 2010:
« Nous n’avons plus de gouvernement depuis 500 jours. Flamands, Wallons, Luxembourgeois, chacun tire de son côté. Comment tenir ensemble ? »
Témoignage fictif de Marie-Claire Jacoby qui est une professeur luxembourgeoise, interview fictive à RTL Belgique
Bilan d’un siècle en 2025:
« La Belgique a grandi après Versailles, mais ses cicatrices aussi. Nous sommes riches et influents, oui. Mais unis ? Cela reste à prouver. »
Editorial fictif du journal, La Libre Belgique en Janvier 2025

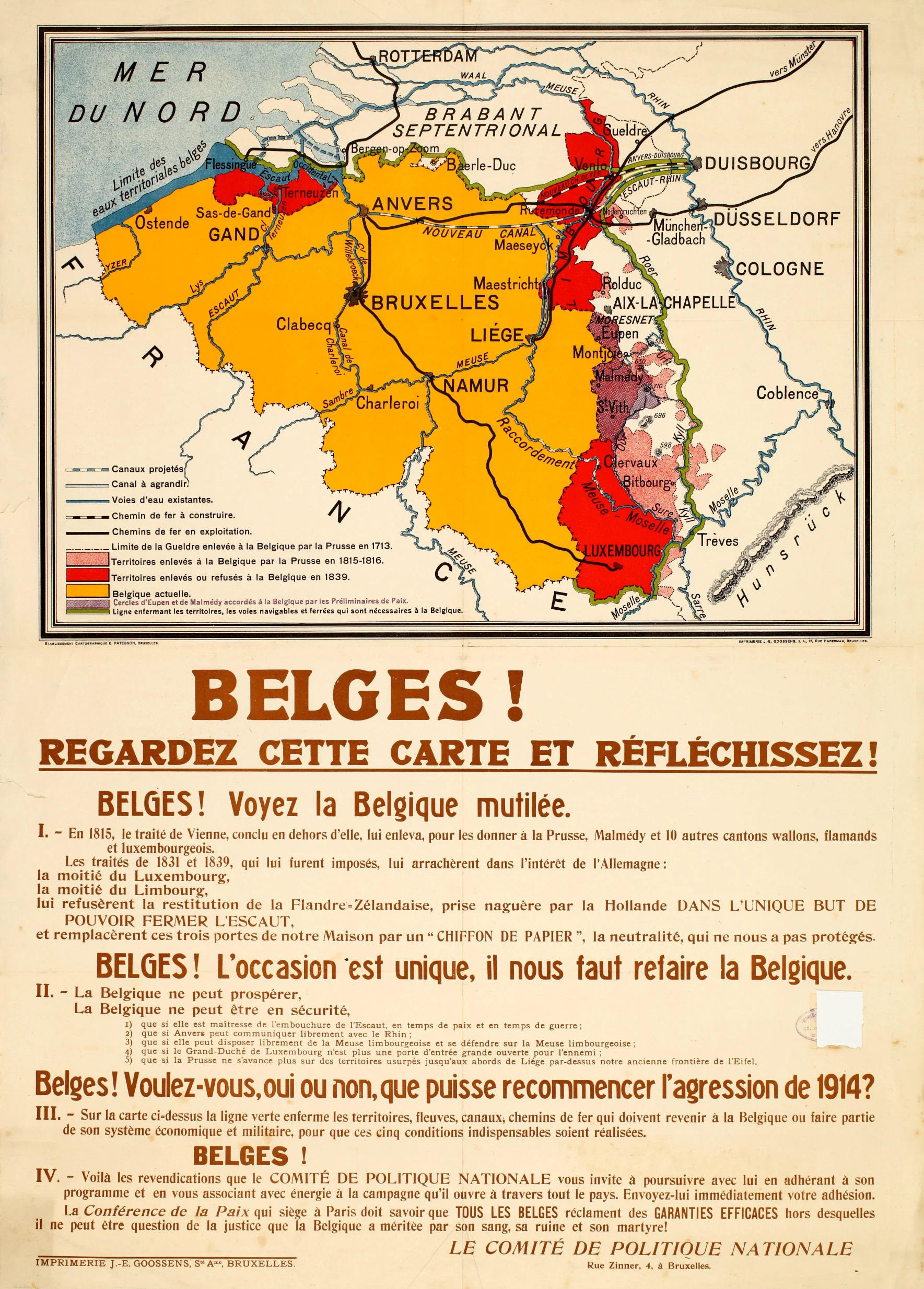
Points de divergences entre 1920 et 1939
5) Et si tout se serait bien passé pour les cantons de l’est belge, l’histoire alternative la plus optimiste,la plus parfaite possible?
En 1920, au lieu d’organiser un plébiscite mal préparé et opaque après la Première Guerre mondiale, les Alliés exigent un référendum clair et transparent.
Les habitants votent majoritairement pour rejoindre la Belgique, par rejet de la guerre et de l’impérialisme allemand.
La Belgique, consciente du défi d’intégrer une population germanophone, accorde immédiatement un statut spécial : reconnaissance de la langue allemande comme officielle dans la région avec une autonomie communale renforcée et des promesses de respect culturel. Les habitants ne se sentent pas « annexés », mais invités à rejoindre un État plus démocratique et pacifique.
Voici la chronologie de cette uchronie:
Un véritable référendum populaire est organisé et 62 % votent pour rejoindre la Belgique. Les élites locales sont invitées à siéger au Parlement belge, intégrant rapidement les germanophones à la vie politique nationale.
Dans les années 1920 à 1930, les écoles deviennent bilingues allemand-français, Liège et Eupen collaborent pour la formation des instituteurs.
La Belgique investit dans les chemins de fer entre Eupen et Liège, les Vennbahn sont modernisés et les industries locales aussi.
Un journal germanophone de qualité reçoit un soutien public, devenant un pilier de la vie démocratique.
Les cantons se sentent valorisés, et l’influence des mouvements pangermanistes reste limitée.
Entre 1933 et 1939, tandis que le régime hitlérien séduit certains germanophones dans la réalité, ici la population reste largement loyale à la Belgique grâce à la reconnaissance culturelle. Le clergé et les notables locaux, intégrés à la vie belge, deviennent des remparts contre la propagande nazie. Eupen accueille des réfugiés allemands anti-nazis, renforçant encore le contraste avec le Reich.
Durant la seconde guerre mondiale, L’invasion allemande intègre militairement les cantons, mais la population refuse massivement la ré-annexion. Bruxelles en exil défend ses germanophones comme « Belges loyaux ». La conscription forcée dans la Wehrmacht est moins massive, car la population locale est protégée par un statut spécial reconnu par les Alliés. Après 1945, aucune suspicion n’est durable, les cantons partagent les souffrances de l’occupation avec le reste de la Belgique.
En 1949, la Belgique réforme sa Constitution : elle reconnaît trois communautés linguistiques, la francophone, la flamande et la germanophone). Les cantons disposent d’un Conseil culturel germanophone avec une trentaine d’élus et il est précurseur de l’actuelle Communauté germanophone. Eupen devient le centre administratif d’une région qui conserve une forte autonomie scolaire et culturelle.
Entre 1950 et 1970, c’est le Plan Marshall qui est mis en place avec la région qui reçoit des fonds pour moderniser ses industries textiles, verrières et forestières. Il y a la création d’une université germanophone à Eupen spécialisée dans le multilinguisme et la coopération transfrontalière. La région devient un modèle d’éducation bilingue, des jeunes germanophones parlent couramment français et souvent néerlandais. L’exode rural est limité, beaucoup de jeunes trouvent du travail dans l’économie locale.
En 1973, les cantons participent au lancement de l’Euro-région Meuse-Rhin-Liège–Aix-la-Chapelle–Maastricht–Eupen–Luxembourg. Eupen est désignée comme une “capitale culturelle transfrontalière “ et accueille de petites institutions européennes. Grâce à leur trilinguisme, les habitants trouvent facilement du travail dans l’administration européenne à Bruxelles et au Luxembourg.
En 1980, la Belgique réforme son État : Flandre, Wallonie, Bruxelles… et la Communauté germanophone est dotée d’une large autonomie plus tôt et plus poussée que dans notre réalité. Le Parlement germanophone à Eupen gère non seulement l’éducation et la culture, mais aussi la santé et l’économie régionale.
Durant les années 90,l’achèvement du marché unique et de Schengen profite énormément aux cantons, car ils deviennent un carrefour économique entre Belgique, Allemagne et Luxembourg. Le tourisme vert en Hautes Fagnes avec les randonnées notamment et la gastronomie se développe avec des fonds européens. Eupen et Sankt Vith accueillent des instituts de traduction et de diplomatie pour former les fonctionnaires européens.
En 2010, alors que la Belgique connaît des tensions communautaires, les cantons de l’Est apparaissent comme le modèle d’équilibre, avec une petite communauté bien intégrée, prospère et sans conflit identitaire. Eupen est surnommée « le Luxembourg miniature », avec une économie basée sur les PME innovantes, le tourisme durable et les services européens.
En 2025, les cantons de l’Est comptent environ 90 000 habitants, et sont une région florissante, le PIB par habitant est supérieur à la moyenne belge, grâce au trilinguisme et à la position géographique. Le Système éducatif est reconnu comme l’un des meilleurs d’Europe. Le taux de chômage est très bas, car l’économie est tournée vers la coopération transfrontalière.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’Anna, une institutrice à Malmedy en 1920:
« Quand le référendum a eu lieu, j’ai voté pour la Belgique. Nous étions fatigués de la guerre, et on nous promettait que nos enfants pourraient apprendre en allemand tout en ayant accès au français. Je n’ai pas eu peur de perdre notre identité, car Bruxelles nous a parlé avec respect. Dès la rentrée, j’ai reçu de nouveaux manuels bilingues envoyés depuis Liège. C’était une nouvelle ère. »
Témoignage fictif de Josef qui est un commerçant à Eupen en 1936:
« Beaucoup parlaient de Hitler chez nos voisins, mais ici, nous n’en voulions pas. Nous avions déjà nos députés à Bruxelles, nos journaux, nos écoles. Pourquoi quitter un pays qui nous respectait ? J’avais des clients de Liège et d’Aix-la-Chapelle, et je voyais bien que la prospérité venait de la paix, pas de la haine. »
Témoignage fictif de Marie qui est veuve de guerre à Sankt Vith en 1945:
« Nous avons beaucoup souffert sous l’occupation allemande, mais personne ne nous a reproché d’être germanophones. Après la Libération, on nous a accueillis comme des Belges qui avaient résisté, pas comme des traîtres. C’est ce qui nous a sauvés de l’humiliation que d’autres régions ont connue. »
Témoignage fictif de Peter qui est un étudiant à l’université d’Eupen en 1968:
« Étudier dans ma langue maternelle, tout en suivant des cours de français et de néerlandais, c’était une chance incroyable. Nos professeurs venaient de Bruxelles, Liège, Cologne… Nous étions un pont entre les cultures. Quand j’ai passé un stage à la Commission européenne, on m’a dit : “Vous, les germanophones de Belgique, vous êtes l’avenir de l’Europe.” »
Témoignage fictif de Claire qui est une infirmière à Saint-Vith en 1985:
“Nous avons enfin eu notre propre Parlement germanophone, avec de vrais pouvoirs. Cela a changé notre quotidien, nos hôpitaux, nos écoles, tout était géré localement. Et pourtant, nous nous sentions toujours Belges et Européens. Cette autonomie nous a protégés des grandes querelles entre Flamands et Wallons. “
Témoignage fictif de Lukas qui est un entrepreneur à Eupen en 2000:
« J’ai lancé ma PME de logiciels de traduction grâce à un fonds européen et à des aides régionales. Mes clients sont en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg. Si je réussis aujourd’hui, c’est parce que nous, ici, nous avons appris à vivre en trois langues dès l’école. C’est notre plus grande richesse. »
Témoignage fictif de Suzanna qui est une étudiante de 20 ans à Malmedy en 2025:
« Je suis allemande de langue maternelle, je parle français avec mes amis de Liège, et flamand avec mes collègues d’Anvers. Mon Erasmus à Vienne a été facile grâce à cette ouverture. Quand je dis que je viens des Cantons de l’Est, on me répond : “Ah, vous êtes Belges, mais aussi Allemands et Européens !” Ici, nous ne devons jamais choisir, nous sommes tout cela à la fois. »
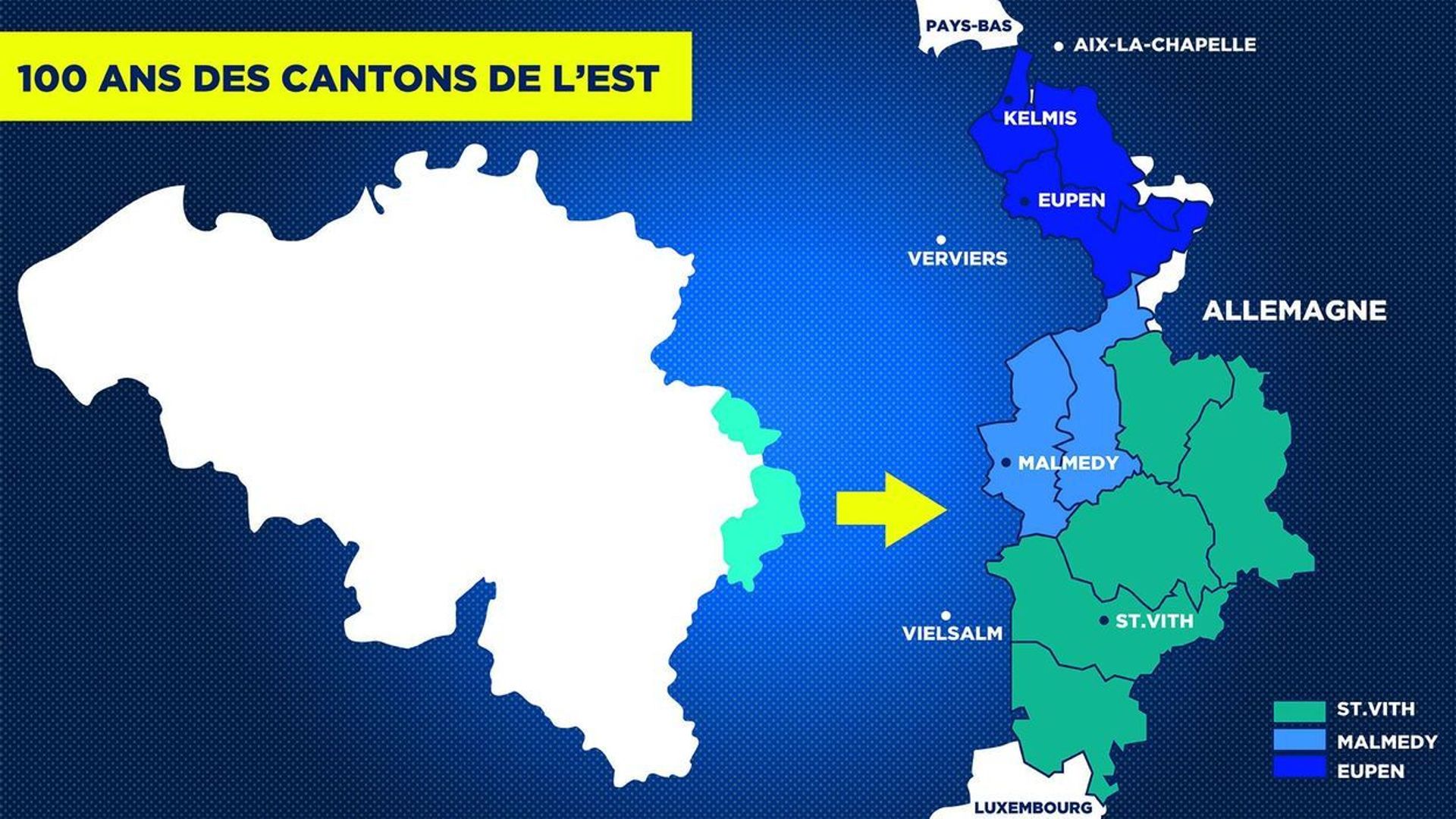
5.1) Et si tout s’était mal passé pour les cantons de l’est, la pire uchronie possible, l’histoire alternative la plus pessimiste?
Voici la chronologie complète:
Entre 1920 et 1925, les Alliés imposent le rattachement sans consultation populaire crédible. La Belgique refuse toute reconnaissance linguistique, le français est obligatoire dans l’administration et l’école. Les journaux germanophones sont fermés, beaucoup de fonctionnaires sont remplacés par des Wallons. Il y a un fort ressentiment, des comités clandestins pro-allemands apparaissent.
Entre 1926 et 1932, La Belgique poursuit la francisation avec des enseignants germanophones licenciés et il y a des panneaux germanophones qui sont retirés. Les germanophones sont perçus comme des «citoyens de seconde zone ». L’économie locale stagne, faute d’investissements. Des associations culturelles pro-allemandes prospèrent, préparant le terrain pour l’idéologie nazie.
Entre 1933 et 1939, l’arrivée d’Hitler renforce le sentiment d’appartenance à l’Allemagne. La propagande nazie trouve un terrain fertile avec une jeunesse endoctrinée et des clubs sportifs et culturels infiltrés. Bruxelles surveille, mais n’offre aucune alternative. En 1939, une part importante de la population est plus proche de Berlin que de Bruxelles.
Durant la seconde guerre mondiale, L’invasion allemande est accueillie par des foules enthousiastes à Eupen et Malmedy. Les cantons sont réintégrés immédiatement au Reich. Les jeunes sont incorporés massivement dans la Wehrmacht et la Waffen-SS. Certains habitants participent activement à l’administration nazie, voire à la persécution des résistants et des Juifs.
De 1945 à 1950, les Alliés hésitent à rendre la région à l’Allemagne, mais choisissent de maintenir l’annexion à la Belgique.Bruxelles punit sévèrement avec des centaines d’habitants qui sont accusés de collaboration et qui sont déchus de leurs droits civiques avec des confiscations de terres et d’entreprises et une interdiction temporaire de la langue allemande dans l’espace public.
Entre 1950 et 1970, la reconstruction belge contourne largement les cantons de l’Est. Les industries locales déclinent, le chômage explose. Les jeunes partent travailler en Allemagne et au Luxembourg, laissant une région vieillissante. Bruxelles se contente de maintenir une présence policière et administrative, sans plan de développement.
Entre 1970 et 1990, alors que la Belgique se fédéralise, les cantons de l’Est ne reçoivent aucun statut propre. La communauté germanophone reste administrée depuis Namur et Liège, sans autonomie culturelle. Dans les années 1980, des groupuscules séparatistes pro-allemands apparaissent, certains commettent des attentats symboliques avec des pylônes électriques sur des bâtiments publics.
Entre 1990 et 2010, l’intégration européenne aurait pu être une chance, mais faute d’élites et d’investissements, la région ne profite pas de Schengen. Les infrastructures ferroviaires sont abandonnées, la Vennbahn est démantelée et les lignes vers Liège restent délaissées. Le chômage reste deux fois supérieur à la moyenne belge. Eupen et Sankt Vith deviennent des villes-dortoirs dépeuplées.
Entre 2010 et 2025, la crise économique de 2008 touche particulièrement la région, où les PME locales ferment. Une extrême droite germanophone prend de l’ampleur, réclamant un rattachement à l’Allemagne. Cela provoque des tensions politiques avec Bruxelles, qui réduit encore les subventions. En 2020, le chômage atteint 18 %, l’exode des jeunes continue. En 2025, un rapport européen classe les cantons de l’Est comme zone de fracture culturelle, avec risques de radicalisation identitaire.
Voici les témoignages fictifs de cette uchronie:
Témoignage fictif de Karl qui est un instituteur fictif à Eupen en 1921:
« Hier, j’ai dû brûler mes manuels scolaires en allemand. On nous a envoyé des inspecteurs de Liège : désormais, tout doit être enseigné en français. Les enfants ne comprennent rien. Certains parents gardent leurs enfants à la maison. Je crains que nous soyons traités comme des étrangers dans notre propre village. »
Témoignage fictif d’Elisabeth qui est une commerçante à Malmedy en 1936:
« Beaucoup de jeunes parlent avec admiration d’Hitler. Ils disent que l’Allemagne, elle au moins, respecte notre langue et notre culture. Je n’aime pas le ton des discours, mais à force d’être méprisés par Bruxelles, beaucoup de mes voisins se laissent convaincre. »
Témoignage fictif de Hans qui est un soldat de Sankt Vith, incorporé dans la Wehrmacht en 1942:
« J’ai 19 ans. On m’a remis un uniforme allemand et envoyé à l’Est. Certains sont partis volontaires, d’autres comme moi n’ont pas eu le choix. Dans ma compagnie, on est presque tous des garçons des cantons. On dit que nous sommes revenus “à la maison”. Mais moi, je me sens nulle part chez moi. »
Témoignage fictif de Bertha qui est une veuve de guerre à Eupen en 1946: « Mon mari a été exécuté comme collaborateur. Il avait juste travaillé à la maison communale sous les Allemands.Depuis la Libération, nous sommes des parias. On nous insulte quand on va au marché de Liège.
Témoignage fictif de Wilhelm qui est un ouvrier au chômage à Malmedy en 1965:
« L’usine de textile a fermé l’an dernier. Personne ne vient investir ici. À Liège, on nous traite encore de “Boches”. Les jeunes partent en Allemagne. Mon fils veut aller à Cologne, il dit qu’il n’y a pas d’avenir chez nous. Je ne peux pas lui donner tort. »-
Témoignage fictif de Anna qui est une étudiante à Eupen en 1983:
« Hier, il y a eu une bombe contre un pylône électrique, posée par un groupe séparatiste. On a perdu l’électricité pendant deux jours. À l’école, on ne parle que de ça.”
Témoignage fictif de Franz qui est un entrepreneur raté à Sankt Vith en 2001:
« J’ai essayé de monter une PME d’informatique, mais personne ne voulait financer un germanophone. La banque m’a conseillé d’aller à Aix-la-Chapelle. J’ai fini par fermer. Ici, tout meurt lentement. Les jeunes partent, les maisons se vident, les commerces ferment un à un. »
Témoignage fictif de Lena qui est une étudiante de 22 ans à Eupen en 2025:
« J’étudie à Liège. Quand je dis que je viens des cantons de l’Est, certains rient : “Ah, les Boches !” Je me sens étrangère, même dans mon pays. Beaucoup de mes amis rêvent de partir au Luxembourg ou en Allemagne. Rester ici, c’est rester dans un trou noir. »

5.2) Et si la Ligne Maginot s’était étendue jusqu’en Belgique?
En août 1914, l’armée allemande envahit la France par la Belgique. Cette mémoire obsède les généraux français dans les années 1920. Dans cette uchronie, le gouvernement et l’état-major français concluent qu’il faut sanctuariser la frontière belge.
Dès 1925, avec les traités de Locarno, la France et la Belgique signent non seulement une alliance militaire, mais aussi un pacte d’infrastructures défensives communes. La Belgique, inquiète d’être de nouveau champ de bataille, accepte que la France construise et finance des fortifications sur son sol, malgré sa politique de neutralité dans notre réalité.
Les élites belges, traumatisées par l’occupation de 1914 à 1918, préfèrent sacrifier une partie de leur neutralité à une protection garantie. La pression de l’opinion publique pousse le roi Albert Ier puis Léopold III à coopérer.
Grâce à des crédits spéciaux et à l’appui de la Société des Nations, le chantier est lancé en 1928. Une ligne fortifiée et continue est construite de Longwy à la mer du Nord, intégrant les places fortes belges comme Liège,Namur et Anvers.
Au printemps 1940, dans notre réalité, le plan allemand (Fall Gelb) mise sur une percée par les Ardennes. Dans cette uchronie, la Ligne Maginot s’étend jusque-là, rendant cette percée beaucoup plus difficile. Les fortifications en Ardenne et autour de Namur ralentissent énormément l’avance allemande.
Les blindés allemands se heurtent aux forteresses de la Sambre et de la Meuse, modernisées par les Français et les Belges.
Contrairement à Sedan où les Allemands ont percé en mai 1940, les divisions françaises et britanniques tiennent plusieurs semaines.
L’Allemagne ne parvient pas à obtenir la victoire éclair espérée. Le front se stabilise au début de l’été 1940, transformant le conflit en guerre de position, rappelant 1914–1918.
Hitler hésite à engager l’opération « Seelöwe » qui est l’invasion de la Grande-Bretagne, car ses armées sont embourbées en Belgique. L’Italie, voyant l’échec allemand, retarde son entrée en guerre.
Voici la chronologie de cette uchronie:
Le 10 mai 1940, L’Allemagne lance Fall Gelb qui est l’attaque de la Belgique et des Pays-Bas. Les fortifications de la Sambre et de la Meuse résistent, empêchant une percée rapide à Sedan. Les divisions blindées allemandes sont stoppées près de Namur et de Liège.
En Juin 1940, Paris n’est pas prise. La France et la Belgique tiennent la ligne fortifiée. Le conflit s’installe : c’est une nouvelle guerre de position.
En 1941,Hitler reporte l’invasion de la Grande-Bretagne, trop risqué sans victoire en France.
En Juin 1941, l’Opération Barbarossa est lancée, mais avec moins de troupes beaucoup restent en Belgique.
L’avancée allemande en URSS est plus lente,Moscou n’est pas menacée dès 1941. L’Italie hésite, mais finit par entrer en guerre aux côtés de l’Allemagne à l’automne.
En 1942 : Les Alliés tiennent le Front occidental est figé. L’aviation allemande bombarde massivement Bruxelles, Liège et Lille. Les États-Unis, après Pearl Harbor en Décembre 1941, débarquent des troupes en France dès l’été 1942. Une ligne logistique anglo-américaine s’établit directement à Brest et Cherbourg, restés français.
Au printemps 1943 c’est la première grande offensive alliée en Belgique avec la libération partielle de Namur et du Limbourg.
En Été 1943, il y a l’effondrement italien après le débarquement allié en Sicile, Mussolini est renversé
En Automne 1943, l’armée allemande recule vers l’Eifel et la Rhénanie.
En 1944, il y a la Chute du Reich à l’Ouest
Au printemps,Bruxelles et Liège sont libérées par les Franco-Belges et les Britanniques.
À l’Été 1944, une offensive alliée est lancée à travers la Rhénanie avec une invasion de l’Allemagne par l’Ouest et l’Est.
En Décembre 1944,Hitler se suicide à Berlin avant que les Soviétiques n’y arrivent. Les Alliés occidentaux entrent dans Berlin en même temps que l’Armée rouge.
L’Europe divisée plus à l’Ouest et l’Allemagne est occupée en quatre zones, mais la ligne de partage est proche de l’Elbe, non de l’Oder.
Après la guerre il n’y a pas de Vichy et pas de collaboration d’État, la mémoire est celle de la résistance et de l’endurance.
La Belgique et la France sortent vainqueurs et non humiliées. Bruxelles est une ville martyre des bombardements mais reste un symbole de résistance et est choisie en 1949 comme le siège de l’OTAN.
Au début de la Guerre froide, la Belgique et la France dans le camp occidental sont très influents.
En 1951, il y a la mort du roi Léopold III(à cause de problèmes cardiaques accéléré par son stress durant la guerre, présent près de ses soldats comme le roi Albert 1er)contesté pour sa politique d’avant-guerre, le roi Baudouin accède au trône sans « question royale ».
Bruxelles et Liège sont reconstruites, et accueillent les premières institutions de la CEE.
En 1960, l’Indépendance du Congo est gérée plus sereinement,l’État belge étant politiquement plus stable.
Entre 1960 et 1980 il n’y a pas de traumatisme de collaboration, les tensions linguistiques existent mais sont moins virulentes. Le fédéralisme apparaît plus tardivement dans les années 1980.
En 1968, à Louvain, le conflit linguistique reste présent, mais est moins explosif.
En 1970, il y a la première réforme de l’État, mais elle reste très limitée.
En 1984, c’est le cinquantenaire du début du chantier Maginot belge avec de grandes commémorations.
En 1985, il y a la Création du Mémorial national de la Ligne fortifiée à Namur.
En 1989, avec la Chute du mur de Berlin, la Belgique est perçue comme un modèle de résistance démocratique.
En 1993 la réforme fédérale a lieu donnant plus d’autonomie aux Régions, mais le souvenir d’une Belgique unie contre Hitler limite les velléités séparatistes.
Durant les années 1990, le tourisme mémoriel est important autour de la « Grande Ligne belge ».
En 2004, à l’occasion du 60ème anniversaire de la libération de Bruxelles. Il y a une visite conjointe des présidents français, américains et russes.
En 2005, il y a le Classement à L’UNESCO de la Grande Ligne Maginot belge, de Liège à Dunkerque. Les fortifications deviennent un symbole identitaire partagé entre Flamands et Wallons.
En 2014, c’est le Centenaire de 1914, il y a une relecture de l’histoire, la Belgique n’a plus seulement l’image de « pauvre victime », mais de citadelle victorieuse.
En 2020, il y a des débats autour de la restauration de certains forts encore en ruine un projet financé par l’UE
En Belgique en 2025 est une monarchie stable de 12 millions d’habitants.
Bruxelles est la capitale de l’UE et de l’OTAN.
La mémoire nationale repose sur le mot d’ordre : « En 1940, nous avons tenu ». L’extrême droite est marginale, elle ne peut se réclamer d’aucun mythe de « trahison de 1940 ».
Voici des témoignages fictifs concernant cette uchronie:
À Namur en mai 1940, un témoignage fictif d’un fantassin belge:
« On disait que les Allemands étaient invincibles, que leurs chars traversaient tout. Eh bien non ! Ils sont arrivés devant nos bunkers, ils ont pilonné, et nous avons tenu. J’ai vu des camarades mourir, mais pas un seul n’a reculé. Cette fois, ce n’est pas 1914. »
Bruxelles en Juin 1940, un témoignage fictif d’une mère de famille:
« Les bombardements étaient terribles. Nous descendions chaque nuit dans les caves avec les enfants. Mais quand on entendait à la radio que nos soldats tenaient la ligne, on reprenait courage. On se disait : Bruxelles souffre, mais Bruxelles ne tombe pas. »
Le Front de la Meuse en février 1941, un témoignage fictif d’un officier français:
« Les Belges ont eu du cran en acceptant que nous construisions ces fortifications sur leur sol. Sans elles, Paris serait tombée comme en 1870. Aujourd’hui, j’écris à ma femme : pour une fois, nous avons appris de l’Histoire.»
Anvers en 1942, un témoignage fictif d’un ouvrier en usine:
« Les Allemands bombardent le port chaque semaine. Mais nos bateaux anglais et américains continuent d’arriver. On dit que les Américains débarquent à Brest. Qui aurait cru que notre petit pays deviendrait la clé de la guerre ? »
Liège en août 1944, un témoignage fictif d’une résistante:
« Quand les blindés alliés sont entrés dans Liège, je n’ai pas pensé à la victoire. J’ai pensé à mes frères tombés en 1940, à mon père arrêté en 1941. Mais je me suis dit : nous ne nous sommes jamais rendus, et ça, personne ne pourra nous l’enlever. »
Bruxelles en juillet 1951, un témoignage fictif d’un étudiant assistant aux funérailles du roi Léopold III
« On pleurait tous comme si on avait perdu un père. On l’appelait le nouveau roi-soldat. Mon grand-père me disait : “Il est venu inspecter notre blockhaus, il nous a parlé comme un camarade.” Aujourd’hui, je sais que nous avons perdu plus qu’un roi, nous avons perdu un symbole. »
Namur en 1985, témoignage d’un survivant de la Ligne:
« Je suis revenu sur les lieux où j’ai combattu en 1940. Le fort est un musée, les enfants rient dans les couloirs. Je leur ai montré l’endroit où mon sergent est tombé. Ils m’ont regardé avec des yeux grands comme des assiettes. J’ai compris : nous avons tenu pour eux. »
Bruxelles en 2004, un témoignage fictif d’un touriste américain:
« J’ai visité le Mémorial de la Ligne belge. Chez nous, on apprend toujours que D-Day a sauvé l’Europe. Ici, j’ai compris que si la Belgique n’avait pas résisté en 1940, il n’y aurait jamais eu de D-Day. C’est un choc de réaliser que tout a commencé ici. »
Louvain en 2014, un témoignage d’une étudiante flamande:
« On parle souvent des tensions entre Wallons et Flamands. Mais quand je vois les cérémonies du centenaire, je me rends compte que, sur la Ligne, ils étaient ensemble. Mon arrière-grand-père était à Namur, celui de mon amie wallonne à Anvers. Ils se sont battus pour le même drapeau. »
Bruxelles en 2025, un témoignage d’un historien belge:
« Chaque fois que je traverse les bunkers de la vieille fortification, je me demande : et si elle n’avait pas existé ? Peut-être parlerions-nous aujourd’hui allemand. Peut-être que l’Europe politique n’aurait jamais existé. La Ligne Maginot belge n’était pas seulement du béton : c’était le choix d’un peuple de ne plus subir.”

5.3) Et si le roi Albert Ier n’était pas mort à Marche-les-Dames?
Dans notre réalité, Albert Iᵉʳ était passionné d’alpinisme et il est mort d’une chute dans les rochers de Marche-les-Dames. Dans l’uchronie, deux options sont réalistes, soit il n’effectue pas l’ascension ce jour-là car empêché par la météo ou retenu par un conseil des ministres. Soit il chute mais survit avec des blessures graves, qui le forcent à ralentir mais pas à abdiquer. Dans les deux cas, il reste roi et Léopold III n’accède pas au trône en 1934.
Albert poursuit son règne. Surnommé le « Roi Chevalier » depuis 1914–1918, il conserve un immense prestige.
Sa réputation de héros de guerre et monarque proche du peuple maintient la cohésion nationale malgré la crise économique mondiale.
Sa longévité freine l’ascension politique des mouvements autoritaires comme Rex où les mouvements nationalistes flamands). Ceux-ci trouvent moins de prise dans un pays uni derrière un roi respecté.
En diplomatie, Albert reste favorable à une alliance franco-britannique, contrairement à Léopold III qui avait misé sur la neutralité stricte en 1936.
Passons maintenant à la chronologie:
En 1934, Albert Iᵉʳ échappe à l’accident d’alpinisme. Officiellement, la météo l’a dissuadé de grimper.
En 1935, c’est la Crise économique persistante. Albert multiplie les voyages en Belgique industrielle comme à Liège et à Charleroi et dans les campagnes, renforçant son image de « roi du peuple ».
En 1936, au lieu de proclamer une stricte neutralité (comme Léopold III dans la réalité), Albert reste partisan d’un alignement avec la France et le Royaume-Uni. La Belgique garde des contacts militaires plus étroits avec Paris et Londres.
En 1939, c’est la mobilisation générale. La présence d’un roi expérimenté et respecté donne confiance à la population et limite la montée des extrémismes.
Le 10 mai 1940, L’Allemagne envahit la Belgique. Albert Iᵉʳ à 59 ans prend la tête symbolique de l’armée.
Le 28 mai 1940, au lieu de capituler seul, Albert ordonne à l’armée de continuer à se battre en coordination avec les Alliés, avant de partir avec le gouvernement en exil à Londres.
Entre 1940 et 1944, À Londres, Albert devient une figure de la résistance européenne, comparable à De Gaulle. Son prestige international monte en flèche.
En 1944 et 1945 , durant la Libération de la Belgique. Albert rentre triomphalement, accueilli par des foules en liesse.
Il n’y a pas de « Question royale ». La monarchie en sort renforcée, Albert Ier est un symbole de l’unité de la Belgique.
En 1945, Albert Iᵉʳ supervise la reconstruction et appuie fortement la participation belge au plan Marshall.
En 1949, la Belgique devient un membre fondateur de l’OTAN. La réputation d’Albert Ier comme roi-soldat en fait un allié respecté des Américains.
En 1951, dans notre réalité, Léopold III abdique après la Question royale. Ici, Albert Iᵉʳ est toujours au pouvoir. Léopold reste héritier, mais vieillissant et effacé politiquement.
En 1956, durant la Crise de Suez. Albert plaide pour un soutien diplomatique à la France et au Royaume-Uni, mais garde la Belgique prudente.
Entre 1959 et 1960, c’est l’Indépendance du Congo. Le roi, conscient des dérives coloniales, pousse à une décolonisation plus négociée. La transition reste difficile mais un peu moins chaotique qu’en réalité.
En 1962, c’est l’indépendance du Rwanda et du Burundi. Albert Iᵉʳ, déjà âgé, continue de jouer un rôle d’arbitre national.
En 1965,ce sont les Réformes linguistiques. Grâce à son autorité morale, Albert Ier apaise les tensions entre Flamands et Wallons, mais le pays avance tout de même vers le fédéralisme.
En 1968, c’est la Crise de Louvain. La tension est forte, mais Albert Ier parvient à calmer la situation par un appel solennel à l’unité.
En 1970, c’est la Première grande réforme de l’État, la Belgique devient un État régionalisé.
En 1972, c’est la mort du roi Albert Iᵉʳ à 91 ans. Ses funérailles sont grandioses, marquées par la présence de chefs d’État du monde entier.
En 1972, son fils Léopold âgé de 71 ans, devient enfin le roi Léopold III. Son règne est bref et discret.
En 1980, c’est la Nouvelle réforme de l’État, avec le renforcement du fédéralisme. La monarchie garde une forte aura grâce au souvenir d’Albert
En 1983, Léopold III meurt comme dans la réalité après seulement 11ans de règne, son fils Baudouin monte sur le trône comme dans la réalité, mais plus tard..
En 1990, c’est la Crise de la loi sur l’avortement. le roi Baudouin s’oppose toujours, mais son abdication temporaire est moins dramatique, car la monarchie est plus solide.
En 1993, c’est la Mort du roi Baudouin. Son frère Albert II devient roi.
Durant les années 1990, L’héritage d’Albert Iᵉʳ comme « roi de la victoire » continue de légitimer la monarchie, qui reste populaire malgré les tensions communautaires.
Durant les années 2000, La Belgique reste un État fédéral complexe, mais la monarchie conserve un rôle d’arbitre incontesté.
Entre 2010 et 2011, la Longue crise politique de 600 jours sans gouvernement a toujours eu lieu Mais la popularité persistante de la monarchie, héritée de la figure d’Albert Iᵉʳ, limite le risque d’effondrement.
En 2013, l’Abdication d’Albert II a toujours eu lieu. Philippe devient roi.
En 2016, les Attentats de Bruxelles ont lieu. Le roi Philippe se réfère directement à l’exemple d’Albert Iᵉʳ dans ses discours : « Comme mon arrière-grand-père en 1914 et 1940, nous resterons debout ».
Durant l’année 2020, avec la Pandémie de Covid-19, le roi Philippe joue un rôle d’apaisement, son prestige étant encore plus fort dans cette uchronie.
En 2022, c’est la Guerre en Ukraine. La Belgique renforce son armée et rappelle la tradition militaire d’Albert Iᵉʳ.
En 2025, la monarchie belge est parmi les plus respectées d’Europe, perçue comme un pilier d’unité. Les tensions communautaires persistent, mais aucun grand mouvement républicain ne menace la monarchie.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Marche-les-Dames, après l’accident évité en 1934:
« Sa Majesté a renoncé à l’ascension ce jour-là. Le ciel était sombre et les rochers glissants. Certains murmurent qu’il a senti un mauvais présage. »
Un témoignage d’un garde royal
La neutralité où les alliances? en 1936:
« J’ai vu le roi serrer la main du général Gamelin. Ce n’est pas un geste anodin : il ne veut pas de neutralité morte. Il veut que la Belgique ait des amis solides. »
Note fictive d’un diplomate britannique à Bruxelles
Sur le front en Mai 1940:
« Le roi est venu dans notre tranchée. Il portait le même casque que nous, couvert de boue. Quand il nous a dit que nous ne nous rendrions pas seuls, j’ai senti qu’on pouvait tenir. »
Lettre fictive d’un soldat belge à sa mère en 20 mai 1940
Londres, le gouvernement en exil en 1941:
« Albert Ier est là, assis à côté de Churchill. Il n’a pas la stature d’un dictateur, mais d’un sage. Quand il parle de la Belgique, même les Anglais se taisent. »
Journal de guerre fictif d’un diplomate français
Le Retour en Belgique en 1945:
« La foule criait : “Vive le Roi ! Vive Albert !” J’ai pleuré, moi qui ne pleure jamais. Il avait refusé la capitulation et nous revenait libre. »
Témoignage fictif d’une infirmière bruxelloise en septembre 1944
La Question royale évitée en 1950:
« En France, ils s’arrachent De Gaulle. Nous, nous avons le Roi Chevalier. Ici, personne ne songe à l’accuser de trahison. »
Éditorial fictif du Soir du 12 juillet 1950
L’Indépendance du Congo en 1960:
« Le roi m’a dit en privé : “Je préfère perdre une colonie que perdre mon âme.” Je crois qu’il savait que le temps des empires était fini. »
Mémoires fictives d’un ministre belge des Colonies
La Crise de Louvain en 1968:
« Il avait 87 ans, mais quand il a parlé à la radio pour appeler à la modération, tout le monde a écouté. Il avait cette autorité tranquille que personne d’autre ne possédait. »
Souvenirs fictif d’un étudiant flamand
Les Funérailles d’un symbole en 1972:
« Quand son cercueil est passé devant moi, j’ai compris que nous enterrions plus qu’un roi. Nous enterrions le siècle d’unité qu’il avait bâti. »
Témoignage fictif d’une veuve de guerre
Les Réformes de l’État en 1980:
« Sans la mémoire d’Albert Iᵉʳ, nous serions peut-être en train de déchirer le pays en deux. Son exemple nous retient encore. »
Déclaration fictive d’un député belge au Parlement
La Crise de l’avortement en 1990:
« Quand le roi Baudouin a refusé de signer, j’ai pensé : si son grand-père était encore là, il aurait su trouver les mots pour apaiser tout le monde. »
Lettre fictive d’un professeur d’éthique à l’université de Louvain
La Crise politique des 600 jours sans gouvernement en 2010:
« Chaque fois que la Belgique chancelle, on évoque encore Albert Iᵉʳ. Il est notre ciment posthume. »
Editorial fictif du journal De Standaard
Les attentats de Bruxelles en 2016:
« Le roi Philippe a dit : “Nous tiendrons, comme Albert Iᵉʳ en 1914 et 1940.” Même les plus jeunes savent qui il était. Son ombre nous protège encore. »
Témoignage fictif d’une survivante de l’aéroport de Zaventem
« Cent ans après sa survie miraculeuse de 1934, Albert Iᵉʳ reste le roi des Belges dans nos cœurs. Sans lui, la Belgique aurait peut-être sombré. »
Discours fictif du roi Philippe à Namur le 17 février 2025



5.4) Et si la reine Astrid n’était pas morte en 1935?
Dans notre réalité, Léopold III perd le contrôle de sa voiture. Elle dérape, percute un arbre et tombe dans le lac. Astrid est tuée sur le coup. Dans l’uchronie, soit Léopold III conduit plus prudemment et ralentit dans la descente. Soit l’accident survient mais Astrid n’est que blessée avec des côtes fracturées, mais survit. Dans tous les cas, la reine Astrid échappe à la mort et reprend son rôle quelques mois plus tard. La Belgique garde sa reine populaire. La reine Astrid continue de jouer un rôle social important notamment avec le soutien aux familles pauvres et la défense des enfants. Léopold III, plus réservé et impopulaire, bénéficie de la sympathie que le peuple voue à Astrid. Elle agit comme un bouclier politique et émotionnel. Le couple royal reste soudé. La reine Astrid accompagne Léopold III dans ses déplacements, humanisant sa figure.
Voici la chronologie:
Le 29 août 1935, L’accident de Küssnacht n’est pas mortel. La voiture de Léopold III percute un arbre, Astrid est blessée avec des côtes fracturées et une commotion mais survit. Après quelques semaines de convalescence, elle reprend ses activités.
De 1936 à 1939, la reine Astrid renforce son image de « reine des pauvres » par son engagement social. Léopold III plus austère, bénéficie de l’immense popularité de son épouse. Le couple royal est vu comme solide et humain.
Le 10 mai 1940, L’Allemagne envahit la Belgique. Léopold III reste en Belgique, capitule avec son armée comme dans notre réalité.
Entre 1940 et 1944, La reine Astrid reste aux côtés du roi, soutenant les œuvres caritatives, visitant les blessés et encourageant les familles. Elle devient pour la population un repère moral comparable à la reine Wilhelmine des Pays-Bas en exil.
En 1944, c’est la Libération. Contrairement à la réalité, le couple royal est accueilli avec ferveur, la reine Astrid a protégé l’image de la monarchie par son rôle visible et rassurant.
Entre 1945 et 1950, le débat sur le rôle du roi divise la Belgique, mais la reine Astrid plaide pour l’unité nationale et apaise les tensions.
En 1950 c’est le Référendum sur le retour du roi, dans notre réalité, il y eut 58 % de « oui », mais clivage il y avait un clivage Nord/Sud et des violentes émeutes à Grâce-Berleur. Dans l’uchronie, grâce à la reine Astrid, le « oui » atteint près de 70 %. Les émeutes sont évitées.
En 1951, Léopold III conserve le trône, au lieu d’abdiquer en faveur de Baudouin. la reine Astrid reste une figure de stabilité.
Durant les années 50, la reine Astrid modernise l’image de la monarchie par sa proximité avec les familles ouvrières et son engagement international. Elle devient une sorte de « princesse Diana avant l’heure ».
En 1960, c’est l’Indépendance du Congo. La reine Astrid accompagne Léopold III lors de visites officielles, insistant sur la réconciliation et le respect. Cela apaise quelque peu les tensions entre Bruxelles et Kinshasa.
En 1965, le roi Léopold III abdique volontairement en faveur de Baudouin, souhaitant « passer la main à une nouvelle génération », mais dans un climat apaisé. Astrid devient « la reine-mère » et conserve une forte influence morale.
Durant les années 1970, la Belgique entre dans une ère de réformes de l’État. La mémoire et l’autorité morale d’Astrid contribuent à contenir les tensions communautaires.
En 1983, la reine Astrid meurt à l’âge de 77 ans, entourée de sa famille. Ses funérailles sont suivies par des foules immenses à Bruxelles et retransmises dans toute l’Europe. Elle est surnommée « la Reine des cœurs ».
En 1993, c’est la Mort du roi Baudouin. Son frère Albert II lui succède sans contestation. La mémoire d’Astrid a consolidé l’image de la dynastie.
Durant les années 2000, la monarchie belge bénéficie encore de l’aura de la reine Astrid. Sa figure est omniprésente dans les discours royaux et dans la mémoire collective.
En 2013, c’est l’Abdication du roi Albert II. Philippe devient roi. La presse internationale insiste sur « l’héritage d’Astrid », toujours célébrée comme un symbole d’unité et de compassion.
En 2016, après les attentats de Bruxelles, le roi Philippe cite la reine Astrid comme un modèle de courage et d’unité nationale dans un discours très suivi.
En 2025, à l’occasion du 90ᵉ anniversaire de l’accident évité de Küssnacht, de grandes commémorations ont lieu en Belgique et en Suisse. La reine Astrid est célébrée comme la figure qui a permis d’éviter la « Question royale » et de renforcer la monarchie belge
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Durant la Convalescence de la reine Astrid après l’accident en 1935:
« Quand la reine est revenue sur le balcon du palais, encore pâle et soutenue par le roi, la foule a pleuré. Elle avait survécu, et c’était comme si la Belgique entière avait été sauvée avec elle. »
Article fictif du Soir du 12 octobre 1935
L’Engagement social en 1938:
« Elle s’est assise à ma table, dans notre petite maison de Seraing. Une reine, chez nous ! Elle a demandé combien je gagnais à l’usine, si les enfants mangeaient assez. Ce n’était pas du théâtre : elle écoutait vraiment. »
Témoignage fictif d’un ouvrier sidérurgiste
Visite fictive aux soldats blessés en 1940:
« J’avais perdu une jambe à Gembloux. La reine est venue. Elle a pris ma main et a dit : “La Belgique ne vous abandonnera jamais.” J’ai cru en elle plus qu’en nos généraux. »
Carnet fictif d’un soldat belge à l’hôpital de Louvain
Sous l’occupation en 1943:
« On chuchote que la reine distribue du lait et du pain dans certains quartiers pauvres, malgré les Allemands. Les gens disent : si la reine Astrid reste, on tiendra. »
Lettre fictive clandestine d’une institutrice bruxelloise
Le Référendum de 1950:
« J’ai voté pour le retour du roi, parce que la reine Astrid m’a convaincue. Elle a parlé à la radio : sa voix tremblait, mais elle disait que la Belgique ne pouvait pas vivre divisée. J’ai pleuré, et j’ai voté oui. »
Témoignage fictif d’une ouvrière wallonne
Le Discours fictif du roi Léopold III:
« Si je demeure sur le trône, ce n’est pas pour mon honneur personnel, mais parce que la reine Astrid m’a appris que le devoir d’un roi est d’abord de servir son peuple. »
Discours fictif au Parlement le 21 juillet 1951
L’Indépendance du Congo en 1960:
« À Léopoldville, quand la reine Astrid est descendue de l’avion, les foules l’ont acclamée. Contrairement aux ministres, elle souriait, les Congolais l’appelaient déjà “Mama Astrid”. »
Journal fictif de voyage d’un journaliste belge
Les funérailles fictives de la reine Astrid en 1983:
« Quand son cercueil a quitté la cathédrale, les gens jetaient des fleurs et les gens voyaient “la Reine des cœurs” une dernière fois. Bruxelles n’avait pas connu une telle émotion depuis la Libération. »
Souvenir fictif d’un policier bruxellois en service
La Mort du roi Baudouin en 1993:
« Les foules pleuraient leur roi, mais dans les prières revenait souvent ce nom : Astrid. On disait qu’il avait été le digne fils de sa mère. »
Journal fictif de La Libre Belgique
Après les attentats de Bruxelles en 2016:
« Dans son discours, le roi Philippe a cité sa grand-mère : “Dans les ténèbres, même une petite lumière compte.” J’ai senti que, même des décennies après sa mort, la reine Astrid nous parlait encore. »
Témoignage fictif d’une survivante de Maelbeek
La Commémoration du 90ᵉ anniversaire de l’accident évité en 2025:
« Sans elle, la monarchie aurait peut-être sombré dans la guerre froide de nos communautés. Avec elle, nous avons gardé un cœur battant au centre du pays. »
Discours fictif du Premier ministre belge à Küssnacht, le 29 août 2025


5.5) Et si le parti Rex avait totalement remporté les élections belge de 1936?
Dans notre réalité, le parti Rex de Léon Degrelle connut un succès fulgurant lors des élections législatives de 1936, obtenant environ 11,5 % des voix. Cependant, son influence déclina rapidement par la suite, en partie parce qu’il effraya l’opinion, suscita un cordon sanitaire avant l’heure et fut miné par ses propres contradictions.
Dans notre uchronie, les conditions changent, la crise économique est encore plus dure et le gouvernement belge échoue à endiguer le chômage. L’instabilité parlementaire fatigue l’opinion avec des coalitions fragiles, des scandales financiers et une montée de la peur du communisme. Léon Degrelle durant les élections réussit à séduire un électorat non seulement de catholiques conservateurs, mais aussi des classes moyennes ruinées et une partie de la jeunesse. Les catholiques traditionnels représentés par le Parti catholique s’effondrent plus vite que dans la réalité, permettant à Rex de capter une majorité de leurs électeurs.
Les premières mesures que le parti Rex aurait imposé, serait une réforme constitutionnelle limitant les pouvoirs du parlement, créant un exécutif fort. Il y aurait aussi eu une abolition progressive des syndicats libres, remplacés par des corporations contrôlées par l’État. Léon Degrelle installe un régime inspiré de Mussolini, glorifiant la jeunesse et la discipline catholique. La presse est muselée et il y a une surveillance accrue des opposants socialistes, communistes et libéraux.
Voici la chronologie de cette uchronie:
En 1936, Rex remporte 40 % des voix aux élections. Léon Degrelle devient Premier ministre.
Entre 1937 et 1938, il y a une concentration des pouvoirs entre les mains de Léon Degrelle avec aussi une dissolution des syndicats libres, le Corporatisme est obligatoire, il y a une censure massive de la presse. Il y a une mise en place de la Jeunesse rexiste comme mouvement de formation paramilitaire.
En 1939, la Neutralité belge est réaffirmée, mais Rex multiplie les contacts avec l’Allemagne nazie. Léopold III est contraint d’accepter le régime autoritaire.
En 1940, durant l’Invasion allemande, la Belgique capitule en quelques jours. Degrelle reste à Bruxelles et forme un gouvernement collaborateur officiel reconnu par Berlin.
Entre 1941 et 1944, La Belgique devient un État satellite du Reich, fournissant des ouvriers et volontaires dont la Légion Wallonie à l’effort de guerre. Il y a aussi une répression féroce contre les Juifs et les résistants.
En 1944, il y a le débarquement allié en Normandie. Bruxelles est libérée dans la douleur. Degrelle fuit en Allemagne, puis en Espagne franquiste. La monarchie est jugée compromise et est abolie en 1945. La Belgique devient une République provisoire.
Entre 1945 et 1946, il y a une épuration violente avec exécutions massives de collaborateurs et la Dissolution de Rex. Les anciens rexistes forment une extrême droite clandestine.
En 1947, il y a la rédaction d’une nouvelle constitution républicaine. La Belgique devient la République fédérale de Belgique(ou RFB).
En 1948, la Belgique rejoint le plan Marshall, mais ses partenaires européens restent méfiants.
En 1951, la Belgique est entrée dans la CECA, mais avec un statut fragile.
Dans les années 1950, il y a une Grande croissance économique, mais avec une mémoire douloureuse de la collaboration. La RFB s’enracine comme un État fédéral, avec de larges compétences régionales pour la Flandre, la Wallonie et Bruxelles).
En 1960, l’Indépendance du Congo est maintenue, mais la métropole est affaiblie par son passé rexiste, la transition chaotique est encore plus brutale qu’en réalité.
Entre 1962 et 1963, il y a la Fixation de la frontière linguistique avec une montée des mouvements flamands et wallons, renforcée par la crise de légitimité post-rexiste.
En 1968, il y a la révolte étudiante à Louvain et Bruxelles. La Mémoire de la dictature rexiste inspire un antifascisme militant.
En 1975, il y a la Fondation d’un parti d’extrême droite nostalgique, le Nouveau Rex, qui tente de se légitimer en dénonçant l’immigration.
Dans les années 1970 et 1980, il y a des crises économiques notamment de la sidérurgie wallonne avec une montée du chômage, ce qui a pour effet de donner du crédit aux régionalismes. Bruxelles devient un foyer de tensions communautaires.
En 1984, le Parlement adopte une loi mémorielle interdisant la propagande rexiste, comparable aux lois contre l’apologie du nazisme en Allemagne.
En 1992, la République fédérale de Belgique signe le traité de Maastricht. Bruxelles devient la capitale officielle de l’UE, plus tôt et plus fermement qu’en réalité, car la monarchie n’existe plus pour peser politiquement.
En 1993, il y a une nouvelle réforme fédérale, chaque région acquiert un statut quasi-étatique.
Dans les années 1990, le Débat est permanent sur la mémoire du régime rexiste avec des musées, des films et des procès tardifs de criminels de guerre.
En 2001, durant les Attentats du 11 septembre, Nouveau Rex profite d’un regain électoral en surfant sur l’islamophobie.
Entre 2007 et 2010, les crises politiques communautaires ont toujours lieu. Mais contrairement à la Belgique monarchique, la République fédérale dispose déjà de mécanismes confédéraux, le blocage est grave, mais moins paralysant.
En 2014, durant le centenaire de la Grande Guerre, la mémoire officielle insiste sur la rupture de 1940, où la Belgique a trahit son passé héroïque en se soumettant au Reich.
En 2016 avec les Attentats de Bruxelles, il y a une montée de l’extrême droite nostalgique. Nouveau Rex obtient 20 % aux élections fédérales.
En 2020, durant la Pandémie de COVID-19, les régions gèrent séparément la crise, confirmant le modèle confédéral.
En 2022, durant la Guerre en Ukraine, la Belgique, marquée par son passé rexiste, adopte une ligne très dure contre la Russie, par peur d’être accusée de complaisance avec les dictatures.
En 2025, la République fédérale de Belgique est une démocratie confédérale instable, où la Flandre et la Wallonie menacent parfois de divorcer. L’extrême droite nostalgique reste puissante avec Nouveau Rex qui a 25 % des intentions des vote. Bruxelles est un symbole européen, mais aussi un rappel constant du passé sombre, des polémiques éclatent régulièrement autour de monuments ou de commémorations.
Voici les témoignages fictifs de cette uchronie:
Journal fictif d’un ouvrier liégeois en mai 1936
« Hier, j’ai voté pour Degrelle. J’en avais assez des socialistes qui promettent et ne tiennent rien, assez des curés qui se mêlent de tout. Degrelle parle clair : il dit qu’il veut une Belgique forte, chrétienne, sans profiteurs. À l’usine, beaucoup l’ont suivi. On dit qu’il va tout changer. J’espère seulement qu’il ne ment pas, comme les autres. »
Lettre fictive d’un professeur catholique à Namur en Octobre 1938
« Cher collègue,
Les temps sont étranges. Mes élèves de rhétorique portent désormais l’uniforme bleu marine de la Jeunesse rexiste. On chante des hymnes avant les cours. Degrelle est partout, dans les manuels, dans les journaux, même dans les sermons.
Je crains qu’on ait remplacé le Christ par un autre dieu. »
Note fictive d’un officier belge en Mai 1940:
« L’ordre est venu ce matin : cessez-le-feu immédiat. Certains régiments ont encore voulu résister, mais nos supérieurs, tous proches du parti, ont fait comprendre qu’il fallait déposer les armes.
Je me sens trahi. Nous avions juré de défendre la neutralité, mais on nous a vendus à l’Allemand. »
Carnet fictif d’une résistante bruxelloise en Février 1943:
« Ils ont arrêté ma sœur hier, dénoncée pour avoir caché des Juifs. Les agents portaient l’insigne rexiste, pas allemand. C’est ce qui fait le plus mal, ce sont des Belges qui frappent, qui torturent, qui livrent nos enfants. On ne se bat plus seulement contre Hitler, mais contre notre propre pays. «
Discours fictif d’un magistrat lors de l’épuration en Septembre 1945:
« Citoyens,
Nous jugeons non seulement des individus, mais un régime tout entier. Le crime de Rex n’est pas seulement d’avoir trahi la patrie : c’est d’avoir corrompu son âme, d’avoir enseigné à nos enfants que l’obéissance valait mieux que la liberté.
C’est pourquoi la monarchie, complice par son silence, ne peut plus avoir sa place parmi nous. »
Témoignage fictif d’un étudiant à Louvain en Mai 1968:
« Nous avons jeté des pavés contre les policiers fédéraux hier. On nous traite d’anarchistes, mais nous n’oublions pas, nos grands-parents ont connu la dictature rexiste. Nous refusons qu’un nouvel ordre autoritaire s’installe, même au nom de l’université ou de la religion. Crier “Plus jamais Rex !” est devenu notre cri de guerre. »
Interview fictive télévisée d’une survivante juive en 1995:
« Ce n’est pas seulement Hitler qui a voulu notre mort. En Belgique, Rex s’est appliqué avec zèle à remplir les trains. Certains de mes voisins, que je croyais amis, portaient l’uniforme bleu.
Après la guerre, on a beaucoup parlé des Allemands, trop peu des Belges. J’ai peur qu’on oublie. »
Extrait fictif d’un forum politique en ligne en Mars 2025:
Utilisateur fictif “Flandre25” :
« Tout le monde diabolise Rex, mais sans Degrelle, la Belgique n’aurait jamais eu son fédéralisme fort. Aujourd’hui, les régions sont libres, et Bruxelles est la capitale de l’Europe grâce à lui. C’est facile de cracher sur le passé, mais la démocratie actuelle lui doit beaucoup. »
Réponse de l’utilisateur fictif “WallonieLibre” :
« N’importe quoi. Rex a vendu notre pays à Hitler et massacré nos familles. Ce fédéralisme, nous l’avons arraché dans la douleur, contre l’héritage rexiste, pas grâce à lui. »
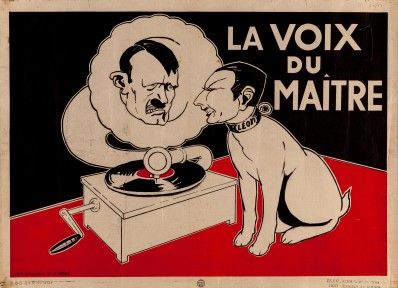
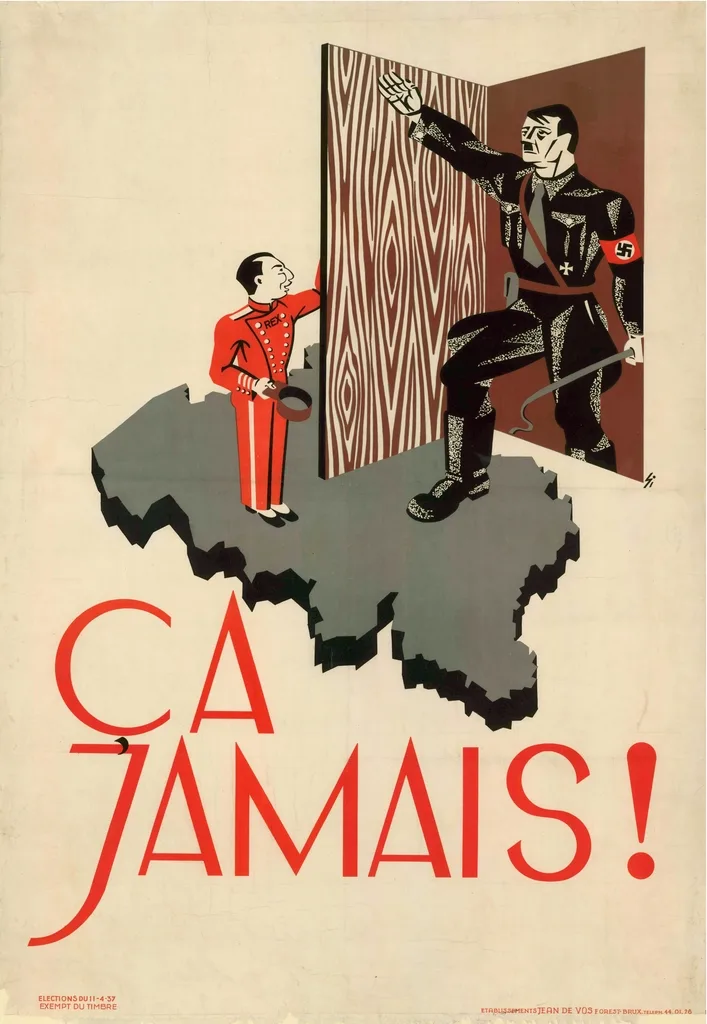
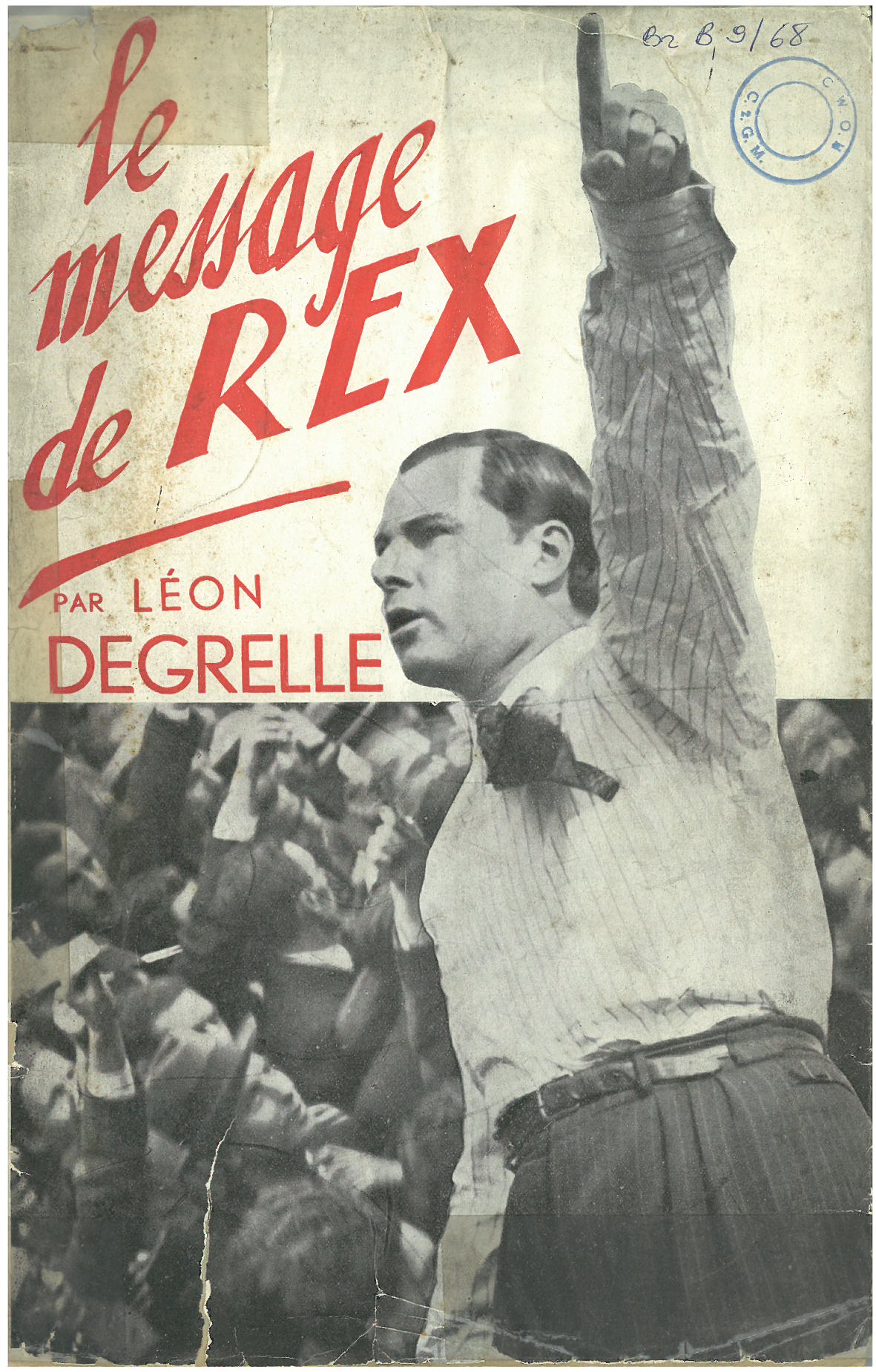
5.6) Et si le parti VNV(Vlaams nationaal verbond) avait totalement remporté les élections en 1936?
Dans notre réalité, le VNV a fait un score en 1936 d’environ de 8 %, mais ne domine pas la scène politique
Dans l’uchronie, plusieurs facteurs changent, Il y a un chômage massif avec un exode rural et un ressentiment contre l’«exploitation wallonne ». Les partis catholique et libéral sont discrédités, accusés de freiner l’émancipation flamande. le VNV promet une « Flandre libre, chrétienne et forte », dans un État flamand autonome ou confédéral. Le Reich allemand, déjà puissant, soutient discrètement le VNV avec de l’argent et de la propagande.
Aux élections de 1936, le VNV obtient 45 % des voix nationales avec une majorité en Flandre et une percée limitée en Wallonie. Rex reste minoritaire, les socialistes et les libéraux sont laminés. Grâce au système proportionnel, le VNV devient le premier parti de Belgique et Léon Degrelle est marginalisé.
Le VNV impose une réforme profonde. La Belgique devient une fédération dominée par la Flandre. La ville de Bruxelles est « flamandisée » de force. Les syndicats socialistes et communistes sont interdits. La Presse est muselée. Les élites francophones sont surveillées. Il y a un rapprochement avec l’Allemagne et une hostilité croissante envers la France vue comme protectrice des Wallons.
L’Église catholique, initialement méfiante, finit par collaborer, séduite par le discours chrétien-nationaliste.
Voici la chronologie de cette uchronie:
En 1936, le VNV obtient 45 % des voix aux législatives. Les partis catholique et libéral s’effondrent en Flandre, le Parti ouvrier belge recule. Le chef du VNV, Staf De Clercq, devient Premier ministre.
En 1937, il y a la mise en place de réformes linguistiques radicales, le Flamand devient seule langue officielle de l’administration. Les fonctionnaires francophones sont déplacés ou licenciés.
En 1938, Bruxelles est proclamée « capitale flamande », les écoles francophones y sont fermées. La presse francophone est censurée.
En 1939, la Constitution est révisée, la Belgique devient une République fédérale, dominée par la Flandre. La Wallonie est placée sous un régime d’«autonomie surveillée ».
En Mai 1940, lors de l’invasion allemande, le VNV négocie la capitulation en quelques jours. La Flandre devient un « Vlaamsche Staat » collaborateur, tandis que la Wallonie est placée sous administration militaire allemande directe.
En 1941, il y a la Création de la « Vlaamse SS », des milliers de jeunes flamands rejoignent le front de l’Est.
En 1942, il y a le début des déportations massives de Juifs depuis Anvers et Bruxelles, organisées avec l’aide du VNV.
En 1943, la Résistance wallonne est très active notamment à Liège, à Charleroi et à Namur, la répression y est féroce.
En 1944, c’est la Libération de la Belgique. Le « Vlaamsche Staat » s’effondre. Ses dirigeants fuient en Allemagne.
En 1945, il y a une épuration sauvage avec des exécutions sommaires de collaborateurs avec des Procès de dirigeants du VNV, la monarchie est abolie à cause de la complicité de Léopold III dans cette uchronie. La Belgique devient une République provisoire.
En 1946, il y a une nouvelle constitution avec la République fédérale de Belgique (ou RFB) avec deux entités, la Flandre et la Wallonie. Bruxelles est administrée par un gouvernement fédéral spécial.
Entre 1947 et 1948, il y a le Plan Marshall, L’aide américaine profite surtout à la Wallonie, jugée comme une « fidèle alliée ». En 1951, la RFB adhère à la CECA, mais la méfiance européenne vis-à-vis de la Flandre reste forte. Durant les années 1950, la Wallonie connaît un âge d’or industriel.
La Flandre reste économiquement marginalisée, associée à la collaboration. En 1960, c’est l’indépendance du Congo. L’opinion internationale rappelle que la Belgique, par le VNV, avait collaboré à la Shoah, L’image du pays reste ternie.
En 1965, la croissance économique redémarre en Flandre avec les ports, les industries chimiques et le textile modernisé. La Wallonie entre en crise avec la sidérurgie.
En 1968, c’est la Crise de Louvain, les étudiants francophones dénoncent la mainmise flamande sur l’université(l’inverse de la réalité). En 1970, a lieu une réforme fédérale, la Flandre obtient une autonomie presque totale, la Wallonie réclame davantage de garanties.
En 1975, a lieu la Fondation du Nieuw-VNV, parti néo-fasciste flamand qui reprend la rhétorique nationaliste, mais tente de se « dédiaboliser ».
Dans les années 1970 et 1980, Bruxelles devient un foyer de conflits mémoriels avec des statues du VNV déboulonnées et des manifestations antifascistes.
En 1980 a lieu une nouvelle réforme institutionnelle, la Belgique devient une confédération de facto, chaque région ayant ses propres ministères.
En 1984, a lieu une Loi mémorielle interdisant la propagande du VNV.
En 1992, a lieu le Traité de Maastricht. Bruxelles devient capitale officielle de l’UE, mais aussi un symbole de la lutte entre mémoires flamande et wallonne.
En 1993, la République fédérale de Belgique adopte un système bicaméral, une chambre flamande, une chambre wallonne, et un sénat fédéral.
En 1995, les débats sur la collaboration resurgissent avec des procès de vieillards, anciens du VNV.
En 2001, après le 11 septembre, le Nieuw-VNV progresse avec un discours islamophobe et sécuritaire.
Entre 2007 et 2010, il y a des crises politiques communautaires. La République fédérale tient grâce à des compromis, mais les tensions sont permanentes.
En 2014, c’est la Commémoration de 1914. Les Wallons insistent sur leur résistance, les Flamands sont divisés entre honte et réhabilitation du VNV.
En 2016, a lieu les Attentats de Bruxelles. Le Nieuw-VNV accuse l’« immigration wallonne francophone » d’avoir favorisé l’islamisme, renforçant les tensions.
En 2020, le COVID-19 est géré séparément par la Flandre et la Wallonie. Le gouvernement fédéral perd encore plus de légitimité.
En 2022, a lieu la guerre en Ukraine. La Belgique, hantée par son passé de collaboration, adopte une ligne dure contre la Russie.
En 2025, La Belgique est une confédération fragile, où la Flandre et la Wallonie fonctionnent presque comme deux États.
Le Nieuw-VNV est à 30 % en Flandre, se présentant comme héritier d’une « vraie Flandre libre », tout en tentant de minimiser l’héritage nazi.
En Wallonie, l’antifascisme reste une culture politique dominante.
Bruxelles est la capitale européenne, est à la fois une vitrine internationale et un champ de bataille mémoriel permanent.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Journal fictif d’un jeune instituteur flamand à Bruges en Octobre 1936:
« Quelle fierté aujourd’hui ! La Flandre a enfin relevé la tête. Plus de français imposé à l’école, plus de mépris des Wallons. À l’institut, nous avons reçu de nouveaux manuels : l’histoire commence à la bataille des Éperons d’Or, et se termine avec Staf De Clercq. Certains collègues francophones protestent, mais ils n’ont plus voix au chapitre. »
Lettre fictive d’un avocat wallon à son frère à Liège en juin 1938:
« Mon cher Émile,
Les temps sont sombres. Ici, nous devons désormais plaider en néerlandais devant certains tribunaux, même en Wallonie. On nous dit que c’est pour “unifier la Belgique”, mais nous savons bien que c’est pour nous humilier.
Beaucoup songent à rejoindre la France, d’autres parlent de résistance. Moi, j’ai peur pour mes enfants. »
Note fictive d’un officier allemand à Bruxelles en mai 1940:
« La capitulation belge a été d’une rapidité étonnante. Les dirigeants du VNV ont non seulement ordonné l’arrêt des combats, mais déjà préparé les structures d’un “État flamand autonome”. C’est une collaboration sans conditions. Nous pourrons utiliser Anvers et Bruxelles comme bases logistiques majeures. »
Témoignage fictif d’une mère anversoise en juin 1942:
« Ils sont venus hier, avec des camions. Ce n’étaient pas des soldats allemands, mais des hommes du VNV. Ils ont frappé à la porte de ma voisine, une couturière juive. Ses deux enfants pleuraient, ils ont été poussés à coups de bottes. On dit qu’ils partent “travailler à l’Est”. Mais tout le monde sait qu’ils ne reviendront jamais. »
Carnet fictif d’un résistant wallon à Namur en Janvier 1943:
« Nous combattons deux ennemis, les nazis et les Flamands du VNV. Les trains pour l’Allemagne partent surtout à Anvers, avec l’aide de la police flamande. Nous faisons sauter les voies, mais chaque fois, la répression tombe sur nos familles. Certains disent qu’après la guerre, il faudra rompre avec la Flandre. »
Extrait fictif du procès de Staf De Clercq à Bruxelles en décembre 1945:
Le juge : « Reconnaissez-vous avoir proclamé un État flamand collaborateur du Reich ? »
– De Clercq : « Oui. Je l’ai fait pour l’avenir de mon peuple. La Flandre seule n’avait pas de place en Europe, avec l’Allemagne nous étions forts. »
– Brouhaha dans la salle : « Traître ! » – « Assassin ! »
– Le juge : « Vous avez vendu votre pays. Vous serez exécuté. »
Journal fictif d’un ouvrier wallon à Charleroi en 1951:
« Voilà que les Américains investissent chez nous. La sidérurgie tourne à plein régime. En Flandre, ils se plaignent d’être laissés pour compte. C’est bien fait : ils ont choisi l’Allemagne, nous avons choisi la liberté. »
Témoignage fictif d’un étudiant flamand à Louvain en Mai 1968:
« Nous avons grandi dans la honte. Nos parents n’osent pas parler de la guerre. Certains étaient au VNV, d’autres ont résisté en silence. Maintenant, nous refusons de porter ce fardeau. Mais quand les francophones nous accusent tous d’être des fils de traîtres, la colère monte. Nous voulons une Flandre nouvelle, sans chaînes, ni de Bruxelles, ni du passé. »
Interview fictive d’une survivante juive à Anvers en 1995:
« Ce n’est pas seulement Hitler qui nous a chassés. Ce sont les hommes du VNV, nos voisins, qui sont venus frapper à notre porte. Quand je marche dans les rues d’Anvers et que je vois des jeunes porter des drapeaux flamands, j’ai peur. Est-ce qu’ils savent ce que leurs grands-parents ont fait ? »
Extrait fictif d’un débat télévisé à Bruxelles en septembre 2025:
Politicien du Nieuw-VNV : « Nous devons enfin réhabiliter notre histoire. Oui, le VNV a commis des erreurs, mais il a posé les bases du fédéralisme moderne et de l’émancipation flamande. »
Députée wallonne : « Erreurs ? Vous appelez collaboration avec les nazis, déportation de nos concitoyens, destruction de la Belgique des “erreurs” ? Jamais nous n’accepterons cette réécriture. »
Le public : applaudissements mêlés de huées.
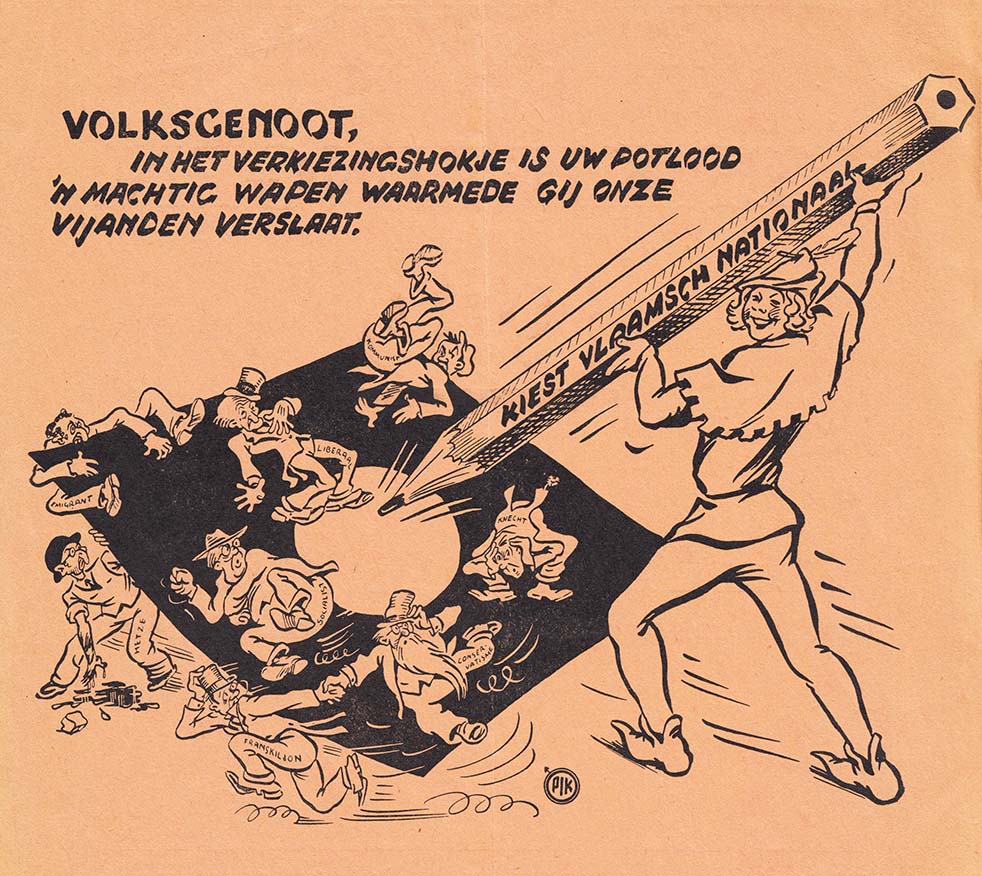

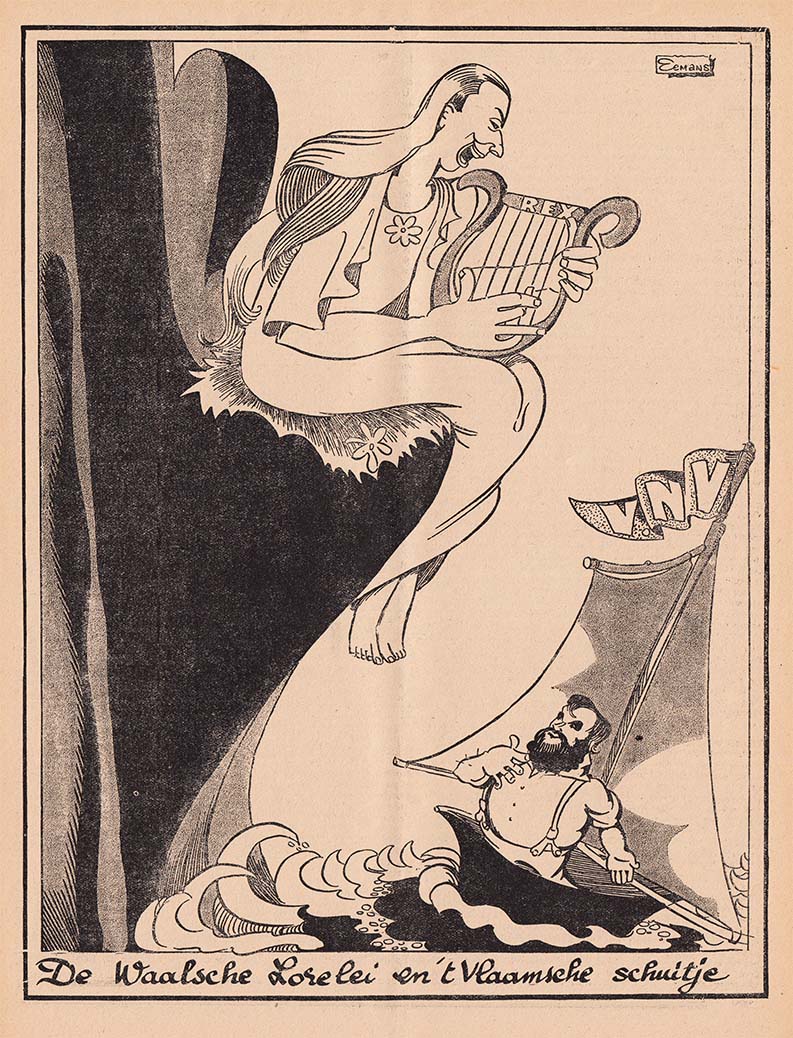
5.7) Et si le Verdinaso avait totalement remporté les élections de 1936?
Dans la réalité, le Verdinaso était un petit mouvement fascisant, catholique et corporatiste, avec une idéologie originale, il prônait un État autoritaire solidariste, un projet de « Groot-Nederland » (rassemblement des Flamands et des Néerlandais), et ce parti avait une vision élitiste, anti-parlementaire, catholique, mais moins grossièrement collaborationniste que Rex.
Dans l’uchronie, la crise économique frappe encore plus durement la Belgique. Rex et le VNV s’affaiblissent par leurs rivalités. Joris van Severen durant les élections, séduit un électorat à la fois de la jeunesse flamande et une partie des élites catholiques wallonnes par son discours de « troisième voie ». En 1936, le Verdinaso obtient 40 % des voix, devient le premier parti du pays, et Van Severen prend la tête du gouvernement.
En 1936 c’est la Victoire électorale du Verdinaso avec 40 % des voix avec une majorité relative. Joris Van Severen devient Premier ministre.
En 1937 a lieu la Dissolution de la Chambre et du Sénat. Il y a la Mise en place d’une « Chambre corporative » représentant les métiers et les corporations. C’est la Fin de la démocratie parlementaire.
En 1938 a lieu la Création de la Garde Dinaso, qui est une milice de jeunesse. Avec une Propagande axée sur « l’unité chrétienne de la nation ».
En 1939, il y a la Proclamation de l’État solidariste de Belgique. Van Severen se déclare « Chef de l’État ». La monarchie subsiste formellement mais est marginalisée.
En Mai 1940, L’Allemagne envahit la Belgique. Contrairement à Rex ou au VNV, Van Severen refuse la dissolution et tente de négocier une collaboration limitée pour préserver l’indépendance.
En 1941, Le Verdinaso accepte l’envoi de volontaires belges sur le front de l’Est (la Légion Dinaso), mais maintient ses institutions.
Entre 1942 et 1943, il y a des tensions croissantes avec Berlin, Van Severen refuse la germanisation et s’oppose à l’intégration dans le Reich.
En Septembre 1944 a lieu la Libération de Bruxelles par les Alliés. Van Severen est arrêté, jugé pour collaboration.
En Mai 1945, c’est la Fin de la guerre. Van Severen est condamné à perpétuité. Le Verdinaso est dissous, mais le système solidariste laisse une empreinte.
En 1946, il y a l’Abolition de la monarchie, jugée compromise par son soutien tacite au régime). Il y a alors la Proclamation de la République belge.
Entre 1947 à 1950, Il y a une épuration mais limitée, contrairement aux rexistes, beaucoup de cadres du Verdinaso sont réintégrés après quelques années.
En 1950, la Tentative de restaurer Léopold III échoue avec un refus massif en Wallonie et à Bruxelles.
En 1955, le pays adopte une constitution « néo-solidariste », combinant république, catholicisme d’État et structures corporatives.
En 1960, il y a l’Indépendance du Congo dans le chaos, c’est la conséquence du manque d’expérience parlementaire après 20 ans d’autoritarisme.
En 1968, il y a des soulèvements étudiants avec une dénonciation du « passé brun » du pays. La jeunesse réclame une démocratisation complète.
En 1970, ont lieu les Premières réformes linguistiques. La fédéralisation est tardive et limitée, car le Verdinaso avait cultivé une vision unitaire.
En 1978, a lieu la Création du Parti Solidariste Belge (PSB), d’extrême droite, héritier symbolique du Verdinaso. Il gagne une base électorale entre 8 à 10 % des intentions de vote.
En 1980, il y a une constitution amendée : la Belgique devient une république fédérale centralisée. Avec un Fédéralisme limité par l’héritage solidariste.
En 1985, Bruxelles devient siège de la CEE. On promeut l’image d’une Belgique « réconciliée avec l’Europe ».
En 1992, a lieu le Traité de Maastricht. La Belgique s’investit dans l’UE pour tourner la page de son passé autoritaire.
En 1995 ont lieu des débats historiques, certains défendent Van Severen comme « protecteur de l’indépendance », d’autres le qualifient de fasciste pur et dur.
En 2001, après le 11 septembre, le Parti Solidariste relance une rhétorique sécuritaire d’« unité nationale » mais aussi d’« identité chrétienne ».
En 2010, les Crises communautaires sont plus faibles que l’Histoire réelle, car l’État reste centralisé, mais le ressentiment flamand se ravive contre « l’État unitaire artificiel ».
En 2020, il y a une gestion centralisée de la pandémie (contrairement à notre histoire). Avec un succès sanitaire relatif, mais avec des tensions en Flandre qui réclame plus d’autonomie.
En 2025, la Belgique est une République fédérale unitaire, paradoxale, elle a des institutions fédérales, mais l’État reste fort au centre. Le Néo-Verdinaso (héritier du PSB) atteint 15 à 20 % des voix. Les débats mémoriels sont vifs : les uns voient Van Severen comme un « dictateur fasciste » qui a compromis la Belgique, les autres comme « l’homme qui a empêché l’annexion totale par Hitler ». Bruxelles reste le symbole de cette ambiguïté, elle est la capitale de l’Europe, mais elle reste hantée par le spectre d’un solidarisme jamais complètement assumé.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Journal fictif d’un étudiant catholique flamand à Gand en Octobre 1936:
« Enfin ! Plus de palabres stériles au Parlement. Le Chef Van Severen va redonner discipline et dignité à notre peuple. À l’université, on parle déjà de remplacer les cours de droit par des cours de doctrine solidariste. Certains professeurs râlent, mais les jeunes, nous, nous croyons. »
Lettre ficitve d’un fonctionnaire wallon à son frère à Namur en février 1938:
« Mon cher Paul,
Le français disparaît peu à peu des documents officiels. Tout doit être bilingue, mais dans les faits, c’est le Flamand qui prime. Les syndicats ont été remplacés par des “corporations professionnelles” qui obéissent au parti. Je crains pour nos libertés, mais qui ose parler finit au poste. »
Note fictive d’un officier allemand à Bruxelles en juin 1941:
« Les Belges du Verdinaso collaborent avec nous, mais ils tiennent à leur indépendance. Van Severen refuse la dissolution de son État. Contrairement au VNV, ils ne rêvent pas de germanisation, mais d’unité catholique. Berlin observe cela avec méfiance. »
Carnet fictif d’une couturière juive à Anvers en Août 1942:
« Ce ne sont pas des SS qui sont venus frapper, mais des hommes de la Garde Dinaso. Ils disaient : “C’est pour l’ordre de l’État.” Ils ont pris mon mari, m’ont laissé avec les enfants. On dit que Van Severen protège les Belges, mais pour nous, il n’y a pas de protection. »
Tract fictif clandestin de la Résistance à Liège en décembre 1943:
“Belges !
Le Verdinaso prétend défendre l’indépendance, mais il livre nos fils au front de l’Est et nos voisins juifs aux camps.
Un régime qui collabore reste un régime de traîtres. Résistez !”
Extrait fictif du procès de Joris Van Severen à Bruxelles en Octobre 1945:
Le juge : « Vous avez maintenu un État fasciste collaborant avec Hitler. »
Van Severen : « J’ai évité que la Belgique soit avalée par le Reich. Sans moi, vous n’auriez plus de pays. »
Un survivant dans la salle : « Et nos morts ? Et les déportés ? Vous les appelez un “sacrifice” ? »
Journal fictif d’un mineur wallon à Charleroi en mai 1951:
« On dit que le solidarisme est fini, mais dans nos mines, les vieilles structures corporatives sont toujours là. Les patrons et l’État marchent main dans la main. Pas étonnant que les syndicats renaissent avec colère. »
Témoignage fictif d’une étudiante flamande à Louvain en Mai 1968:
« Nous ne voulons plus vivre sous l’ombre du Verdinaso. Nos parents se taisent, honteux ou complices. Nous voulons une vraie démocratie. Mais quand on dit cela, on nous répond qu’on doit être reconnaissants à Van Severen d’avoir “sauvé la Belgique”… Quelle hypocrisie. »
Interview fictive d’un rescapé juif à Gand en 1995:
« Le régime n’a pas été nazi, dit-on. Mais quand ils sont venus chercher ma famille, ce n’étaient pas des Allemands : c’étaient des Belges, en uniforme dinaso. Cela, je ne pourrai jamais le pardonner. »
Débat télévisé fictif à Bruxelles en Septembre 2025:
Politicien du Néo-Solidarisme : « Van Severen n’était pas un traître, il a empêché l’annexion totale. Nous devons reconnaître son rôle de protecteur. »
Historienne wallonne : « Protecteur ? Il a instauré un régime fasciste, collaboré aux déportations et muselé la Belgique. C’est cela, votre héritage ? »
Le public : applaudissements mêlés de huées.


5.8) Et si les trois partis dont le parti Rex,VNV et le Verdinaso individuellement n’ont pas assez de voix pour l’emporter mais décident de s’unir en 1936 en coalition et l’emportent?
Dans la réalité, Rex, le VNV et le Verdinaso se faisaient concurrence, Rex en Wallonie et à Bruxelles, le VNV en Flandre, le Verdinaso plus marginal avec son projet:« grand-néerlandais ».
Dans l’uchronie, les chefs de partis comprennent que séparément, aucun n’aura assez de voix pour peser.
L’ascension d’Hitler et de Mussolini donne une légitimité nouvelle aux mouvements autoritaires.
En Belgique, les élites traditionnelles que cela soit du côté catholique,libéral ou socialiste paraissent incapables de gérer la crise économique et la polarisation linguistique.
Des contacts secrets entre Léon Degrelle et Joris Van Severen débouchent sur un compromis, Rex garde son rôle de mouvement catholique et populiste en Wallonie, le VNV domine en Flandre, et le Verdinaso devient la passerelle idéologique. Ils créent ensemble la Coalition nationale (Nationaal-Rexistische Verbond ou NRV).
Durant les Élections législatives de mai 1936 : au lieu d’un succès dispersé, la coalition NRV présente des listes communes.
Le résultat est qu’ ils ont récoltés 38 % des voix au lieu des 11,5 % de Rex et 7 % du VNV dans notre réalité). Ils deviennent le premier bloc de la Chambre, devant les socialistes. Le Roi Léopold III, inquiet mais pragmatique, les appelle à former un gouvernement minoritaire avec un soutien extérieur.
Le gouvernement NRV instaure un régime « d’ordre nouveau » avec des lois limitant la liberté de la presse, la dissolution des syndicats socialistes et communistes, la création de milices paramilitaires légales.
La Belgique reste monarchique, mais le roi perd son influence au profit d’un exécutif fort dominé par Degrelle qui aurait été ministre de la Propagande et de l’Éducation, Staf De Clercq aux Affaires flamandes et Van Severen à la Défense et Ordre intérieur.
Il y a un accord fragile entre les flamands et les wallons, on reconnaît officiellement deux communautés mais dans le cadre d’un État autoritaire centralisé.
Le Verdinaso pousse à une ouverture vers les Pays-Bas, ce qui crée des tensions internes.
La Belgique se rapproche de l’Italie fasciste et de l’Allemagne nazie.
Les accords militaires avec la France et le Royaume-Uni sont progressivement vidés de leur sens.
En 1938, Degrelle est reçu par Mussolini à Rome, Bruxelles est vue comme un « maillon autoritaire » du continent.
Voici la chronologie de cette uchronie:
En Juillet 1936, il y à la Création d’une milice d’État issue des « croisés rexistes » et du Verdinaso.
Entre 1937 et 1939, il y a la mise en place de réformes autoritaires avec des lois limitant le droit de grève, le contrôle de l’université et de l’enseignement. Il y a un rapprochement avec l’Italie fasciste et l’Allemagne nazie.
En 1938, Degrelle rencontre Mussolini à Rome.
En 1939, la Neutralité officielle est toujours d’application mais orientée vers l’Axe.
Entre 1940 et 1944, la Belgique devient alliée de l’Axe
En Mai 1940, il y a l’invasion allemande. La Belgique ne résiste quasiment pas, le gouvernement NRV ordonne la reddition immédiate. Bruxelles devient un État satellite du Reich, dirigé par Degrelle comme « Chef du Gouvernement National ».
Le régime collabore activement et met en place de lois antisémites dès 1941. Il y a une participation à l’envoi de volontaires belges sur le front de l’Est. Il y a une répression sanglante de la Résistance,moins forte qu’en réalité car étouffée très tôt.
En Septembre 1944, il y a la Libération par les Alliés. Le gouvernement NRV s’effondre. Degrelle,De Clercq et Van Severen sont capturés et après le procès ils sont exécutés en 1945.
En 1946, il y a l’abolition de la monarchie Léopold III est accusé de compromission avec le NRV. La Belgique devient une République parlementaire. Il y a l’interdiction définitive de Rex, du VNV et de tout parti d’extrême droite.
Entre 1947 et 1955, la Reconstruction se fait sous la tutelle et la surveillance des alliés(comparable à l’Allemagne).
La Constitution est réécrite et est inspirée de la IVe République française et de la Loi fondamentale allemande.
Il y a un fort soutien du Plan Marshall, la Belgique étant vue comme un « laboratoire de démocratisation ».
En 1951, il y a le Retour d’institutions stables. Bruxelles est choisie comme le siège de l’OTAN en 1952.
Entre 1957 et 1970, l’intégration européenne commence.
En 1960, il y a les commémorations de la « libération » de 1944, mais la mémoire est douloureuse avec le silence officiel sur la collaboration massive du NRV.
Les tensions linguistiques sont étouffées , toute revendication flamande ou wallonne est assimilée au spectre du NRV.
Les élites politiques insistent sur une identité « belge unitaire » comme rempart contre le fascisme.
Entre les années 1970 et 1980, le traumatisme refait surface, car en 1976 il y a la Publication de témoignages d’anciens résistants dénonçant la complaisance des élites d’après-guerre.
En 1980,il y a les premières demandes sérieuses de fédéralisme, mais qui sont freinées par la peur de voir resurgir des nationalismes extrêmes.
En 1985, il y a des manifestations étudiantes à Louvain et Liège contre l’oubli du passé fasciste.
En 1993 il y a une révision constitutionnelle, la Belgique devient enfin un État fédéral avec 20 ans de retard sur notre réalité.
Les partis flamands et wallons obtiennent plus d’autonomie, mais avec de fortes garanties « antifascistes » comme la cour constitutionnelle vigilante et l’interdiction de partis extrémistes. Bruxelles est confirmée comme la capitale de l’UE et le symbole de la réconciliation démocratique.
En 2002, il y a l’ouverture d’un musée national de la Dictature du NRV à Namur. Toute forme de populisme ou de nationalisme est surveillée de près. L’extrême droite belge reste ultra-minoritaire et criminalisée.
En 2014, c’est le 70ème anniversaire de la chute du NRV avec de grandes cérémonies avec la présence de dirigeants européens.
En 2016, il y a les attentats de Bruxelles, la Belgique insiste sur la défense de la démocratie contre les extrémismes, en rappelant le traumatisme de 1936–1944.
En 2025, la Belgique est une République fédérale stable d’environ 11,5 millions d’habitants. Bruxelles est la capitale de l’UE et de l’OTAN. L’identité belge repose sur un mot d’ordre : « Plus jamais ça ». L’extrême droite est quasiment inexistante, aucun parti n’obtient plus de 5 %.
La société reste cependant hantée par la question, comment un petit pays a-t-il pu tomber si vite aux mains d’une coalition autoritaire en 1936 ?
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Bruxelles au mois de juin 1936, témoignage fictif d’un jeune électeur catholique:
« Mon père a toujours voté pour les catholiques. Cette fois, il m’a dit : “ Je vote pour Degrelle, il est jeune, il parle vrai, il donnera de l’honneur à la Belgique.” Je l’ai fait. Quand j’ai vu que Rex et les Flamands s’étaient alliés, je me suis senti fort, comme si notre pays reprenait son destin en main. »
Liège en octobre 1937, témoignage fictif d’une institutrice socialiste renvoyée:
« Ils m’ont appelée dans le bureau du directeur : “Votre enseignement n’est pas conforme aux valeurs du nouvel État.” Le lendemain, un homme du parti est venu me remplacer. On dit que j’ai été dénoncée parce que j’avais distribué des tracts ouvriers. Mes élèves pleuraient. Moi aussi. »
Anvers, mai 1940, un témoignage d’un soldat belge:
« On nous a dit de poser les armes. Pas un coup de feu, pas une résistance. J’ai vu l’ennemi entrer dans ma ville sans bataille. Certains de mes camarades criaient : “Trahison !” D’autres disaient : “Au moins, la guerre est finie.” Mais au fond, nous savions que nous étions vendus. »
Namur en février 1942, témoignage fictif d’une jeune femme juive:
« On nous a obligés à porter l’étoile. Les miliciens du NRV se moquaient de nous dans la rue. Mon père a été convoqué à la maison communale. Il n’est jamais revenu. On dit qu’il a été envoyé vers l’Est. Je ne savais pas que des Belges pouvaient faire ça à d’autres Belges. »
Charleroi, septembre 1944, témoignage fictif d’un résistant:
« Quand les Américains sont arrivés, nous sommes sortis de nos caches. Mais le plus incroyable, c’était de voir nos voisins frapper les rexistes, les tondre, les insulter. Le pays entier a vomi ce qu’il avait accepté huit ans plus tôt. J’ai pensé : trop tard pour mes camarades morts. »
Bruxelles en 1946, témoignage fictif d’une employée administrative:
« Le roi est parti. On dit qu’il avait trop toléré le régime. J’ai voté pour la République. Moi, simple secrétaire, j’ai eu l’impression de choisir l’avenir. On voulait oublier Degrelle, oublier ces années sombres, mais comment oublier ? »
Gand, en 1962, témoignage fictif d’un étudiant flamand:
« Je voulais militer pour plus d’autonomie flamande, mais mes professeurs m’ont prévenu : “Attention, jeune homme. Chaque revendication communautaire rappelle le fascisme.” Alors je me tais. Ma langue est un fardeau, pas une fierté. »
Bruxelles en 1985, témoignage fictif d’un survivant juif, lors d’une conférence:
« On parle peu de nous, trop peu. Pendant qu’en France on discute de Vichy, ici on détourne le regard. Mais je dis aux jeunes : c’était ici aussi, dans vos rues, vos écoles, vos gares. Le NRV n’était pas seulement un parti : c’était vos voisins, vos instituteurs, vos bourgmestres. »
Louvain en 1993, témoignage d’une militante wallonne
« Enfin, le fédéralisme ! Il était temps. Mais chaque fois que nous prononcions le mot “Wallonie”, on nous rappelait Degrelle. Comme si aimer sa région, c’était déjà flirter avec l’extrême droite. On a dû se battre deux fois : pour nos droits, et pour notre innocence. »
Bruxelles en 2025, témoignage fictif d’un étudiant en histoire:
« J’ai visité le Musée de la Dictature à Namur. Les photos m’ont glacé. Degrelle souriant aux côtés de Léopold III, les défilés du NRV dans les rues, les affiches contre les Juifs… Et de penser que tout ça avait commencé par une élection. Une seule élection. Je suis sorti avec une certitude : ça ne doit plus jamais arriver. »
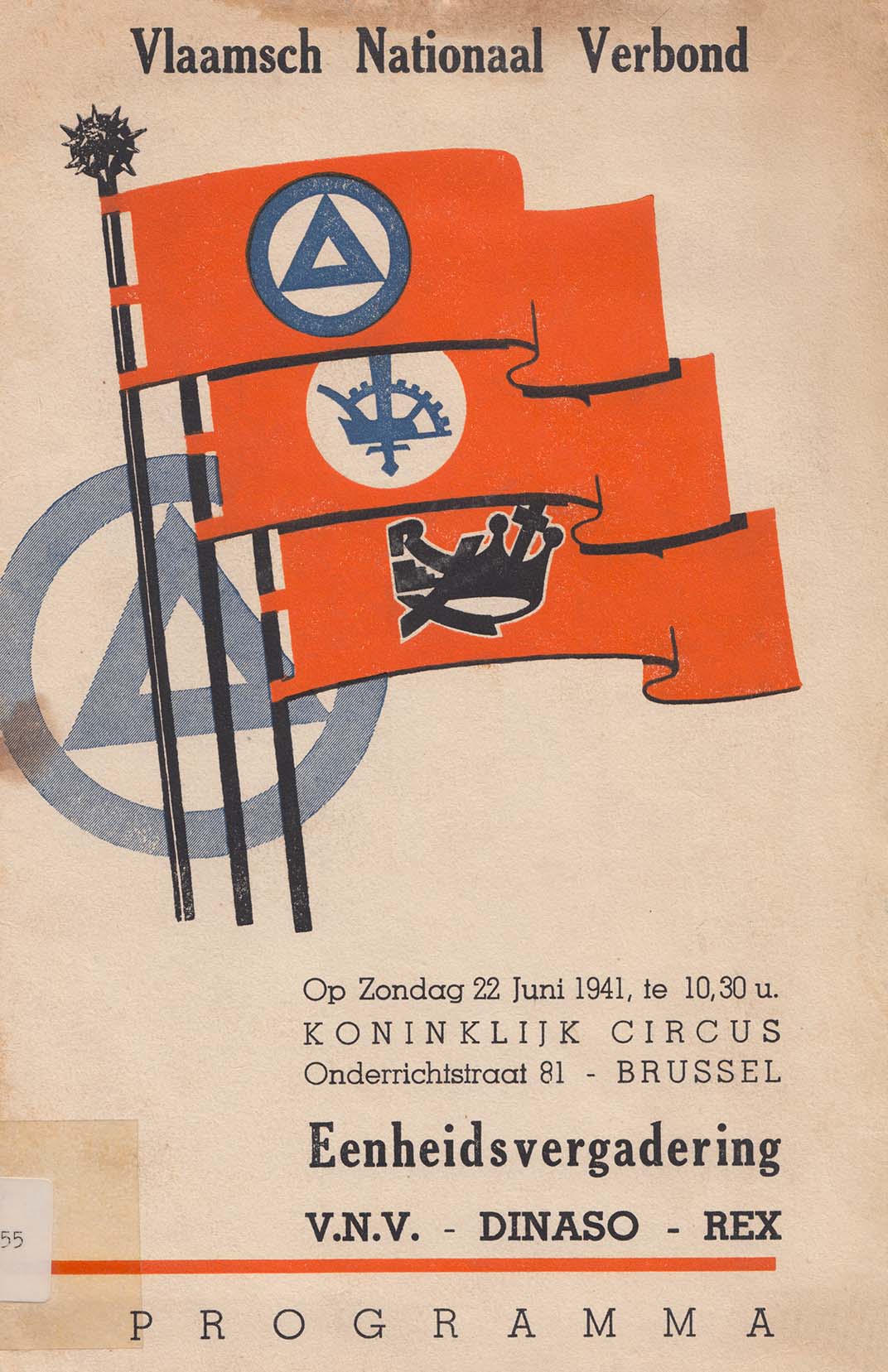
5.9) Et si en 1936, suite à la remilitarisation de la Rhénanie la Belgique avait proposé aux Pays-Bas et au Luxembourg de former une union démocratique du Bénélux?
La remilitarisation de la Rhénanie par Hitler en mars 1936 inquiète gravement la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Le Sentiment d’urgence est de créer une frontière commune défensive.
La Belgique est en crainte d’isolement face à l’Allemagne. Les Pays-Bas ont peur de l’agression et une envie de coopération économique avec la Belgique. Le Luxembourg est trop petit pour se défendre seul et il voit l’union comme un moyen de sécurité.
Le roi Léopold III et le gouvernement belge de Pierre Nothomb ou son successeur plaident pour une fédération démocratique et économique, inspirée des idées de coopération européenne précoce.
Voici la chronologie pour cette uchronie:
En 1936, il y a la Signature d’un traité fédéral du Bénélux avec un parlement commun pour les affaires étrangères, la défense et le commerce extérieur. Il y a une monnaie unique encore facultative, mais avec la libre circulation des capitaux et des travailleurs.
En 1937, il y a la création d’une force militaire conjointe de 150 000 hommes, coordonnée entre Bruxelles, Amsterdam et le Luxembourg.
En 1938, il y a la mise en place d’un marché commun pour les industries clés comme charbon, l’acier et le textile.
Entre 1939 et 1940, lorsque l’Allemagne attaque la France en mai 1940, le Bénélux fédéré offre une défense coordonnée :
Il y a une ligne fortifiée combinant Liège, Maastricht et la vallée de l’Escaut. La résistance militaire est plus organisée que dans la réalité historique. L’Allemagne envahit quand même, mais avec des pertes plus lourdes et un retard stratégique ou bien Hitler hésite à attaquer immédiatement le Bénélux, craignant une guerre prolongée.
Durant l’occupation, les territoires fédérés servent de pôle de résistance coordonnée avec les Alliés. Il y a l’Administration unifiée du Benelux avec une planification économique et un rationnement mieux organisé que dans la réalité. Après la guerre, le Bénélux est prêt à devenir un embryon d’Europe unie dès 1945 grâce à ses institutions fédérales préexistantes.
Il y a moins de destructions initiales que dans la réalité.Marché commun précoce, Il y aurait des échanges internes stimulés et une industrialisation rapide. Le sentiment d’appartenance à une fédération démocratique avant l’UE.
En 1945, c’est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Bénélux fédéral est intact comparé aux autres pays européens.
En 1946, il y a l’adoption de la Constitution fédérale définitive avec la création d’un Parlement bicaméral avec une chambre des peuples et un Sénat des régions.
En 1947, c’est la Reconstruction des infrastructures, des ports comme Anvers, et Rotterdam), et des voies ferrées, et des centrales électriques.
En 1948, il y a la mise en place du plan Marshall Bénélux, combiné à des fonds fédéraux pour moderniser l’industrie et l’agriculture.
En 1950, il y a la création d’une armée fédérale intégrée pour garantir la sécurité face à la guerre froide naissante.
En 1951, c’est le lancement d’un programme d’éducation bilingue (français, néerlandais + luxembourgeois officiel).
En 1952, la Première banque centrale fédérale est créée avec une politique monétaire commune pour stabiliser l’économie.
En 1955, le Bénélux devient un leader européen dans le charbon et l’acier, favorisant l’industrialisation.
En 1958, durant les premières élections fédérales au suffrage universel direct il y a une augmentation de la participation citoyenne.
En 1959, il y a le lancement d’un programme de logement social fédéral pour les ouvriers et employés.
En 1960, il y a la Première réforme agricole majeure avec la mécanisation et la collectivisation partielle des exploitations pour augmenter la productivité.
En 1962, il y a la signature d’un accord douanier renforcé avec les voisins allemands et français, consolidant le marché fédéral.
En 1965, il y a la Fondation de l’Université Fédérale du Bénélux avec un campus à Bruxelles, Liège et Amsterdam.
En 1968, il y a des manifestations étudiantes influencées par Mai 1968 en France avec une réforme du système éducatif et une inclusion de programmes civiques.
En 1970, c’est le début d’un plan énergétique fédéral pour diversifier le charbon et lancer les premières centrales nucléaires.
En 1973, c’est le choc pétrolier mondial, le Bénélux fédéral met en place des mesures d’économie d’énergie et de subventions industrielles.
En 1975, c’est le lancement du programme de transports intégrés avec un train à grande vitesse entre Bruxelles, Amsterdam et le Luxembourg.
En 1977, il y a le lancement de réformes sociales avec des congés payés étendus, avec une assurance santé fédérale unique.
En 1979, le Bénélux devient un modèle pour la coopération européenne, inspirant les futurs traités de la CEE.
En 1981, c’est le début des programmes fédéraux de recherche technologique : microélectronique, chimie, télécommunications.
En 1985, c’est l’Adoption du Code fédéral des droits civiques, garantissant l’égalité linguistique et culturelle.
En 1988, le Bénélux joue un rôle diplomatique actif dans la Guerre froide, le médiateur dans les crises européennes et africaines.
En 1990, il y a la transition vers des institutions numériques pour les services publics, précurseurs de l’e-gouvernance.
En 1992, le Bénélux fédéral est membre fondateur actif du traité de Maastricht, apportant un modèle de fédération réussie à l’UE.
En 1995, la première monnaie commune expérimentale pour les transactions internes avant l’Euro est mise en place.
En 1997, il y a une réforme fiscale fédérale avec une harmonisation des impôts pour entreprises et particuliers.
En 1999, c’est le début de programmes d’énergie renouvelable que cela soit de l’éolien et du solaire pour compléter le nucléaire.
En 2001, c’est le déploiement d’un haut débit fédéral et universel, le Bénélux devient le leader en TIC, des technologies de l’information.
En 2005, il y a l’Adoption de programmes culturels communs pour la promotion des langues et d’arts locaux.
En 2007, le Bénélux est membre actif de l’ONU et du G20 en tant qu’entité unifiée.
En 2009, il y a des réformes environnementales fédérales avec des normes strictes pour la pollution industrielle et automobile.
En 2010, le Bénélux fédéral atteint 90 % de couverture en éducation supérieure.
En 2015, il y a l’adoption d’un plan de neutralité carbone en 2050.
En 2020, il y a une coordination fédérale renforcée pour la santé publique face à la pandémie mondiale avec un succès dans la vaccination et le confinement harmonisé.
En 2023, le Bénélux est reconnu comme un modèle européen de démocratie fédérale et de développement durable.
En 2025, la population totale est de 30 millions avec un PIB fédéral élevé, avec une forte influence dans l’UE et dans le commerce international avec une intégration culturelle et linguistique consolidée.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif en 1937 d’un journaliste belge à Bruxelles:
« Enfin, nos voisins du nord nous écoutent. Une union démocratique, cela semblait impossible il y a cinq ans. Nous partageons notre armée, notre commerce et notre avenir. »
Témoignage fictif en 1940 d’un soldat néerlandais à Maastricht
« Quand les Allemands sont arrivés, nous avons combattu ensemble avec nos camarades belges. La coordination était meilleure que jamais. Même si la bataille fut dure, nous avons tenu plus longtemps. »
Témoignage fictif en 1945, d’un ministre luxembourgeois:
« La fédération Bénélux a survécu à la guerre. Nous avons appris à travailler ensemble pour défendre notre démocratie. Ce sera la base de l’Europe à venir. »
Témoignage fictif en 1955 d’un ouvrier à Anvers:
« Les entreprises tournent à plein régime. Grâce à l’union, nous avons accès aux matières premières du nord et aux ports de la Belgique. On se sent moins isolés que dans les années trente. Le commerce et l’industrie ne connaissent pas de frontières ici. »
Témoignage fictif en 1970 d’une étudiante en droit à Louvain:
> « J’ai étudié dans trois villes différentes du Bénélux l’année dernière. Le parlement fédéral décide de beaucoup de choses pour nous tous. Il y a des tensions parfois, mais au moins, nous avons une vraie voix et pas un État éclaté. “
Témoignage fictif en 1985 d’un journaliste à Amsterdam:
« La fédération a résisté à la crise pétrolière des années 70 mieux que la France ou l’Italie. Les politiques économiques communes et le marché intégré nous ont protégés. On parle même d’un modèle Benelux pour le reste de l’Europe. »
Témoignage fictif d’un diplomate luxembourgeois en 1995:
« Quand l’Union européenne s’est construite, nous avions déjà trente ans d’expérience fédérale. Les traités de Maastricht ont été plus faciles à signer : nous savions travailler ensemble depuis longtemps. Le Bénélux fédéral est devenu une référence internationale. »
Témoignage fictif en 2008 d’un entrepreneur belge à Liège:
« Notre entreprise exporte dans tout le Bénélux sans paperasse, sans douane. Cette union qui a commencé comme un projet de défense est devenue un moteur économique. Nous avons même des programmes communs d’innovation et de formation. »
Témoignage fictif en 2023, d’une étudiante en sciences politiques à Bruxelles:
« Beaucoup de gens pensent encore que le Bénélux est juste un marché commun, mais c’est une véritable fédération. Les décisions sont prises pour tout le monde. Les élections fédérales, les lois sur l’éducation, la sécurité sociale… tout est intégré. Cela fait partie de notre identité européenne. »
Témoignage fictif en 2025 d’un retraité à Luxembourg
« Je me souviens des histoires de guerre que mes parents racontaient. Le Bénélux nous a permis de rester libres et unis. Aujourd’hui, mes petits-enfants voyagent et étudient dans toutes les villes du pays fédéral comme si c’était naturel. Cela a changé notre destin. »

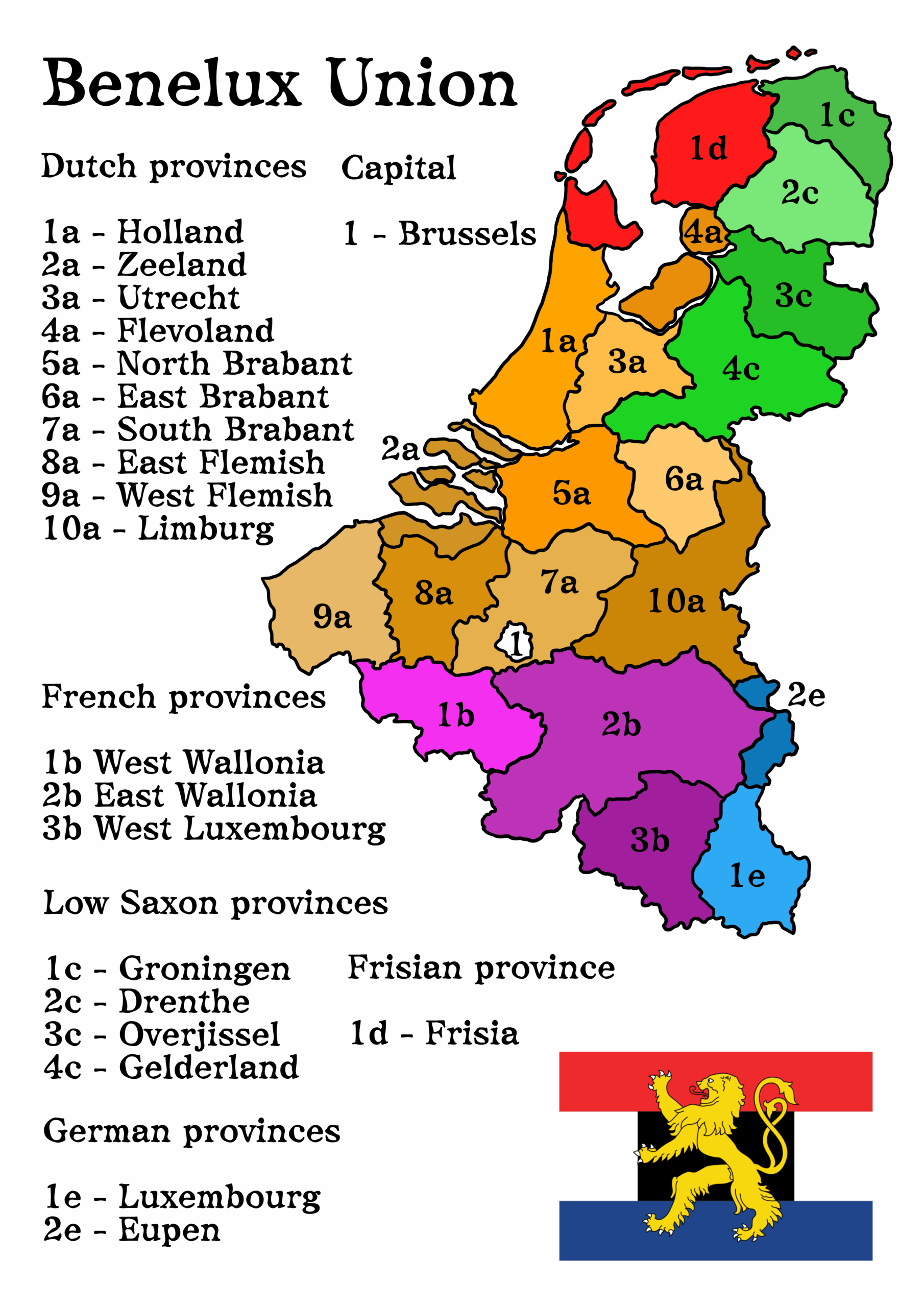
Points de divergences entre 1940 et 1945
6) Et si Léon Degrelle avait été assassiné en 1940?
Dans notre réalité, en mai 1940, après l’invasion allemande de la Belgique, Léon Degrelle, chef du mouvement rexiste, est capturé par les autorités françaises alors qu’il tente de fuir vers l’Allemagne. Dans notre uchronie, il ne survivra pas à sa détention : il est assassiné dans des circonstances troubles, probablement par des agents français inquiets de ses ambitions politiques et de ses contacts avec l’Allemagne nazie.
Les causes de l’assassinat aurait été que Degrelle était un fervent sympathisant nazi et rêvait de transformer la Belgique en État collaborateur. Les autorités françaises veulent empêcher toute influence rexiste sur le territoire qu’ils contrôlent. Le gouvernement français, fragilisé, cherche à envoyer un signal fort à la population belge et aux forces rexistes : toute tentative de collaboration sera neutralisée. Certains officiers français, outrés par la brutalité du mouvement rexiste et ses violences lors des manifestations précédentes, décident d’éliminer Degrelle pour régler “le problème à la source”.
Les conséquences auraient été que sans son leader,le parti Rex aurait perdu rapidement sa cohésion. Les structures locales deviennent rivales entre elles, incapables de coordonner un soutien aux Allemands. En Wallonie, certaines cellules qui hésitaient à s’opposer à Rex deviennent plus audacieuses, profitant de l’absence d’un leader central pour organiser des actions contre les collaborateurs et les nazis. L’Allemagne perd un relais belge influent. La propagande nazie peine à trouver un visage crédible en Belgique francophone, et les plans de recrutement pour la Légion Wallonie sont retardés.
Voici la chronologie de cette uchronie:
En Mai 1940, Léon Degrelle est capturé par les autorités françaises alors qu’il tente de fuir vers l’Allemagne.
En Juin 1940, Degrelle est assassiné dans sa cellule par des agents français ou des partisans anti-fascistes infiltrés. L’événement est tenu secret, officialisé comme “mort naturelle suspecte”. La disparition de Degrelle provoque un effondrement du mouvement rexiste. Les cellules locales s’affrontent entre elles pour le contrôle, mais restent incapables de soutenir efficacement les nazis.
Entre 1940 et 1944 : La résistance wallonne gagne en audace. Sans leader rexiste pour coordonner la collaboration, la Légion Wallonie est plus tardive et moins nombreuse. La propagande nazie en Belgique francophone est inefficace, la Wallonie devient un terrain moins favorable à la collaboration. Les bombardements et l’occupation allemande continuent, mais la population wallonne perçoit moins de collaboration officielle.
En 1945, durant la Libération de la Belgique. L’absence d’un leader rexiste emblématique réduit la visibilité des procès pour collaboration. Les survivants rexistes restent isolés et marginalisés politiquement. La Wallonie se concentre sur la reconstruction industrielle avec des programmes étatiques, mais reste moins prospère que la Flandre. L’émergence de leaders socialistes et catholiques modérés stabilisent la politique wallonne.
Dans les années 1960, la Wallonie subit la désindustrialisation des mines et des aciéries, mais sans la stigmatisation liée à la collaboration. Les gouvernements régionaux commencent à investir dans des infrastructures publiques et l’éducation pour freiner l’exode économique.
Durant les années 1970, les tensions communautaires entre Wallons et Flamands sont modérées par l’absence d’un mythe rexiste durable.
Durant les années 1980 et 1990, la Wallonie tente de se reconvertir dans les services et les nouvelles technologies. Certains anciens bastions rexistes sont redevenus des zones de faible influence politique et sociale. Bruxelles et la Flandre attirent encore la majorité des investissements étrangers, mais la Wallonie bénéficie de fonds européens pour moderniser ses universités et hôpitaux.
Durant les années 2000 et 2010, la Wallonie demeure moins riche que la Flandre, mais elle n’est plus associée à la collaboration et au fascisme. La mémoire de Degrelle disparaît rapidement des manuels et médias. Les groupuscules néo-fascistes wallons restent marginaux.
Entre 2010 et 2025, la Wallonie investit dans le tourisme, l’éducation et la recherche, avec des réussites modestes.
En 2025, la région a encore des défis économiques, mais l’absence d’un héritage collaborationniste permet une identité politique et culturelle plus stable et moins polarisée.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Liège en 1941, témoignage fictif d’un militant rexiste désabusé:
« Je ne comprends plus rien. Degrelle était notre chef, notre espoir, et il est mort… assassiné, disent certains. Depuis, notre mouvement se déchire. Personne ne sait quoi faire. Les Allemands nous regardent avec méfiance et nous, on se sent perdus. Je n’ai jamais cru que la politique pouvait être aussi cruelle. »
Charleroi en 1943, témoignage fictif d’une une résistante locale:
« Avant, certains voisins murmuraient des mots d’admiration pour Degrelle et ses idées. Mais maintenant, sans lui, on ose enfin organiser la résistance. Les Allemands ne savent plus sur qui compter parmi les rexistes. C’est dangereux, mais au moins, nous avons un peu plus d’espoir de protéger notre ville. »
Liège en 1950, témoignage fictif d’un ancien ouvrier et témoin de l’après-guerre:
« J’ai vu nos amis rexistes s’éparpiller et disparaître après la guerre. Les procès pour collaboration étaient moins spectaculaires, sans Degrelle pour attirer l’attention. Nous avons pu nous reconstruire sans que tout le monde nous regarde comme des traîtres. Ça n’a pas été facile, mais au moins, il y avait moins de haine à gérer. »
Namur en 1975, témoignage fictif d’un enseignant d’histoire
« Je raconte à mes élèves l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en Wallonie, mais Degrelle n’existe presque pas dans nos livres. Les rexistes étaient faibles et désorganisés, et la population a souffert moins de stigmatisation collective. Les débats politiques sont plus calmes, même si l’industrie a disparu et que le chômage reste un problème. »
Charleroi en 2000, témoignage fictif d’une employée dans une start-up locale:
« Mes parents me racontaient que, si Degrelle avait survécu, la Wallonie aurait eu une réputation de fascisme durable. Mais nous avons grandi dans un environnement où l’histoire était moins polarisée. Les villes sont encore en reconstruction après la désindustrialisation, mais politiquement, nous avons plus de liberté et moins de divisions. »
Liège en 2025, témoignage fictif d’un retraité et historien amateur:
« Je passe mes journées à étudier les archives et je constate que notre région a été marquée par la guerre, mais pas par un culte de Degrelle ou du rexisme. L’assassinat de ce type a changé l’histoire de la Wallonie. On a perdu un leader… mais notre mémoire collective a été préservée d’un poids idéologique qui aurait pu durer des décennies. »


6.1) Et si le roi Léopold III était parti avec son gouvernement à Londres en 1940?
Dans notre réalité, en mai 1940, l’armée belge est débordée par l’invasion allemande. Le 28 mai, Léopold III capitule sans l’accord de son gouvernement et se constitue prisonnier et reste en Belgique. Le gouvernement de Hubert Pierlot constitué notamment de Paul-Henri Spaak et de Henri Jaspar s’exile à Londres. Cette décision provoque la « Question royale » après 1945, Léopold III est accusé d’avoir trahi la Belgique et il abdique en 1951 au profit du prince Baudouin.
Voici la chronologie de cette uchronie:
Le 28 mai 1940, au lieu de rester prisonnier en Belgique, Léopold III part à Londres avec le gouvernement Pierlot. Il rejoint la reine Wilhelmine des Pays-Bas et le grand-duc du Luxembourg, ils sont des symboles de la résistance des petits États occupés. Le roi Léopold III depuis Londres, il lance des appels radiophoniques à la population belge. Les mouvements de résistance en Belgique se réclament de lui, le roi devient une figure morale comme Churchill au Royaume-Uni. La collaboration de Rex et DeVlag est affaiblie car elle ne peut plus prétendre agir “au nom du roi”
En 1945, le roi retourne en Belgique et est accueilli avec enthousiasme et il n’y a pas de crise royale. Il visite les ruines et soutient la reconstruction. Son rôle symbolique renforce la cohésion belge.
En 1948, la Belgique participe activement à la création du Benelux. Le prestige du roi facilite les négociations.
En 1949, la Belgique est un des fondateurs de l’OTAN, avec Bruxelles choisie comme siège grâce à l’image d’un pays uni.
En 1950, Il n’y a pas de « Question royale » ,dans la réalité, la consultation populaire avait provoqué des grèves et des émeutes. Ici, le pays reste stable. La monarchie en sort renforcée. Léopold III reste roi.
Durant les années 1950, Léopold III incarne la modernisation de la Belgique. L’économie avec le développement de la sidérurgie, et du textile et des colonies est florissante.
En 1958, l’Exposition universelle de Bruxelles est l’apogée de la monarchie. Le roi Léopold III est une figure prestigieuse, inaugure l’Atomium comme le symbole d’un futur pacifique et européen.
En 1960, la décolonisation du Congo se fait. Ici aussi, elle est brutale, mais le roi conserve plus de légitimité pour apaiser les tensions.
Durant les années 1960, malgré la montée des tensions communautaires, la monarchie joue un rôle de médiateur fort. Il n’y a pas de crise ouverte. Bruxelles est considérée comme la capitale de l’Europe, grâce à un État belge stable.
En 1970, c’est la première réforme de l’État. Elle se fait dans le calme, le roi Léopold III arbitrant comme garant de l’unité.
En 1975, Léopold III abdique volontairement au profit de Baudouin, sans scandale. La transition est apaisée.
Durant les années 1980, durant le règne du roi Baudouin, la Belgique traverse la crise économique mais reste politiquement plus stable, car la monarchie n’a pas été fragilisée. Bruxelles attire encore plus d’institutions européennes avec la Commission, le Conseil européen et le Parlement). Strasbourg reste symbolique mais secondaire. La Belgique garde une image d’un pays stable avec une monarchie forte, une capitale européenne incontestée.
En 1993, c’est la Mort du roi Baudouin. Ici, l’image de la monarchie est intacte grâce au prestige de Léopold III, la transition vers Albert II se passe sans contestation.
Durant les années 1990, Bruxelles devient véritablement la capitale unique de l’Union européenne, grâce à la stabilité de la Belgique et au rôle symbolique de la monarchie dans la réconciliation européenne. Les tensions communautaires existent, mais la monarchie garde un rôle d’arbitre fort. Les réformes institutionnelles sont moins conflictuelles.
En 2008, c’est la crise financière, la Belgique souffre, mais conserve sa crédibilité internationale. Bruxelles se profile comme une ville globale, au même rang que Genève ou New York.
En 2013, il y a l’abdication du roi Albert II, son fils le prince Philippe devient roi. Comme il hérite d’une monarchie sans la fracture de la Question royale, son autorité est mieux acceptée.
En 2016, ce sont les attentats à Bruxelles. Comme dans la réalité, ils choquent, mais le pays réagit avec unité nationale, la monarchie incarnant la résilience.
Durant les années 2020, Bruxelles attire de nouvelles institutions et entreprises. La stabilité monarchique n’est jamais remise en cause et renforce l’image de la Belgique.
En 2025, la Belgique est fédérale, mais pas menacée d’éclatement. La monarchie reste un symbole d’unité nationale fort. Bruxelles est la capitale européenne unique et assumée, prospère et verte.
Voici les témoignages de cette uchronie:
Témoignage fictif d’un soldat belge sur la Lys en 1940
« On a appris que le Roi était parti avec le gouvernement à Londres. Certains disaient qu’il aurait dû rester, mais moi je suis fier : il ne s’est pas livré aux Allemands. C’est un signal : la Belgique ne baisse pas les bras. “
Témoignage fictif d’une résistante à Liège en écoutant la BBC en 1941:
« Quand j’ai entendu la voix du Roi à la radio de Londres, j’ai pleuré. Il disait que la Belgique ne mourrait pas. Dans mon groupe, ça nous a donné la force de continuer les sabotages contre l’occupant nazi. »
Témoignage fictif d’un diplomate britannique en 1945:
« Le retour de Léopold III à Bruxelles fut triomphal. Il n’y a pas eu de divisions comme chez les Français avec De Gaulle et Pétain. Ici, roi et gouvernement avaient tenu ensemble. C’est une monarchie sortie grandie de la guerre. »
Témoignage fictif d’un visiteur américain à l’Expo universelle en 1958:
« Quelle ville ! L’Atomium, les pavillons modernes, et le Roi Léopold III, une figure charismatique, qui incarne la paix et l’Europe. Bruxelles ressemble déjà à la capitale d’un continent. »
Témoignage fictif d’un syndicaliste wallon en 1961:
« Le Congo nous a échappé trop vite, et c’est une tragédie. Mais au moins, le Roi a su parler à tous : Flamands, Wallons, anciens coloniaux, militaires. On s’est senti guidés, pas abandonnés. »
Témoignage fictif d’un professeur de Louvain:
« Le Roi Léopold a abdiqué aujourd’hui. Contrairement à ce que disent certains de ses détracteurs, il aura marqué le siècle. Pas de crise, pas de sang versé. Son règne en exil et son retour ont évité au pays bien des divisions. »
Témoignage fictif d’un professeur de l’université de Louvain en 1975:
« Le Roi Léopold III a abdiqué aujourd’hui. Contrairement à ce que disent certains de ses détracteurs, il aura marqué le siècle. Il n’y aura pas eu de crise, pas de sang versé. Son règne en exil et son retour ont évité au pays bien des divisions. »
Témoignage fictif d’une Bruxelloise lors de la mort du Roi Baudouin:
« On pleure le roi Baudouin, mais on se souvient que si nous avons encore une monarchie respectée, c’est grâce à son père, Léopold III, qui avait choisi Londres en 1940. Sans ça, tout aurait basculé. »
Témoignage fictif d’un étudiant bruxellois après les attentats en 2016:
« Ce soir, le Roi Philippe a pris la parole. Beaucoup de mes amis disaient : “les rois, ça ne sert plus à rien”. Mais là, je dois avouer : sa voix nous a rassemblés. Peut-être qu’on sous-estime encore ce que la monarchie représente. »
Une journaliste allemande en reportage à Bruxelles en 2025:
« Bruxelles est aujourd’hui la capitale officielle de l’Europe. Dans les rues, on voit que la ville est cosmopolite. Beaucoup disent que si la Belgique a tenu malgré ses divisions, c’est grâce à un choix fait en 1940 : celui d’un roi qui a préféré l’exil à la reddition. »

6.2) Et si la Belgique avait beaucoup plus résisté en 1940?
Le 10 mai 1940, l’Allemagne lance son offensive à l’Ouest. Dans notre réalité, la Belgique est surprise par la rapidité de la percée allemande dans les Ardennes. Dans cette uchronie, les Belges appliquent un plan de défense plus prévoyant avec la destruction systématique de tous les ponts sur la Meuse et la Sambre ralentissant l’avance blindée allemande, il y a une défense renforcée de la ligne Koningshooikt-Wavre, préparée dès 1939, il y a une coordination bien meilleure avec les Français et les Britanniques, la résistance tenace dans les Ardennes au lieu d’un repli précipité.
Voici la chronologie de l’uchronie:
Du 10 au 15 mai 1940, l’armée belge, au lieu de reculer trop vite, se bat farouchement dans les Ardennes avec ses chasseurs ardennais. Les ponts de Dinant, Houx et Givet sautent avant l’arrivée des panzers. Guderian est ralenti depuis plusieurs jours.
Entre le 16 et le 22 mai 1940, la ligne KW tient fermement autour de Louvain et de Wavre. Les Britanniques et les Français, au lieu d’être coupés trop tôt, profitent de ce délai pour stabiliser leur front.
Du 23 au 30 mai 1940, Bruxelles tombe, mais les Belges poursuivent le combat sur l’Escaut et dans les Flandres. La bataille de Gand dure une semaine entière.
Au début de juin 1940, alors que Paris est menacée, l’armée belge tient encore une poche autour de Bruges et d’Ostende, permettant une évacuation massive par la mer de type Dunkerque bis.
Le 15 juin 1940, la Belgique capitule enfin, mais après plus de 5 semaines de combat au lieu de 18 jours. Grâce au retard belge, les Britanniques évacuent non seulement à Dunkerque mais aussi via Ostende et Zeebruges. L’armée britannique sauve beaucoup plus de matériel. La Wehrmacht est ralentie d’environ 2 à 3 semaines. Paris tombe plus tard, et la bataille de France s’étire. La Belgique devient le « petit pays qui a tenu », comparable à la Finlande en 1939–1940 contre l’URSS.
Entre 1940 et 1941, l’occupation est plus brutale qu’en réalité car Hitler puni la « trahison belge ». Mais cela provoque une Résistance plus massive dès le début.
En 1942, Londres reconnaît officiellement un « gouvernement belge combattant » comme allié de premier plan.
En 1943, les sabotages belges se multiplient avec les chemins de fer, au port d’Anvers et de Zeebruges).
En 1944, à la Libération, les Alliés traitent la Belgique comme un partenaire militaire héroïque, pas comme une victime passive.
Entre 1945 et 1960, la Belgique, auréolée de prestige, obtient une place politique accrue avec un siège plus fort à l’ONU, un rôle clé dans la fondation de l’OTAN, un statut moral équivalent à la Norvège ou aux Pays-Bas dans l’imaginaire allié. La mémoire belge devient celle d’un « peuple résistant », sans fracture durable entre francophones et flamands. Le roi Léopold III, ayant combattu jusqu’au bout, est beaucoup moins contesté après-guerre. La « Question royale » est évitée ou atténuée
Entre 1960 et 2000, la Belgique se pose comme pays-pivot européen, son prestige militaire renforce son poids politique dans la CEE. Le séparatisme flamand est beaucoup plus faible, le récit de 1940 reste unificateur (« nous avons résisté ensemble »). L’armée belge, modernisée avec l’aide américaine et conserve une image prestigieuse, comparable à celle de l’armée suisse ou finlandaise. Bruxelles est la capitale européenne qui est vue comme « symbole de la Résistance de 1940 » autant que comme capitale fédérale.
En 2000, il y a l’inauguration d’un mémorial international à Louvain, rappelant la résistance belge de 1940.
En 2014, c’est le Centenaire de 1914–1918, le parallèle avec 1940 renforce le récit d’un peuple qui s’est toujours sacrifié.
En 2020, lors de la pandémie, le gouvernement rappelle le « courage de 1940 » pour nourrir “le patriotisme sanitaire.”
En 2022, la Belgique est l’un des pays européens les plus fermes dans le soutien à l’Ukraine, revendiquant son héritage de résistance.
En 2025, la Belgique demeure un État fédéral, mais plus soudé. La mémoire de 1940 a neutralisé en partie les tensions communautaires.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un chasseur ardennais, le 14 mai 1940:
« On nous disait que les panzers étaient invincibles. Mais quand on a fait sauter les ponts et qu’on les a vus bloqués, on a compris qu’on pouvait leur résister. Chaque jour gagné, c’était une victoire. Nous n’avons pas tenu pour nous, mais pour l’Angleterre, pour la France, pour l’Europe entière. »
Témoignage fictif d’une civile bruxelloise, le 22 mai 1940:
« Les avions allemands bombardaient la ville. Mais quand les rumeurs circulaient que l’armée tenait encore à Louvain, chacun retrouvait du courage. On disait : “Cette fois, la Belgique ne se couchera pas.” »
Témoignage fictif d’un soldat britannique évacué d’Ostende le 3 juin 1940:
« Sans les Belges, nous n’aurions jamais eu le temps d’embarquer. Ils tenaient les lignes tandis que nous courions vers les bateaux. Je leur dois la vie. »
Témoignage fictif d’un résistant flamand, en Septembre 1944:
“Quand les blindés alliés sont entrés, nous avons sorti nos brassards. Mais ce n’était pas la fin pour nous, c’était la suite logique. Nous n’avions jamais cessé de combattre, depuis 1940. “
Témoignage fictif d’un officier américain en Novembre 1944:
« En France, on a vu la débâcle, aux Pays-Bas, l’occupation écrasante. Mais en Belgique, on parlait toujours de la “bataille des 40 jours”. Les Belges avaient perdu, mais ils avaient résisté comme des guerriers. C’est pour ça qu’on les respecte. »
Témoignage fictif d’un ouvrier wallon à Liège en 1955:
« Dans ma rue, trois voisins sont morts en 1940. On ne les a pas oubliés. Quand on se dispute avec les Flamands, je pense à ce temps-là : on s’est battus ensemble, et ça nous a soudés. »
Témoignage fictif d’un professeur d’histoire, à Louvain en 1963:
« Mes étudiants me demandent pourquoi la Belgique est restée unie. Je leur réponds : parce qu’en 1940, elle a résisté. La mémoire de cette bataille est le ciment belge. »
Témoignage fictif d’un jeune flamand en 1985:
« On réclame plus de droits pour notre langue, oui. Mais quand mon grand-père raconte 1940, je sais qu’il s’est battu avec des Wallons. Alors je veux plus d’autonomie, pas de séparation. »
Témoignage fictif d’un historien français en 1995:
« L’histoire belge de 1940 est unique. Contrairement au cliché d’une reddition rapide, les Belges ont gagné leur place parmi les pays résistants. Ce récit a profondément marqué leur construction fédérale et européenne. »
Témoignage fictif d’un visiteur canadien au mémorial de Louvain en 2005:
« Mon grand-oncle a été évacué à Ostende grâce aux Belges. En voyant ces stèles, j’ai compris qu’un petit pays pouvait changer le cours d’une guerre mondiale. »
Témoignage fictif d’un bruxellois pendant le Covid en 2020:
« Quand les confinements sont devenus durs, on entendait souvent : “Nous avons tenu en 1940, nous pouvons tenir aujourd’hui.” C’était une manière de rappeler qu’ensemble, on est plus forts. »
Témoignage fictif d’un étudiant ukrainien réfugié à Gand en 2023:
« Mon professeur m’a dit : la Belgique sait ce que veut dire résister à un envahisseur plus fort. Ici, on m’a parlé de la bataille de 1940 comme d’un modèle. Ça m’a donné du courage. »

6.3) Et si Léon Degrelle au lieu d’être dans la collaboration aurait fait comme la légion belge qui était fasciste d’être dans la résistance?
Léon Degrelle fut le fondateur du mouvement Rex, il était profondément égocentrique. Il se rallia sans réserve à l’Allemagne nazie et devint officier de la Waffen-SS qui est un symbole de la collaboration belge. À l’opposé, certains fascistes belges comme des membres de la Légion belge (avant son absorption) prirent finalement le parti de la résistance par nationalisme et refus de l’occupation allemande.
Et si, imaginons qu’en 1940, lors de l’invasion de la Belgique, Degrelle connaisse une crise idéologique et narcissique. Voyant la rapidité de la défaite belge et l’arrogance des Allemands, il ne supporte pas d’être réduit au rôle de vassal. Son égocentrisme se retourne, il veut rester le « sauveur de la Belgique ».
Au lieu de collaborer, il fait basculer Rex en un mouvement de résistance nationaliste et autoritaire, à la manière de certains mouvements fascistes européens qui s’opposèrent au nazisme par jalousie de leur indépendance, par exemple les Oustachis croates dans certaines phases, ou les franquistes qui restèrent officiellement neutres.
Certains rexistes, surtout catholiques traditionalistes, étaient mal à l’aise avec le paganisme nazi, Degrelle aurait pu instrumentaliser ce malaise pour redorer son image.
Entre 1940 et 1941, l’issue du conflit n’était pas encore claire. Degrelle aurait pu miser sur une victoire alliée à long terme pour se placer comme un « homme fort » d’après-guerre.
Voici la chronologie de cette uchronie:
Le 10 mai 1940, l’Allemagne envahit la Belgique. Rex est pris de court. Degrelle, d’abord enthousiaste, est choqué par le mépris des officiers allemands qui l’ignorent et préfèrent traiter directement avec Léopold III et l’administration.
Le 28 mai 1940, la capitulation belge provoque une crise dans les rangs rexistes. Degrelle comprend qu’il ne sera jamais l’égal d’Hitler mais toujours son subalterne. Son narcissisme s’enflamme : il jure de devenir « l’homme providentiel de la Belgique ».
Au Printemps 1941, plutôt que de se rallier à la Waffen-SS, Degrelle fonde clandestinement la Légion nationale rexiste qui est un mouvement ultra-nationaliste anti-allemand. Il attire une partie des anciens miliciens rexistes, frustrés de ne pas avoir obtenu de postes auprès des autorités d’occupation. Ses discours dénoncent « l’arrogance germanique » et appellent à une « Belgique catholique, libre et forte ».
En 1942, la Légion nationale sabote des convois ferroviaires allemands, mais refuse toute coordination avec les communistes. Les belges à Londres sont divisés entre ceux qui y voient une opportunité d’élargir la Résistance, d’autres redoutent un cheval de Troie fasciste. La Gestapo commence à traquer les « rexistes dissidents », ce qui brouille les lignes, aux yeux de la population, Degrelle n’apparaît plus comme le collaborateur évident qu’il est dans notre réalité.
En 1943, la Légion nationale s’implante surtout en Wallonie, profitant de réseaux paroissiaux et de sympathisants dans la gendarmerie. Degrelle prend contact mais indirectement avec les services britanniques, cherchant à se faire reconnaître comme un interlocuteur politique. Londres reste méfiant mais lui fournit quelques armes. Il y a des conflits violents avec les communistes, Degrelle accuse les communistes de « trahir la patrie au profit de Moscou ».
En Juin 1944, après le Débarquement, Degrelle intensifie les sabotages et organise quelques insurrections locales. Il fait filmer ces actions pour préparer sa future propagande.
Entre Août et septembre 1944, les Alliés entrent en Belgique. La Légion nationale défile à Bruxelles aux côtés d’autres mouvements résistants. Degrelle proclame :
« J’ai arraché la Belgique aux griffes du nazisme et je la protégerai des griffes du bolchevisme. », Il se présente comme le chef naturel de la Belgique libérée.
En 1945, le Procès de l’épuration, contrairement à la réalité, Degrelle n’est pas jugé comme collaborateur mais comme un résistant controversé. Il exploite la Question royale avec l’impopularité de Léopold III qui est accusé de compromission. Degrelle se propose comme alternative au roi, un « chef national » au-dessus des partis. Les communistes et socialistes belges s’opposent à lui farouchement, mais les conservateurs catholiques et certains militaires voient en lui un rempart contre la gauche.
Entre 1946 et 1950, Degrelle fonde un parti national-résistant, héritier de Rex, et rafle 20 à 25 % des voix aux premières élections d’après-guerre. Dans le climat de Guerre froide, les Américains et les Britanniques, craignant l’influence soviétique, tolèrent Degrelle comme un « homme d’ordre ». La Belgique évolue vers un régime semi-autoritaire, à la manière de l’Espagne franquiste ou du Portugal salazariste, mais avec une façade parlementaire.
En 1950, lors de la « Question royale », le retour de Léopold III provoque la crise. Dans notre réalité, le roi abdique en 1951. Dans cette uchronie, Degrelle s’impose comme l’homme fort en mobilisant ses partisans contre Léopold III. Sous pression, le roi abdique plus tôt à l’été 1950. Degrelle obtient un rôle quasi-présidentiel en réformant la Constitution.
Entre 1951 et 1955, La Belgique est officiellement une monarchie constitutionnelle avec Baudouin, mais le pouvoir réel appartient à Degrelle, qui est un « Premier Ministre à vie » appuyé par un appareil policier et son Parti National-Résistant (PNR). Il a rejoint l’OTAN en 1949 pour se protéger de l’URSS, malgré son passé fasciste. Il bloque les premiers projets d’intégration européenne avec la CECA car il craint de diluer la souveraineté belge.
Degrelle installe un régime autoritaire « à la belge » avec une Censure des médias, mais une tolérance d’une presse catholique conservatrice. Il y a une répression brutale des syndicats rouges. Il y a le maintien d’élections “contrôlées “le PNR domine toujours, mais l’opposition socialiste et libérale subsiste dans un rôle marginal.
En 1960, durant l’Indépendance du Congo. Degrelle cherche à garder le contrôle en installant un gouvernement fantoche soutenu par Bruxelles. Cela mène à une guerre civile prolongée au Congo qui est pire que dans notre réalité.
En 1968, il y a des révoltes étudiantes en Flandre et à Louvain. Degrelle les réprime durement, ce qui radicalise une génération. La fracture communautaire entre les Wallons et les Flamands s’aggrave.
En 1973, c’est la Crise pétrolière. La Belgique entre en récession. Degrelle instrumentalise la crise pour renforcer l’autoritarisme et le contrôle des syndicats et avec une propagande nationaliste. La Flandre prospère plus vite que la Wallonie, provoquant des tensions. Le régime réagit en promouvant une idéologie « unitariste » belge, mais cela accentue les rancunes flamandes. La Belgique reste dans l’OTAN mais reste méfiante vis-à-vis de la CEE ( la Communauté économique européenne). Elle ralentit son intégration européenne et se rapproche de régimes autoritaires comme l’Espagne franquiste, le Portugal de Salazar ou la Grèce des colonels.
En 1975, c’est la Mort de Franco en Espagne. Cela fragilise Degrelle, l’Europe occidentale fait pression pour démocratiser la Belgique.
En 1980, vieillissant, Degrelle accepte une « libéralisation encadrée », il y a une autorisation partielle de partis d’opposition, mais il y a un maintien du contrôle policier et du culte de la personnalité.
En 1989, c’est la Chute du Mur de Berlin. L’URSS s’effondre, ce qui prive Degrelle de sa justification principale que fut l’anticommunisme. Il tente de se présenter comme le « gardien de l’ordre contre le chaos ».
En 1994, Léon Degrelle meurt à 87 ans, toujours chef de l’État. Ses funérailles nationales sont grandioses, mais polarisent la population. Son dauphin, un technocrate plus pragmatique, hérite du pouvoir. Mais sans le charisme de Degrelle, le régime s’effondre progressivement.
En 1995, une transition démocratique est engagée, proche des cas espagnol et portugais. Une « Loi d’amnistie » blanchit la plupart des crimes du régime pour éviter une guerre civile. La mémoire nationale reste éclatée. Certains voient Degrelle comme le « sauveur de la Belgique », d’autres comme un dictateur fasciste qui a étouffé la démocratie. La Belgique devient enfin une démocratie parlementaire normale, mais très marquée par 50 ans de degrellisme.
En 2001, la Belgique rejoint la zone euro tardivement, après avoir refusé Maastricht en 1992).
En 2004-2005, il y a la montée des partis populistes flamands inspirés du Vlaams Belang, héritiers du ressentiment contre l’unitarisme imposé par Degrelle. La Flandre réclame toujours plus d’autonomie, profitant de la transition démocratique pour pousser vers le confédéralisme.
Durant les années 2010, La Belgique souffre d’un retard démocratique et européen, les institutions sont fragiles, L’Union européenne se méfie toujours de la Belgique « post-fasciste ».
Durant la crise Crise migratoire de 2015, les anciens réseaux degrellistes, restés dans l’ombre, nourrissent un populisme anti-immigration puissant. La mémoire du « Vieux Chef » divise encore avec des statues détruites par des militants, contre-manifestations nationalistes.
En 2020, durant la Crise du Covid-19. La Belgique gère difficilement la pandémie, son système de santé, affaibli par des décennies de clientélisme degrelliste, craque.
En 2025, La Belgique est une démocratie parlementaire, membre de l’UE et de l’OTAN, mais encore marquée par son passé. Le spectre de Degrelle continue de hanter le pays, les Flamands dénoncent un héritage « unitariste fasciste », les Wallons restent divisés entre mémoire de la Résistance démocratique et la mémoire « nationale-résistante » degrelliste. Dans les sondages, 25 % des Belges pensent que « malgré ses excès, Degrelle a sauvé la Belgique ». Les historiens européens considèrent la Belgique comme le dernier pays d’Europe de l’Ouest à être réellement sorti du fascisme, mais trop tardivement.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un ancien résistant communiste en 1946:
« Quand j’ai vu Degrelle défiler à Bruxelles en 1944 sous les drapeaux de la Résistance, j’ai cru vomir. Cet homme qui avait bâti Rex sur la haine et le culte du chef osait maintenant se dire notre camarade de lutte ! Mais il avait des armes, des journaux, des prêtres avec lui. On ne pouvait pas le faire taire. Et les Anglais, qui ne voyaient que les communistes comme ennemis, ont fermé les yeux. Voilà comment il nous a volé notre victoire. »
Un Témoignage fictif d’une paysanne flamande dans les années 1950:
« Sous Degrelle, il y avait de l’ordre. Pas de grèves, pas de désordre dans les rues. On avait peur de la police, oui, mais au moins les trains arrivaient à l’heure. Les curés disaient qu’il protégeait la Belgique contre les rouges. Moi, je me taisais et je travaillais. C’était plus sûr. »
Un Témoignage fictif d’un officier américain en 1960:
« Degrelle est un salaud, mais c’est notre salaud. Il tient les communistes en laisse, et dans cette Europe fragile, c’est ce qui compte. Bien sûr, il nous agace avec son culte de la personnalité et son refus de s’intégrer à la CEE. Mais entre un fasciste vieillissant et un gouvernement instable, Washington préfère la stabilité. »
Témoignage fictif d’un étudiant francophone en 1968:
« Louvain en flamand ? Pourquoi pas. Mais nous, les étudiants, on en avait assez de la police degrelliste dans nos dortoirs, de l’interdiction de publier des tracts, de ces portraits du “Chef” dans chaque classe. Nous n’étions pas marxistes, pas vraiment. Nous voulions juste respirer. Alors nous avons crié : “Degrelle, dégage !” »
Témoignage fictif d’Une infirmière congolaise en 1975:
« Mon père disait que la Belgique nous avait donné des écoles. Moi je n’ai vu que des soldats, envoyés par Degrelle pour protéger les compagnies minières. Quand on protestait, on disparaissait. À Léopoldville, tout le monde savait que le Congo n’était pas indépendant. C’était encore un empire, mais un empire de la peur. »
Témoignage fictif d’un opposant libéral en 1985:
« Degrelle nous disait : “Je vous donne un peu d’air, mais souvenez-vous, c’est moi qui ouvre la fenêtre.” On pouvait publier des journaux, mais pas critiquer directement le Chef. On pouvait se présenter aux élections, mais les résultats étaient toujours arrangés. Nous vivions dans une cage dorée. »
Témoignage fictif d’un jeune manifestant flamand en 1995:
« Quand le vieux Chef est mort, j’avais 19 ans. Mon père a pleuré. Moi, j’ai fêté. Enfin, on pouvait parler, enfin on pouvait dire qu’on voulait une Flandre libre. Tout ce qu’il avait fait, c’était nous enfermer dans une Belgique artificielle. Il est mort trop tard, beaucoup trop tard. »
Témoignage fictif d’une historienne belge en 2025:
« L’héritage degrelliste est notre fardeau. Pendant cinquante ans, il a confisqué la Résistance pour en faire un mythe fasciste. Résultat, en Belgique, on ne sait plus célébrer l’unité nationale de 1944. Chaque communauté, chaque parti a sa version de l’histoire. Certains encore aujourd’hui déposent des fleurs sur sa tombe, d’autres la profanerait volontiers. Degrelle a gagné une chose, même mort, il nous divise. »

6.4) Et si Joris van Severen n’était pas mort en 1940?
Le 27 mai 1940 à Abbeville, dans l’histoire réelle, Van Severen et d’autres prisonniers politiques sont massacrés par des soldats français paniqués. Dans l’uchronie, les officiers français gardent le contrôle. Van Severen est transféré dans un camp, puis libéré après l’armistice.
Voici la chronologie de cette histoire:
Le 27 mai 1940, À Abbeville, les prisonniers belges ne sont pas exécutés. Van Severen est transféré vers un camp d’internement.
En 1941, il est libéré par les Allemands après l’armistice. Il refuse de dissoudre le Verdinaso, mais évite de se livrer à une collaboration militaire directe.
Entre 1942 et 1944, son discours reste nationaliste et autoritaire, mais prudent. Il parle d’une « Flandre chrétienne dans une Europe fédérale ». Le VNV le critique comme trop tiède vis-à-vis des Allemands.
Entre 1944 et 1945, c’est la Libération. Van Severen est arrêté comme suspect de collaboration, mais faute de preuves, il est interné brièvement puis libéré en 1947.
En 1950, durant la Question royale Van Severen appelle à “l’unité flamande et à l’ordre “. Il se rapproche du camp pro-léopoldiste.
En 1952, Il fonde un nouveau parti, l’Union Flamande Nationale (UFN), il est héritier du Verdinaso mais adapté au parlementarisme.
Entre 1950 et 1959, L’UFN reste marginale au début, mais sa rhétorique national-conservatrice séduit une partie de la classe moyenne flamande. Van Severen se présente comme l’alternative respectable au Vlaams Nationaal Verbond qui fut discrédité par la collaboration.
Entre 1960 et 1961, c’est la Grande grève contre la « loi unique ». Van Severen défend l’ordre social et un corporatisme chrétien. L’UFN gagne du terrain.
Entre 1962 et 1963, il y a la Fixation définitive des frontières linguistiques. Van Severen se félicite, mais réclame plus d’autonomie.
En 1965, l’UFN obtient 10 % des voix en Flandre.
En 1968, c’est la Crise de Louvain. Van Severen, vieux mais influent, soutient les étudiants flamands. Cela renforce le prestige de son mouvement.
En 1970, c’est la Première réforme de l’État. Van Severen pousse à une autonomie culturelle forte.
En 1972, c’est la Mort de Van Severen à 76 ans. Son enterrement devient une démonstration de force du mouvement nationaliste flamand.
Durant les années 1970, ses héritiers transforment l’UFN en Parti National Flamand (PNF). Plus modéré que le Vlaams Blok naissant, il devient la principale force nationaliste.
En 1977, l’Accord d’Egmont voulait une autonomie régionale renforcée. Le PNF revendique que cela est « l’accomplissement du projet de Van Severen ».
En 1980, c’est la Deuxième réforme de l’État : avec la création officielle des Régions. Le PNF participe au gouvernement flamand.
Entre 1981 et 1989, le PNF atteint régulièrement 20 à 25 % des voix en Flandre, devenant un acteur incontournable.
En 1989, c’est la création de la Région Bruxelles-Capitale. Le PNF proteste, mais accepte, misant sur la défense des minorités flamandes à Bruxelles.
En 1993, durant la Quatrième réforme de l’État qui rend la Belgique fédérale. Le PNF revendique d’avoir gagné la bataille idéologique commencée par Van Severen.
En 1995, le Vlaams Blok, affaibli par la domination du PNF, reste marginal.
Durant la fin des années 1990, la Flandre connaît une prospérité économique et une grande autonomie politique.
En 2001, durant la Cinquième réforme de l’État, le PNF obtient plus de compétences fiscales pour la Flandre.
En 2004, le PNF se rebaptise Nieuwe Vlaamse Unie (NVU), plus pro-européenne. Elle incarne la droite national-conservatrice moderne, inspirée par Van Severen.
Entre 2007 et 2011, durant les crises politiques belges à répétition. Le NVU pèse lourd dans les négociations, mais défend une Flandre forte dans une Belgique confédérale, pas l’indépendance immédiate.
En 2010, la NVU devient le premier parti flamand, comme la N-VA dans notre histoire réelle.
En 2014, la Coalition fédérale est dominée par la droite flamande. Le NVU gouverne la Flandre et influence Bruxelles.
En 2019, il y a une crise politique, mais le NVU refuse une scission totale du pays, arguant que « Van Severen croyait en une Europe des patries, pas en l’isolement ».
En 2020, durant la pandémie de Covid-19. La Flandre et la Wallonie appliquent des politiques différentes, mais le fédéralisme belge fonctionne mieux qu’en réalité, car l’architecture institutionnelle est plus claire depuis les années 1970 avec l’héritage du projet van severen.
En 2024, durant les élections fédérales, le NVU reste premier parti flamand, mais gouverne avec les chrétiens-démocrates et libéraux.
En 2025, la Flandre est l’une des régions les plus prospères d’Europe, avec une autonomie quasi totale, mais reste officiellement dans le Royaume de Belgique. Van Severen est célébré comme le « père de la Flandre moderne », une figure idéologique comparable à De Gaulle en France ou Adenauer en Allemagne.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Bien sûr ! Voici une série de témoignages fictifs pour illustrer l’uchronie où Joris Van Severen survit et influence la Flandre de 1940 à 2025. Ils donnent un aperçu de l’impact humain et politique de sa survie.
Témoignage fictif d’un jeune membre du Verdinaso, à Gand:
“ Quand Van Severen est revenu après la guerre, il nous a dit : “Nous devons reconstruire la Flandre, mais sans haine, sans armes.” Je n’oublierai jamais cette phrase. Beaucoup pensaient que nous allions collaborer, mais il a tenu parole. Pour la première fois, je me suis senti fier d’être flamand et belge à la fois.”
Discours fictif de Van Severen à Bruxelles en 1955:
« Aujourd’hui, nous ne voulons pas diviser la Belgique, mais obtenir ce qui nous revient,la reconnaissance de notre langue, de notre culture, de notre travail. Une Flandre forte ne menace pas les autres régions ; elle enrichit tout le pays. »
Témoignage fictif d’une étudiante à Louvain en 1968:
« La crise de Louvain a été effrayante. Mais l’influence des anciens discours de Van Severen a calmé certains mouvements radicaux. Ses idées de respect mutuel et d’autonomie ont permis que la division des universités se fasse sans violence majeure. »
Entretien fictif avec un entrepreneur à Anvers:
« Depuis que Van Severen est devenu un symbole politique respecté, la Flandre a pu structurer son économie. Les entreprises flamandes sont solides, nous avons des infrastructures modernes, et la politique reste stable même dans les crises fédérales. Beaucoup de jeunes ne quittent plus la région ; ils voient un avenir ici. »
Témoignage fictif d’un élu du NVU en 2005:
« Van Severen est toujours présent dans notre manière de faire de la politique. Son idée : “La Flandre doit être autonome, mais responsable” guide toutes nos décisions. Aujourd’hui, nous gérons nos finances, notre culture, et notre éducation sans querelles constantes avec Bruxelles ou la Wallonie. »
Témoignage fictif d’une jeune chercheuse à Bruxelles en 2025:
« Je suis née dans une Belgique fédérale stable, et je peux parler flamand, français et anglais sans problème. La Flandre est autonome et prospère, et Van Severen est célébré comme un bâtisseur plutôt que comme un extrémiste. Quand je voyage, les gens me demandent souvent : “Comment avez-vous réussi à unir tant de forces différentes ?” C’est grâce à des hommes comme lui, qui ont survécu et ont guidé notre région vers l’avenir. »

6.5) Et si la Résistance belge durant la seconde guerre mondiale était beaucoup plus unie que dans la réalité?
Il aurait fallu plusieurs conditions pour que cela advienne, au lieu d’une dispersion par exemple avec l’Armée secrète, le Front de l’Indépendance, les Partisans armés, etc.), une figure forte et reconnue prendrait la tête de la Résistance dès la capitulation. Dans la réalité, la Résistance était morcelée entre les royalistes, les socialistes, les communistes et les libéraux… Dans l’uchronie, un accord clair aurait pu se former : « après la guerre, on débattra, pendant la guerre, on se bat ensemble ». Londres ou le gouvernement belge en exil auraient joué un rôle de coordination beaucoup plus fort, à la manière de la France Libre. Les services britanniques (SOE) auraient privilégié la création d’un commandement unique au lieu d’alimenter différents réseaux.
Les conséquences auraient été multiples durant la guerre, la résistance unie aurait organisé des attaques coordonnées contre les chemins de fer, les dépôts d’armes et les transmissions. Les Allemands auraient été beaucoup plus gênés dans leurs mouvements militaires surtout en 1944 lors du débarquement. Dans la réalité, la division de la résistance a facilité les infiltrations de la Gestapo. Une Résistance unie, mieux organisée, aurait limité les trahisons et les doublons. Les Alliés auraient considéré la Résistance belge comme un partenaire militaire à part entière, comparable à la Résistance française unifiée sous Jean Moulin. Cela aurait renforcé le poids de la Belgique dans la Libération. Les forces de résistances belges auraient pu libérer Bruxelles ou Liège par leurs propres forces, avant l’arrivée des Alliés. Cela aurait permis un prestige accru et une fierté nationale renforcée.
Voici la chronologie de l’uchronie:
En Mai 1940, Après la capitulation, un groupe de militaires et de responsables politiques refuse la dispersion. Sous l’impulsion d’officiers de l’Armée belge comme le colonel Jules Pire, fictivement renforcé par Spaak et avec l’appui discret du gouvernement en exil à Londres, ils fondent le Comité de la résistance belge
En 1941,Les communistes, socialistes, catholiques et libéraux signent un accord de guerre, « Un seul commandement, un seul objectif : la libération de la Belgique ».
En 1942, Le comité de la résistance belge coordonne les sabotages des chemins de fer qui permettent de causer une forte gêne pour l’acheminement vers le front de l’Est. Londres reconnaît officiellement la Résistance belge comme un partenaire militaire.
En 1943, il y a la formation d’unités armées belges baptisées les Forces résistantes belges. Les Allemands intensifient la répression, mais la discipline interne réduit les infiltrations.
Durant l’Été 1944, au moment du débarquement, les forces résistantes belges sabotent massivement les voies ferrées et harcèlent les convois et lancent une insurrection coordonnée.
En Septembre 1944, Bruxelles et Liège sont libérées par un mélange d’Alliés et de résistants belges. Contrairement à la réalité, la Résistance belge joue un rôle décisif et se bat comme une armée nationale.
En 1945, La Résistance unie fonde le Parti de la Résistance Belge (PRB), qui remporte 40 % des voix aux premières élections d’après-guerre.
Entre 1946 et 1950, Le PRB domine la vie politique. La Question royale est désamorcée , Léopold III est contraint d’abdiquer dès Octobre 1948, avec l’accord du comité de résistance belge, pour éviter les divisions. Baudouin monte plus tôt sur le trône.
Dans les années 1950, la Belgique est reconstruite rapidement grâce à l’aide du plan Marshall et à la cohésion politique. Le PRB gouverne en coalition avec les socialistes et libéraux, incarnant l’unité nationale.
En 1957, il y a la Signature du Traité de Rome CEE, la Belgique y entre avec un prestige renforcé comme un pays résistant héroïque.
En 1960, l’Indépendance du Congo est négociée plus prudemment que dans notre réalité, avec un processus plus progressif avec des fédérations régionales et des coopérations économiques. Il y a moins de chaos immédiat, même si des tensions persistent.
Durant les années 1960, les Crises linguistiques sont modérées. L’existence du PRB comme ciment politique empêche la fracture totale. Le fédéralisme avance plus lentement.
En 1968, le mouvement étudiant se développe, mais il se heurte à un pouvoir central fort. Les jeunes reprochent au PRB de se figer dans la mémoire de la guerre.
Durant les années 1970, malgré les crises économiques causées par le choc pétrolier, la mémoire de la Résistance reste un facteur d’unité. Les commémorations du 9 septembre de la Libération de Bruxelles deviennent une fête nationale centrale.
En 1978, le PRB se scinde en deux ailes à gauche et à droite, mais conserve une forte influence.
En 1980, le fédéralisme est instauré, mais dans un esprit de compromis. Le souvenir d’une Résistance unifiée sert de référence aux réformes institutionnelles.
En 1983 meurt le roi Léopold III, encore vu comme une figure ambiguë, mais le PRB détourne l’attention vers ses propres héros de la Résistance.
En 1989, durant la Chute du mur de Berlin, la Belgique met en avant son expérience d’unité résistante comme modèle de lutte démocratique.
En 1993, à la mort du roi Baudouin, la monarchie reste respectée, mais son prestige est inférieur à celui du « mythe de la Résistance ».
1999:Le PRB disparaît progressivement comme force politique autonome, mais son héritage moral reste présent.
Durant les années 2000, les Crises communautaires persistent, mais les références à la Résistance freinent les projets de scission. Le discours est : « On a libéré le pays ensemble, on doit continuer ensemble ».
Durant les années 2010, les commémorations de la Résistance unifiée prennent un ton plus critique. Les jeunes chercheurs rappellent les zones d’ombre de celle-ci
En 2014, durant le centenaire de la Première Guerre mondiale avec un parallèle constant avec la Seconde, la Belgique se présente comme la « nation résistante par essence ».
En 2025, la Belgique existe toujours comme État unitaire fédéral, avec une monarchie stabilisée. Le souvenir de la Résistance unifiée est enseigné comme l’acte fondateur moderne de la Belgique.
Voici les témoignages:
Témoignage fictif d’un Officier du Comité de résistance belge en 1941:
« Nous savions que si nous restions divisés, nous serions broyés un par un. Les communistes, les catholiques, les libéraux, les socialistes… Nous avons juré de combattre sous un même drapeau. La Belgique ne devait pas avoir plusieurs Résistances, mais une seule. C’était notre force. »
Témoignage fictif d’une résistante en 1943:
« Quand on a fait sauter le dépôt de locomotives de Louvain, je savais que, pour la première fois, nous n’étions pas un petit groupe isolé. À la radio, d’autres équipes annonçaient des sabotages coordonnés à Namur, à Liège, à Anvers. On avait l’impression que tout le pays respirait ensemble. »
Témoignage fictif d’un paysan flamand à l’été 1944:
“Des gars en uniforme mal assorti sont sortis des bois près de mon village. Ils portaient un brassard tricolore avec le lion belge. Pas des partisans rouges ou des bandes perdues : une vraie armée ! Ils m’ont dit qu’ils étaient l’armée belge de la résistance. Ce jour-là, j’ai compris que le pays n’était pas mort. “
Un témoignage fictif d’un soldat américain en Septembre 1944:
« Nous pensions entrer seuls à Bruxelles. Mais quand nous sommes arrivés, les belges avaient déjà pris des positions stratégiques. Leurs unités combattantes, bien organisées, arboraient fièrement leur drapeau. Ce n’était pas la France, ce n’était pas la Hollande mais c’était la Belgique qui avait libéré sa propre capitale. »
Témoignage fictif d’un prisonnier politique libéré en 1945:
« On nous appelait les oubliés de Breendonk. Quand les portes se sont ouvertes, ce n’étaient pas les Américains que j’ai vus en premier, mais des Belges en uniforme de la Résistance. Je me suis dit : au moins, ce sont nos frères qui viennent nous chercher. »
Témoignage fictif d’un ancien résistant devenu député en 1950:
« Nous avons fait tomber l’occupant ensemble. Nous ne pouvions pas nous permettre de nous diviser après. C’est pour cela que nous avons fondé le Parti de la Résistance belge. Pas pour gouverner éternellement, mais pour protéger l’esprit d’unité qui avait sauvé la Belgique. »
Témoignage fictif d’une étudiante à Louvain en 1968:
« Nos parents nous parlaient toujours de la Résistance de 1940 à 1945. Nous, on voulait du changement, plus de liberté, moins d’ordre. Mais même en manifestant, on ne pouvait pas ignorer ce qu’ils avaient accompli. Quand on voyait un ancien résistant, on sentait presque une gêne : comment contester ceux qui avaient risqué leur vie pour que nous puissions crier dans la rue ? »
Témoignage fictif d’un Historien flamand en 1990:
« La mémoire de la Résistance unie a évité l’explosion du pays. Elle a servi de mythe fondateur. Bien sûr, cette mémoire a été sélective, la Résistance a tu la violence de l’épuration, et oublié que l’unité n’était pas toujours parfaite. Mais elle a donné à la Belgique un récit commun, que peu d’autres pays européens possèdent. »
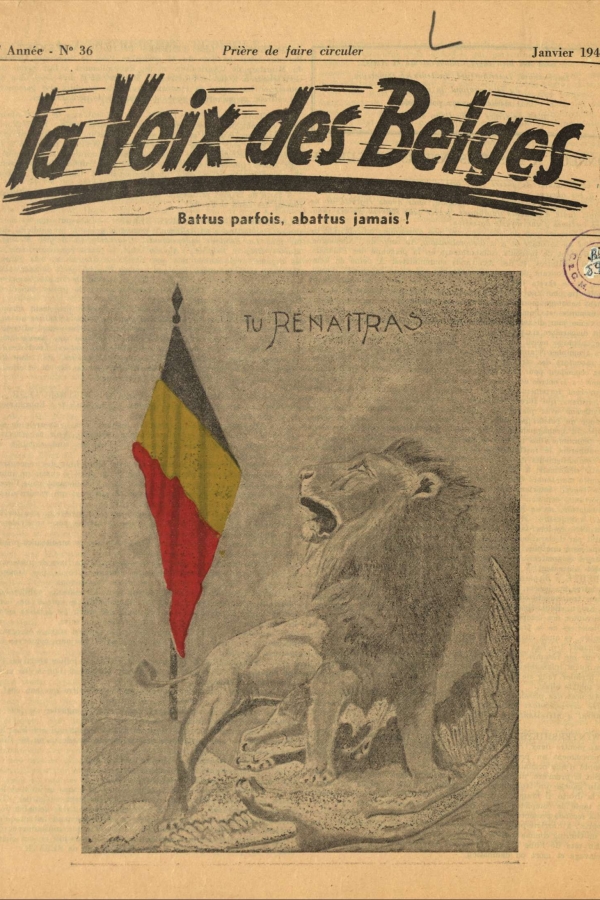
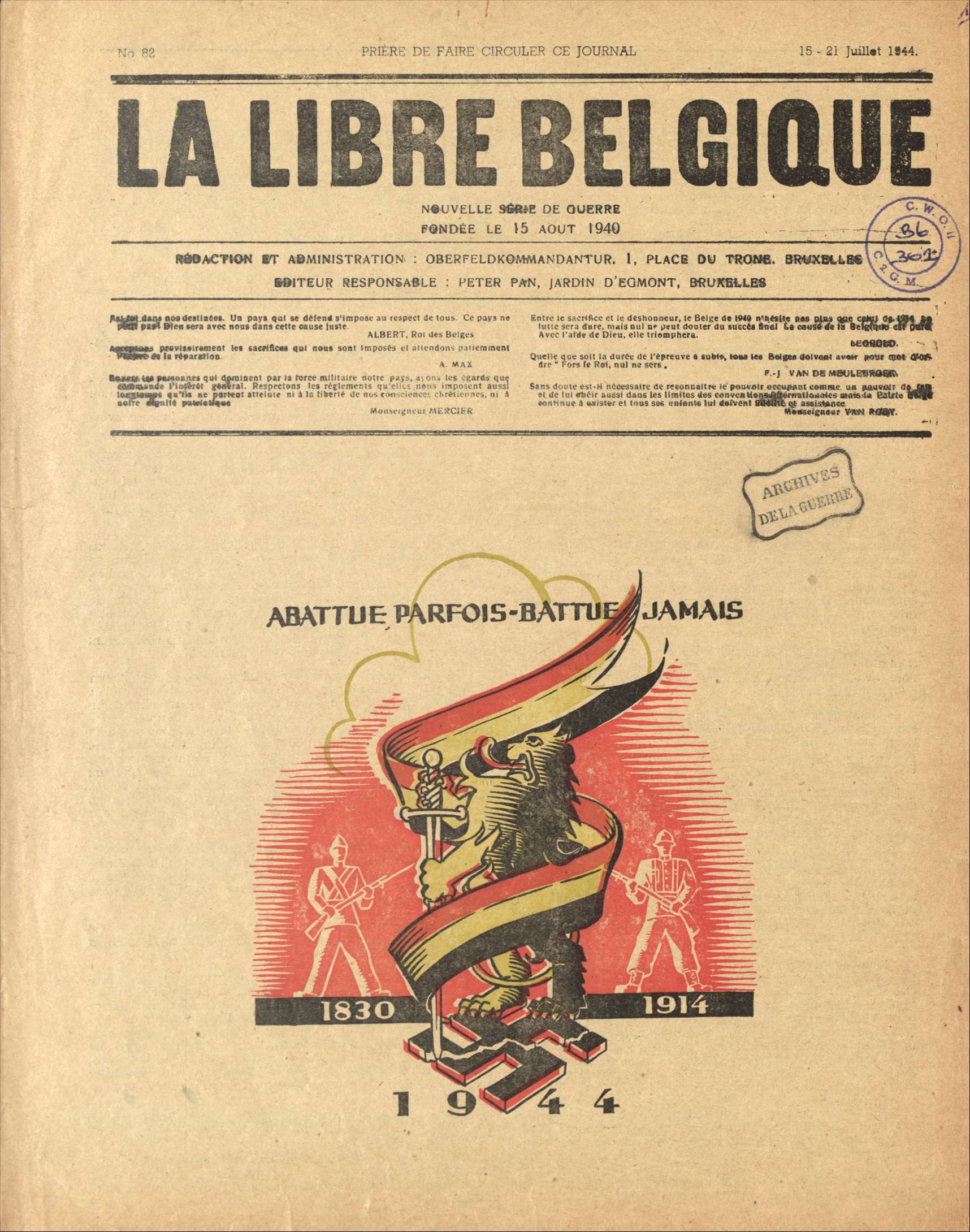
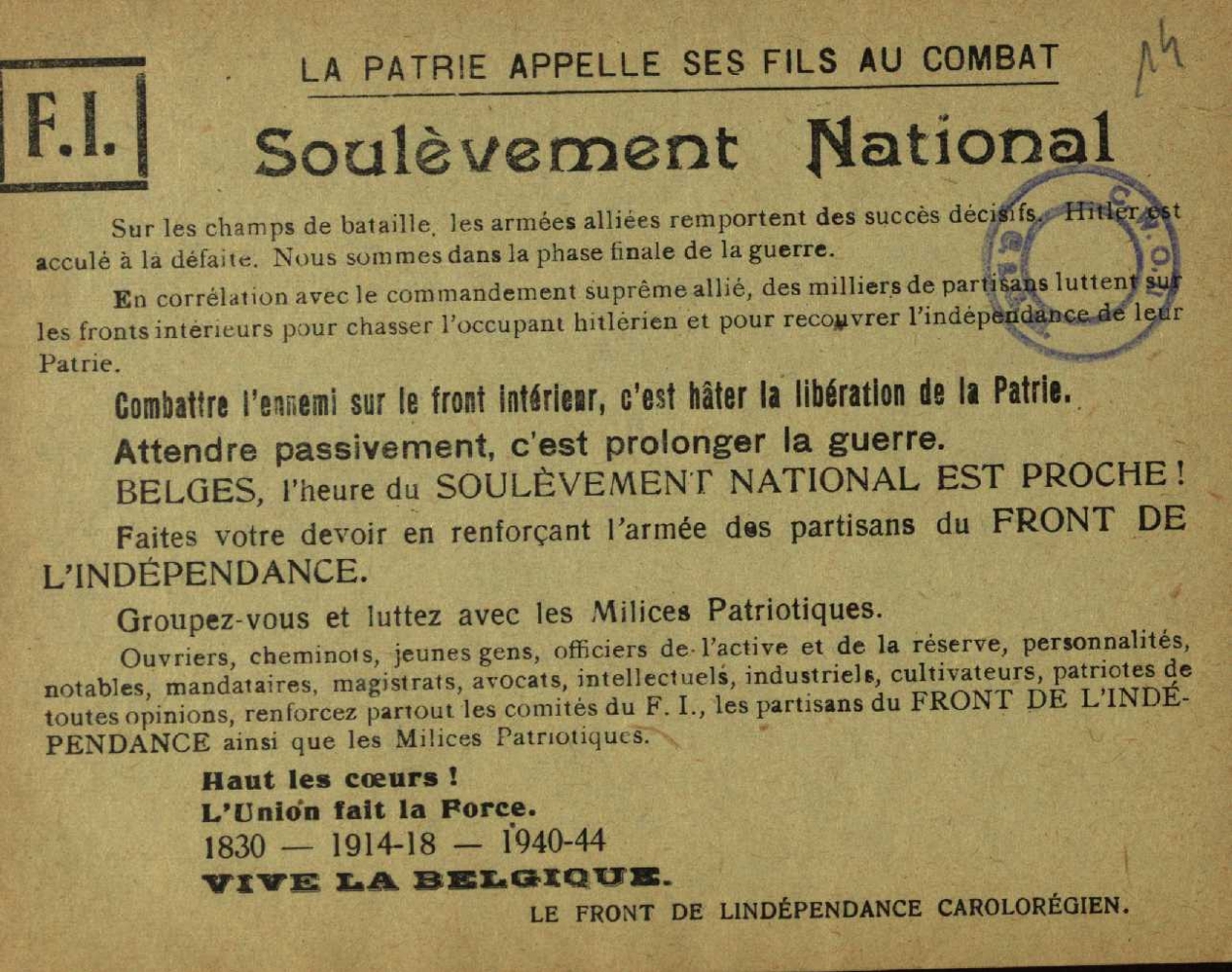
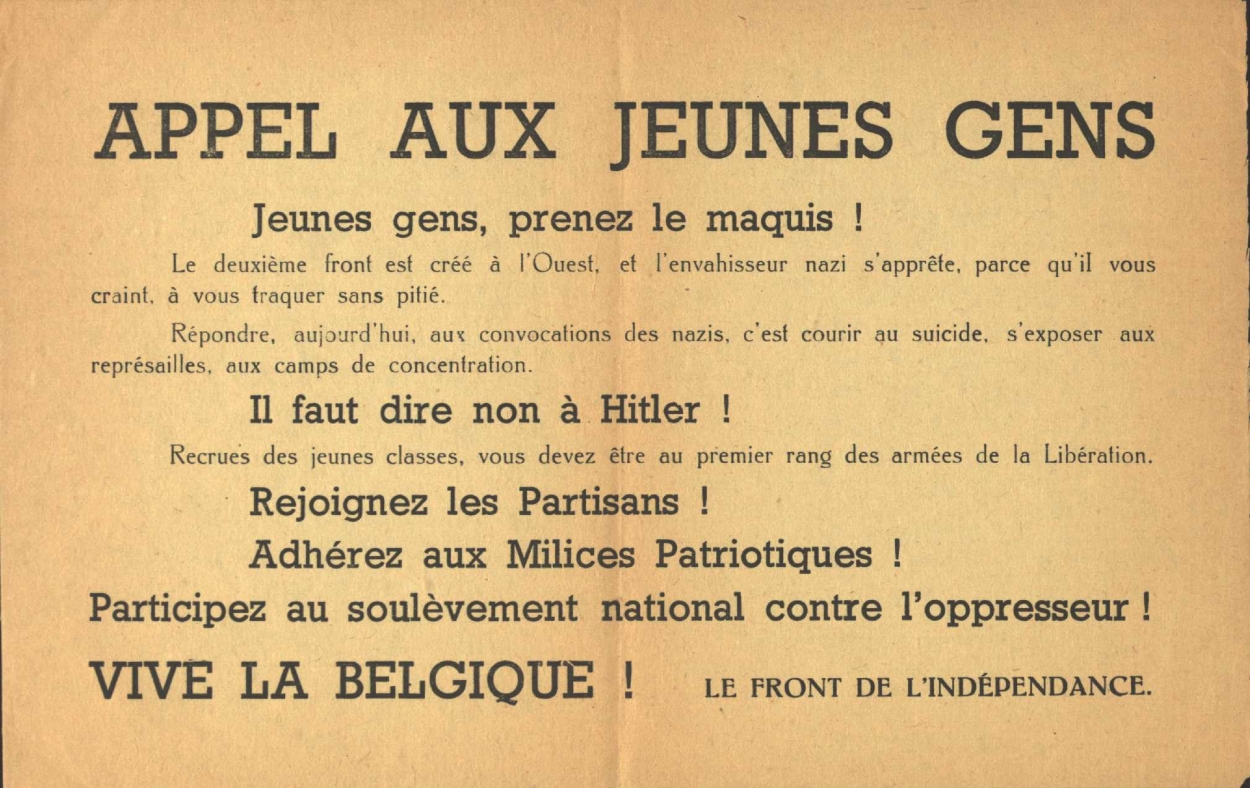

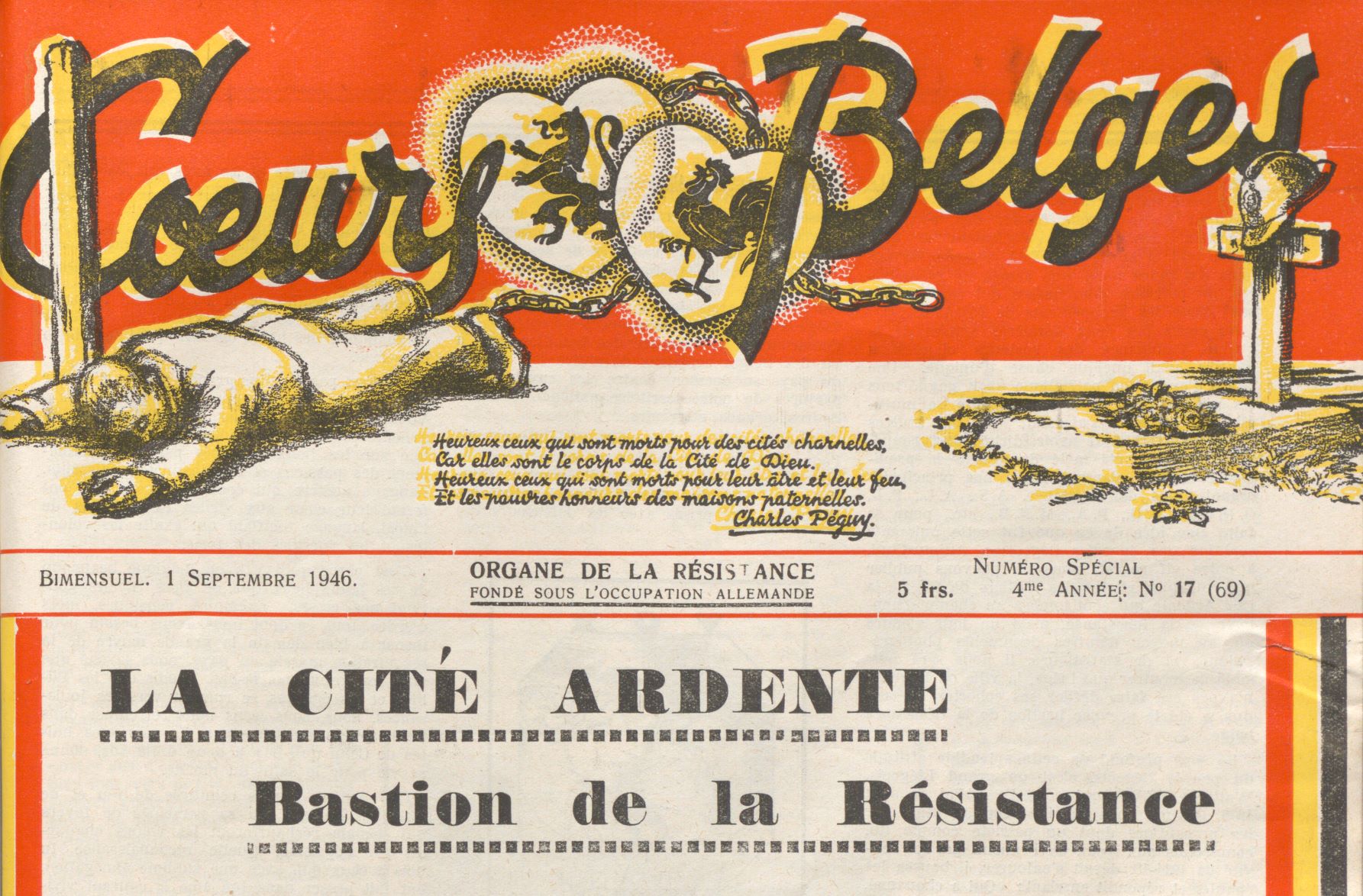
6.6) Et si Staf de Clerck avait avec son parti été dans la résistance?
Dans la réalité, Staf De Clercq est le fondateur et le chef du VNV, il a choisit la collaboration avec l’occupant nazi. Le VNV devient un relais du pouvoir allemand en Flandre, en échange de promesses d’autonomie flamande dans une « Grande Allemagne ».
Les causes dans cette uchronie du changement de cap aurait été que au lieu de miser sur l’occupant, De Clercq, marqué par le souvenir de la répression du mouvement flamand après 1918 et conscient du danger d’une annexion allemande de la Flandre, décide que la survie du peuple flamand passe par l’indépendance et non par la soumission. Il convainc le VNV de basculer vers une stratégie clandestine par exemple d’infiltrer les administrations mises en place par l’occupant. D’organiser des réseaux de renseignement pour les Alliés. De nouer des contacts avec la résistance francophone par exemple avec le Front de l’Indépendance et l’Armée Secrète.
Les conséquences auraient été multiples, avec L’apport du VNV, bien implanté en Flandre, il apporte de la logistique, des réseaux et des cadres militants. La résistance, jusque-là est plus forte en Wallonie mais ici elle s’équilibre sur tout le territoire. Ceux qui veulent collaborer notamment les rexistes flamands et les SS-Vlaanderen s’opposent frontalement au VNV résistant. On assiste à une « guerre civile dans la guerre » entre nationalistes flamands pro-nazis et anti-nazis. Les nazis considèrent la Flandre comme « fiable ». La découverte d’un VNV résistant pousse l’occupant à multiplier les arrestations, les déportations et les exécutions, ce qui radicalise encore la population.
Voici la chronologie:
Le 15 juillet 1940, Staf De Clercq, après une réunion extraordinaire du comité directeur du VNV à Gand, annonce publiquement (mais de façon codée) le tournant, le VNV cesse toute politique de collaboration ouverte et travaille dès cet été à la mise en place d’un réseau clandestin.
D’Août à Décembre 1940, le VNV crée une structure clandestine le « Comité Flamand pour la Liberté » (CFL),il y a des recrutements parmi ses cadres locaux, de ses anciens combattants et fonctionnaires. Il y a le Début des contacts secrets avec des cellules résistantes wallonnes comme le Front de l’Indépendance et avec des réseaux britanniques via des agents belges réfugiés aux Pays-Bas.
En Novembre 1940, des cellules du VNV commencent l’espionnage des plans de germanisation locale avec des relevés d’établissements scolaires, des listes de fonctionnaires à germaniser, des infrastructures ferroviaires.
En Décembre 1940, les nazis, surpris par des actes de sabotage ciblés dans des installations rail et de fabrication en Flandre, lancent une série d’arrestations. Quelques cadres du VNV sont arrêtés mais De Clercq reste en liberté grâce à son profil anciennement coopératif, c’est une couverture utile pour lui.
En Janvier 1942, le CFL qui est le bras armé du VNV commence des opérations de sabotage coordonnées, des rails, des télécommunications en lien avec l’Intelligence britannique.
Le 1er février 1942, il y a une scission publique, une fraction minoritaire, pro-nazie menée par des militants plus jeunes attirés par l’idéologie allemande, quitte le VNV et fonde des groupes collaborationnistes dont certains rejoignent SS-Vlaanderen. Il y a des conflits armés ponctuels entre groupes nationalistes flamands rivaux.
À L’automne 1942, les autorités d’occupation intensifient la répression en Flandre avec des exécutions, des déportations et des perquisitions, ce qui, paradoxalement, renforce le soutien populaire à la résistance VNV.
Du Printemps à l’Été 1943, le renseignement du CFL fournit des informations clés aux Alliés sur les flux logistiques allemands reliant Anvers et la Ruhr, des attaques de la résistance perturbent l’approvisionnement.
Le 6 juin 1944 c’est le D-Day, les forces alliées débarquent en Normandie. Les réseaux CFL intensifient les sabotages en Flandre en coordination.
À l’Automne 1944, la Libération est progressive en Belgique. À la capitulation des forces d’occupation, des unités VNV clandestines se présentent aux autorités alliées comme des réseaux de résistance.
De Novembre 1944 à 1946, il y a des enquêtes et des procès locaux de la collaboration francophone notamment de Degrelle et de Rex qui sont massivement sanctionnés, la situation du nationalisme flamand est plus complexe, le VNV résistant est distingué des groupuscules collaborationnistes.
À l’Été 1946, De Clercq meurt dans notre uchronie, il décède d’une maladie aggravée par la clandestinité, l’hypothèse plausible est pour maintenir son rôle symbolique. Il y a la reconnaissance officielle de certaines unités VNV pour leur rôle dans la libération avec des médailles collectives, des archives de résistance.
En 1946, le VNV est transformé en parti politique légitime, il est restructuré et purgé des éléments pro-nazis, participe au débat politique sur la reconstruction. Son crédit résistant lui permet d’exiger des réformes institutionnelles.
En 1947, il y a un accord politique informel entre les partis flamands et wallons : avec un engagement en faveur d’une réforme administrative pour reconnaître les spécificités linguistiques avec une commission de réforme.
Le 10 janvier 1950, la loi sur la décentralisation est mise en place avec la création de provinces dotées de pouvoirs étendus en ce qui concerne l’éducation et la culture c’est la première étape vers un fédéralisme asymétrique. Les syndicats et les partis wallons acceptent en échange de garanties sociales nationales.
En 1952, le VNV se repositionne comme un parti nationaliste modéré-démocratique, son nom a changé en « Vlaams Nationaal Front » pour marquer la rupture avec les années 1930 et 1940.
En 1957, la Belgique est un membre fondateur de la CEE dans notre uchronie comme dans la réalité, la présence d’un VNF qui fut dans cette uchronie un ancien VNV pro-européen pousse pour une représentation régionale dans les instances belges de coordination européenne.
En 1960, c’est l’indépendance du Congo avec des crises politiques internes en Belgique. Le VNF utilise la crise pour défendre une plus grande autonomie fiscale flamande.
Entre 1963 et 1968, il y a une série de lois linguistiques et de réformes territoriales, avec la clarification des frontières linguistiques et le renforcement des compétences régionales. Le fédéralisme accélère et les wallons et les flamands négocient un pacte d’autonomie macro-économique.
En 1970, il y a la Première réforme d’envergure du système d’État, la Belgique devient officiellement un État à composantes régionales avec une parité d’organes sur plusieurs dossiers-clés comme l’éducation, la culture, l’économie régionale. Le calendrier est plus précoce que dans notre réalité.
En 1976, le VNF se scinde avec une aile modérée qui est majoritaire et centrée sur l’autonomie et l’intégration dans l’UE et une petite aile plus radicale marginalisée. Le parti conserve une base électorale solide en Flandre.
Dans les années 1980, la Flandre développe une politique industrielle ciblée avec des ports et une logistique, la montée économique régionale renforce la demande d’autonomie fiscale partielle. Les partis wallons poursuivent la nationalisation partielle de certaines industries.
En 1989, c’est la Chute du Mur et fin de la Guerre froide, il y a le repositionnement stratégique des partis belges dans un cadre européen. Le VNF promeut la coopération transfrontalière avec les Pays-Bas et l’Allemagne du Nord.
En 1993, dans cette uchronie, la Constitution fédérale belge est entièrement réécrite en 1993 le contenu est plus fédéral que dans notre réalité avec la création d’un Sénat régional fort et d’un mécanisme de coopération inter-régional institutionnalisé. Le VNF pèse fortement dans la rédaction grâce à sa légitimité historique résistante.
Durant les années 2000, les institutions régionales sont pleinement opérationnelles. Sur certains dossiers comme les infrastructures portuaires et les politiques économiques, la Flandre agit presque comme un État sub-national fort.
Entre 2007 et 2010, les crises gouvernementales fédérales sont fréquentes avec la logique de la cohabitation régionale. Le VNF participe à des coalitions régionales avec des partis centristes et libéraux, nationalement les gouvernements fédéraux sont coalitionnels et fragiles.
En 2011, il y a l’introduction d’un « pacte fiscal régional » donnant davantage d’outils d’imposition indirecte aux régions.
En 2014,il y a le Renforcement des commémorations officielles du rôle du VNF dans la Résistance, avec des musées, des archives numérisées et des journées nationales de la Résistance flamande avec une controverse limitée grâce à la mémoire documentée)”
En 2016, la Flandre adopte des politiques migratoires plus strictes que la Wallonie, provoquant des débats nationaux. Le VNF propose des accords bilatéraux avec les Pays-Bas sur la gestion des ports.
En 2018, le VNF, toujours ancré dans un discours d’autonomie constructive, remporte des succès électoraux en Flandre mais maintient une stratégie pro-UE qui est différente des nationalistes populistes contemporains.
En 2020 avec la pandémie COVID-19, il y a la Gestion régionale des mesures sanitaires qui crée des divergences. La Flandre applique des politiques adaptées à son économie d’exportation avec une coordination fédérale parfois laborieuse. L’expérience renforce l’idée de compétences sanitaires régionales.
En 2022, il y a l’accélération des politiques climatiques régionales,la Flandre investit massivement dans la modernisation portuaire et la transition énergétique pour rester compétitive en Europe du Nord.
En 2025, la Belgique est un État fédéral consolidé depuis des décennies, avec des compétences régionales fortes, avec une éducation, une fiscalité partielle et des infrastructures. Le VNF est un parti régional majeur en Flandre, perçu comme un acteur traditionnel et respecté pour son rôle historique pendant la guerre, il participe généralement aux gouvernements régionaux et influe sur la politique européenne de la région flamande.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un militant du Vnv à l’Été 1940.
« Quand Staf est revenu de Bruxelles, il avait le visage fermé. Il nous a dit que les Allemands ne nous voyaient pas comme des alliés, mais comme des sujets. Alors il a frappé du poing sur la table : « Jamais la Flandre ne sera une province allemande. Nous nous battrons, mais pour nous-mêmes. » Nous n’avons pas applaudi. Nous avions peur. Mais au fond, nous savions qu’il avait raison. »
Témoignage fictif d’une habitante d’Anvers en 1943:
« La nuit, on entendait parfois des coups de feu dans le port. On disait que c’était les gars du CFL, qu’ils avaient encore fait sauter un train. Les Allemands ripostaient, ils arrêtaient des voisins, ils fusillaient des jeunes. J’ai perdu mon frère, dénoncé par un collaborateur. Mais ce qui me donnait du courage, c’était de savoir que, cette fois, les Flamands ne se laissaient pas faire. »
Témoignage fictif d’un officier britannique en Septembre 1944:
« Nous avons été surpris par la discipline des unités du VNV qui se sont présentées à nous, brassards au bras, drapeaux flamands rangés. Ils avaient infiltré l’administration allemande, saboté les voies ferrées et transmis des rapports réguliers. Leurs informations sur le trafic ferroviaire entre Anvers et la Ruhr se sont avérées précieuses. Sans leur réseau, nos bombardements auraient été bien moins efficaces. »
Discours fictif d’un député wallon, au Parlement en 1950:
« Je dois l’admettre, chers collègues : si la Flandre réclame aujourd’hui des compétences accrues, ce n’est pas avec l’ombre de la trahison sur elle, mais avec l’honneur de la Résistance. Nous, Wallons, devons trouver un équilibre, non pas pour punir, mais pour construire un État plus juste. »
Témoignage fictif d’un étudiant flamand en 1970:
« À l’université, nos professeurs nous rappellent toujours que le VNF n’est pas né d’un ressentiment ethnique, mais d’une volonté de liberté. Cela change tout. Quand je discute avec mes amis wallons, nous pouvons nous chamailler sur l’argent ou sur Bruxelles, mais jamais on ne nous traite de « fils de collabos ». Cette blessure-là, nous ne l’avons pas. »
Témoignage fictif d’une enseignante d’histoire belge en 2024:
« L’uchronie est devenue une réalité historique pour nos étudiants. Le choix de De Clercq en 1940 a changé le récit national, au lieu d’une mémoire fracturée par la collaboration, nous avons une mémoire partagée, même si elle reste complexe. La Belgique existe encore en 2024 parce que la Résistance a été bilingue et binationale. Voilà ce que les commémorations nous rappellent.»
6.7) Et si Joris van Severen et le Verdinaso avaient été dans la Résistance?
Contrairement à la réalité en Mai 1940, Joris Van Severen n’est pas exécuté à Abbeville. Libéré peu après, il revient clandestinement en Belgique occupée. Confronté à la brutalité de l’occupation nazie, il comprend vite que son rêve d’une Dietse Staat, un État unissant la Flandre et les Pays-Bas, est incompatible avec le projet allemand d’annexion dans un Grossgermanisches Reich.
Les causes qui auraient pu le mener à la résistance est que Joris Van Severen notamment voit dans l’occupation une menace directe à son idéal. Pour lui, la Flandre et les Pays-Bas doivent former un bloc autonome, non une simple province du Reich. Même si son mouvement a flirté avec l’autoritarisme fasciste, Van Severen n’a jamais été un nazi doctrinaire. L’obsession nazie pour la race et la subordination culturelle est incompatible avec son idéologie élitiste et nationale. En choisissant la Résistance, il anticipe la victoire alliée et cherche à sauver son mouvement de la disqualification totale.
Les conséquences auraient pu être qu’après la guerre, le Mouvement flamand sorte de la guerre légitimé par une figure héroïque. Des ponts politiques se créent avec les Pays-Bas. L’idée d’une union économique belgo-néerlandaise émerge plus tôt avec un Benelux beaucoup plus intégrée. La Résistance francophone n’a plus le monopole moral. Cela oblige à négocier un pacte politique qui reconnaît à parts égales l’apport flamand et wallon.
Voici la chronologie détaillée:
Le 20 mai 1940 à Abbeville, Joris Van Severen est arrêté par les autorités françaises, il n’est pas exécuté lors du massacre. IL est blessé mais vivant, il réussit à s’évader grâce au chaos des combats. Après quelques semaines de fuite, il rejoint clandestinement la Belgique occupée.
Chronologie détaillée:
À l’Été 1940, Joris Van Severen reprend contact avec les cadres survivants du Verdinaso. Le constat est que l’occupant allemand ne veut pas d’un État flamand autonome, mais d’une province germanisée.
À l’Automne 1940, il y a la Formation d’un Comité National en secret qui a pour objectif de résister aux Allemands au nom d’une identité « dietse », flamande plus néerlandaise.
En 1941, il y a la Création de cellules paramilitaires de résistance, les Dinaso-groepen. Avec une discipline quasi-militaire, inspirée des structures autoritaires du mouvement. Les Premiers sabotages discrets sont dans le port d’Anvers.
En 1942, Joris Van Severen ordonne une ligne claire, avec aucune collaboration avec l’occupant, mais pas d’alliance idéologique avec les communistes non plus. Des Dinaso-groepen sabotent des lignes ferroviaires reliant Anvers à l’Allemagne. Les nazis exécutent plusieurs jeunes militants capturés, ce qui crée un effet de martyr dans la population flamande.
En 1943, il y a un contact établi via les Pays-Bas avec le SOE britannique. Les alliés commencent à fournir du matériel radio et des armes légères. Londres voit dans Van Severen un outil utile pour équilibrer la Résistance belge, souvent dominée par les réseaux francophones ou communistes.
En Juin 1944, les Dinaso-groepen lancent une vague de sabotages coordonnés avec le débarquement allié.
En Septembre 1944, à la Libération de Bruxelles, des colonnes Verdinaso se présentent comme des « forces de Résistance flamandes ». Leur discipline impressionne les Britanniques.
En 1945, Van Severen, auréolé de prestige, participe aux cérémonies officielles de la Libération. Le Verdinaso est transformé en parti légal, rebaptisé le Parti Diets de Résistance (PDR). Les collaborateurs flamands, surtout des ex du VNV pro-nazis , sont sévèrement sanctionnés, tandis que le PDR est blanchi et reconnu comme un acteur de la Résistance.
En 1946, le PDR obtient 12 % des voix en Flandre. Il se pose comme la « droite nationale résistante », entre les chrétiens-démocrates et les libéraux.
En 1950, il y a les débats autour de la « Question royale ». Van Severen se pose en arbitre national, prônant une monarchie forte mais modernisée.
Entre 1952 et 1955, il y a la mise en place d’un pacte linguistique entre les francophones et flamands. Le prestige résistancialiste du PDR permet d’imposer la reconnaissance pleine du flamand dans l’administration et l’éducation.
En 1957, il y a la Création de la CEE. Van Severen défend une participation belge active, mais insiste sur une coopération renforcée entre les pays du Benelux.
En 1960, durant la Crise congolaise, le PDR profite de la confusion pour pousser une réforme interne, plus d’autonomie pour les régions.
En 1963, les lois linguistiques fixent définitivement la frontière linguistique. Dans cette uchronie, le compromis est moins conflictuel grâce à la légitimité du PDR.
En 1968, des manifestations étudiantes ont lieu à Louvain. Le PDR soutient la flamandisation, mais en discours pro-résistant, sans anti-belgicisme.
En 1970, la Belgique devient officiellement fédérale bien plus tôt que dans notre réalité. Les Régions et les communautés disposent de compétences larges.
En 1972, Joris Van Severen meurt à 78 ans. Avec des obsèques officielles à Bruges avec la présence du roi Baudouin et de délégations néerlandaises. Van Severen est consacré comme le « chef résistant et le père du fédéralisme belge ».
En 1973, durant la Crise pétrolière. Le PDR défend une politique énergétique commune au Benelux. Avec les premiers projets conjoints belgo-néerlandais d’éoliennes côtières.
En 1975, il y a la Création de la Communauté culturelle flamande et wallonne (dans notre réalité, ce fut en 1971, mais ici, c’est plus poussée. Le PDR revendique que ces communautés aient aussi une fonction politique.
En 1977, il y a des accords communautaires qui préparent une réforme profonde de l’État. Le PDR joue un rôle clé comme une force de stabilité.
En 1979, ce sont les premières élections européennes directes. Le PDR obtient 3 sièges au Parlement européen, dans le groupe des conservateurs démocrates.
En 1980. Les Régions obtiennent des compétences élargies en matière économique et territoriale. Le PDR s’impose comme architecte du compromis.
En 1981, il y a une crise sociale en Wallonie avec les fermetures d’usines sidérurgiques. Le PDR plaide pour une solidarité nationale, mais exige que chaque région définisse sa propre stratégie industrielle.
En 1985, il y a la Signature d’un « Pacte Benelux renforcé » à Rotterdam avec une coordination accrue en matière d’infrastructures, d’énergie et d’universités. Cette coopération inspire plus tard certains mécanismes de l’Union européenne.
En 1988, les Communautés obtiennent des pouvoirs étendus sur l’éducation et la culture. Le PDR insiste pour que Bruxelles ait un statut européen particulier qui est un reflet de sa fonction bilingue.
En 1989, avec la Chute du mur de Berlin. Le PDR s’aligne sur la ligne atlantiste, d’intégration des pays d’Europe de l’Est dans l’UE et l’OTAN.
En 1993, c’est la Révision constitutionnelle, la Belgique devient officiellement un État fédéral comme dans notre réalité, mais ici, c’est la consolidation d’un processus déjà bien avancé).
En 1995, le PDR lance l’idée d’un « Parlement Benelux » symbolique qui est installé à Breda, sans grands pouvoirs mais comme un forum transnational.
En 1998, le PDR obtient 20 % des voix en Flandre. Il participe au gouvernement flamand avec les chrétiens-démocrates.
En 1999, il y a la Défaite électorale au fédéral face à une coalition « arc-en-ciel » de libéraux de socialistes et d’écologistes). Le PDR reste néanmoins central au niveau régional.
En 2000, il y a l’Inauguration à Bruges du Musée de la Résistance Dietse, consacré au rôle du Verdinaso dans la lutte clandestine. Il y a des commémorations transfrontalières avec les Pays-Bas.
En 2001, avec les attentats du 11 septembre. Le PDR adopte une ligne sécuritaire stricte, mais insiste sur la cohésion sociale par l’intégration linguistique.
En 2007, avec le début des longues crises gouvernementales fédérales, Le PDR propose une réforme confédérale douce, d’élargir les compétences des Régions tout en gardant une défense et une diplomatie communes.
En 2009, durant la Crise financière mondiale, Le PDR soutient un plan de sauvetage coordonné du Benelux, inspirant certains mécanismes de coopération européenne.
En 2011, le « Pacte fiscal régional » est adopté, chaque Région obtient davantage de leviers fiscaux avec des impôts sur les sociétés et aussi une part de TVA, mais une solidarité minimale est maintenue.
En 2014, c’est la Grande année de la commémoration du centenaire de 1914 à 1918. Le PDR met en avant une « ligne de continuité » entre les combattants flamands de 1914–1918 et les résistants Verdinaso de 1940–1945 et le fédéralisme belge moderne.
En 2016, avec la Crise migratoire, le PDR adopte une politique d’accueil sélective avec des quotas, des priorité aux familles et aux réfugiés néerlandophones. Bruxelles conteste cette ligne plus dure.
En 2019, le PDR obtient 22 % en Flandre et participe au gouvernement régional avec les libéraux et les nationalistes modérés.
En 2020, durant la pandémie du COVID-19. La gestion est fortement régionalisée. Le PDR critique les lenteurs fédérales mais refuse d’aller vers l’indépendance flamande, plaidant pour une coordination Benelux en matière de santé publique.
En 2022, durant l’Invasion de l’Ukraine,le PDR, héritier d’un récit résistant, soutient fermement l’OTAN et l’aide militaire. Le discours associe l’Ukraine de 2022 à la Flandre de 1940.
En 2024, pour le 80ème anniversaire de la Libération. Il y a de grandes cérémonies communes à Bruxelles, à Gand et à Rotterdam. Van Severen est honoré comme un « chef résistant flamand », avec une statue inaugurée à Bruges.
En 2025, le PDR reste un parti pivot en Flandre, représentant environ 20 % des voix. La Belgique est un État fédéral robuste, où le séparatisme radical est marginal. L’idée d’une « confédération du Benelux élargie » avec une coopération militaire, énergétique et universitaire poussée domine le discours du parti.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif en 1942, d’un résistant Dinaso à Anvers:
« On nous appelait les « fascistes de 1939 ». Mais quand les Allemands ont voulu faire de nous leurs marionnettes, Van Severen a dit non. Notre serment était à la patrie dietse, pas au Reich. La nuit, nous piégions les rails menant au port. Le jour, nous faisions semblant de distribuer des journaux de propagande. Nous vivions dans la peur, mais avec la certitude d’être du bon côté. »
Témoignage fictif d’une Paysanne flamande en 1943:
« Mon fils a rejoint un groupe Dinaso. Je tremblais chaque fois qu’il quittait la maison. Mais quand l’occupant a fusillé deux jeunes de son âge, la paroisse a sonné le glas comme pour des martyrs. Depuis ce jour, même les plus sceptiques ont vu qu’ils se battaient pour nous. »
Témoignage fictif d’un officier britannique, à Bruxelles en septembre 1944:
> « Les Dinaso… je les avais connus avant-guerre comme des nationalistes bruyants. Mais là, je les ai vus entrer en colonnes, armés, organisés, encadrés comme une armée régulière. Sans eux, saboter le port d’Anvers aurait été impossible. Ils ont gagné leur place parmi les résistants. »
Témoignage fictif d’un étudiant flamand, à Louvain en 1952:
« Quand j’ai vu Van Severen parler à la Chambre, je me suis dit, voilà un homme qui a refusé Hitler, et qui ose maintenant demander que le néerlandais ait la même dignité que le français. Personne ne pouvait l’accuser de trahison. C’est ce qui a fait la différence. »
Témoignage fictif d’un jeune militant PDR, à Bruges en 1975:
« On me dit souvent, pourquoi milites-tu dans ce vieux parti ? Parce que c’est le seul qui a résisté sans renier nos racines. Van Severen est mort, mais nous avons hérité de son esprit de discipline d’identité, mais aussi de fidélité à la liberté. »
Témoignage fictif d’un ouvrier wallon à Liège en 1981:
« J’étais méfiant des flamands du PDR. Mais ils sont venus avec des propositions concrètes, un fonds Benelux pour réindustrialiser. J’ai compris qu’ils ne voulaient pas nous écraser, mais que chacun prenne son destin en main. »
Témoignage fictif d’un historien néerlandais à Amsterdam en 2000:
« Le destin du Verdinaso est unique en Europe. Nulle part ailleurs un mouvement nationaliste radical n’a basculé de la tentation fasciste à la Résistance, puis à la démocratie parlementaire. C’est une leçon pour l’histoire politique du XXe siècle. »
Témoignage d’une famille flamande à Gand, en avril 2020 avec la pandémie du Covid:
« Quand les hôpitaux débordaient, chacun se tournait vers sa Région. Mais on avait encore un filet commun. Mon grand-père, qui avait connu la guerre, disait : “Sans les Dinaso, on serait divisés pour de bon. Ils ont sauvé le pays, même s’ils l’ont changé à jamais.” »
Témoignage fictif d’une étudiante ukrainienne réfugiée à Bruxelles en 2022:
« Je ne connaissais rien de la Belgique. Mais un professeur m’a dit, votre combat, c’est le nôtre en 1940. J’ai appris l’histoire du Verdinaso résistant, et j’ai compris pourquoi les Flamands et les Wallons soutenaient si fermement mon pays. »

6.8) Et si le roi Léopold III avait été au Congo en 1940 avec son gouvernement?
En mai 1940, quand la Belgique est envahie, Léopold III refuse de suivre son gouvernement en exil à Londres puis le Congo. Il reste en Belgique, capitule avec l’armée, ce qui lui vaut des accusations de compromission avec les nazis.
Le roi dans cette uchronie est conseillé par une partie de ses généraux et de sa mère la reine Elisabeth et choisit de suivre le gouvernement Pierlot en exil. Il embarque avec le gouvernement pour Londres puis Leopoldville à Kinshasa. Le Congo devient la base politique et militaire de la monarchie belge en exil, comparable à la manière dont le général de Gaulle a utilisé l’Afrique équatoriale française.
Les causes auraient été que le roi Léopold III voulait incarner l’indépendance nationale plutôt que de paraître soumis à l’Allemagne.Il se voit comme un roi « guerrier », capable de défendre la Belgique libre depuis l’Empire colonial. Le gouvernement l’y pousse pour éviter une fracture comme dans la réalité.
Voici les deux chronologies des deux scénarios que j’ai imaginé:
Le premier scénario
En Mai 1940, Léopold III part avec le gouvernement en exil. Après Londres, il s’installe au Congo belge.
Entre 1941-1944, il fait des discours radiophoniques depuis Léopoldville, il devient un symbole de la « Belgique libre ».
En 1944, le Congo belge contribue massivement à l’effort allié avec le cuivre, le caoutchouc et l’uranium.
En Septembre 1944, le du roi retourne à Bruxelles avec les troupes alliées avec une foule en liesse et un prestige immense.
En 1945, Léopold III, un héros national, devient le pivot de la reconstruction.
En 1949, la Belgique fonde l’OTAN, avec Léopold III en première ligne diplomatique.
Durant les années 1950, il n’y avait pas de « Question royale » et donc il y a de la stabilité politique.
En 1960, l’indépendance du Congo est retardée, au lieu de 1960 dans notre réalité.Bruxelles maintient un contrôle colonial plus dur.
Dans les années 60, Léopold III résiste aux révoltes étudiantes et communautaires grâce à son prestige.
Durant les années 1970, ce sont les Crises pétrolières, il y a un renforcement d’un pouvoir monarchique autoritaire modéré.
En 1980, le roi Léopold III abdique au profit de Baudouin, mais garde un rôle d’« arbitre moral ».
En 1983, le roi Léopold III meurt, vénéré comme le « roi libérateur ».
Durant les années 1990, La Belgique reste monarchiste et centralisée, mais les tensions flamandes persistent.
En 1999, l’Intégration européenne est réussie, la monarchie conserve un rôle symbolique mais fort.
Durant les années 2010, il y a les crises migratoires et les tensions communautaires, mais la monarchie reste un ciment national grâce au souvenir glorieux de 1945.
En 2025, la Belgique est un pays stable de l’UE, la dynastie royale est intouchable, le souvenir de Léopold III est célébré comme celui du « sauveur de la patrie ».
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Un témoignage fictif d’un soldat congolais de la Force publique en 1944:
« Quand le Roi est venu nous voir à Léopoldville, c’était comme si Dieu lui-même marchait parmi nous. On ne comprenait pas toutes ses paroles en français, mais on savait qu’il nous demandait de nous battre pour la Belgique et pour l’Afrique libre. Beaucoup de mes frères sont morts en Birmanie et en Éthiopie. Nous étions fiers, mais aussi tristes : la Belgique se souvenait-elle de nos sacrifices ? »
Un témoignage fictif d’une ménagère bruxelloise en Septembre 1944:
« On avait souffert quatre ans de privations, de peur, de rationnement. Quand les chars alliés sont arrivés, et que derrière eux, le Roi lui-même est descendu de voiture, je n’ai pas pu retenir mes larmes. On criait : “Vive le Roi ! Vive la Belgique !” Pour nous, il n’était plus seulement un roi, mais un père revenu protéger ses enfants. »
Un témoignage fictif d’un ministre du gouvernement belge en exil en 1945:
« Nous avions eu peur, au Congo, que le Roi nous eclipse. Et c’est ce qui s’est passé. Ses discours radiophoniques touchaient le peuple plus que nos communiqués froids. Mais sans lui, aurions-nous eu la même légitimité ? Non. Quand il est rentré à Bruxelles, le pays entier ne parlait que de lui. Il a étouffé toute contestation par son prestige. »
Un témoignage fictif d’un résistant wallon en 1946
« J’ai combattu dans les bois de l’Ardenne, j’ai perdu des camarades. Quand le Roi est revenu, on l’a acclamé. Mais entre nous, on grinçait un peu des dents : c’était nous qui avions souffert ici, sous l’occupant, et c’est lui qu’on célébrait. On ne pouvait rien dire : qui aurait osé critiquer le Roi-libérateur ? »
Témoignage fictif d’un intellectuel flamand dans les années 1950:
« La monarchie n’avait jamais été aussi forte. Mais je me demandais : était-ce bien ? L’autorité du Roi muselait les partis, les syndicats, les mouvements flamands. C’était une stabilité achetée au prix du silence. Dans nos journaux, impossible de critiquer la colonisation du Congo. Toute voix dissidente passait pour une trahison envers le libérateur. »
Un témoignage fictif d’une étudiante à Bruxelles en 1968:
« Nos parents nous parlaient de Léopold III comme d’un saint. Mais nous, nous voulions autre chose que des portraits du Roi et des leçons de patriotisme. Quand nous avons manifesté, la police a chargé. Je me suis demandé : peut-être qu’en devenant héros en 1945, le Roi a enfermé la Belgique dans son ombre… »
Témoignage fictif d’un vieil homme à l’enterrement du Roi en 1983:
« Je me souviens du jour de son retour en 1944 comme si c’était hier. C’était le plus beau jour de ma vie. Aujourd’hui, je suis là pour lui dire adieu. Sans lui, peut-être que la Belgique n’aurait pas survécu à la guerre. Il a fait des erreurs, oui, mais il restera pour toujours le Roi-sauveur. »
Témoignage fictif d’une historienne belge en 2025:
« La légende de 1945 a figé notre mémoire. Léopold III est devenu intouchable, comme De Gaulle en France. Mais derrière la gloire, il y a aussi des zones d’ombre : la répression des grèves, le maintien brutal du Congo, la censure des opposants. Le “roi de la victoire” fut aussi le roi d’un ordre autoritaire. La Belgique l’a aimé, mais au prix de sa démocratie. »
Voici le deuxième scénario:
Voici la chronologie:
En Mai 1940, Léopold III fuit au Congo avec le gouvernement.
Durant la seconde guerre mondiale, le Congo belge devient une base alliée, mais l’Europe tombe entièrement aux nazis.
En 1945, le Reich domine l’Europe. La Belgique est occupée et devient un satellite de l’Allemagne.
Durant les années 1950, Léopold III règne depuis Léopoldville, transformant le Congo en capitale de la « Belgique libre ».
Durant les années 1960, Les États-Unis soutiennent le Congo belge comme bastion anti-nazi, mais des révoltes africaines éclatent.
En 1970, Léopold III se fait appeler le « Roi en exil », il devient une figure quasi prophétique, célébrée par les Belges réfugiés en exil
Durant les années 1970, le Reich s’affaiblit à cause de guerres civiles internes et des crises économiques.
Entre 1980 et 1983, les Alliés lancent une grande offensive depuis l’Afrique et l’Atlantique.
En 1983, Léopold III qui est un vieillard de 81 ans, débarque à Bruxelles libérée. Il apparaît comme le « Moïse belge », revenu après 43 ans d’exil.
En 1983, La Belgique sort de 40 ans d’occupation et celle-ci est en ruine économique avec un retard démocratique. Le roi Léopold III décède cette même année-là. La monarchie, auréolée de la figure messianique du Roi, devient le pivot de la reconstruction démocratique.
Durant les années 2010, La mémoire de Léopold III divise, pour les uns, il est le « libérateur de 1983 ». Pour d’autres, un roi colonialiste qui a sacrifié l’Europe pendant 40 ans.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Un témoignage fictif d’une adolescente bruxelloise sous l’occupation en 1948:
« À l’école, on nous apprend que le Roi nous a trahis et qu’il a fui en Afrique. On nous fait chanter des hymnes à Hitler et à l’Europe nouvelle. Mais le soir, mon père ferme les rideaux et me dit en chuchotant : “Un jour, le Roi reviendra. Il reviendra nous délivrer.” J’avais 12 ans, je n’y croyais pas, mais cette phrase me donnait la force de tenir. »
Un témoignage fictif d’un collaborateur flamand en 1955:
« Cela faisait quinze ans que l’Allemagne était là, et tout le monde s’y habituait. Les nazis disaient que le Roi était mort, qu’il avait été abandonné par les Anglais. Pour nous, il n’existait plus. Pourtant, certains murmuraient son nom dans les tavernes. Comme une légende… Moi, je pensais qu’il ne reviendrait jamais. »
Témoignage fictif d’un Belge réfugié au Congo en 1960:
« Léopold III n’était pas seulement un roi en exil, il était devenu un prophète. Il parlait aux réfugiés, promettant que la Belgique renaîtrait un jour. Mais le temps passait. Nous étions devenus vieux à attendre. Certains de mes amis sont morts en se demandant si nous reverrions jamais Bruxelles. »
Témoignage fictif d’un jeune résistant clandestin en 1972:
« Nous vivions dans une nuit sans fin. Les nazis contrôlaient tout : les journaux, les radios et les rues. Mais dans les caves de Liège, on faisait circuler des tracts avec la photo du Roi, plus vieux, barbu, qu’on disait encore vivant en Afrique. On appelait ça “la rumeur blanche”. On se battait pour un fantôme. »
Témoignage fictif d’une Bruxelloise lors du retour du Roi en septembre 1983:
“ Je n’oublierai jamais ce jour. Les chars alliés sont entrés par l’avenue Louise. Puis, une voiture noire est apparue. Et là… un vieillard en uniforme est descendu. C’était lui. Le Roi. Certains pleuraient, d’autres restaient figés, comme s’ils ne croyaient pas leurs yeux. Quarante-trois ans… J’avais 55 ans. J’en avais 12 quand il était parti. C’était comme si le temps s’était arrêté. “
Témoignage fictif d’un jeune homme de 20 ans en 1983:
“Pour nous, qui avions grandi sous les nazis, le Roi c’était un mythe, un conte de grand-mère. Et puis, d’un coup, il était là. Vieux, fragile, mais debout. On criait son nom dans les rues. On se sentait enfin Belges. Ce jour-là, j’ai cru que tout était possible. “
Témoignage fictif d’un ancien collaborateur en 1985:
« Quand j’ai vu le Roi rentrer, j’ai compris que ma vie était finie. Tout ce que nous avions cru éternel s’est effondré en une semaine. Je pensais avoir bâti un empire de mille ans, et voilà qu’un vieillard, sorti d’un exil africain, réduisait tout en poussière par sa seule présence. »
Un témoignage fictif d’un historien belge en 1995:
« Le retour de Léopold III en 1983 fut un événement unique dans l’histoire du monde. Un monarque en exil depuis plus de quarante ans, débarquant comme Moïse pour libérer son peuple. Mais ce miracle avait un prix, la Belgique entra dans la démocratie avec cinquante ans de retard. Nous avons dû réapprendre à être libres. »
Témoignage fictif d’une étudiante en 2025:
« À l’école, on nous montre les images du retour du Roi en 1983. Les gens à genoux, pleurant, le vénérant comme un saint. C’est étrange : pour mes grands-parents, il est un sauveur. Pour moi, c’est presque une légende biblique. Mais je me demande : était-ce vraiment une chance, ou juste une tragédie retardée ? »

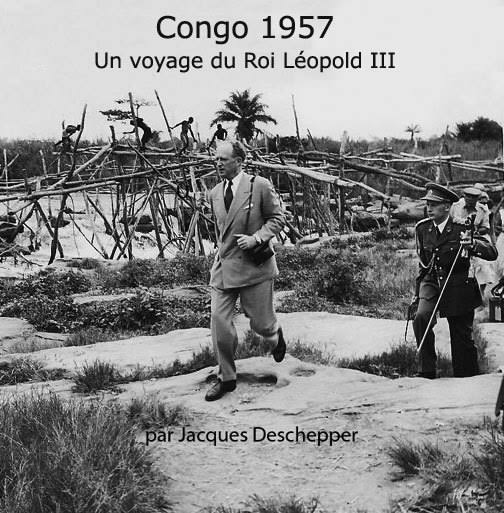


6.9) Et si Staf de Clerck n’était pas mort en 1942?
En réalité, De Clercq meurt en octobre 1942. Dans cette uchronie, il survit à sa maladie et reste à la tête du VNV. Sous son autorité, la collaboration flamande est plus centralisée et disciplinée que dans notre réalité. Les rivalités avec DeVlag qui étaient des pro-nazis plus radicaux, soutenus directement par Berlin existent toujours, mais De Clercq parvient à garder l’essentiel de la légitimité auprès des Allemands.
Entre 1943 et 1944, le VNV contrôle une partie de l’administration flamande et coopère étroitement avec l’occupant. La propagande présente De Clercq comme le “Quisling flamand”, le chef d’un futur État flamand allié au Reich. Le recrutement dans la Légion flamande qui était liée à la Waffen-SS est plus important que dans la réalité, à cause de sa légitimité politique. À la Libération, le VNV est beaucoup plus impliqué qu’historiquement, sa responsabilité politique est écrasante.
En Septembre 1944, la Libération de la Belgique a lieu, Staf De Clercq fuit en Allemagne avec les nazis, emportant une partie de la direction du VNV. En mai 1945, il est arrêté par les Alliés à Hambourg. Son procès devient le plus grand procès de collaboration en Belgique, comparable à celui de Pétain en France.
Entre 1945 et 1946 se déroulent les Procès de Bruxelles, De Clercq est accusé de haute trahison. Les preuves de son rôle dans le recrutement de volontaires SS et dans l’administration pro-nazie sont accablantes. Il est condamné à mort en 1946 et est exécuté.
Dans les années 1950, la Flandre vit avec une mémoire écrasante de la collaboration. Les débats sur l’amnistie des collaborateurs sont encore plus violents, l’affaire De Clercq devient un symbole des « traîtres flamands ». La cause flamande est durablement associée à la collaboration, ce qui retarde la naissance d’un mouvement autonomiste crédible. Pendant ce temps, le mouvement wallon pro- français et anticlérical, lié aux syndicats prend une longueur d’avance dans le débat communautaire.
Durant les années 1960, en Wallonie, la crise économique du charbon relance le mouvement régionaliste. En Flandre, le nationalisme reste marqué par l’ombre de De Clercq. Les partis flamands « respectables » hésitent à revendiquer trop fortement l’autonomie, de peur d’être assimilés au VNV.
Durant les années 1970, dans notre réalité, la Volksunie devient le parti flamand modéré porteur de l’autonomie. Dans cette uchronie, la Volksunie peine à se développer, car elle est sans cesse attaquée, on l’accuse de marcher dans les pas de De Clercq. L’État belge se fédéralise quand même, mais au ralenti et sous une forte pression wallonne et bruxelloise. Les accords communautaires sont moins équilibrés, la Flandre obtient moins de compétences qu’historiquement.
Durant les années 1980, L’extrême droite flamande l’équivalent de Vlaams Blok garde la mémoire de De Clercq comme un martyr. Cela entretient un courant radical, bruyant, mais isolé. Dans la société flamande plus large, la gêne historique empêche l’émergence d’un grand parti autonomiste dominant. Le nationalisme flamand reste minoritaire jusque dans les années 1990, contrairement à notre réalité.
Durant les années 2000, alors que dans notre monde la N-VA devient la grande force politique flamande, ici elle peine à émerger. Les électeurs flamands restent divisés entre les partis traditionnels comme CD&V, les libéraux et les socialistes, aucun ne voulant trop s’identifier à un passé marqué par De Clercq. La Flandre reste prospère économiquement, mais politiquement moins affirmée face à Bruxelles et la Wallonie.
Entre 2010 et 2025, dans notre réalité, la N-VA domine la Flandre et pousse la Belgique vers une confédération de fait. Dans cette uchronie, le traumatisme De Clercq empêche le nationalisme flamand de devenir respectable. En 2025, la Belgique est toujours fédérale, mais moins menacée d’éclatement, la Wallonie conserve une influence importante, la Flandre n’a pas osé pousser trop loin ses revendications, Bruxelles reste le centre fédéral incontesté.
Voici les témoignages de cette uchronie:
Témoignage fictif de Paul Van den Broeck qui est un étudiant en droit à Louvain et témoin du procès en 1945:
« J’ai assisté à une audience du procès De Clercq. Il n’a pas nié avoir collaboré. Il disait qu’il voulait sauver la Flandre, mais chaque mot sonnait comme une justification creuse. Quand le juge a prononcé la peine de mort, la salle a retenu son souffle. Certains ont applaudi. Moi, je me suis senti honteux : honte que la Flandre ait eu pour chef un homme jugé traître devant tout le pays. »
Témoignage fictif de Maria Janssens, une veuve d’un collaborateur à Anvers en 1958:
« Mon mari a été fusillé en 1946. Quand je vais à l’église, les gens chuchotent encore. Avec le procès De Clercq, c’est comme si on nous rappelait chaque jour que nos hommes étaient des traîtres. Je ne sais pas comment mes enfants pourront se dire Flamands sans porter cette croix. “
Témoignage fictif de Hendrik Peeters qui fut un jeune militant flamand à Gand en 1969:
« J’ai voulu rejoindre la Volksunie, mais mes parents me l’ont interdit. “Tu veux finir comme De Clercq ?”, m’ont-ils dit. On nous répète toujours que le nationalisme flamand, c’est la trahison. Pourtant, je ne veux pas être allemand, je veux juste être flamand et respecté. Pourquoi est-ce impossible ? »
Témoignage fictif de Jean Verbruggen qui fut professeur d’histoire à Bruges en 1984:
« Quand j’évoque De Clercq en classe, les élèves détournent les yeux. Pour eux, le nom est synonyme de honte. On peut parler de Degrelle en Wallonie, de Quisling en Norvège, mais ici, c’est pire : c’est notre propre chef politique. La Flandre n’a jamais vraiment fait la paix avec son passé. »
Témoignage fictif de Katrien qui est une étudiante en sciences politiques à Anvers en 2003:
«À l’université, on a étudié pourquoi le nationalisme flamand est plus faible qu’ailleurs. Les professeurs disent que c’est à cause du procès De Clercq : il a empoisonné l’image de l’autonomisme pour plusieurs générations. Mes amis rient quand j’en parle : pour eux, revendiquer l’indépendance flamande, c’est être complice de trahison. »
Témoignage fictif de Pieter un militant d’extrême droite à Courtrai en 2025:
« Chaque année, nous allons fleurir la tombe de De Clercq, malgré l’interdiction. Pour nous, c’ est un héros, pas un traître. Mais nous sommes peu nombreux, et les médias nous ridiculisent. Les partis modérés n’osent jamais parler de lui. La Belgique tient encore debout à cause de cette peur. Peut-être que c’est ça, sa vraie défaite. »
6.10) Et si le régent Charles avait cessé d’être régent et était devenu roi?
Après la Seconde Guerre mondiale, le roi Léopold III était controversé à cause de sa capitulation en 1940 et de son attitude pendant l’Occupation. En 1944, son frère cadet, le prince Charles, est nommé Régent du Royaume jusqu’au règlement de la « Question royale ». En 1950, un référendum donna une majorité en faveur du retour de Léopold III, mais la crise politique fut telle qu’il dut abdiquer en 1951 en faveur de son fils Baudouin. Charles, lui, quitta la régence et mena ensuite une vie discrète.
Cet événement aurait pu arriver par exemple si l’abdication de Léopold III se faisait en 1945 notamment sous la pression des Alliés, de la Résistance et de l’opinion publique, Léopold III aurait abdiqué plus tôt, laissant le trône à son frère. Une autre possibilité, aurait été que Léopold III n’abdique pas et que le référendum ait toujours lieu en 1950, celui-ci aurait pu basculer dans l’autre sens, les résultats étaient déjà très divisés avec 57 % pour le retour, mais avec de fortes différences régionales. Dans ce cas, Léopold III aurait dû abdiquer au profit de Charles, et non du prince Baudouin. Une autre possibilité aurait été qu’en 1944, dans la réalité, Charles ne voulait pas régner. Mais s’il avait accepté la couronne, il aurait été reconnu comme un souverain de compromis.
Les conséquences auraient pu être les suivantes:
La Belgique aurait eu un roi plus neutre et consensuel, Charles n’aurait pas le bagage polémique de Léopold III. Son accession aurait désamorcé la « Question royale », évitant les grèves et émeutes de 1950. La monarchie aurait été apaisée, la dynastie n’aurait pas été abîmée par la fracture des pro-Léopold contre les anti-Léopold. Le règne du roi Baudouin si il a lieu aurait été retardé,le roi Baudouin aurait pu rester prince héritier longtemps, accédant au trône plus tard, à la mort de Charles en 1983. Le retour de Léopold III avait cristallisé une opposition entre la Flandre et la Wallonie, les Flamands majoritairement pro-Léopold, les Wallons majoritairement anti. Avec Charles roi, cette fracture aurait pu être moins brutale. Charles était discret et réservé. La monarchie aurait sans doute évolué plus vite vers une monarchie symbolique, laissant davantage de place aux partis. La Crise institutionnelle aurait été atténuée,la transition d’après-guerre aurait pu être plus fluide, sans les manifestations sanglantes de 1950.
La Belgique aurait été plus stable dans les années 1950, au lieu d’un traumatisme politique, le pays aurait pu se concentrer sur la reconstruction économique. On aurait eu une image monarchique différente, Charles, était célibataire et sans enfant aurait donné une image moins familiale que Baudouin ou Albert II. Mais il aurait incarné la continuité, sans scandale. La succession dynastique aurait été complexe, n’ayant pas d’héritier direct, il aurait fallu préparer la transition vers le prince Baudouin ou le prince Albert, ce qui aurait pu être une source de tension.
Des témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un ouvrier wallon à Charleroi en 1951:
« On craignait le retour du roi Léopold, ça aurait mis le feu à la plaine. Beaucoup d’entre nous ne lui pardonnaient pas sa capitulation de 1940. Mais voilà que Charles est devenu roi, discret, sérieux. Ça a calmé les esprits. On peut retourner au boulot sans que Bruxelles s’embrase. »
Témoignage fictif d’un étudiant flamand à Louvain en 1955:
« On parle souvent des querelles entre les Flamands et les Wallons. Mais depuis que Charles est roi, on dirait que ça s’est un peu apaisé. Il n’a pas de préférence, il est plutôt distant. Certains disent qu’il est trop froid, mais moi je préfère ça à un roi qui divise. »
Discours fictif de Charles Ier, durant le Noël 1960:
« Mes chers compatriotes,
La Belgique a souffert de la guerre et de la discorde. J’ai accepté la couronne non pour ma gloire personnelle, mais pour garantir l’unité du royaume. Que chaque Wallon, chaque Flamand, chaque Bruxellois sache que je suis avant tout le roi de tous les Belges. »
Témoignage fictif d’un colon belge au Congo, en 1961:
« Ici, tout le monde parle de l’indépendance. Certains croient que Baudouin, s’il était roi, aurait fait de grands discours moralisateurs. Charles, lui, reste plus réservé. On ne sait pas trop quelle est sa position. On dit que les Belges de métropole se sentent moins soutenus… »
Journaliste fictif bruxellois en 1975:
“ Le roi Charles Ier, qui règne depuis trente ans, est devenu une figure de stabilité. Discret, presque effacé, il a incarné une monarchie neutre, loin des polémiques de la Question royale. Mais son célibat et son absence d’héritiers directs soulèvent une question : que deviendra la dynastie après lui ?”
Témoignage du prince Baudouin en 1983:
« Mon oncle a porté le poids de la régence puis du règne. Grâce à lui, j’ai pu grandir hors de la tempête politique. Je monte sur le trône à 53 ans, plus mûr, plus préparé. Je veux honorer sa mémoire en servant à mon tour le pays. »
Témoignage fictif d’une historienne belge en 2025:
« Le règne de Charles Ier a évité une guerre civile larvée dans les années 1950. Il a offert une monarchie apaisée, mais aussi plus distante. Le roi Baudouin, est monté sur le trône plus tard, a incarné un roi plus moderne, moins marqué par le catholicisme conservateur. Ainsi, la Belgique a sans doute gagné une monarchie moins polarisante, même si elle y a perdu un peu de chaleur humaine. »
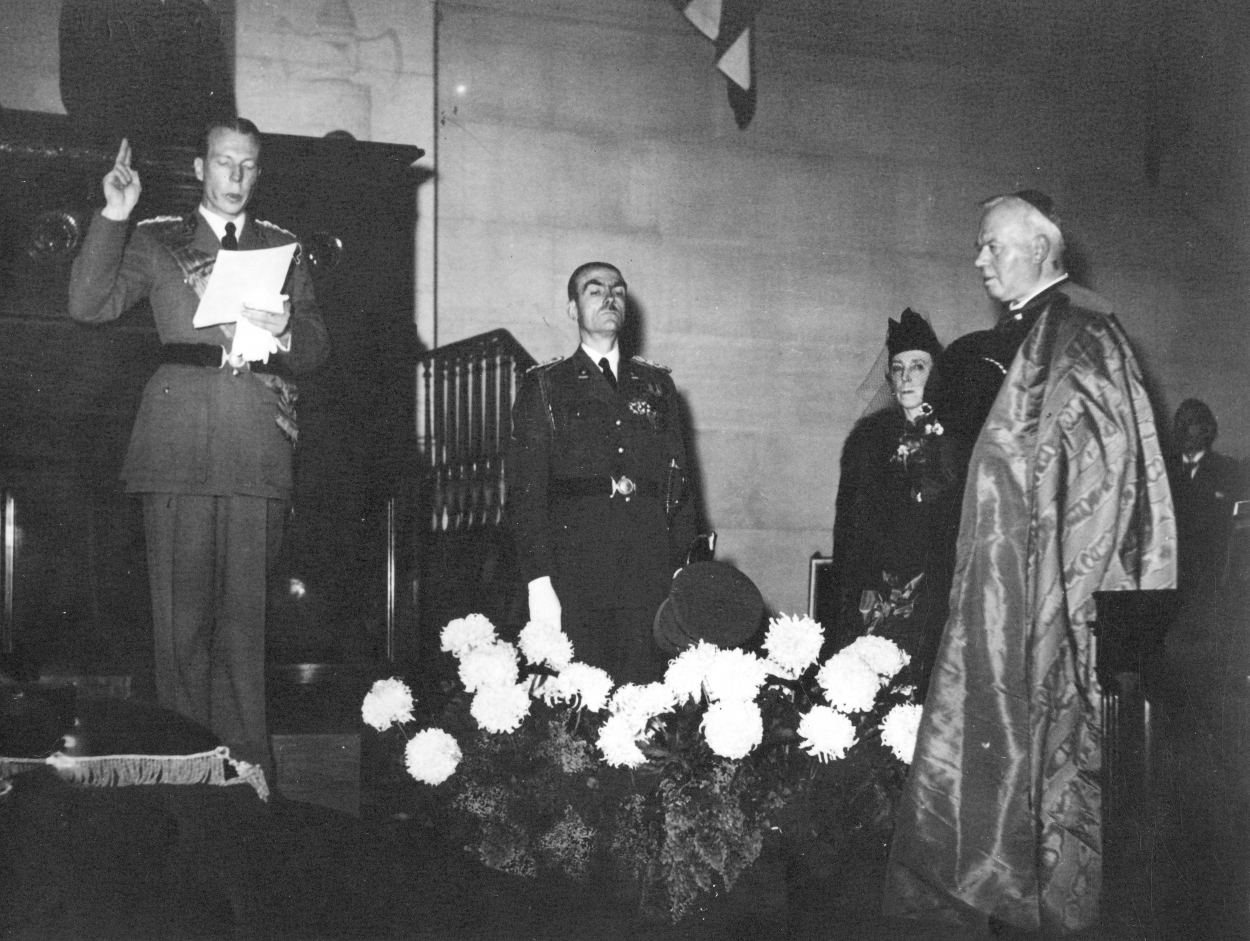

6.11) Et si l’Allemagne avait gagné la seconde guerre mondiale, que se serait t’il passé pour la Belgique?
En 1945, c’est la capitulation des Alliés. L’Europe occidentale tombe sous le contrôle allemand, la Belgique cesse d’exister, la Flandre devient un Reichsgau Flandern, avec un Gauleiter flamand proche de la SS. La Wallonie devient un Reichsgau Wallonien, confiée à Léon Degrelle comme figure de transition, sous la tutelle de Himmler. Bruxelles est déclarée « ville impériale », directement sous autorité allemande.
Entre 1946 et 1949, il y a des purges et des répressions. Les résistants et des anciens responsables belges et intellectuels francophones sont arrêtés, exécutés ou déportés.
En 1950, il y a la suppression des institutions belges. Les provinces sont intégrées administrativement au Reich,la monarchie belge est abolie, la famille royale est envoyée en exil ou neutralisée.
Entre 1950 et 1955, la germanisation est accélérée. L’école passe à l’allemand en Flandre, en Wallonie le bilinguisme est forcé français et allemand, mais la avec priorité à l’allemand.
Dans les années 1950, il y a la colonisation démographique, avec une installation de colons allemands dans les campagnes flamandes et wallonnes. Les familles résistantes sont expulsées ou déplacées. La sidérurgie wallonne et le port d’Anvers sont intégrés dans l’économie du Reich appelé « Großraumwirtschaft ». Le charbon wallon alimente l’expansion allemande.
En 1960, arrive la germanisation culturelle. En Flandre, l’allemand devient une langue quasi unique dans l’administration. En Wallonie, Degrelle pousse la thèse des « Wallons germains » et obtient un soutien limité pour des écoles SS germanophones.
En 1965, une architecture impériale est mise en place. Bruxelles est remodelée en capitale régionale, avec de vastes avenues et de bâtiments monumentaux nazis, conçus comme une vitrine du Reich en Europe de l’Ouest. Les identités belge et nationale disparaissent ; les jeunes grandissent comme « Flamands du Reich » ou « Wallons germains », formés dans la jeunesse hitlérienne.
Dans les années 1970, il y a la montée d’une élite nazifiée. Une nouvelle génération de cadres flamands et wallons, formés dans les jeunesses hitlériennes et les universités allemandes, prend la relève. Le flamand est interdit à l’école et ne subsiste que dans la sphère privée. Le français est toléré en Wallonie mais marginalisé, toute carrière passe par la maîtrise de l’allemand.
En 1980, c’est l’intégration totale. Les Reichsgaue sont représentés au Reichstag à Berlin, Degrelle, vieillissant, devient une figure honorifique, remplacé par un Gauleiter plus directement contrôlé par la SS. Il y a une prospérité relative. L’Europe nazie connaît un essor économique, comme le « miracle allemand » réel des années 1950, mais à plus grande échelle. Les Reichsgaue flamands et wallons bénéficient d’investissements en logistique, en armement et en chimie. Malgré la prospérité, des réseaux clandestins subsistent avec des intellectuels francophones, des catholiques, et des anciens flamands nationalistes et anti-nazis.
Dans les années 1990, il y a le vieillissement du régime. Hitler étant mort dans les années 1960, le Reich est dirigé par un triumvirat SS (Himmler et ses successeurs). Les Reichsgaue ouest-européens sont présentés comme des « provinces modèles », la vitrine de la germanisation réussie.
En 1994, Léon Degrelle meurt. Le vieux chef rexiste meurt en Gauleiter honorifique, ses obsèques sont mises en scène comme celles d’un « héros germain ».
Durant les années 60, il y a des tensions culturelles. Malgré 60 ans de germanisation, des poches de résistance culturelle subsistent avec la littérature clandestine en français et en flamand, des radios pirates, des traditions religieuses. Mais elles restent marginales. Bruxelles et Anvers deviennent hubs économiques du Reich occidental, avec des autoroutes et complexes industriels massifs.
Durant les années 2010, l’uniformisation est achevée. Les jeunes parlent uniquement l’allemand à l’école, au travail, dans l’administration. Le flamand et le français ne survivent que comme langues familiales dans quelques villages.
En 2020, dans cette uchronie la pandémie de COVID-19 a lieu aussi. La gestion est centralisée depuis Berlin, avec un appareil médical puissant. Les Reichsgaue de l’Ouest sont une vitrine d’efficacité, mais la défiance populaire grandit.
En 2025, 80 ans après. Les Reichsgaue flamands et wallons sont devenus des provinces allemandes à part entière. Pourtant, dans certaines familles, on transmet encore en secret l’idée d’une « Belgique disparue », symbole d’un monde d’avant. Ces mémoires circulent sous forme de récits clandestins, interdits, mais vivants.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un résistant wallon exécuté en 1947:
« Ils veulent nous faire croire que nous sommes Allemands, que notre langue n’est qu’un patois inutile. À l’école, mes enfants ne peuvent plus prier en français, tout est en allemand. Hier, on a arrêté mon voisin pour avoir chanté la Brabançonne. On parle déjà de déporter ceux qui refusent d’envoyer leurs enfants aux jeunesses hitlériennes. Mais moi, je jure que jamais je ne serai Allemand. »
Témoignage fictif d’une élève flamande en 1962:
« Nous n’avons plus le droit d’écrire en flamand. Papa murmure parfois encore des histoires en flamand le soir, mais à l’école, si un mot nous échappe, le maître nous frappe avec sa règle. On nous enseigne que nous sommes Aryens, frères des Bavarois. Je ne sais plus qui je suis. Une Allemande ? Une Flamande ? »
Témoignage fictif de colons allemands installés à Liège en 1965:
« L’installation des familles venues de Rhénanie progresse. Les vieilles maisons ouvrières de Seraing sont vidées de leurs habitants “non assimilables” et attribuées à nos colons. La population wallonne manifeste encore de l’hostilité passive, mais nous voyons déjà les enfants jouer ensemble en allemand. La transformation raciale se réalise lentement, mais sûrement. »
Discours public fictif de Léon Degrelle en 1970:
« Wallons, vous êtes les héritiers des Francs, les frères germains des Flamands et des Allemands ! Grâce au Führer et au Reich, nous avons retrouvé notre vraie famille. Oubliez la Belgique, ce petit État artificiel des temps décadents. Ici commence l’éternité germanique. »
Témoignage fictif d’une vieille Bruxelloise en 1989:
« Quand j’étais enfant, Bruxelles parlait français. Aujourd’hui, tout est en allemand. Les rues ont changé de nom, la ville est méconnaissable. Les jeunes ne comprennent plus quand je leur parle ma langue maternelle. On nous a volé notre pays, et bientôt, on nous aura volé notre mémoire. »
Témoignage fictif d’un étudiant en 2005 à Louvain:
« Toute ma vie, j’ai parlé allemand. Pourtant, chez ma grand-mère, j’entends encore quelques mots en flamand. On m’a dit que jadis il existait un pays, la Belgique. On chante même en cachette un hymne interdit. On se sent comme des fantômes : ni tout à fait Allemands, ni plus jamais Belges. »
Témoignage fictif d’un touriste allemand à Bruxelles en 2022:
« Bruxelles est une merveille. On y voit la grandeur du Reich, des avenues monumentales, des musées à la gloire de la victoire de 1945, des bâtiments colossaux dessinés selon les plans d’Albert Speer. Rien ne rappelle plus la petite Belgique d’autrefois, sinon quelques vieilles façades épargnées. Ici, on respire l’éternité germanique. »



6.12) Quelle aurait été la pire fin pour la Belgique à la suite de la 2ème guerre mondiale?
Voici la chronologie de cette uchronie qui se base sur le lore mod du jeu vidéo heart of iron:the new order, last day of Europe(Le Nouvel Ordre, les derniers jours de l’Europe)même si j’ai inventé beaucoup de choses dans ce scénario, celui-ci se divisera en plusieurs points d’embranchements
En 1940 se déroule l’Invasion allemande, la Belgique capitule.
En 1941, a lieu la Création du Reichskommissariat Belgien-Nordfrankreich sous autorité allemande.
En 1945, l’Allemagne triomphe, le Reich domine l’Europe.
Entre 1945 et 1957, Le Reichskommissariat administre la Belgique, le nord de la France et les Flandres. La Résistance est écrasée, et les collaborations forcées, avec notamment Rex en Wallonie.
En 1954, Après la tentative de coup d’État SS pendant la West Russian War(ou la guerre de la Russie occidentale), Berlin concède le territoire à Himmler.
En 1954, a lieu la Création officielle de l’Ordensstaat Burgund(où Ordre de Bourgogne SS) avec pour capitale, Nanzig ou Nancy.
En 1957, c’est la Dissolution formelle du Reichskommissariat,tout passe sous administration SS.
Entre 1957 et 1963, Himmler installe son système bourguignon. Avec des camps de concentration et d’extermination partout et avec une militarisation totale. La France de Vichy survit sous Jean-Louis Tixier-Vignancour, mais est instable.
En Novembre 1963 a lieu la Disparition mystérieuse de Tixier-Vignancour. Avec cette crise politique, l’Ordensstaat envahit la France.
Voici les différentes voies uchroniques à partir d’ici:
La Bourgogne SS triomphe du conflit. L’État français perd Paris-Nord, la Normandie-Est, et l’Est de la France. Le Gouvernement français recule à Bordeaux. En 1970, a lieu la Mort de Himmler et c’est le début de la guerre civile bourguignonne, trois factions apparaissent :
L’Ordre national belge, mené par Léon Degrelle. Le Großes Nationalstaat,mené par Bert Eriksson qui est un néo-nazi flamand. Le Mouvement des Fleurs de Pavot, mené par Henri Grouès connu dans notre réalité en tant que Abbé Pierre qui est une figure de résistance transformée en chef d’insurrection populaire.
Une autre possibilité aurait pu exister en 1963, L’Ordensstaat est écrasé par l’État français Paris est récupérée, le Reich ferme les yeux pour éviter une guerre totale. La Bourgogne est dissoute, son territoire réabsorbé par la France et par l’Allemagne. Himmler est discrédité, la SS perd énormément d’influence.
Voici les scénarios possibles pour la guerre civile dans l’éventualité où la Bourgogne l’emporte:
Degrelle l’emporte,
En 1975, Degrelle unifie la Bourgogne. Il restaure une monarchie symbolique en invitant le roi Baudouin Ier à reprendre son trône. La « Nouvelle Belgique-Bourgogne » devient une dictature monarchique autoritaire sous influence rexiste.
Eriksson l’emporte,
Durant les années 1970, l’État SS est encore plus radical, dominé par un national-socialisme pur et dur. La « Grande Bourgogne » devient un cauchemar racial totalitaire, proche d’un mini-reich SS.
Henri Grouès l’emporte,
La guerre civile tourne en révolution. Le Mouvement des Fleurs de Pavot instaure un État socialiste-chrétien anti-SS. La Bourgogne devient un havre révolutionnaire en Europe, refuge pour résistants, inspirant des insurrections dans le Reich.
L’Invasion franco-allemande en 1970
Profitant de la mort de Himmler, Berlin et le gouvernement de Bordeaux envahissent ensemble la Bourgogne. Le territoire est partagé entre le Nord et les Flandres pour l’Allemagne. La Wallonie et la Bourgogne historique pour la France. L’Ordensstaat cesse d’exister.
Voici le dernier scénario:
Degrelle, Eriksson et Grouès survivent tous après 1970. La Bourgogne reste fragmentée en trois entités rivales, aucune ne réussissant à unifier le pays.
En 2025,
Le territoire bourguignon est une zone grise de l’Europe, instable et criblée de ruines, attirant des mercenaires, des espions et des idéologues.
Voici des témoignages concernant ces différentes uchronies:
Témoignage fictif de Marie, 19 ans à Liège, en 1943:
« Chaque jour nous marchons la peur au ventre. Les Allemands disent que tout est pour notre bien, mais des voisins disparaissent et les enfants doivent apprendre l’allemand comme langue officielle. Je ne sais pas si nous verrons la Belgique un jour libre. »
Témoignage fictif de Hans un membre SS Burgundien en 1954:
« Himmler a enfin reçu le territoire. Nous commençons à construire un État selon ses plans. Certains voient cela comme un rêve, mais la population locale… disons qu’ils ne partagent pas notre enthousiasme. Chaque geste de dissidence est surveillé. »
Témoignage fictif de Pierre, 42 ans, à Anvers, en 1960:
« Il y a des camps de travail, de concentration et d’extermination partout, et nous savons que nos amis et voisins y disparaissent pour la moindre critique. Certains appellent l’Ordenstaat ‘le pays de la peur’. Les écoles enseignent le Système Bourguignon comme si c’était la vérité. Nous espérons encore un soulèvement. »
Témoignage fictif de Elisabeth à Paris en 1962:
« Le gouvernement de Tixier-Vignancour tente de maintenir la stabilité, mais les nouvelles de Bourgogne sont effrayantes. La guerre semble inévitable. »
Témoignage fictif de Jean qui est un soldat français en 1963:
« Nous avons vu les troupes de la Bourgogne franchir nos lignes. La disparition de Tixier-Vignancour a plongé l’État dans le chaos. Nous essayons de défendre Paris, mais ils sont organisés et disciplinés. C’est un cauchemar. »
Témoignage de Luc qui est un civil à Bordeaux en 1963:
« La capitale a été déplacée ici. Les journaux disent que nous avons perdu Paris et la Normandie. Les familles se séparent, et tout le monde craint les représailles de l’Ordenstaat. »
La Bourgogne perd la guerre en 1963,
Témoignage fictif de Alain à Overijse en 1965:
« Les troupes françaises ont écrasé la Bourgogne. Le Reich regarde mais n’intervient pas. Les camps sont démantelés, mais les souvenirs restent. Ceux qui ont survécu racontent l’horreur de l’Ordensstaat. »
Léon Degrelle unifie la Bourgogne après la guerre civile dans le scénario où l’Ordenstaat a gagné la guerre Franco-Bourguignone
Témoignage fictif de Claire à Namur en 1975:
« Degrelle a repris le contrôle. Beaucoup d’entre nous craignaient un nouvel effondrement, mais il a restauré le roi Baudouin. La monarchie est symbolique, mais le régime est autoritaire. Nous vivons dans une discipline stricte. »
Témoignage fictif d’un Journal étudiant, à Namur en 1985:
« Les écoles enseignent maintenant l’histoire officielle Degrelliste. Ceux qui critiquent le régime disparaissent. Nous sommes libres de rêver, mais pas de parler. »
Bert Eriksson unifie la Bourgogne,
Témoignage fictif de Sofie d’Anvers en 1978:
“ La discipline militaire est totale, et les minorités sont marginalisées. On nous apprend à vénérer le passé SS. Même mes parents craignent de parler à la maison. »
Témoignage fictif de Jan en 1990:
« J’ai grandi sous le régime Erikssoniste. Chaque rue est surveillée, et l’armée est partout. Nous sommes fiers de notre “grande Flandre”, mais personne n’ose contester le gouvernement.
Henri Grouès unifie la Bourgogne,
Témoignage fictif de Marie à Lyon en 1976:
« Le mouvement des Fleurs de Pavot a créé un État où la solidarité prime. Il y a encore des élections populaires et un fort sens de communauté. Les jeunes comme moi peuvent espérer un avenir différent. »
Témoignage fictif de François à Wavre en 2005:
« Le pays est stable, mais les cicatrices de la guerre civile restent. Nous devons constamment protéger nos villes contre les anciens SS et leurs sympathisants. »
La France et Allemagne envahissent la Bourgogne en 1970,
Témoignage fictif de Henri qui est un civil à Louvain en 1971:
« L’armée allemande est partout au nord, les Français contrôlent le sud. Les villages sont partagés, et les familles séparées. Nous avons perdu toute indépendance bourguignonne. C’est comme si nous étions des pions sur un plateau. »
Témoignage fictif d’un journal de Bruxelles en 1972:
« La Bourgogne ne sera plus jamais un État indépendant. Le Reich et la France se partagent le territoire. La population doit apprendre à vivre sous occupation. »
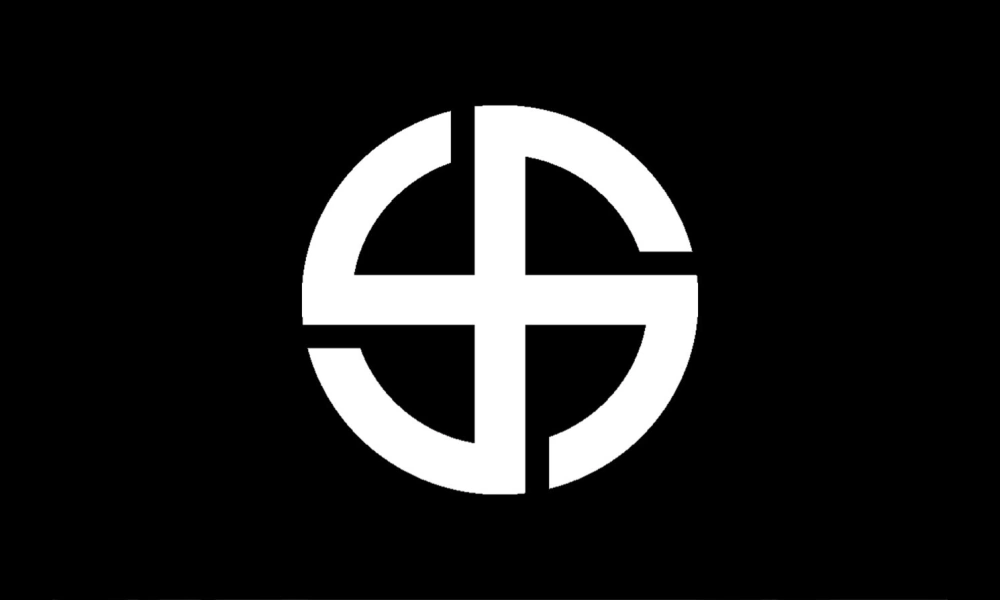








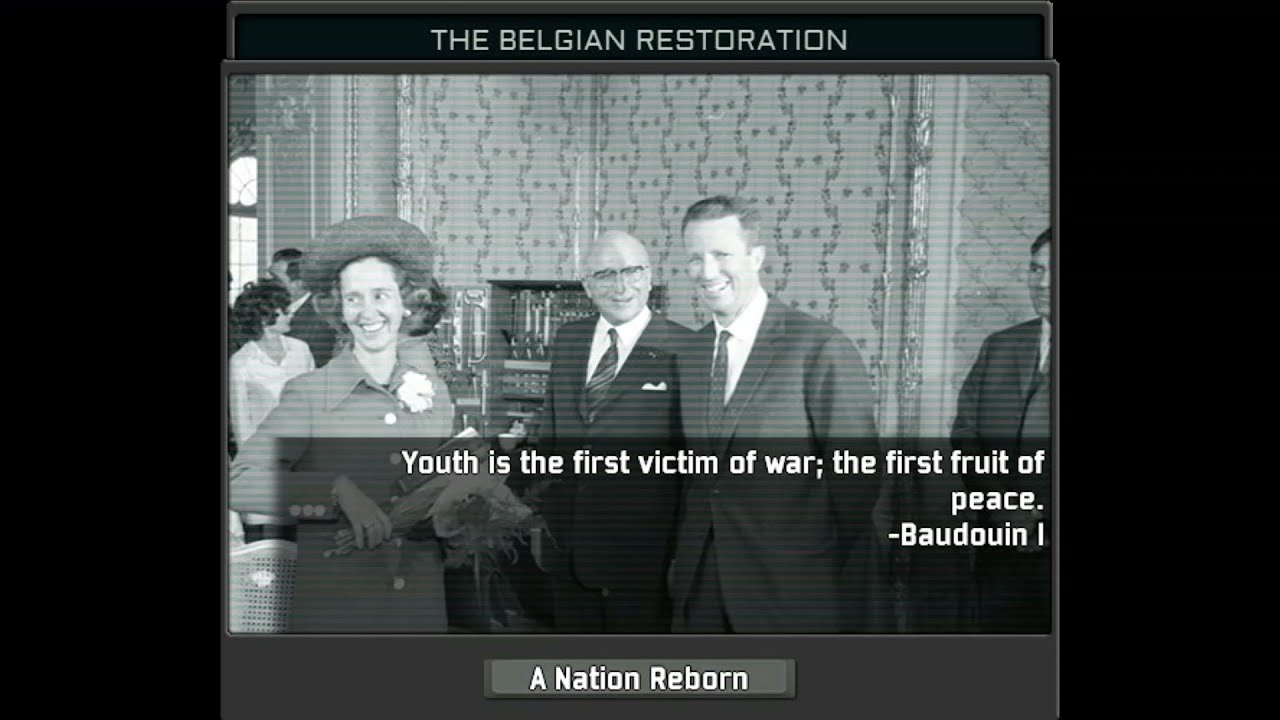

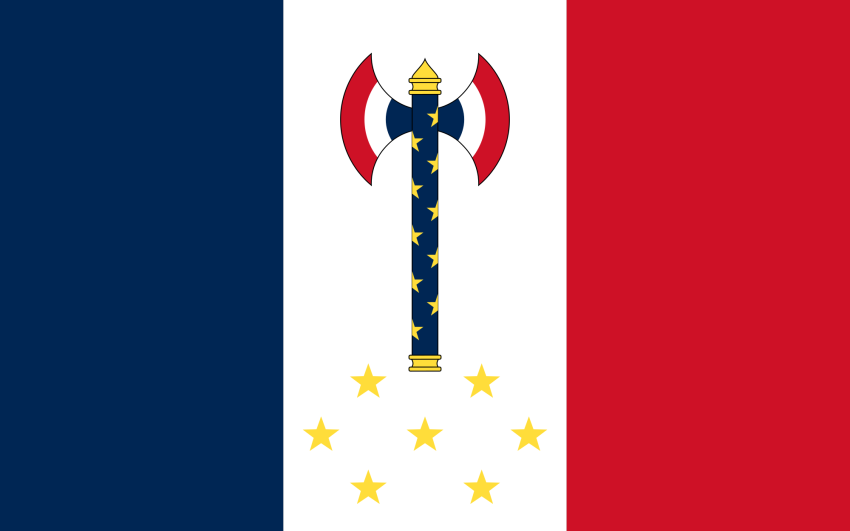
Points de divergences entre 1946 et 1990
7) Et si le roi Léopold III avait gagné avec une large majorité le référendum de 1950?
Les causes de cette large victoire auraient été multiples. Dans la réalité, les Flamands étaient majoritairement favorables au retour du roi avec un résultat réel de 72 % en Flandre. Dans cette uchronie, l’appui flamand aurait été encore plus massif autour de 80 à 85 %, grâce à une campagne habile de la monarchie et à la peur d’une instabilité politique. Les partis socialistes et libéraux wallons auraient été moins influents : peut-être par des divisions internes ou une mauvaise communication, réduisant leur impact. La Résistance communiste et catholique wallonne aurait été moins mobilisée. L’Utilisation de la radio, de discours publics et d’alliances avec le clergé catholique aurait pu présenter Léopold comme le symbole de la continuité belge et de la reconstruction. Les Alliés et les gouvernements européens auraient pu encourager son retour pour stabiliser la Belgique en pleine reconstruction économique.
Les conséquences auraient pu être les suivantes: Léopold III serait revenu au palais avec un soutien populaire massif. La crise politique de l’été 1950 avec les grèves, les manifestations, les violences à Bruxelles et à Liège aurait été fortement atténuée. Avec une légitimité éclatante, le roi aurait été perçu comme le représentant incontesté de la Belgique. L’opposition wallonne aurait été affaiblie, mais des tensions culturelles et régionales persisteraient. En additionnant la légitimité démocratique plus sa forte popularité avec ce résultat, Léopold III aurait pu se sentir en position de jouer un rôle politique plus actif, allant au-delà de la simple fonction représentative.
Voici la chronologie concernant cette uchronie:
En Juillet 1950, le Référendum est largement favorable à Léopold III entre 70 et 75 %. Le roi revient officiellement, apaisant la crise politique.
En Août 1950, des Manifestations minoritaires en Wallonie ont lieu, le roi tient des discours conciliants mais fermes, affirmant son rôle de garant de l’unité belge.
Entre 1951 et 1955, les gouvernements consultent systématiquement le roi pour les nominations ministérielles. Il exerce une influence forte mais prudente sur la politique intérieure.
En 1955, c’est le début des premières tensions communautaires modernisées, le roi favorise subtilement les réformes linguistiques en Flandre, ralentissant celles en Wallonie.
En 1960, durant l’Indépendance du Congo. Léopold III joue un rôle diplomatique plus actif, négociant directement avec les leaders congolais pour sécuriser les intérêts belges.
Entre 1962 et 1965, les réformes linguistiques (notamment la loi de 1963 sur les langues en administration) sont appliquées, mais le roi intervient pour limiter les tensions, donnant plus de pouvoirs aux provinces flamandes.
Entre 1965 et 1969, Léopold III encourage un style conservateur dans les réformes sociales et économiques, freinant certaines mesures progressistes proposées par les gouvernements de gauche.
Durant les années 1970, il y a les premières élections communales après les réformes linguistiques majeures, la Wallonie exprime son mécontentement face à la domination politique de la Flandre loyale au roi.
En 1973, il y a la Crise énergétique mondiale, Léopold III intervient en conseil pour influencer les décisions économiques, montrant une monarchie encore très présente dans la gestion nationale.
En 1983, c’est la mort de Léopold III. Son fils Baudouin monte sur le trône, plus préparé, avec l’expérience d’un roi père actif et autoritaire.
Durant le reste des années 1980, le roi Baudouin règne en tant que roi conservateur mais respectueux du parlement. L’héritage d’un roi-père autoritaire continue d’influencer la diplomatie et la politique intérieure.
En 1985, a lieu les premières discussions sur le fédéralisme belge. Le souvenir de Léopold III favorise une monarchie conciliatrice mais toujours attentive aux fractures communautaires.
En 1990, il y a des Modernisations économiques et sociales. Les partis flamands et wallons négocient des réformes, la monarchie servant d’arbitre symbolique.
Durant les années 2000, les réformes fédérales successives ont lieu avec la création de régions et de communautés qui achèvent de transformer la Belgique en un État fédéral. La monarchie est influente par tradition historique, devient largement cérémoniale.
Durant les années 2010, il y a des crises gouvernementales fréquentes avec les blocs linguistiques, mais la monarchie intervient uniquement pour arbitrer symboliquement.
En 2025, le roi Philippe règne sur une Belgique fédérale stabilisée. L’héritage de Léopold III reste dans les mémoires comme celui d’un roi ayant consolidé son autorité, évitant la guerre civile, mais aussi accentué certaines fractures régionales par sa présence politique.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un ouvrier wallon à Liège en 1951
« Tout le monde parle du retour du roi. Ici à Liège, nous n’étions pas sûrs qu’il serait accepté. Mais avec cette large majorité, il est revenu. On se sent un peu écrasés par cette popularité. Certains disent qu’il pourrait tout décider seul… j’ai peur que nos voix de Wallons comptent moins que celles des Flamands. »
Témoignage fictif d’un étudiant flamand à Gand en 1953:
« C’est étrange de voir notre roi respecté partout. Même à Bruxelles, où on craignait les manifestations, tout est calme. Léopold III est discret mais on sent qu’il pèse beaucoup sur le gouvernement. On parle moins de partis et plus du roi lui-même. »
Article fictif d’un journaliste bruxellois en 1960:
« Léopold III, roi légitime et soutenu par la majorité, influence la politique intérieure plus que tout roi précédent. Les ministres le consultent avant chaque décision majeure. La Belgique est stable, mais certains craignent que cette autorité ne devienne trop pesante, surtout pour les Wallons. »
Témoignage fictif d’une femme wallonne à Charleroi en 1965:
“On nous rappelle partout que le roi est notre guide. Mais à l’usine, les collègues parlent de lui comme d’un homme qui peut tout imposer. On sent un décalage entre notre vie quotidienne et cette monarchie si puissante. “
Discours fictif d’un député flamand en 1970:
« Grâce au roi Léopold, nous avons traversé une crise qui aurait pu être sanglante. Mais sa présence constante dans les affaires politiques, sa légitimité populaire, nous rappelle que le pays repose encore sur la monarchie. Cependant, il ne faut pas oublier que le Parlement reste souverain. »
Le Prince Baudouin en 1983 , extrait d’une interview fictive après son accession au trône:
« Mon père a régné longtemps et avec autorité. Cela a stabilisé le pays, mais j’ai grandi en voyant les tensions communautaires exacerbées dans certaines régions. Mon rôle sera d’incarner un roi plus conciliant et symbolique, laissant au Parlement la gestion des affaires. »
Témoignage fictif d’un historien belge lors d’une conférence en 2025:
« La large victoire de Léopold III en 1950 a permis d’éviter une guerre civile larvée et d’affirmer la légitimité royale. Mais cette légitimité a aussi créé une perception de royauté autoritaire, les Flamands se sont sentis privilégiés, tandis que certains Wallons ont développé un ressentiment latent. Les conséquences se sont fait sentir sur la montée du régionalisme et le fédéralisme plus tard. »

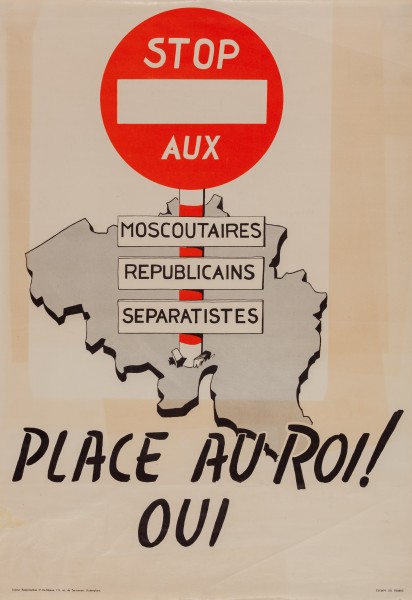
7.1) Et si la question royale avait dégénérée?
Après la Seconde Guerre mondiale, le roi Léopold III est très contesté pour son attitude lors de la capitulation de 1940 et ses rapports ambigus avec l’occupant nazi.
En 1950, un référendum mal nommé de “consultation populaire” donne environ 57 % en faveur de son retour. Mais le pays est coupé en deux :
La Flandre largement pro-Léopold et la Wallonie et Bruxelles majoritairement anti-Léopold.
En juillet 1950, quand Léopold revient, la colère explose en Wallonie avec des grèves générales, des manifestations violentes et des morts à Grâce-Berleur près de Liège. Pour éviter le chaos, Léopold abdique en faveur de son fils Baudouin en 1951.
Il y a deux scénarios possibles, le premier aurait été qu’ il y aurait pu avoir une guerre civile larvée, avec des émeutes qui s’étendent en Wallonie et à Bruxelles. Les syndicats wallons de la FGTB notamment organisent une grève insurrectionnelle. En Flandre, des mouvements catholiques et nationalistes défendent le roi Léopold III L’armée, divisée, pourrait être utilisée pour rétablir l’ordre, risquant des affrontements sanglants. La sécession aurait pu arrivée de fait de la Wallonie, appuyée par certains milieux républicains et de gauche.
Un autre scénario possible aurait pu être que la Belgique aurait pu éclater en deux entités, une Belgique flamande monarchiste autour de Léopold III. Une Wallonie républicaine, peut-être rattachée à la France (certains y pensaient déjà). Bruxelles, très mixte, serait devenue un point chaud disputé par les deux camps.
J’ai imaginé 6 scénarios pour cette uchronie, voici les chronologies liées à ceux-ci et leurs témoignages.
Entre 1950 et 1960, la Guerre civile mène à un statu quo. Le roi Baudouin devient “Roi de Flandre”, la constitution est suspendue. La Flandre devient donc une monarchie absolue.
Bruxelles accueille les institutions européennes sous la protection de l’OTAN.Elle est une social-démocratie.
La Wallonie devient une République populaire satellite de Moscou donc Staliniste
Entre 1970 et 1990, La Flandre continue d’avoir un régime paternaliste avec un culte monarchique avec l’interdiction des partis d’opposition. Bruxelles prospère comme “petite Suède” avec un capitalisme-social. La Wallonie subit une industrialisation forcée, avec des camps de travail pour les opposants.
Entre 1990 et 2000 avec l’effondrement de l’URSS, la Wallonie s’isole comme l’Albanie d’Enver Hoxha.Bruxelles s’impose comme la capitale de l’UE. La Flandre s’ouvre lentement au commerce mais reste autoritaire.
En 2025, la Flandre reste une monarchie autoritaire mais stable. Bruxelles reste une démocratie sociale modèle. La Wallonie est un régime stalinien fossile, vieux et arriéré.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif de Marcel Lefèvre, 51 ans, ancien mineur devenu militant du Parti:
« On nous dit qu’en Flandre les gens vivent libres et prospères. Mais ici, le Parti nous nourrit. On fait la queue, mais au moins nous sommes fidèles au camarade Staline. L’Occident nous hait, donc nous sommes sur la bonne voie. »
Témoignage fictif de Jan Verbruggen, 34 ans, docker au port d’Anvers:
« Je me souviens encore du jour où Sa Majesté Baudouin nous a promis de guider la Flandre comme un père guide ses enfants. Depuis, nos vies sont réglées par le roi et l’Église. Les journaux ne parlent que de sa sagesse. Certains murmurent qu’il y a trop de police secrète, mais je préfère ne rien dire. Quand je vois les files pour du pain en Wallonie, je me dis que nous avons choisi la stabilité. Même si, parfois, j’aimerais pouvoir voter. »
Témoignage fictif de Claire Dumont, 42 ans, institutrice à Woluwé-Saint-Lambert:
« Ici, c’est comme vivre entre deux mondes. Au nord, les Flamands prient leur roi comme un dieu, au sud, les Wallons brandissent leurs drapeaux rouges à l’effigie de Staline. À Bruxelles, nous avons nos élections, nos syndicats, nos débats. Les Européens affluent, et la ville devient la capitale de l’union des démocraties. On nous dit que nous sommes privilégiés. C’est vrai, mais quand je traverse la frontière vers la Wallonie pour voir ma famille, j’ai toujours peur des contrôles et des arrestations. Nous vivons libres, mais encerclés. »
Voici le deuxième scénario possible:
Entre 1950 et 1970, La Flandre tombe sous influence fasciste avec des uniformes noirs et un corporatisme d’État. Bruxelles devient un Singapour européen, le paradis du capitalisme. La Wallonie devient des fédérations anarchistes autogérées qui est plus proches de la Yougoslavie autogestionnaire.
Entre 1970 et 2000, La Flandre aurait voulu une expansion militaire vers la mer du Nord avec des tensions avec les Pays-Bas. Bruxelles devient une mégapole hypercapitaliste, mais inégalitaire. La Wallonie est une société libertaire instable avec des guerres de factions.
En 2025, la Flandre est un régime fasciste sclérosé mais toujours debout. Bruxelles est un hub financier mondial. Wallonie est en anarchie chronique avec des zones rouges et noires.
Témoignage fictif de Henri Collard un ancien mineur devenu membre d’une commune autogérée à Liège en 1972:
“Pas de patrons, pas d’État, pas de police. On vit libres, mais aussi sans hôpitaux ni routes. Les fascistes au nord nous menacent, et à Bruxelles, ils nous traitent de sauvages.”
Témoignage fictif de Sofia Claes qui est une ouvrière en textile qui a 41 ans ,à Anvers en 1987:
« Les usines marchent au pas du régime. Tout appartient à l’État ou aux corporations. On n’a pas le droit de manifester. Mais il faut être honnête, il y a du travail, et les rues sont sûres. Certains disent que c’est le prix à payer pour la stabilité. Moi, je ne suis pas sûre que ça en vaille la peine. »
Témoignage fictif de Georges Vermeulen, 37 ans qui est un entrepreneur en imprimerie à Bruxelles en 1965:
« Ici, l’État nous laisse tranquilles. Pas d’impôts écrasants, pas de lois inutiles. J’ai pu monter ma société sans que personne ne m’en empêche. Bien sûr, il y a des pauvres dans les rues, mais chacun est responsable de lui-même. Bruxelles, c’est la liberté. »
Voici le troisième scénario:
Entre 1950 et 1970:
L’Armée flamande prend le pouvoir c’est le régime de généraux. Bruxelles adopte un modèle modéré conservateur, inspiré de la CDU allemande. La Wallonie est un bastion trotskiste, dénonçant autant Staline que le capitalisme.
Entre 1970 et 2000, la Flandre subit des coups d’État successifs entre factions militaires. Bruxelles, c’est la prospérité bourgeoise et l’ordre moral. La Wallonie trotskiste soutient des guérillas en Europe.
En 2025, la Flandre est épuisée par la corruption militaire. Bruxelles est une démocratie stable mais vieillissante. La Wallonie est toujours en “révolution permanente” et isolée.
Témoignage fictif de Marie-Claire Dupont qui a 38 ans, et est une caissière à Ixelles en 1980:
« À Bruxelles, la vie est ordonnée mais stricte. Les écoles enseignent les valeurs traditionnelles et la discipline est importante. On vote encore, mais la plupart du temps, les décisions sont cadrées par les autorités. Je me sens en sécurité et protégée, mais parfois je rêve de débats plus libres comme ceux que j’entends de mes amis flamands qui vivent sous la junte militaire… même si c’est effrayant. »
Témoignage fictif de Philippe Dubois, 27 ans, et qui est un étudiant et militant à Liège en 1985:
« Ici, tout est à construire chaque jour. Nous organisons nos assemblées, nous planifions nos actions révolutionnaires, nous dénonçons à la fois le capitalisme de Bruxelles et la junte militaire flamande. C’est dur, épuisant, mais excitant. Certains nous appellent fous, mais nous savons que notre lutte est la seule qui ait du sens. »
Témoignage fictif de Jan Verstraeten qui a 42 ans et qui est officier de l’armée à Anvers en 1975:
“ Depuis que le général Vandenberg a pris le pouvoir, tout est organisé selon la discipline militaire. Les rues sont surveillées, les manifestations interdites, et l’armée contrôle la plupart des institutions. Certains camarades se plaignent de la rigueur et de la hiérarchie, mais pour ma part, je vois la Flandre devenir forte et unie. Nous savons que Bruxelles et la Wallonie nous regardent avec méfiance, mais tant que nous restons disciplinés, notre pays sera respecté. »
Voici le quatrième scénario:
Entre 1950 et 1970, La Flandre entre dans le culte de la “race germanique” avec une inspiration directe de Himmler. Bruxelles est une société libérale et progressiste avec des droits civils renforcés. La Wallonie est un mélange étrange de communisme et de nationalisme, soutenu par Moscou.
Entre 1970 et 1990, Bruxelles un devient refuge pour les dissidents flamands et wallons. La Flandre commet des répressions féroces avec des milices SS flamandes. La Wallonie à un discours grandiloquent de la “nation prolétarienne”.
En 2025, la Flandre est un paria international, proche du néo-nazisme moderne. Bruxelles est le centre d’un bloc européen. La Wallonie est une dictature nationale-bolchevique, alliée à la Russie de Poutine.
Témoignage fictif de Hendrik Storm qui a 36 ans et qui est un employé administratif à Gand en 1965:
« Depuis que le régime SS a pris le contrôle, tout est codifié par la race et la loyauté. On vit sous surveillance constante et les uniformes sont partout. La propagande insiste sur la grandeur de la Flandre. Certains osent murmurer des critiques, mais ils disparaissent vite. Moi, je fais mon travail et je ne pose pas de questions. C’est effrayant, mais ça me donne un sentiment d’ordre. »
Témoignage fictif de Claire Leclercq qui est une bruxelloise de 29 ans et qui est avocate à Bruxelles en 1982:
« À Bruxelles, nous avons la chance de vivre dans une société ouverte et tolérante. Les droits civils sont respectés, et la ville attire des intellectuels et des diplomates du monde entier. On entend les histoires terrifiantes de la Flandre SS et du régime national-bolchevique en Wallonie. Ici, nous essayons de rester libres et éclairés, mais parfois je me demande combien de temps nous pourrons tenir face à ces voisins si différents. »
Témoignage fictif de Lucien Marchal qui a 41 ans et qui est un cadre industriel à Charleroi en 1975:
« Ici, tout est organisé par le Parti, et le national-bolchevisme guide notre vie quotidienne. Les symboles rouges et noirs sont partout, et nous nous efforçons de bâtir une nation forte et unie sous la doctrine du Parti. Certains disent que nous sommes extrêmes, mais nous pensons que seule cette discipline nous protégera de la Flandre et de Bruxelles. »
Voici le cinquième scénario:
Entre 1950 et 1970, la Flandre reprend quasi intégralement le modèle nazi. Bruxelles est un État où l’État n’a pas de pouvoir avec des libertés totales avec des impôts quasi nuls. La Wallonie impose un léninisme orthodoxe avec un parti unique et une économie planifiée.
Entre 1970 et 2000, Bruxelles est le paradis des entrepreneurs mais il y a un chaos social. La Flandre veut de l’expansionnisme ce qui cause des tensions avec l’OTAN. La Wallonie est un État rigide et austère, fidèle à Moscou.
En 2025, Bruxelles est une société libertarienne fragile. La Flandre est toujours national-socialiste et isolée. La Wallonie a un régime figé et stagnant.
Témoignage fictif de Adriaan Vermeer qui a 38 ans et qui est un fonctionnaire à Anvers en 1968:
« La Flandre s’est redressée sous le régime national-socialiste. On nous apprend à être fiers de notre sang et de notre histoire. Les rues sont surveillées, les cérémonies patriotiques sont obligatoires, et ceux qui doutent disparaissent. Je ne participe pas aux critiques, mais je sens parfois que nous avons perdu quelque chose de précieux, la liberté individuelle. »
Témoignage fictif de Paul De Smet qui a 32 ans et qui est un entrepreneur à Bruxelles en 1985:
« Ici, chacun est libre de faire ce qu’il veut, sans que l’État n’intervienne. On peut créer, échanger et voyager sans contraintes. Mais il y a un prix, il n’y a pas de sécurité sociale, pas d’assistance si tu tombes malade. Certains m’appellent chanceux, d’autres inconscient. Je préfère ce chaos libre à n’importe quelle tyrannie. »
Témoignage fictif de Maurice Henrion qui a 46 ans et qui est le cadre du Parti à Liège en 1975:
« Tout est dirigé par le Parti. Chaque décision, chaque usine, chaque école suit le plan central. Nous avons éliminé le capitalisme et organisé la société pour qu’elle serve le peuple. Ceux qui s’opposent disparaissent rapidement ou sont rééduqués. Certains disent que nous sommes trop durs, mais sans discipline, nous ne survivrions pas face à la Flandre et Bruxelles. »
Voici le sixième scénario:
Entre 1950 et 1970, la Flandre est dominée par l’Église,le roi est sacré et la société est ultra-catholique. Bruxelles est une démocratie autoritaire avec un multipartisme limité. En Wallonie, il y a le culte du “Grand Guide wallon” qui est une version européenne du Juche.
Entre 1970 et 2000, la Flandre est un État clérical avec une interdiction de l’avortement, avec des tribunaux religieux. Bruxelles est prospère mais avec une surveillance accrue. La Wallonie est dans un isolement extrême, avec des famines et un culte de la personnalité.
En 2025, La Flandre est toujours un régime clérical. Bruxelles est toujours démocratique mais autoritaire comme Singapour. La Wallonie est une dictature juche figée avec des famines et de la propagande.
Témoignage fictif de Karel Van Roey qui a 40 ans et qui est un instituteur à Malines en 1970:
« Chaque matin, nous commençons par une prière à l’école. Le Cardinal est à la tête de tout et veille à ce que la société vive selon les lois de l’Église. Certains trouvent cela étouffant, mais moi, j’apprécie l’ordre et la stabilité. On sait ce qu’on peut faire et ce qu’on ne peut pas. Les autres régions nous paraissent chaotiques à côté de notre Flandre bien guidée. »
Témoignage fictif bruxellois de Jean-Paul Lefèvre qui a 35 ans et qui est fonctionnaire à Bruxelles en 1985:
« À Bruxelles, nous avons des élections et un parlement, mais l’État contrôle étroitement la sécurité et l’économie. On nous dit que c’est pour notre bien et pour la stabilité. C’est vrai que la ville est propre, sûre et prospère. Mais parfois, je rêve d’une démocratie plus ouverte et moins surveillée, comme j’en ai entendu parler dans d’autres pays. »
Témoignage fictif de Jules Masson qui a 50 ans et qui est un ingénieur industriel à Charleroi en 1975:
« Nous avons notre Grand Guide, et tout est construit autour de sa vision. Chaque travailleur est assigné à sa tâche, chaque école enseigne la loyauté et la discipline. On ne voit presque jamais le monde extérieur. Certains disent que nous sommes isolés et rigides, mais ici, chacun connaît sa place et notre pays est uni derrière le Guide. »
Est ce que cette uchronie est réaliste?
Oui, les différents scénarios de cette uchronie ont une part de réalisme la Flandre était plus rurale, catholique et conservatrice que la Wallonie industrielle en 1945 et après 1945, la Flandre a longtemps voté massivement pour le Parti catholique (CVP) puis pour des partis plus à droite comme les nationalistes, les libéraux et les conservateurs. On y observe aussi la montée du Vlaams Blok, de la NVA et du Vlaams Belang dans les années 1980 à 2025. Donc oui, imaginer une Flandre qui penche fortement à droite est réaliste, surtout dans un contexte de guerre froide et de soutien occidental.
Bruxelles est historiquement plus cosmopolite, francophone, bourgeoise et ouverte à l’Europe. La ville attire des immigrés, des fonctionnaires et des étudiants avec une société plus mixte et modérée. Si elle devient le siège d’institutions occidentales comme l’OTAN et l’UE, elle a tout intérêt à garder une façade démocratique et pluraliste. Une “île démocratique” au milieu de deux blocs idéologiques est tout à fait crédible.
La Wallonie fut une région fortement industrialisée avec les charbonnages, les aciéries et les verreries. Il y a des syndicats puissants comme la FGTB surtout avec une tradition ouvrière et une influence du PCF et du PS français voisins. Après 1945, la gauche wallonne était plus combative que la gauche flamande. Dans une guerre froide gelée, l’URSS aurait naturellement soutenu la Wallonie, ce qui renforcerait une identité politique socialiste voire communiste. L’idée d’une Wallonie “de plus en plus rouge” est plausible, surtout si Moscou l’arme et la finance.
Voici tout les leaders de ces scénarios:
Dans le scénario n°1
La Flandre (monarchie absolue): En 1950, le Roi Baudouin, en 2025, le Roi Philippe
Bruxelles (social-démocratie): En 1950, Paul-Henri Spaak, en 2025, Elio Di Rupo
Wallonie (stalinisme): En 1950, Julien Lahaut, en 2025, Raoul Hedebouw
Dans le scénario n°2
Flandre (fascisme): En 1950, Hendrik Elias, en 2025, Dries Van Langenhove
Bruxelles (libéralisme économique):En 1950, Camille Gutt, en 2025, Georges-Louis Bouchez
Wallonie (anarcho-communisme): En 1950, André Renard, en 2025, Marc Goblet
Dans le scénario n°3
Flandre (junte militaire): En 1950 Albert Folens, en 2025, Theo Francken
Bruxelles (social-conservatisme): En 1950, Joseph Pholien, en 2025, Koen Geens
Wallonie (trotskisme): En 1950, Ernest Mandel, 2025, Peter Mertens
Dans le scénario n°4
Flandre (SS): En 1950, René Lagrou, en 2025, Filip Dewinter
Bruxelles (sociale-libérale):En 1950, Paul Van Zeeland, en 2025, Sophie Wilmès
Wallonie (national-bolchevisme): En 1950, Jacques Grippa, en 2025, Jean-Claude Marcourt
Dans le Scénario n°5
Flandre (NS): En 1950, Ward Hermans, en 2025, Bart De Wever
Bruxelles (libertarianisme): En 1950, Fernand Collin, en 2025, Vincent Van Quickenborne
Wallonie (léninisme): En 1950, Edgar Lalmand, en 2025, Germain Mugemangango
Dans le scénario n°6
Flandre (théocratie): En 1950, Cardinal Van Roey, en 2025, Jozef De Kesel
Bruxelles (démocratie autoritaire): En 1950, Gaston Eyskens, en 2025, Charles Michel
Wallonie (Juche): En 1950, Jean Terfve, en 2025, David Pestieau


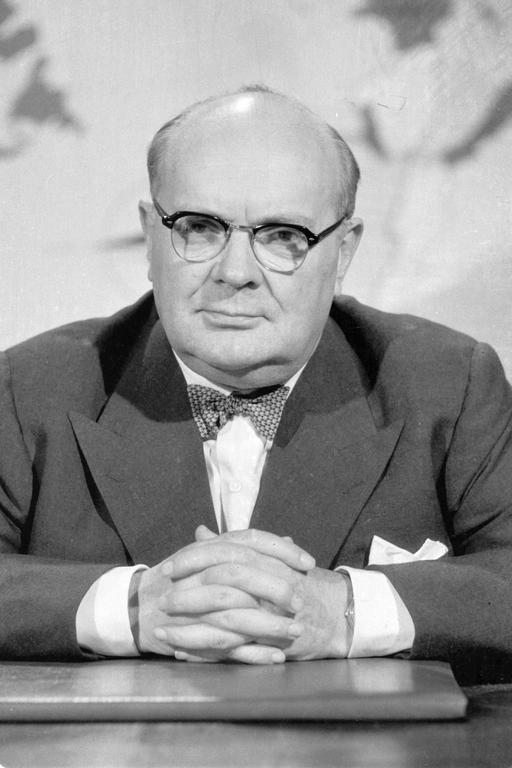














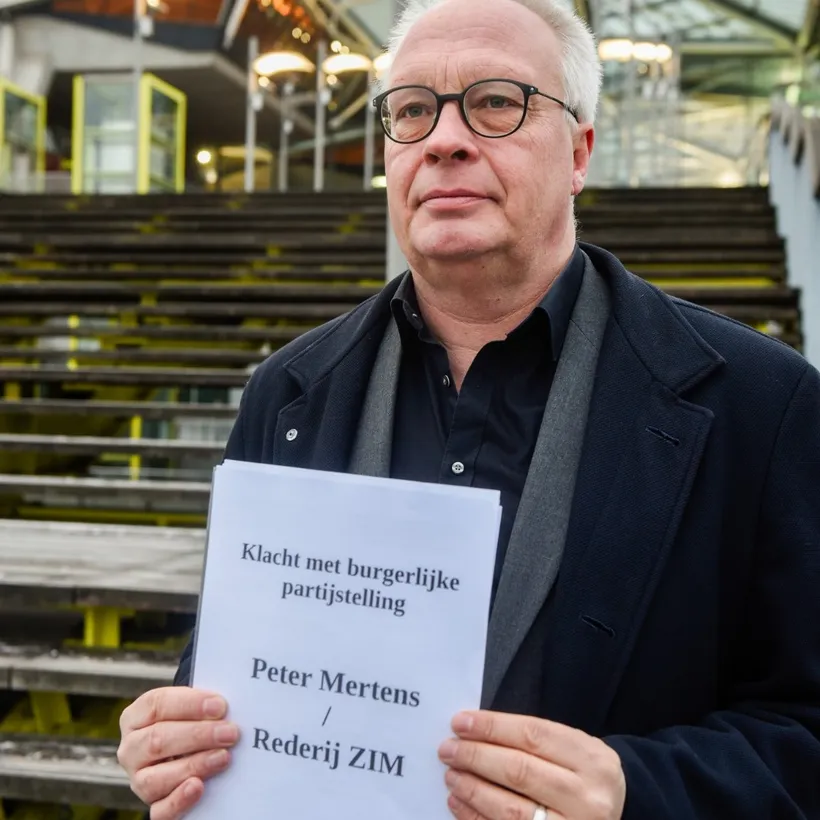










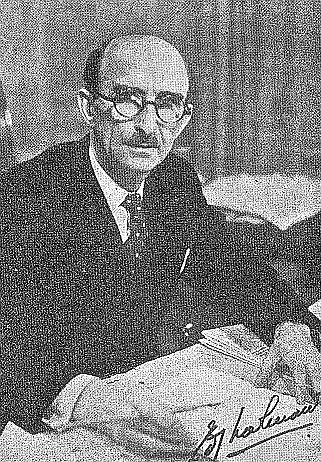

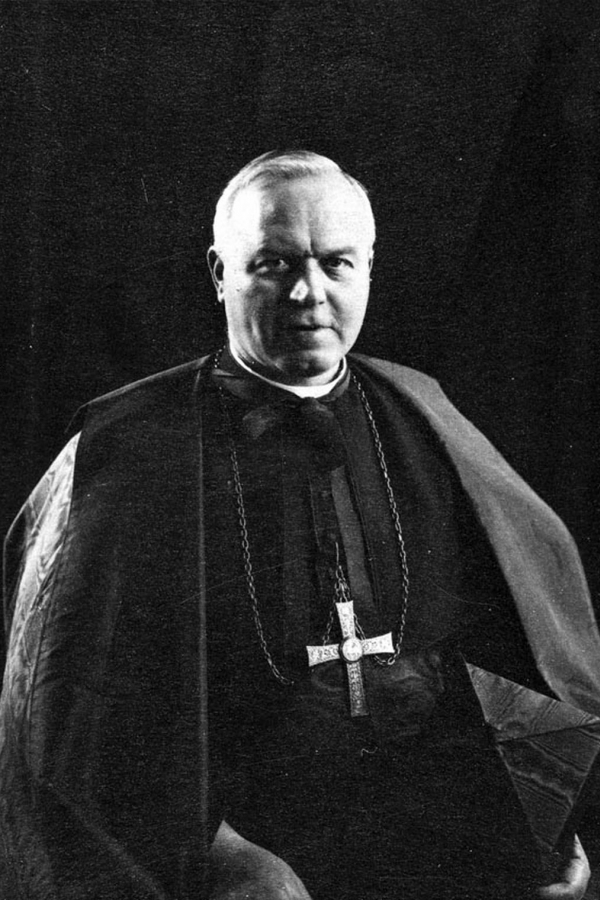
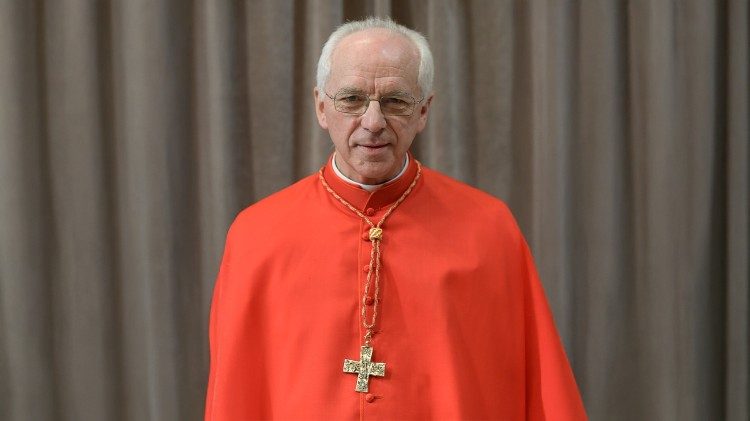


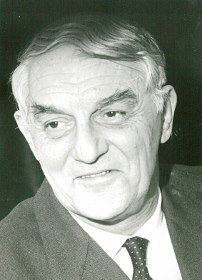

7.2) Et si la Belgique avait pris l’initiative en 1950 après la Convention de Rome de créer les États-Unis d’Europe en fédérant tous les pays de la Communauté européenne du charbon de l’acier et puis plus tard toute l’Europe?
En 1950, la Déclaration Schuman propose de créer la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) pour mettre en commun la production de charbon et d’acier de la France et de l’Allemagne, avec l’idée d’éviter de nouveaux conflits. La Belgique, le Luxembourg, l’Italie, et les Pays-Bas rejoignent bientôt. La Convention de Rome en 1957 crée la Communauté économique européenne (CEE), visant à instaurer un marché commun, mais ce n’est pas encore une union politique.
Imaginons que la Belgique, au lieu de suivre Schuman, propose dès 1950 la création des États-Unis d’Europe, à cette époque il y avait un contexte favorable, déjà la Belgique avait déjà une tradition de coopération européenne ,Bruxelles deviendra plus tard la capitale de l’UE. En 1950, beaucoup de pays européens sont encore traumatisés par la guerre et cherchent des solutions pour la paix et la reconstruction.
Si les pays de la CECA acceptent rapidement l’idée d’une fédération européenne : on aurait un État fédéral européen dès les années 1950, avec des institutions politiques centrales, une armée fédérale, une monnaie commune ou du moins une politique monétaire commune. La coopération économique aurait été intégrée à une structure politique forte, ce qui aurait probablement accéléré l’intégration économique et sociale.
Mais ce scénario aurait rencontré quelques difficultés, la France, par exemple, voulait garder un certain contrôle sur l’économie et la politique. L’Allemagne de l’Ouest était prudente après la guerre. Créer un État fédéral avec des institutions puissantes aurait été complexe à gérer dès le départ. Les États-Unis auraient pu soutenir cette initiative, mais l’URSS aurait sans doute vu d’un mauvais œil un fédéralisme européen fort proche de l’OTAN.
Voici la chronologie de cette uchronie:
En 1950, la Belgique propose la création des États-Unis d’Europe après la Déclaration Schuman. La France, l’Allemagne de l’Ouest, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas acceptent sous condition d’un fédéralisme progressif. Il y a la Création d’une Constitution provisoire européenne définissant un Parlement européen, un gouvernement fédéral et une Cour suprême européenne. Il y a l’adoption d’un système de monnaie unique provisoire basée sur un panier de monnaies existantes pour stabiliser l’économie.
En 1952, il y a le Lancement d’une armée fédérale européenne, avec un commandement intégré, pour garantir la sécurité et stabiliser la région dans le contexte de la guerre froide.
En 1955, le Premier plan de reconstruction européenne est coordonné avec une harmonisation des infrastructures et des réseaux ferroviaires et électriques.
En 1957, les Traités de Rome sont absorbés dans la fédération européenne. La Communauté économique européenne devient un ministère de l’économie des États-Unis d’Europe.
En 1959, a lieu la création de la Première citoyenneté européenne officielle, donnant des droits politiques et sociaux aux habitants des États fédérés.
En 1960, il y a l’Adoption d’une monnaie unique européenne, pour faciliter le commerce interne.
En 1962, Il y a le lancement d’un plan spatial européen commun, le prédécesseur de l’ESA.
En 1965, L’Europe fédérale devient un acteur diplomatique majeur avec une participation unifiée à l’ONU et une coordination de la politique étrangère.
En 1968, il y a la Mise en place de programmes éducatifs et culturels européens pour renforcer l’identité européenne.
En 1969 a lieu le Premier sommet officiel des États-Unis d’Europe, avec un président fédéral élu pour 5 ans.
En 1973, a lieu la Première crise pétrolière mondiale, la fédération agit de manière coordonnée pour limiter l’impact économique.
En 1975, les États-Unis d’Europe s’étendent avec la Grèce, l’Espagne et le Portugal qui intègrent la fédération après une transition démocratique.
En 1979, il y a le Lancement des élections directes du Parlement européen à l’échelle fédérale. Il y a l’adoption d’un programme d’harmonisation éducative, avec un diplôme européen standard pour faciliter la mobilité professionnelle.
En 1981, il y a la Création d’un plan industriel commun, favorisant l’automobile, l’électronique et les technologies avancées. L’Europe fédérale développe une industrie nucléaire civile coordonnée, garantissant l’énergie pour les décennies suivantes.
En 1985, il y a la libre circulation totale des citoyens, des biens et des services au sein des États-Unis d’Europe. Il y a l’instauration d’un système de sécurité sociale européen, harmonisant pensions et santé publique.
En 1989, avec la Chute du mur de Berlin, il y a l’intégration progressive de l’Allemagne de l’Est dans la fédération. Il y a aussi la Mise en place d’un programme de réintégration économique et sociale pour les anciennes régions de l’Est.
En 1992, il y a la Signature d’un traité fédéral consolidé, renforçant le pouvoir exécutif central et la monnaie européenne commune , le précurseur de l’euro-fédéral.
En 1995, il y a l’intégration officielle de l’Europe centrale et orientale avec la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie. Il y a la Création de zones économiques spéciales pour soutenir la modernisation industrielle.
En 1999, il y a l’adoption complète de la monnaie unique européenne, “l’Euro-Fédéral”. Il y a le lancement d’un fonds de développement technologique européen pour l’innovation industrielle et la recherche scientifique.
En 2001, la fédération européenne coordonne une force de maintien de la paix internationale, intervenant au Moyen-Orient et en Afrique sous mandat un mandat de l’ONU.
En 2004, il y a une expansion majeure vers l’Est avec les 10 nouveaux États membres rejoignent la fédération avec la Roumanie, la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Hongrie et la République tchèque et Malte. Il y a la mise en place d’une politique agricole et industrielle européenne unifiée, harmonisant les normes et les subventions. Il y a la création d’un programme de cohésion économique pour soutenir les États fédérés moins développés.
En 2005, il y a le développement d’une agence fédérale pour la recherche et l’innovation, visant à coordonner les projets technologiques et scientifiques à l’échelle européenne.
En 2007, il y a le lancement d’un plan de transport européen intégré, incluant les trains à grande vitesse, les corridors logistiques et les ports maritimes.
En 2008, c’est la Crise financière mondiale, avec les fonds de stabilisation économique européen permet de limiter l’impact sur les États fédérés, évitant de graves récessions nationales.
En 2009, il y a l’adoption d’un plan énergétique commun, visant à diversifier les sources d’énergie et lancer la transition vers les énergies renouvelables.
En 2010, il y a la création d’une agence européenne pour l’énergie et le climat, coordonnant les politiques de transition énergétique et la réduction des émissions de carbone. Il y a l’harmonisation des politiques de santé publique et de sécurité sociale entre États fédérés.
En 2012, Il y a la mise en place d’un réseau de cybersécurité européen pour protéger infrastructures critiques et données sensibles.
En 2013, il y a le début de la standardisation des diplômes européens pour faciliter la mobilité des étudiants et chercheurs.
En 2014, Il y a le lancement d’un programme européen pour l’innovation numérique, visant à développer l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies de communication.
En 2015, L’Europe fédérale devient un leader mondial en intelligence artificielle et en robotique grâce à des centres de recherche coordonnés. Le début de la transition énergétique est avancée, avec des investissements massifs dans l’éolien, le solaire et l’hydrogène.
En 2017, Il y a l’adoption d’une politique européenne de défense commune, avec un budget militaire fédéral et une force expéditionnaire européenne intégrée.
En 2018, il y a la mise en place d’un système fédéral de régulation économique et financière, harmonisant la fiscalité et la régulation bancaire.
En 2019, il y a le déploiement d’un plan de mobilité intercontinental, intégrant les trains, les avions, les corridors logistiques et les normes environnementales communes.
En 2020, la Coordination européenne fait face à la pandémie mondiale, il y a des protocoles sanitaires, avec une distribution centralisée des vaccins et de soutien économique aux secteurs touchés.
En 2021, Il y a le déploiement d’un programme européen de résilience sanitaire et économique, anticipant les crises futures.
En 2022, il y a le renforcement de la politique de défense commune avec des missions de maintien de la paix et de cyberdéfense et de sécurité des frontières fédérales.
En 2023, il y a eu le lancement d’un plan européen pour la transition numérique, visant à créer un marché unique numérique, intégrer l’intelligence artificielle et sécuriser les infrastructures critiques.
En 2024, Il y a la mise en œuvre d’un programme de mobilité sociale européenne garantissant un accès équitable à l’éducation, à l’emploi et à la santé pour tous les citoyens fédéraux.
En 2025, La fédération compte 35 États membres, avec 450 millions d’habitants, et une économie unifiée représentant 30 % du PIB mondial. Les États-Unis d’Europe sont un acteur central dans la diplomatie, le commerce, la technologie et la politique climatique mondiale.
Voici les témoignages de cette uchronie:
Témoignage fictif d’un citoyen belge en 1965:
« Je n’aurais jamais cru voir l’Europe unie de mon vivant. Quand j’étais enfant, on parlait de guerre et de frontières, et maintenant je peux étudier en Allemagne et travailler en France sans aucun problème. Mon passeport européen me donne des droits que je n’imaginais pas possibles. »
Témoignage fictif d’une étudiante allemande, 1989:
« Intégrer l’Allemagne de l’Est dans la fédération a été un défi pour tout le monde. Mais grâce aux programmes éducatifs et sociaux, nous avons rapidement retrouvé un niveau de vie et une mobilité que nous n’aurions jamais imaginés. Je me sens européenne avant tout. »
Témoignage fictif d’un entrepreneur italien en 2004:
« L’expansion vers l’Est a ouvert de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités. Avec la monnaie unique et la réglementation fédérale harmonisée, nous pouvons exporter partout en Europe sans barrières ni coûts exorbitants. Cela a transformé mon entreprise. »
Témoignage fictif d’une ingénieure française en 2015
« Travailler pour le programme européen de robotique et d’intelligence artificielle est un rêve. Nous collaborons avec des équipes en Suède, en Espagne ou en Pologne comme si nous étions dans la même ville. La fédération a rendu la recherche scientifique vraiment européenne.”
Témoignage fictif d’un fonctionnaire européen en 2020:
« Quand la pandémie est arrivée, la coordination fédérale a sauvé des millions de vies. Les protocoles sanitaires étaient harmonisés et les vaccins distribués de manière centralisée. Cette crise a montré à quel point l’unité européenne est précieuse. »
Témoignage fictif d’un étudiant espagnol en 2025
« Grandir dans les États-Unis d’Europe, c’est avoir aussi des racines dans son pays. Nous avons accès à une éducation de qualité partout, à des opportunités de travail dans tous les États membres et à une protection sociale incroyable. »
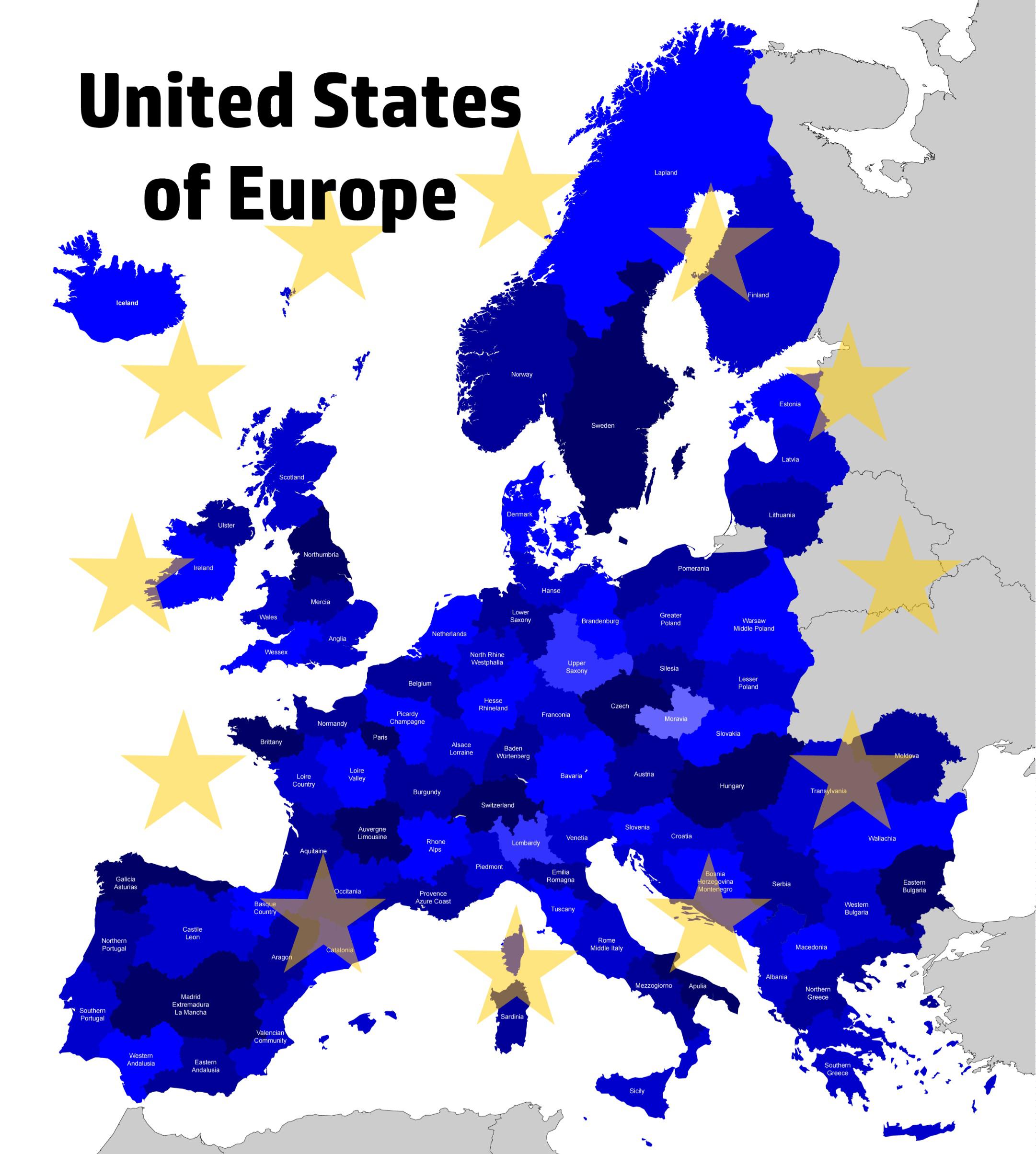

7.3) Et si le référendum concernant le roi Léopold III durant la question royale était majoritairement contre le retour du roi?
Voici la chronologie:
En 1945, il y a la Libération de la Belgique. Léopold III est retenu en Autriche par les nazis et attend son retour. La Régence est assurée par son frère, le prince Charles.
Entre 1945 et 1949, il y a un fort climat de division, les socialistes et les communistes dénoncent la « compromission » de Léopold avec l’occupant allemand, les catholiques le défendent.
Le 12 mars 1950, il y a un référendum populaire, dans notre réalité, 57 % votent pour le retour du roi. Ici dans cette uchronie, il y a 55 % des gens qui votent contre. La Wallonie et Bruxelles refusent massivement, seule la Flandre soutient Léopold.
En Juillet 1950, Léopold III refuse d’abdiquer. Il tente de reprendre son trône de force, avec l’appui d’une partie de l’armée. Des émeutes éclatent.
En Août 1950, il y a des grèves générales insurrectionnelles en Wallonie et à Bruxelles. Les militants communistes, soutenus discrètement par Moscou, prennent le contrôle des mines et des grands ports.
En Septembre 1950, un coup d’État pro-soviétique est déclenché. Le Parti communiste belge (PCB) proclame la République soviétique de Belgique (RSB). Léopold III est arrêté. Le nouveau secrétaire général du parti est René Magritte, en effet ce peintre surréaliste célèbre belge était membre du parti communiste de Belgique et sa renommée aurait pu le mener à devenir secrétaire général.
Entre 1950 et 1952, il y a des nationalisations massives avec la sidérurgie, les charbonnages et le port d’Anvers.
En 1952, La Belgique adhère officiellement au Kominform et devient un État satellite de Moscou.
En 1953, il y a le début de la répression anticléricale avec des affrontements sanglants avec les catholiques flamands. La Flandre entre en résistance.
En 1955, Bruxelles devient capitale d’un État communiste. L’OTAN est privée de la Belgique et déplace son siège à Bonn.
En 1956, il y a des soulèvements d’ouvriers flamands pro-occidentaux écrasés dans le sang comme à Budapest.
En 1960, en réalité il y eut des grèves massives contre la loi unique. Ici, elles sont dirigées par l’État communiste contre les « bourgeois saboteurs ».
En 1961, la république soviétique de Belgique entre dans le Pacte de Varsovie. La Belgique rouge devient une « frontière » de la Guerre froide.
En 1968, les étudiants belges célèbrent le « Mai rouge », soutenus par l’État. La contestation anti-autoritaire est étouffée, il n’y a pas de libéralisme culturel.
Durant les années 1970, la Flandre devient le foyer d’une guérilla anticommuniste, soutenue par les services secrets occidentaux la CIA et le MI6.
En 1980, avec la crise économique. La RSB s’enfonce dans la pauvreté. Les files devant les magasins deviennent la norme.
En 1985, il y a des attentats de groupes flamands indépendantistes. La répression est féroce.
En 1989, il y a la Chute du Mur de Berlin avec des manifestations massives à Bruxelles, Liège et Anvers.
En 1991, la République soviétique de Belgique s’effondre avec l’URSS. Il y a la proclamation de la République de Belgique, démocratique.
En 1995, L’UE accepte la nouvelle Belgique comme membre, mais sous conditions de réformes démocratiques et économiques.
En 1999, Bruxelles redevient candidate pour accueillir les institutions européennes.
En 2004, la Belgique est intégrée dans l’UE et l’OTAN, mais avec vingt ans de retard par rapport à la réalité.
Durant les années 2010, la Mémoire est divisée, les Wallons glorifient parfois la « république ouvrière », les Flamands dénoncent la répression.
En 2020, les archives révèlent l’ampleur des purges, 30 000 morts, des centaines de milliers d’exilés en France et aux Pays-Bas).
En 2025, la Belgique est une démocratie, mais son histoire communiste la distingue du reste de l’Europe occidentale. Elle est comparée à une « petite Allemagne de l’Est en plein Benelux ».
Le dernier secrétaire général dans cette uchronie en 2025 aurait pu être Peter Merteens, il est député et fut président du PTB de 2008 à 2021.
Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un ouvrier wallon à Liège en 1950:
« Quand on a hissé le drapeau rouge sur l’Hôtel de Ville, on a cru que c’était la victoire du peuple. Mais très vite, on n’avait plus de patrons… ni de travail non plus. »
Témoignage fictif d’un étudiant flamand à Gand en 1956:
« Mon frère a manifesté contre le régime. Ils l’ont envoyé en camp. Ma mère prie chaque jour, mais ici, prier peut vous valoir la prison. »
Témoignage fictif d’un réfugié belge à Lille en 1982:
« Nous avons fui Anvers de nuit. J’ai laissé mon usine, ma maison, tout. Là-bas, c’était devenu une prison à ciel ouvert. »
Témoignage fictif d’une militante à Bruxelles en 1991:
« J’ai vu tomber la statue de Lénine place de Brouckère. J’ai pleuré. Ce n’était pas seulement la fin du communisme, c’était la fin de ma jeunesse. »
Témoignage fictif en 2025, d’un professeur d’histoire à Namur:
« Les étudiants me demandent toujours : comment un pays comme le nôtre, au cœur de l’Europe, a-t-il pu devenir une dictature communiste ? Je leur réponds, à cause d’un roi qui ne voulait pas abdiquer. »




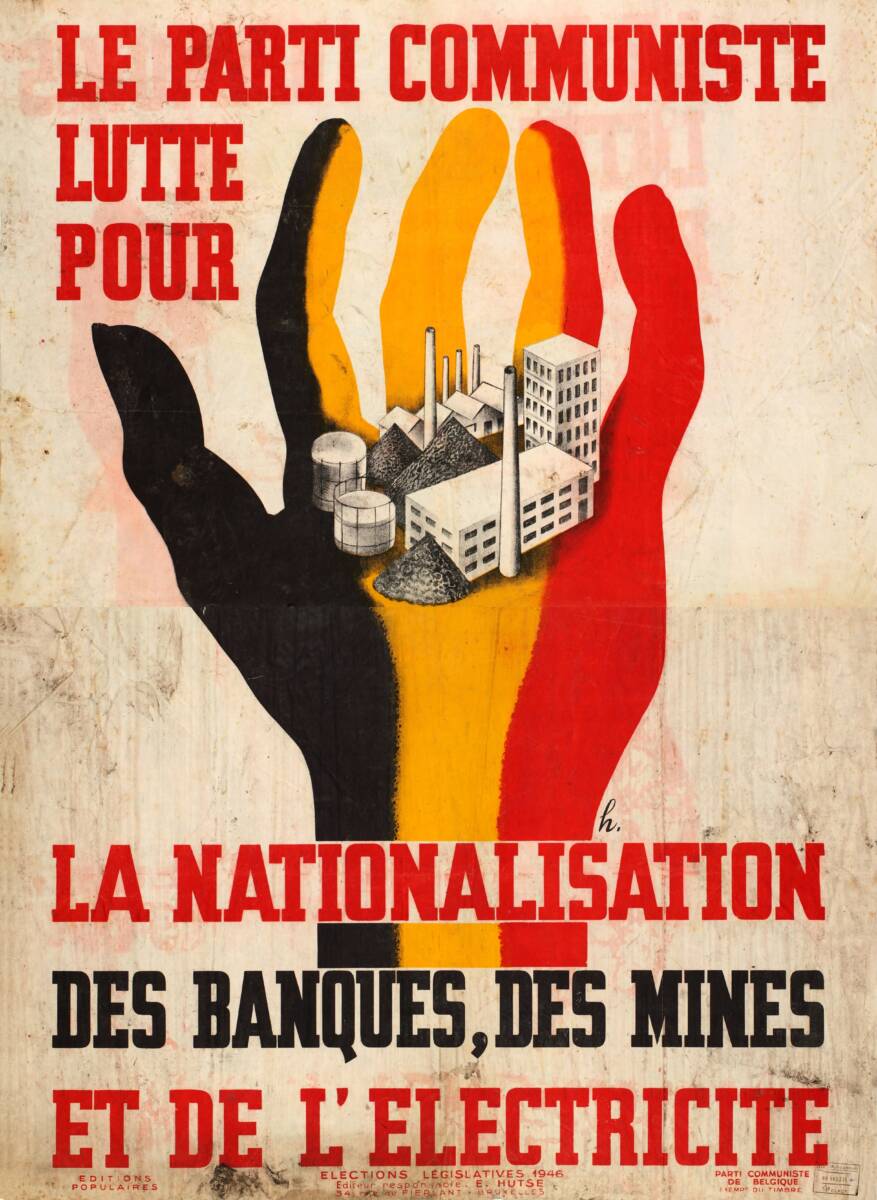

7.4) Et si la peine de mort n’avait jamais été abolie en Belgique?
Voici la chronologie de l’uchronie:
Dans notre réalité la peine de mort a été abolie le 11 Juillet 1996.
Dans cette uchronie, entre 1950 et 1970, la peine capitale encore appliquée, les dernières exécutions ont lieu dans les années 1950–1960, principalement pour les crimes de guerre ou meurtre. Les tribunaux utilisent la peine de mort comme un outil de dissuasion. Les débats éthiques existent mais restent marginaux. Le public considère la peine de mort comme légitime pour les crimes les plus graves comme les meurtres, le terrorisme et la pédocriminalité.
Entre 1970 et 1990, La peine de mort est maintenue dans la loi, mais appliquée seulement pour des crimes particulièrement odieux. Durant les crises politiques et sociales les grèves sont traitées avec un certain autoritarisme. La présence de la peine de mort renforce le pouvoir coercitif de l’État et la crainte chez les criminels.
Entre 1990 et 2000, Si Dutroux existait, avec la peine de mort encore en vigueur, la population réclamerait son exécution immédiate. Le gouvernement pourrait l’appliquer rapidement, ce qui satisferait partiellement l’opinion publique. Pas besoin de Marche blanche radicale pour exiger des peines « sévères » : la justice dispose déjà de l’arsenal capital.
Entre 2000 et 2010, La peine de mort reste un sujet de débat moral, mais très minoritaire dans les discours des gauchistes. Les crimes graves sont résolus rapidement et souvent médiatisés, renforçant l’idée d’une « justice forte ». L’Europe observe la Belgique avec inquiétude, elle reste le seul pays de l’UE occidentale avec des exécutions possibles, ce qui affecte son image.
Entre 2010 et 2025, Les pressions internationales pour abolir la peine de mort continuent avec le Conseil de l’Europe et UE). La Belgique résiste, invoquant la souveraineté belge et l’efficacité de la dissuasion. Des débats éthiques sont légions entre abolitionnistes contre les conservateurs. Dans les cas les plus graves comme le terrorisme ou la pédophilie, la peine capitale est encore appliquée sporadiquement, suscitant un scandale et une attention médiatique mondiale.
Philipp Schmitt fut la dernière personne a avoir été condamné à mort en Belgique en 1950 dans notre réalité car il fut un criminel de guerre allemand et il fut le commandant du fort de Breedonk et du camp de rassemblement de Malines.
Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Témoignage fictif à Bruxelles en 1996 d’une mère d’un enfant disparu:
« Quand Dutroux a été condamné à mort, j’ai senti un poids partir de ma poitrine. Au moins, la justice pouvait agir vite et fort. »
Témoignage fictif à Anvers en 2005 d’un magistrat conservateur:
« La peine de mort nous permet de montrer que l’État ne tolère pas les crimes les plus horribles.”
Témoignage fictif à Liège en 2020 d’un étudiant en droit:
« En Europe, nous sommes la seule démocratie occidentale avec la peine de mort. Cela nous distingue… et parfois pas pour les bonnes raisons. »
Témoignage fictif à Bruxelles en 2025 d’une historienne:
« La Belgique est toujours démocratique, mais la peine capitale a façonné notre culture de la justice : plus répressive, plus sécuritaire, moins indulgente. »


7.5) Et si la Belgique n’était jamais rentrée dans la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier et dans toutes les institutions qui la remplacera?
Dans cette uchronie, la Belgique participe pas à la création de la CECA le 18 Avril 1951.
Voici la chronologie de l’uchronie:
Durant les années 1950, après la guerre, la Belgique choisit de ne pas entrer dans la CECA. Les Raisons possibles auraient été les pressions de certains industriels du charbon et de l’acier particulièrement en Wallonie par crainte de perdre de la souveraineté, ou d’influence britannique qui elle-même refuse la CECA. La Belgique reste alignée sur l’OTAN, mais garde son économie protectionniste et nationale.
Durant les années 1960, les Trente Glorieuses profitent quand même à la Belgique, mais elle est exclue du marché commun européen. Les exportations belges souffrent car la France, l’Allemagne, l’Italie privilégient leurs échanges intracommunautaires. Le pays se tourne davantage vers ses anciennes colonies (Congo, Rwanda, Burundi), qui deviennent son débouché économique principal. La question du Congo prend encore plus d’importance,l a Belgique doit le garder plus longtemps pour compenser son isolement européen.
Durant les années 1970, le choc pétrolier frappe durement la Belgique qui n’a pas le soutien d’un marché commun pour amortir la crise. La désindustrialisation en Wallonie est encore plus brutale : sans financements européens, le chômage explose. Les tensions communautaires des flamands contre les wallons sont aggravées par l’absence de solidarité européenne, le fédéralisme arrive plus tôt et plus violemment.
Durant les années 1980, alors que la CEE s’élargit avec la Grèce, l’Espagne et le Portugal), la Belgique reste dehors et est de plus en plus périphérique et marginalisée. Bruxelles n’accueille pas les institutions européennes, peut-être que Genève ou Strasbourg devient la « capitale européenne ». La Belgique se rapproche du Royaume-Uni de Thatcher, mais reste économiquement fragile.
Durant les années 1990, avec la chute du mur de Berlin, la Belgique reste dans l’OTAN mais n’a aucune influence politique sur l’UE naissante avec le Traité de Maastricht de 1992. Elle n’adopte pas l’euro et garde le franc belge. L’économie belge est moins compétitive, avec des taux de chômage plus élevés que dans notre réalité. Bruxelles devient une ville secondaire, sans la présence des institutions européennes.
Entre les années 2000 et 2020, sans l’effet stabilisateur de l’intégration européenne, la Belgique vit une montée plus rapide du nationalisme flamand. La Wallonie, appauvrie, réclame de l’aide mais sans fonds structurels européens, les inégalités se creusent. La Belgique devient un État tampon, entre la France et l’Allemagne intégrées, mais elle-même marginalisée. Sur le plan international, elle reste membre de l’OTAN, mais n’a aucune influence dans les débats européens. Bruxelles n’est plus capitale de l’Europe, le pays perd son prestige international.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif à Liège en 1975 d’un ouvrier sidérurgiste:
« Les Français et les Allemands travaillent ensemble, mais nous on reste seuls. La sidérurgie ferme partout, et personne ne nous aide. »
Témoignage fictif à Bruxelles en 1995 d’un étudiant:
« J’ai visité Strasbourg. C’est là qu’est le Parlement européen… Ça aurait pu être chez nous. Bruxelles serait la capitale de l’Europe. Mais on a raté le train. »
Témoignage fictif à Anvers en 2010 d’un entrepreneur
« Nos voisins sont dans l’euro, pas nous. Pour exporter, c’est une galère. On dépend trop des fluctuations monétaires. »
Témoignage fictif à Namur en 2025 d’un historien:
« En choisissant l’isolement, la Belgique a perdu son rôle stratégique. Elle est devenue un petit État périphérique, alors qu’elle aurait pu être au centre de l’Europe. »



7.6) Et si la Bruxellisation n’avait pas eu lieu?
Durant les années 1950 et 1960, au lieu de céder aux promoteurs, la Ville et l’État choisissent une politique proche de la loi Malraux en France en 1962 avec la restauration du tissu urbain ancien, avec des subventions pour rénover les immeubles haussmanniens et art nouveau avec des interdiction de raser sans projet de conservation. Les Marolles, le quartier Léopold, Saint-Géry et Dansaert échappent à la destruction. L’Art nouveau de Horta et Hankar, très menacé en réalité, est protégé dès les années 1960.
Durant les années 1970 et 1980, au lieu des grands viaducs et des tours de bureaux, Bruxelles adopte une logique de ville à l’échelle humaine. Les gares comme la Gare du Nord sont modernisées, mais intégrées au tissu urbain. Les Marolles deviennent un quartier culturel et bohème, au lieu d’un champ de bataille urbanistique. Bruxelles commence à être comparée à Vienne ou Prague pour son harmonie architecturale.
Durant les années 1990, quand Bruxelles devient capitale de l’UE, le quartier européen est construit de façon intégrée dans la ville, sans destruction massive.Les bâtiments européens s’inspirent de l’architecture historique rénovée, au lieu des blocs de verre anonymes. Bruxelles a gagné une réputation de capitale élégante et culturelle, et non pas seulement administrative.
Durant les années 2000 à 2020, Le tourisme explose, au lieu que Bruges et Gand monopolisent l’image patrimoniale belge, Bruxelles devient une destination mondiale, à la hauteur de Prague, Vienne ou Budapest. L’Art nouveau devient l’image de marque de la ville avec des musées, des circuits et des festivals. L’économie profite de cette attractivité avec des hôtels, des restaurants et des galeries d’art se multiplient. La gentrification s’accélère surtout à Ixelles, Saint-Gilles et Schaerbeek, mais la ville reste vivante.
En 2025, Bruxelles est considérée comme l’une des plus belles capitales d’Europe, avec son patrimoine XIXe siècle et Art nouveau intact. Le centre-ville n’est pas coupé par des autoroutes, la mobilité est pensée plus tôt en termes de tram, métro et piétonnisation. L’image de « ville sans visage » n’existe pas, Bruxelles rivalise avec Paris pour son charme architectural.
Voici les témoignages fictifs:
Témoignage fictif à Bruxelles en 1978 d’une habitante des Marolles:
« On devait être expulsés pour des tours de bureaux. Finalement, on a rénové nos maisons. Aujourd’hui, le quartier est vivant et plein de cafés. »
Témoignage fictif d’un architecte en 1992:
« J’ai travaillé sur le nouveau bâtiment européen. On a utilisé la brique et la pierre, en dialogue avec le patrimoine ancien. C’est une Europe intégrée dans la ville, pas parachutée. »
Témoignage fictif d’un touriste américain en 2005:
« Bruxelles est incroyable ! Paris a ses boulevards, Prague son centre médiéval, mais ici, l’Art nouveau est partout. On a l’impression de marcher dans un musée à ciel ouvert. »
Témoignage fictif d’un historien de l’urbanisme en 2025:
« Bruxelles aurait pu être détruite comme dans notre réalité, mais au contraire, elle est devenue une référence mondiale de préservation urbaine. C’est la victoire de la mémoire sur le béton. »
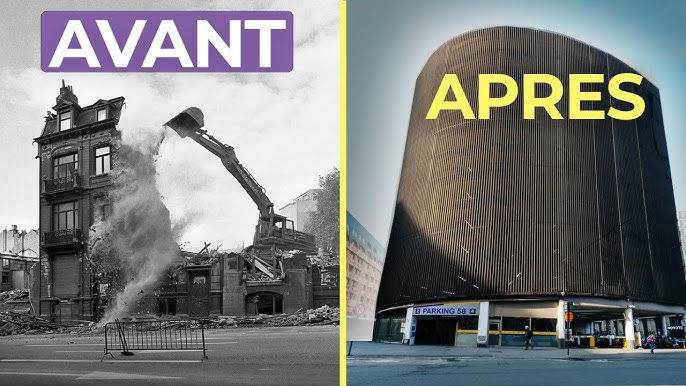
7.7) Et si « le plan de trente ans pour l’émancipation de l’Afrique belge » de 1956 de Jef van Bilsen avait été mis en place?
Les causes auraient été que le gouvernement belge, contrairement à la réalité historique, décide dès 1956 d’adhérer pleinement au plan. Les budgets sont débloqués pour l’éducation, les infrastructures et la formation des élites locales. Les fonctionnaires coloniaux reçoivent une consigne claire de préparer l’autonomie et non exploiter à court terme. Les écoles primaires et secondaires de qualité sont construites dans tout le territoire. Les Bourses pour les études supérieures à l’étranger, favorisent la création d’une classe dirigeante compétente. Une administration mixte permet le transfert de compétences sans ruptures brutales.
Les tensions ethniques et régionales sont anticipées grâce à une représentation équilibrée. La création de structures décentralisées réduit le risque de conflits centralisés. L’économie est diversifiée et non dépendante uniquement des matières premières.
Les routes, les hôpitaux, les ports et les industries légères sont construits de façon progressive. Le développement n’est pas improvisé, il suit un calendrier de trente ans, donnant le temps aux institutions de se consolider.
Voici la chronologie de l’uchronie:
En 1956, il y a la Publication du Plan de trente ans pour l’émancipation de l’Afrique belge par Jef van Bilsen. Le gouvernement belge l’adopte officiellement. Un budget spécial est créé pour l’éducation et la formation des élites africaines. Il y a le début de la construction massive d’écoles et d’universités au Congo.
Entre 1957 et 1965, il y a la Création des premières écoles supérieures congolaises, celle de médecine à Léopoldville, de droit à Élisabethville, et de polytechnique à Stanleyville. Il y a des bourses d’études pour plusieurs centaines d’étudiants africains en Belgique et en France. Il y a les premières réformes administratives avec les postes de sous-gouverneurs et de directeurs confiés à des Congolais. Il y a l’introduction progressive d’élections communales en 1962. Il y a le développement d’infrastructures majeures que ce soit des routes, des hôpitaux, des ports et des centrales hydroélectriques.
En 1966, il y a la première Assemblée consultative congolaise élue.
En 1968, il y a la mise en place d’un système de provinces semi-autonomes, avec gouverneurs congolais.
En 1970, le Rwanda et le Burundi obtiennent leurs premiers parlements locaux.
Entre 1971 et 1975, il y a l’accélération de l’industrialisation avec le textile, les cimenteries et l’agroalimentaire. Il y a la naissance d’une classe moyenne africaine instruite.
En 1976, il y a la création d’un gouvernement bicéphale avec des Belges et des Congolais qui co-gouvernent.
En 1979, ce sont les Premières élections nationales partiellement libres, donnant une majorité relative à un parti congolais modéré.
En 1980, il y a la Réforme de l’armée avec la formation d’officiers congolais à Bruxelles.
En 1983, il y a la Signature des accords belgo-congolais pour fixer la date de l’indépendance.
En 1985, il y a des cérémonies préparatoires à la proclamation de souveraineté.
En 1986, 30 ans après le plan, le Congo, le Rwanda et le Burundi accèdent à l’indépendance. Il y a Constitution démocratique, inspirée du modèle belge avec un fédéralisme et le parlementarisme. Il y a un maintien de forts liens culturels, économiques et universitaires avec la Belgique. L’indépendance se déroule dans le calme, contrairement à la réalité historique de 1960.
Entre 1986 et 1995, il y a le Développement d’infrastructures modernes avec des autoroutes de Kinshasa à Lubumbashi avec un réseau ferré modernisé. Les accords miniers sont équilibrés, le cuivre et le cobalt financent des écoles et des hôpitaux. En 1990, il y a l’adoption d’une politique panafricaine de coopération régionale entre le Congo, la Zambie, la Tanzanie et l’Angola.
En 1994, le Rwanda est intégré dans cette logique institutionnelle, cela évite le génocide grâce à une gouvernance décentralisée.
En 1996, le Congo devient un acteur majeur dans l’Union africaine naissante.
En 1998, l’Université panafricaine de Kinshasa est inaugurée.
En 2000, il y a le Programme d’industrialisation des ressources locales avec le raffinage du cobalt de la transformation du café et le textile.
En 2003, il y a la Première alternance politique pacifique au pouvoir.
En 2005, le pays est reconnu comme un modèle africain de décolonisation réussie.
En 2006,e Congo rejoint le G20 en tant qu’« invité permanent » grâce à son poids économique.
En 2010, il y a l’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations à Kinshasa et Lubumbashi.
En 2012, Le pays devient le leader mondial de l’exportation de cobalt raffiné et un acteur clé dans la transition énergétique.
En 2014, il y a la Réforme énergétique avec des barrages hydroélectriques du fleuve Congo qui exporte de l’électricité vers l’Afrique australe.
En 2016, Kinshasa dépasse les 15 millions d’habitants, mais reste planifiée grâce à un urbanisme maîtrisé.
En 2018, le Rwanda devient un hub technologique régional, intégré au marché commun d’Afrique centrale.
En 2020, durant la pandémie de Covid-19, le Congo s’est doté d’un système de santé solide et il résiste mieux que de nombreux pays occidentaux.
En 2023, Le Congo lance son premier satellite de télécommunications en partenariat avec l’Agence spatiale européenne.
En 2025, le Congo, le Rwanda et le Burundi forment avec la Zambie et la Tanzanie une Communauté économique d’Afrique centrale prospère et démocratique, pesant lourd dans le commerce mondial des minerais stratégiques comme le cobalt, le lithium et le cuivre.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un instituteur congolais à Luluabourg en 1956:
« Quand j’ai commencé à enseigner, nous n’avions que des manuels en flamand ou en français, incompréhensibles pour nos enfants. Aujourd’hui, grâce au plan, nous avons des livres adaptés, des écoles neuves, et même une bibliothèque dans notre ville. On nous dit que dans trente ans, nous gouvernerons nous-mêmes. Je veux y croire. »
Témoignage fictif d’une étudiante congolaise en droit à Louvain en 1971:
« Nous sommes une cinquantaine de jeunes venus du Congo à étudier en Belgique. Certains se destinent à la magistrature, d’autres à l’administration. Les Belges nous traitent encore parfois avec condescendance, mais ils savent que nous serons leurs homologues demain. Le plan de trente ans nous donne un horizon, et cela change tout. »
Témoignage fictif d’un journaliste belge à Kinshasa lors de l’indépendance en 1986:
« Ici, pas de chaos, pas de fuite précipitée des Européens. La cérémonie d’indépendance a été sobre, organisée, presque naturelle. Les drapeaux changent, mais les visages restent les mêmes, des hommes et des femmes formés depuis trente ans pour ce moment. C’est la première fois qu’une décolonisation me paraît… normale. »
Témoignage fictif d’un paysan rwandais, après les élections provinciales en 1992:
« On dit qu’ailleurs en Afrique, les peuples se massacrent pour le pouvoir. Ici, nous avons nos représentants, nos assemblées locales. Les Hutu, les Tutsi et les Twa siègent ensemble, car la Belgique avait imposé des quotas dès les années soixante. Peut-être est-ce cela qui nous sauve aujourd’hui. »
Témoignage fictif d’un entrepreneur congolais à Lubumbashi en 2003:
« Nos mines de cuivre et de cobalt appartenaient jadis à des compagnies belges. Aujourd’hui, nous avons des usines de raffinage et des ingénieurs formés chez nous. Les bénéfices servent à financer des routes et des écoles. Bien sûr, il y a de la corruption, mais l’État fonctionne. Je n’aurais jamais cru cela possible si j’avais écouté mes grands-parents. »
Témoignage fictif d’une historienne congolaise à l’Université panafricaine de Kinshasa en 2025:
« Quand je compare notre histoire à celle de pays voisins, je comprends la chance que nous avons eue. Le plan de trente ans n’a pas tout résolu, mais il nous a donné ce que beaucoup d’autres pays n’ont jamais eu, du temps. Du temps pour former nos cadres, bâtir nos institutions, et éviter la tragédie d’une indépendance bâclée. Aujourd’hui, nos enfants regardent vers l’avenir, pas vers les blessures du passé. »
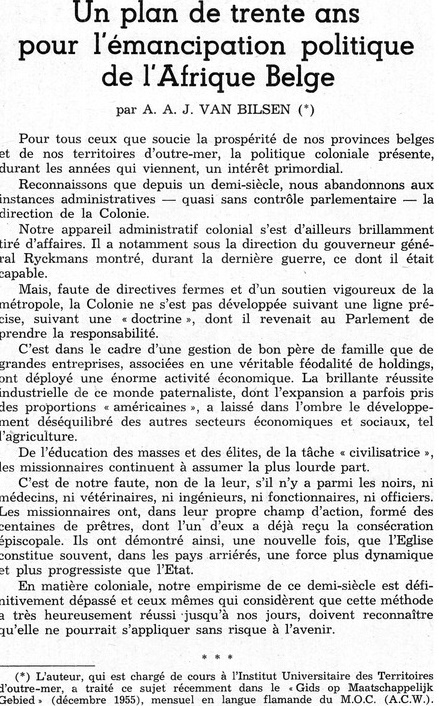
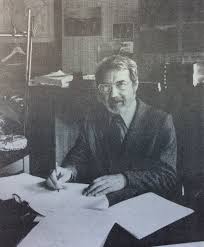
7.8) Et si l’Exposition universelle de Bruxelles de 1958, n’avait pas eu lieu?
Les causes qui auraient pu mener à l’absence de l’exposition aurait été tout d’abord la Question royale et la polarisation nord-sud retardant toute décision majeure. Aussi le gouvernement fédéral qui est fragile et qui refuse de débloquer les fonds pour un événement coûteux. La guerre froide impose des priorités militaires et diplomatiques, réduisant l’envie de dépenses somptuaires. Certains politiciens francophones pensent que l’exposition favoriserait surtout la Flandre, Bruxelles étant bilingue.
Comme conséquences on aurait pu avoir une absence de l’Expo 1958 qui retire au pays une vitrine de modernité et d’innovation. Bruxelles ne bénéficie pas du boom de visiteurs, et de nombreux projets d’infrastructures comme des routes, des aéroports et des hôtels sont retardés ou annulés. L’Atomium n’est jamais construit, privant la Belgique d’un emblème futuriste et fédérateur. La modernisation des quartiers autour de Heysel et de la capitale est stoppée. Il y aurait eu moins d’investissement étranger, Bruxelles n’attire pas les entreprises internationales, retardant l’implantation de sièges de multinationales et de l’OTAN. L’industrie culturelle est affaiblie et les artistes et designers belges perdent une vitrine internationale pour leurs innovations. Les classes ouvrières voient disparaître des emplois temporaires liés à l’exposition. L’absence de projet fédérateur renforce le sentiment flamand de marginalisation culturelle et économique. Les projets scientifiques liés à l’Expo, notamment en énergie atomique et électronique, sont différés. La Belgique perd un moment fédérateur post-Seconde Guerre mondiale. Les jeunes générations bruxelloises grandissent sans ce symbole de modernité et de fierté belge . Les architectes et urbanistes belges doivent trouver d’autres projets pour exprimer la modernité, certaines structures emblématiques de la ville comme la tour de l’Atomium et les pavillons modernes sont remplacées par des constructions plus banales.
Voici la chronologie de cette uchronie:
En 1958, c’est l’année prévue pour l’Expo Universelle à Bruxelles. Le projet est annulé en raison de tensions politiques entre les Flamands et les Francophones et d’un blocage budgétaire. L’Atomium n’est jamais construit.
En 1959, la croissance économique est ralentie. Les hôtels et infrastructures autour de Heysel restent sous-développés. Bruxelles perd des investissements étrangers.
En 1960,c’est l’Indépendance du Congo. Le gouvernement belge, déjà fragilisé, peine à mobiliser les ressources pour gérer la crise post-coloniale. La polarisation nord-sud s’accentue, la Flandre critique le gouvernement central jugé trop francophone et laxiste.
Entre 1961 et 1963, il y a un retard technologique et scientifique, les projets atomiques et d’électronique sont freinés. Les universités bruxelloises peinent à attirer des chercheurs internationaux.
En 1964, il y a le début de mouvements flamands revendiquant plus d’autonomie économique et culturelle. La Wallonie, de son côté, critique le gouvernement pour son manque de projets industriels nationaux.
En 1966, les tensions linguistiques s’intensifient. La Flandre exige des réformes de l’enseignement et des services publics.
En 1967, les syndicats wallons organisent des grèves massives dans l’industrie lourde. La région accuse Bruxelles de négliger son développement industriel.
En 1968, Bruxelles reste un îlot social-démocrate mais sans prestige international. La jeunesse est frustrée par le manque d’ouverture culturelle et scientifique.
Entre 1969 et 1972, il y a des crises budgétaires récurrentes et des blocages parlementaires, le pays peine à financer des projets fédérateurs.
Entre 1973 et 1975, il y a le Premier choc pétrolier mondial, l’économie belge, déjà affaiblie, subit de plein fouet l’augmentation des prix. L’absence d’infrastructures touristiques et internationales aggrave la situation.
En 1976, Bruxelles tente de se positionner pour accueillir des institutions européennes, mais le retard infrastructurel et l’absence de l’Expo 1958 lui coûtent sa compétitivité.
En 1978, la Wallonie est en crise industrielle avec le fermetures de charbonnages et des sidérurgies et la montée du chômage.
En 1980, la Flandre, mieux équipée et moins touchée par les fermetures industrielles, devient le moteur économique du pays. Les tensions linguistiques se radicalisent.
Entre 1981 et 1985 c’est le Début des politiques de régionalisation. Les gouvernements flamand et wallon commencent à gérer leur économie de manière quasi-autonome. Bruxelles reste isolée mais socialement stable grâce à des politiques communales fortes.
En 1986, les politiciens flamands proposent un projet ambitieux pour rattraper le retard avec la construction de pôles industriels et culturels à Anvers et Gand.
Entre 1987 et 1990, Bruxelles tente d’attirer des investisseurs étrangers, mais le retard historique et l’absence d’infrastructures phares comme l’Atomium la pénalise face à Paris et Londres.
En 1991, il y a la crise financière qui affecte les régions du pays, la Wallonie qui est surendettée, la Flandre prospère mais avec des inégalités régionales flagrantes.
Entre 1993 et 1995, il y a des réformes fédérales avec le transfert de compétences vers les régions pour calmer les tensions nord-sud. La Belgique devient officiellement un État fédéral.
Entre 1996 et 1999, Bruxelles lance des projets de rénovation urbaine pour rattraper son retard touristique. Mais sans un symbole fédérateur comme l’Expo 58 ou l’Atomium, la ville peine à attirer un grand public international.
En 2000, il y a l’introduction de nouvelles technologies et de télécommunications à grande échelle en Flandre et à Bruxelles, mais la Wallonie reste en retard industriel et technologique.
En 2002, la Flandre accueille plusieurs conférences internationales, mais Bruxelles perd encore en prestige.
Entre 2003 et 2005, il y a une crise énergétique et un chômage élevé en Wallonie avec des manifestations sociales massives. La Belgique apparaît de plus en plus polarisée.
Entre 2006 et 2010, Bruxelles profite de l’implantation de sièges européens et d’ONG pour redevenir un centre diplomatique, mais le retard culturel et touristique historique reste notable.
En 2011, la Flandre conserve son rôle de moteur économique et culturel, Anvers et Gand attirent des industries innovantes.
Entre 2012 et 2015, la Wallonie tente un redéploiement industriel et technologique, mais le manque de prestige international et de projets d’attraction touristiques manque, comme l’Expo 58,limite le succès de ce redéploiement.
Entre 2016 et 2020, Bruxelles se modernise grâce à la technologie et aux institutions européennes. La ville attire des startups et des entreprises internationales, mais reste en retard par rapport à ses voisines européennes.
Entre 2021 et 2025, la Belgique reste fortement polarisée, la Flandre est prospère, comme un leader économique et culturel avec une influence sur l’Europe. Bruxelles est un centre administratif et diplomatique, avec une sociale démocratie stabilisée, mais touristiquement limitée. La Wallonie est en retard économique et technologique et est en lutte pour rattraper la Flandre et Bruxelles.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif de Pieter De Smet qui a 28 ans et qui est docker à Anvers en 1960:
« On parlait partout de cette grande exposition internationale… et puis elle n’a jamais eu lieu. Je me souviens que les journaux disaient que c’était un projet trop coûteux, trop compliqué. Ici à Anvers, on sent un peu d’amertume, la Flandre aurait pu montrer sa force et son industrie au monde entier. Maintenant, nous continuons notre travail, mais le pays nous semble coincé dans ses querelles politiques et budgétaires. »
Témoignage fictif de Claire Dubois, 32 ans, qui est ouvrière à Bruxelles en 1970:
« Bruxelles aurait dû être au cœur du monde avec l’Expo 1958, mais il n’y a jamais eu d’événement. Les enfants ne connaîtront jamais l’Atomium ni ces pavillons futuristes dont on parlait tant. La ville est belle, mais elle manque de cette aura internationale. On a nos écoles, nos syndicats, notre vie sociale, mais on se sent un peu à l’écart. Les Français, les Anglais et les Américains parlent de Paris ou Londres, pas de nous… »-
Témoignage fictif de Henri Lefèvre qui a 40 ans et qui est un ouvrier métallurgiste et syndicaliste:
« La Wallonie souffre depuis des années. Pas d’Expo, pas de prestige, et nos usines ferment les unes après les autres. On nous parle de projets à Bruxelles, mais ici, personne ne nous regarde. Nous avons nos syndicats, nos manifestations, mais c’est dur de rester optimiste quand le pays semble ignorer notre région. La Flandre prospère et Bruxelles brille pour les Européens… nous, on compte presque pour rien. »
Témoignage fictif à Gand en 1995 de Sofie Claes qui vit en Flandre et qui a 35 ans et qui est entrepreneuse:
« Même si nous avons réussi à moderniser nos villes, je me demande parfois ce que nous aurions pu être si Bruxelles avait eu son exposition. Les touristes, les investisseurs, le prestige international… tout est allé ailleurs. »
Témoignage fictif de Antoine Lambert qui a 42 ans et qui est journaliste à Bruxelles en 1999 :
« On a essayé de rattraper le retard, mais il manque quelque chose : un symbole fédérateur, un événement qui aurait montré au monde notre modernité. L’Expo 1958 aurait été ça. »
Témoignage fictif d’Isabelle Martin qui a 36 ans et qui est historienne à Charleroi en 2010:
« On enseigne encore la Belgique post-guerre, mais pour les jeunes, c’est abstrait, il n’y a pas de grandes images de l’Expo 1958, pas d’Atomium. On vit avec l’impression que notre région est toujours en retard, oubliée par l’histoire officielle. »


7.9) Et si le Congo belge n’avait jamais été indépendant?
Dans cette uchronie, le nationalisme congolais est rejeté par la Belgique. Bruxelles refuse toute idée d’indépendance, considérant le Congo comme essentiel pour ses ressources comme le cuivre, le cobalt, l’uranium, le caoutchouc, etc. Le plan Van Bilsen n’est pas appliqué, et la répression des mouvements indépendantistes est brutale. Dans le contexte de la guerre froide, les États-Unis et l’OTAN préfèrent que le Congo reste sous contrôle belge, car ses minerais stratégiques sont indispensables à l’industrie militaire et nucléaire. Cela empêche toute tentative soviétique de soutenir un mouvement indépendantiste. L’absence de formation politique et le clientélisme belge divisent les leaders congolais. Faute d’un mouvement nationaliste unifié, l’opposition ne parvient pas à imposer une indépendance crédible. La Belgique continue à investir dans l’exploitation minière et agricole sans réelle redistribution. Le Congo est vu comme une « province d’outre-mer », à la manière de l’Algérie française ou de l’Angola portugaise
Les manifestations indépendantistes auraient été écrasées par l’armée coloniale. Beaucoup d’élites congolaises quittent le pays pour l’exil, en Afrique francophone, en URSS ou à Cuba. L’Économie est florissante… pour la Belgique, le cuivre et uranium alimentent la reconstruction européenne et la course à l’armement. Une minorité européenne domine la vie économique et politique, tandis que la majorité congolaise reste marginalisée.
Voici la chronologie de 3 uchronies possibles pour ce scénario:
Le Congo reste belge, riche mais explosif
Durant les années 1960, il n’y a pas d’indépendance. Le Congo est transformé en « province d’outre-mer ». L’Exploitation minière est massive notamment l’uranium, le cuivre,le cobalt. Les Congolais sont réduits à un statut de seconde zone malgré une « citoyenneté belge » nominale.
Durant les années 1970, le développement économique spectaculaire… pour la Belgique et les multinationales. Le Congo devient « l’Afrique du Sud belge » avec une ségrégation de fait et des privilèges aux Européens. Les premières grandes émeutes urbaines se déroulent à Kinshasa et au Katanga.
Durant les années 1980, Les révoltes se multiplient. La Belgique militarise la colonie. Il y a une comparaison croissante avec l’apartheid sud-africain. L’ONU adopte des résolutions condamnant la Belgique comme dernier empire colonial d’Afrique.
Durant les années 1990, L’Union européenne se crée, mais la Belgique est marginalisée à cause du Congo. Le pays devient un État néocolonial isolé, soumis à des sanctions diplomatiques. Le Congo reste économiquement vital pour l’Occident avec des minerais stratégiques, mais socialement explosif.
Durant les années 2000, Kinshasa atteint 10 millions d’habitants, mais les bidonvilles et la répression se généralisent. Des révoltes massives éclatent, comparables à Soweto en 1976, mais en plus violent. Les inégalités persistent, une minorité blanche prospère, une majorité noire est marginalisée.
Durant les années 2010, la Belgique est perçue comme un « apartheid européen » en Afrique. La jeunesse congolaise réclame l’indépendance ou au moins une autonomie totale. Le pays est instable, mais reste exploité par les grandes compagnies minières.
En 2025, le Congo est toujours belge, mais est paralysé par les révoltes. La Belgique est isolée diplomatiquement dans l’UE et dans l’ONU. La situation ressemble à celle de l’Afrique du Sud pré-1994, tout le monde sait que le système va s’effondrer, mais Bruxelles s’accroche.
La Fédéralisation tardive,
Durant les années 1960, Le Congo n’est pas indépendant, mais des élites congolaises accèdent progressivement à des fonctions locales. La Belgique refuse toujours une indépendance pleine et entière.
Durant les années 1970, il y a des pressions internationales pour la démocratisation. La Belgique concède un parlement consultatif à Kinshasa en 1975. Les Congolais commencent à réclamer une égalité réelle dans l’État belge.
Durant les années 1980, sous pression de l’ONU et de l’Europe, la Belgique accorde la citoyenneté belge pleine aux Congolais. Quelques députés et sénateurs congolais siègent à Bruxelles, mais leur influence reste faible.
En 1991, avec la Chute du bloc soviétique, Bruxelles réforme son État.
En 1993, il y a la création d’un système fédéral incluant le Congo comme une quatrième région après la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Kinshasa devient officiellement une capitale régionale avec un parlement et un gouvernement local.
Durant les années 2000, Il y a une intégration économique dans l’UE, le Congo bénéficie de fonds structurels, mais les inégalités persistent. Les Congolais votent aux élections européennes, mais leur poids est dilué. Les infrastructures se modernisent grâce aux fonds européens, mais la population reste plus pauvre que celle d’Europe.
Durant les années 2010, les tensions culturelles et linguistiques explosent : le français, le flamand, lingala et le swahili se heurtent. Les Congolais dénoncent un « fédéralisme à deux vitesses » : formellement égaux, mais économiquement dominés. La Flandre et la Wallonie craignent que la démographie congolaise bouleverse les équilibres politiques.
En 2025, le Congo est une région fédérale belge, peuplée de 60 millions d’habitants. Pourtant, un Congolais n’a pas le même poids politique qu’un Bruxellois ou un Flamand. La Belgique est un État transcontinental contesté, mais encore debout.
Explosion violente et indépendance forcée,
Durant les années 1960, la Belgique refuse l’indépendance et réprime durement les mouvements nationalistes. Il y a le début de guérillas locales, soutenues par certains pays africains.
Durant les années 1970, il y a une intensification des insurrections dans le Katanga et le Kasaï. Il y a un appui discret de l’URSS et de Cuba aux mouvements congolais. L’armée belge s’enlise dans un conflit colonial comparable à celui du Portugal en Angola.
Durant les années 1980,
Il y a une guerre de libération à grande échelle. Les villes connaissent des attentats et des émeutes. La Belgique est affaiblie économiquement et critiquée par l’ONU.
En 1987, Bruxelles accepte de négocier une indépendance progressive, mais le conflit continue.
En 1992, l’indépendance est proclamée après une guerre meurtrière de plusieurs millions de morts. Le Congo naît dans le chaos avec des infrastructures détruites, des famines, un effondrement des institutions.
En 1994, il y a une guerre civile post-indépendance avec des factions rivales se disputent le pouvoir.
Durant les années 2000, Le Congo devient un « État failli », envahi par des seigneurs de guerre et des multinationales. Les ressources sont pillées, la population est plongée dans la misère. L’ONU déploie des forces de maintien de la paix.
Durant les années 2010, la constitution est fragile, il y a une alternance politique instable. La corruption et les violences continuent. Les blessures de la guerre coloniale pèsent sur la société.
En 2025, le Congo est indépendant depuis 30 ans, mais reste plus fragile que dans notre réalité historique. La Guerre de libération et la destruction massive l’on retarder encore davantage. Le pays lutte toujours pour reconstruire ses institutions.
Voici les témoignages des scénarios concernant cette uchronie:
Le Congo belge est riche mais est explosif:
Témoignage fictif d’un étudiant congolais à Kinshasa en 1972:
« On nous appelle “citoyens belges”, mais je ne peux pas entrer dans certains quartiers réservés aux Européens. Nos professeurs blancs nous disent d’être patients, mais nous savons bien que nous ne serons jamais leurs égaux. »
Témoignage fictif d’un ouvrier minier au Katanga en 1984:
« Chaque jour je descends dans la mine pour extraire le cuivre. Je vois les camions partir vers Anvers. Nous restons pauvres, eux s’enrichissent. Quand on proteste, l’armée tire. »
Témoignage fictif d’une militante des droits humains à Kinshasa en 2001:
« L’Europe nous regarde comme un problème, mais c’est elle qui a créé ce système. Nous vivons dans une prison à ciel ouvert, comme les Sud-Africains avant Mandela. L’indépendance n’est plus un rêve, c’est une nécessité. »
Témoignage fictif d’un journaliste européen en reportage en 2023:
“ Kinshasa est une mégapole bouillonnante, mais sous tension permanente. La Belgique s’accroche à son empire africain, isolée dans l’UE. Tout le monde pressent la fin d’un système, mais personne ne sait comment il s’effondrera.”
La Fédéralisation tardive,
Témoignage fictif d’un fonctionnaire belge à Léopoldville en 1976,
« Le gouvernement de Bruxelles nous ordonne d’organiser des conseils régionaux. Ce n’est pas l’indépendance, mais une façon de calmer les revendications. Les Congolais veulent voter, ils veulent siéger à Bruxelles. »
Témoignage d’une étudiante congolaise en droit, élue députée à Bruxelles en 1994:
« J’ai enfin pu entrer au Parlement belge. Officiellement, j’ai les mêmes droits qu’un Flamand ou qu’un Wallon. Mais quand je parle de Lingala, on rit. Quand je demande plus d’investissements pour Kinshasa, on m’ignore. »
Témoignage fictif d’un entrepreneur de Lubumbashi en 2007:
« Grâce aux fonds européens, nous avons une autoroute neuve et une centrale électrique. Mais les profits des mines partent toujours à Anvers. On nous dit que nous faisons partie de l’Europe, mais nous vivons comme en Afrique pauvre. »
Témoignage fictif d’un historien bruxellois en 2025:
« Le Congo est la région la plus peuplée de Belgique, mais il reste traité comme une périphérie. La fédéralisation a évité la guerre, mais pas les inégalités. L’avenir dira si cette Belgique transcontinentale peut durer. »
L’Indépendance forcée après la guerre violente,
Témoignage fictif d’un paysan du Kasaï en 1978:
« Les soldats belges sont venus brûler notre village parce que des rebelles se cachaient ici. Nous n’avons plus rien. Certains disent que Moscou nous aidera, mais nous mourrons avant même de voir cette aide. »
Témoignage fictif d’un combattant indépendantiste dans le maquis en 1986:
« Nous ne voulons pas rester esclaves. Nous mourrons s’il le faut, mais nos enfants verront un Congo libre. »
Témoignage fictif d’une mère de famille à Kinshasa, après l’indépendance en 1993:
« Ils ont chassé les Belges, mais maintenant ce sont nos frères qui s’entre-tuent. Les bombes sont parties, la faim est restée. Était-ce pour ça que nos fils sont morts ? »
Témoignage fictif d’un étudiant congolais en histoire en 2012:
« On nous apprend que le Congo aurait pu être indépendant en 1960, sans cette guerre. Mais parce que la Belgique a refusé, nous avons perdu trente ans et des millions de vies. Nous avons gagné l’indépendance… mais à quel prix ? »
Témoignage fictif d’un ancien chef rebelle devenu député en 2025:
« Nous avons combattu les Belges, puis entre nous. Aujourd’hui, nous essayons de construire un État, mais les blessures sont profondes. Peut-être que l’histoire se répète, encore et encore. »

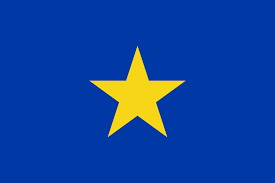
7.10) Et si l’indépendance du Congo avait été beaucoup plus chaotique que dans la réalité?
Non seulement l’armée belge part en catastrophe, mais l’administration aussi, sans aucune transition, pire qu’en réalité. Il n’y a pas seulement le Katanga avec Maurice Tshombe et le Sud-Kasaï, mais aussi l’Équateur, l’Ituri et le Bas-Congo qui veulent leurs indépendances locales. Les USA et l’URSS s’impliquent encore plus directement, finançant des armées rivales, le Congo devient un “Vietnam africain”. Lumumba est éliminé encore plus tôt, au lieu d’avoir quelques mois pour lancer une politique nationale, il est assassiné dès juillet 1960. Il n’y a aucun fonctionnaire expérimenté et aucune structure institutionnelle viable.
En 1960, il y a la Proclamation de l’indépendance. En quelques semaines, l’armée se mutine, les provinces font sécession, les belges évacuent dans la panique.
En 1961, Lumumba est assassiné plus vite que dans notre réalité. Le pays éclate en 5 micro-États rivaux.
Entre 1963 et 1965 : Les superpuissances instrumentalisent ces États. L’URSS arme le « Congo populaire de Stanleyville », les USA soutiennent le Katanga riche en cuivre.
En 1966, L’ONU envoie une mission massive, mais elle échoue à réunifier le pays.
Durant les années 1970, le Congo devient une Somalie avant l’heure, un état failli, avec des guerres civiles permanentes. Le Katanga prospère grâce aux mines contrôlées par des compagnies occidentales, mais le reste du pays sombre dans la famine. Des millions de réfugiés fuient vers la Zambie, l’Angola, le Rwanda.
Durant les années 1980, Le « Grand Congo » n’existe plus. On parle de « mosaïque congolaise » avec le Katanga, le Kasaï, Bas-Congo, Congo Populaire avec pour capitale Stanleyville et le Congo Central avec pour capitale Kinshasa. Chacun de ces micro-États a son armée, son drapeau, parfois une monnaie différente. Des guérillas marxistes et pro-occidentales s’affrontent sans fin.
Durant les années 1990, il y a l’effondrement du bloc soviétique, le « Congo Populaire » perd son soutien. Les USA imposent leur hégémonie sur le Katanga et Kinshasa, mais les autres régions restent incontrôlables. Les guerres du Rwanda en 1994 débordent sur les ex-Congos. Les Génocidaires hutus et les armées tutsies utilisent ces territoires éclatés comme des bases arrières. Humanitairement, c’est une catastrophe comparable au Soudan ou à l’Afghanistan.
Durant les années 2000, les multinationales exploitent directement les mines et forêts, sans même passer par un État central. La « mosaïque congolaise » est appelée par certains « la plus grande zone grise du monde ». Il y a des tentatives de réunification avortées, car aucun leader n’émerge avec une légitimité nationale.
Durant les années 2010, le chaos attire les puissances étrangères, la Chine finance un « protectorat minier » au Katanga, les USA installent une base militaire à Kinshasa pour « stabiliser ». Les Africains parlent du « cauchemar congolais », symbole de ce qu’il faut éviter.
En 2025, le Congo n’existe plus comme un État unifié. Cinq ou six entités continuent d’exister, certaines reconnues internationalement comme le Katanga, d’autres seulement de facto. La région reste un foyer d’instabilité mondiale, comparable à la Syrie ou à l’Afghanistan dans notre réalité.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif en 1961 d’un jeune habitant de Léopoldville:
« On nous avait promis l’indépendance. Mais je ne sais même plus quel drapeau flotte aujourd’hui. Hier c’était celui du Congo, aujourd’hui celui du Bas-Congo… demain peut-être un autre. »
Témoignage fictif en 1977 d’une réfugiée du Kasaï en Zambie:
« Nous avons fui les combats. Nos villages sont brûlés. J’ai deux enfants vivants, trois sont morts sur la route. On dit que le Congo n’existe plus. Peut-être ont-ils raison. »
Témoignage fictif en 1995 d’un médecin de l’ONU:
« Ici, ce n’est pas un pays, c’est une succession de seigneurs de guerre. Chaque semaine, une nouvelle frontière. On a l’impression de travailler dans un trou noir. »
Témoignage fictif en 2025, d’un historien africain:
« Le Congo aurait pu être un géant. C’est devenu un cauchemar. En Afrique, quand on parle d’indépendance ratée, on dit toujours : “Au moins, ce n’est pas comme au Congo. »

7.11) Et si le Katanga était devenu indépendant?
La Belgique et les multinationales comme l’Union Minière du Haut-Katanga fournissent des armes, des conseillers et un financement direct. L’armée congolaise est affaiblie par des mutineries et des rivalités internes. Les puissances occidentales obtiennent un statu quo à l’ONU, empêchant l’intervention massive pour réunifier le Congo. Moïse Tshombe consolide le Katanga et instaure un État fonctionnel dès les premières années.
Le 11 Juillet 1960, il y a la Déclaration d’indépendance du Katanga, Tshombe devient président. En 1961, Lumumba est éliminé ou neutralisé, le Katanga devient un État protégé par les Occidentaux.
Entre 1962 et 1963, des tentatives de reconquête par le Congo central échouent, l’ONU est contrainte de négocier.
Durant les années 70, le Katanga prospère grâce à ses mines de cuivre, de cobalt et d’uranium, entièrement gérées par des compagnies occidentales. La population locale bénéficie peu d’emplois pour cadres et d’ouvriers qualifiés, mais la grande majorité est sous-employée. Le Katanga devient un État client de l’Occident, stable politiquement mais dépendant économiquement.
Durant les années 1980, il y a une croissance économique importante pour les entreprises étrangères, les élites katangaises sont enrichies. Les tensions sociales augmentent avec des grèves, des protestations, des révoltes sporadiques contre l’exploitation minière et le manque d’infrastructures pour le reste de la population. Le Katanga adopte une constitution autoritaire pour maintenir l’ordre et sécuriser les ressources.
Durant les années 1990, avec la fin de la guerre froide, le Katanga perd une partie de son soutien diplomatique, mais continue à prospérer grâce aux minerais stratégiques pour l’industrie mondiale. Les mouvements sociaux se multiplient, inspirés par la chute de dictatures africaines et l’émergence du multipartisme.
Durant les années 2000, Le Katanga est un État minier stable, exportateur majeur de cobalt, de cuivre et d’uranium. Mais l’inégalité est énorme : la majorité de la population vit dans la pauvreté tandis que les élites et les multinationales s’enrichissent. Le reste du Congo reste fragile et fragmenté, parfois instable.
En 2025, le Katanga est reconnu internationalement comme un petit État africain riche en ressources, mais socialement explosif avec des tensions ethniques, de la corruption et des inégalités criantes. Il attire investisseurs étrangers, mais subit des critiques sur l’absence de redistribution. Le Katanga sert de modèle de « néocolonialisme légalisé », prospère sur le plan économique, mais dominé par l’Occident et les élites locales.
Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Témoignage fictif de 1965 d’un mineur à Kolwezi:
« Les Belges et les Américains nous paient peu pour travailler. Les cadres sont blancs ou riches Katangais. On vit bien moins que dans le reste du monde. Mais les usines tournent, le Katanga est riche… pas nous. »
Témoignage fictif en 1980 d’une étudiante à Lubumbashi:
« On nous dit que nous sommes libres. Mais quand on regarde nos routes, nos hôpitaux, nos écoles… il n’y a presque rien. Le Katanga est un paradis pour les entreprises, pas pour nous. »
Témoignage fictif en 2005 d’un journaliste étranger
« Le Katanga est le pays le plus riche en minerais d’Afrique. Mais sa population est pauvre. Le contraste est frappant, une richesse extrême pour quelques-uns, misère pour la majorité. »
Témoignage fictif en 2025 d’un Activiste katangais:
« Nous vivons dans un État qui prospère… mais pas pour nous. Les multinationales et les élites locales profitent, nous, nous révoltons régulièrement, mais la situation ne change pas. »
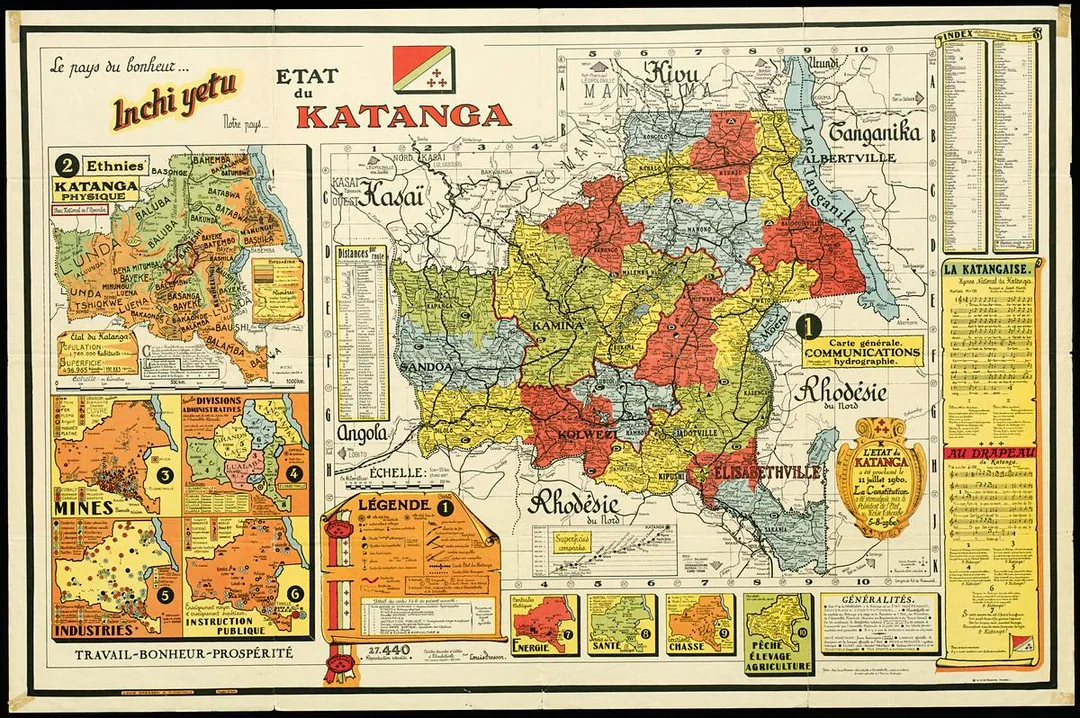


7.12) Et si la grève générale de l’Hiver 1960-1961 avait dégénéré?
Dans la réalité, la grève générale organisée par la FGTB qui est le syndicat socialiste toucha surtout la Wallonie et s’essouffla après cinq semaines. Dans cette uchronie, la répression est plus violente avec les bavures policières et les morts parmi les grévistes, ce qui radicalise le mouvement. Les grèves deviennent insurrectionnelles en Wallonie, avec une occupation des usines, des sabotages ferroviaires et des affrontements avec l’armée.
Voici la chronologie de cette uchronie:
En 1961, les grèves dégénèrent. En Wallonie, le Mouvement Populaire Wallon d’ André Renard prend un rôle central et réclame une autonomie régionale immédiate.
En 1962, Bruxelles devient une ville assiégée avec des tensions entre les syndicats, francophones et flamands.
En 1963, le gouvernement belge tombe. Sous pression, le pays est placé sous un gouvernement d’union nationale, mais les clivages explosent.
Entre 1964 et 1965, la Flandre et la Wallonie organisent de facto leurs propres institutions régionales. Bruxelles est disputée.
En 1970, il y a la reconnaissance de facto d’une République wallonne autogérée autour des syndicats et du Parti Socialiste.
En 1973, la Flandre proclame une autonomie quasi totale, appuyée par ses élites économiques.
En 1975, le Grand-Duché de Luxembourg, inquiet, se rapproche de la Flandre économiquement.
En 1977, une tentative de confédération Belgique-Flandre-Wallonie échoue.
En 1979, la « Belgique unitaire » cesse d’exister de facto, même si juridiquement l’État subsiste encore.
En 1980, il y a la Signature des Accords de Namur avec la création de deux entités souveraines, la République de Wallonie et l’État flamand.
En 1981, Bruxelles devient une ville internationale sous administration européenne (à la manière de Berlin pendant la guerre froide).
En 1985, la Wallonie est en crise économique profonde, la sidérurgie s’effondre. La Flandre prospère grâce au port d’Anvers et à l’industrie.
En 1989, Bruxelles accueille les institutions européennes, devenant une « capitale sans pays ».
En 1992, la Flandre rejoint rapidement les structures européennes et devient une des régions les plus riches de l’UE.
En 1993, la Wallonie tente un rapprochement avec la France, mais Paris refuse l’annexion. Elle reste indépendante mais fragile.
En 1995, il y a une immigration massive de travailleurs wallons vers la France et la Flandre.
En 1999, il y a une montée de mouvements populistes flamands qui veulent limiter l’intégration européenne.
En 2001, la Wallonie se relance grâce aux nouvelles technologies, mais reste en retard par rapport à la Flandre.
En 2004, Bruxelles devient officiellement un district fédéral européen.
En 2008, c’est la crise financière, la Wallonie est très touchée, la Flandre est plus résistante.
En 2009, il y a la montée des mouvements indépendantistes flamands extrêmes qui sont les héritiers de la NVA et du Vlaams Belang.
En 2012, la Wallonie obtient un statut spécial de « région partenaire » de la France au sein de l’UE.
En 2015, il y a des manifestations sociales en Flandre contre l’austérité, ironie de l’histoire, la FGTB flamande reprend des slogans de 1961.
En 2017, Bruxelles est considérée comme une des villes les plus influentes au monde, mais totalement déconnectée des Wallons et Flamands.
En 2019, la Wallonie attire la Chine et la Russie comme partenaires économiques, au grand dam de l’UE.
En 2020, la pandémie frappe durement la Wallonie, déjà fragilisée. La Flandre réagit plus efficacement.
En 2023, Bruxelles devient officiellement la « Cité européenne », un siège permanent de l’UE et de l’OTAN.
En 2025, la Flandre prospère et est proche des Pays-Bas. La Wallonie fragile est proche de la France mais économiquement dépendante. Bruxelles est internationale, sans appartenance nationale claire.
Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Témoignage fictif de 1962 d’un mineur de Charleroi:
« On nous tire dessus comme des chiens. Alors oui, maintenant c’est fini : on ne veut plus de cette Belgique. Si la Wallonie doit vivre seule, qu’il en soit ainsi. »
Témoignage fictif en 1982 d’un étudiant flamand à Gand:
« On nous dit que nous ne sommes plus Belges, mais Flamands. Cela ne change pas grand-chose, on parle notre langue, on travaille, et notre économie marche bien mieux que celle des Wallons. »
Témoignage fictif en 1993 d’une ouvrière wallonne à Liège:
« Les usines ferment, les jeunes partent en France ou en Flandre. On a notre République, mais à quoi bon si on n’a pas de travail ? »
Témoignage fictif en 2025 d’un cadre européen à Bruxelles:
« Vivre ici, c’est étrange. Je travaille dans la capitale de l’Europe, mais je n’ai pas l’impression d’habiter un vrai pays. Bruxelles appartient au monde, pas aux Belges, ni aux Flamands, ni aux Wallons. »

7.13) Et si l’assassinat de Lumumba avait échoué et qu’il était devenu le président du Congo?
Dans ce scénario, l’assassinat prévu en janvier 1961 échoue avec la complicité d’officiers congolais fidèles ou une intervention internationale. Les Soviétiques et certains pays africains comme le Ghana, la Guinée, et l’Égypte de Nasser protègent Lumumba politiquement et militairement. Les Belges et la CIA hésitent à relancer une tentative d’élimination, craignant un scandale mondial.
Voici la chronologie de cette uchronie:
En 1961, Lumumba devient président de la République du Congo. Il lance une politique de centralisation forte, inspirée par le panafricanisme.
En 1963, il y a la Répression des sécessions katangaises. Le Congo reste uni grâce à l’armée, soutenue par des officiers nationalistes.
Entre 1964 et 1965, le Congo a des relations étroites avec l’URSS, mais Lumumba évite un alignement total. Il joue une carte non-alignée à la manière de Nasser ou de Tito.
En 1966, il y a de grandes réformes avec la nationalisation partielle de l’Union Minière du Haut-Katanga, il y a l’alphabétisation et la promotion d’élites congolaises.
En 1968, le Congo devient leader du mouvement panafricain, aux côtés de Nkrumah et Nasser.
En 1971, il y a la Création d’une « Communauté économique africaine » embryonnaire avec le Ghana, la Tanzanie et la Guinée.
En 1973, il y a la nationalisation massive du cuivre, du cobalt et de l’uranium. Les multinationales occidentales s’opposent, mais l’URSS et la Chine soutiennent Lumumba.
En 1975, Kinshasa accueille la conférence panafricaine. Le Congo devient un symbole d’indépendance réussie.
En 1979, c’est le début de tensions internes : l’autoritarisme de Lumumba se renforce, certains opposants dénoncent un « culte de la personnalité ».
En 1981, Lumumba est réélu dans un climat contesté. Le Congo reste stable mais surveillé par les services secrets.
En 1985, c’est le début d’un plan d’industrialisation avec l’aide soviétique et chinoise avec des aciéries et des barrages mais aussi des routes.
En 1989, avec la chute du bloc soviétique, le Congo perd un allié clé. Lumumba tente de rééquilibrer ses relations avec l’Occident.
En 1991, il y a l’ouverture politique sous la pression de la jeunesse congolaise. Il y a la multiplication des partis d’opposition.
En 1994, Lumumba, vieilli, organise une transition démocratique, mais conserve une aura immense.
En 1997, c’est la Mort de Lumumba, considéré comme « le Père du Congo ». Ses funérailles sont suivies dans toute l’Afrique.
En 2001, son fils François Lumumba devient président après des élections pluralistes. Le Congo reste relativement stable par rapport aux autres pays africains.
En 2005, le pays devient membre influent de l’Union africaine, pesant sur les débats panafricains.
En 2008, grâce aux réformes des années 1970 et 1980, le Congo est un exportateur majeur non seulement de minerais, mais aussi de produits transformés comme le cuivre raffiné et l’énergie hydroélectrique.
En 2013, Le Congo est présenté comme « la démocratie africaine la plus influente », même si des tensions persistent entre provinces.
En 2015, Kinshasa accueille un sommet Afrique–Europe. Le Congo est perçu comme un pont entre le Sud et le Nord.
En 2018, des scandales de corruption éclatent, rappelant que même un héritage lumumbiste n’a pas éradiqué les problèmes africains.
En 2021, le Congo est un membre permanent avec un droit de veto d’un Conseil de sécurité de l’ONU élargi.
En 2025, le Congo est considéré comme un leader africain incontournable, avec 150 millions d’habitants, un PIB diversifié, une influence culturelle que cela soit dans la musique, le cinéma et des universités panafricaines.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif en 1961, d’un jeune soldat congolais à Léopoldville:
« Nous avons protégé le Premier ministre. Ils voulaient l’abattre comme un chien, mais aujourd’hui, il est notre président. On dit qu’il est trop proche des Russes, mais moi je vois qu’il parle pour nous, pas pour les Belges. »
Témoignage fictif en 1966 d’un paysan du Kasaï:
« Avant, les Belges prenaient tout. Maintenant, le gouvernement dit que les mines appartiennent au peuple. Nous ne sommes pas encore riches, mais je vois des écoles dans mon village. Mes enfants apprennent à lire. »
Témoignage fictif en 1975 d’une étudiante à Kinshasa:
« Quand j’écoute Lumumba à la radio, j’ai l’impression d’entendre mon père. Il parle d’une Afrique unie, fière. Mes camarades et moi rêvons de voyager à Accra, à Dar es-Salaam, de construire un continent libre. »
Témoignage fictif en 1982 d’un ingénieur congolais formé à Moscou:
« Nous avons ouvert la première aciérie du pays. C’est dur, il manque des pièces, mais nous ne dépendons plus uniquement des Européens. Le président Lumumba nous a dit : “Un Congo sans usines, c’est un Congo encore colonisé.” »
Témoignage fictif en 1991, d’un militant démocrate à Kinshasa:
« J’ai un immense respect pour Lumumba, mais il est fatigué, et son gouvernement contrôle trop de choses. Nous voulons aussi parler, voter, critiquer. L’indépendance n’est pas complète sans liberté politique. »
Témoignage fictif d’une vieille commerçante au marché de Kisangani, le jour des funérailles de Lumumba en 1997:
« Quand il est arrivé au pouvoir, j’étais une jeune femme. Aujourd’hui, je suis vieille, et il part. Quoi qu’on dise, il nous a donné la dignité. Mes enfants n’ont pas grandi sous les bottes d’un dictateur. C’est déjà une victoire. »
Témoignage fictif en 2008, d’un étudiant en économie à l’Université de Kinshasa:
« Le Congo est riche, mais pas assez juste. On a des routes, des barrages, des universités. Pourtant, je vois encore la corruption. On dit : “Lumumba nous a donné l’unité, à nous maintenant de trouver la justice.” »
Témoignage fictif en 2023, d’une jeune militante congolaise pour le climat:
« Nous sommes héritiers de Lumumba, mais nous avons nos propres combats. Lui parlait de l’indépendance et du panafricanisme, nous parlons d’écologie et de justice sociale. Le Congo est un pays qui compte, mais il doit montrer l’exemple. »

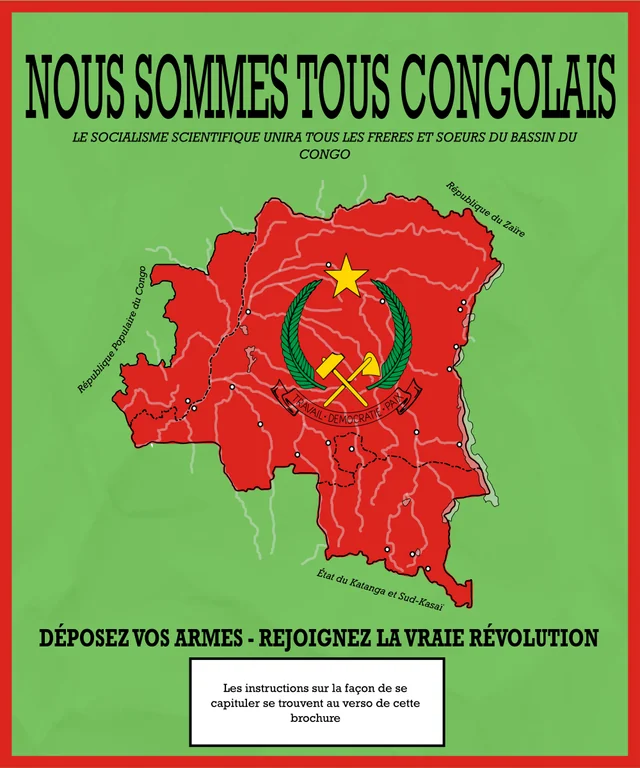
7.14) Et si la Bruxellisation avait été beaucoup plus terrible que dans la réalité?
Voici la chronologie:
Entre les années 1960 et 1970, les pouvoirs publics, influencés par les promoteurs immobiliers, adoptent une logique de tabula rasa ce qui veut dire une destruction quasi totale des quartiers historiques comme les Marolles, le Sablon, Saint-Géry, Dansaert, etc.). Les boulevards intérieurs deviennent des autoroutes urbaines. Les immeubles haussmanniens et art nouveau de Horta disparaissent pour laisser place à des tours de béton. Bruxelles prend des allures de ville américaine brutale, avec des grattes-ciel, et des parkings géants et des centres commerciaux.
Durant les années 1980, le centre historique est presque détruit hors Grand-Place et quelques monuments classés. Les habitants quittent massivement le centre pour la périphérie avec une explosion des banlieues-dortoirs. Bruxelles est vue comme une ville froide et administrative, répulsive pour ses habitants mais attractive pour les sièges sociaux. La fracture sociale s’aggrave entre quartiers pauvres laissés à l’abandon et les riches dans les communes périphériques.
Durant les années 1990, Les institutions européennes s’installent quand même, mais Bruxelles est perçue comme une ville dystopique avec des surnoms dans la presse comme “Bruxellograd” ou “la cité de béton”. Le tourisme s’effondre, pourquoi visiter une ville de tours grises quand Paris, Amsterdam ou Prague gardent leur charme ? La colère des bruxellois explose des associations de riverains, des mouvements écologistes et patrimoniaux dénoncent la destruction totale du tissu urbain.
Entre les années 2000 et 2010, Bruxelles devient un symbole d’échec urbanistique mondial, étudié dans les facultés d’architecture comme le contre-exemple absolu. Des émeutes éclatent dans les quartiers abandonnés. La criminalité grimpe fortement. Certains réclament même le transfert de la capitale de l’Europe vers une autre ville comme Strasbourg ou Francfort, jugeant Bruxelles invivable et disgracieuse.
Dans les années 2020, la ville est dominée par des autoroutes urbaines, des tours vétustes et des zones désertées. La gentrification échoue, car il n’y a plus de patrimoine à réhabiliter. Les habitants surnomment leur capitale “le Chicago d’Europe”. Le fossé entre Bruxelles et les autres grandes villes européennes est énorme, culturellement et économiquement. La Belgique souffre d’une mauvaise image internationale, Bruxelles n’attire plus que pour les affaires, pas pour la culture.
Voici les témoignages fictifs:
Témoignage fictif à Bruxelles en 1985 d’un ancien habitant des Marolles:
« Ma maison a été rasée pour construire une tour de bureaux. Maintenant, je vis à Anderlecht, mais je ne reconnais plus ma ville. »
Témoignage fictif d’un touriste américain en 1998:
« Je m’attendais à visiter une capitale historique… mais c’est du béton, des parkings et des autoroutes. On se croirait dans une zone industrielle. »
Témoignage fictif d’un étudiant en architecture en 2010:
« À l’école, on nous montre Bruxelles comme l’exemple de ce qu’il ne faut jamais faire. C’est triste d’habiter dans une caricature. »
Témoignage fictif à Bruxelles en 2025, d’un militant écologiste:
« Bruxelles aurait pu être une capitale culturelle européenne. On l’a sacrifiée aux promoteurs, et aujourd’hui nous vivons dans une ville que ses habitants fuient. »

7.15) Et si en 1964, l’immigration extra-européenne n’avait jamais été acceptée en Belgique, seulement l’immigration européenne?
En 1964, la Belgique est un pays marqué par ses cicatrices coloniales et par un essor industriel encore robuste. Dans notre uchronie, les décisions politiques et économiques prises à cette époque interdisent strictement l’immigration extra-européenne. Seules les migrations provenant d’autres pays européens sont autorisées, principalement en provenance d’Italie, d’Espagne, de Grèce et du Portugal, répondant aux besoins en main-d’œuvre industrielle.
Les causes de ces décisions sont multiples:
Tout d’abord, face aux tensions liées à l’indépendance du Congo en 1960, le gouvernement belge adopte une politique très restrictive pour éviter de “répéter les erreurs coloniales”, craignant une arrivée massive de Congolais dans les villes industrielles. L’économie belge, fortement dépendante de l’industrie charbonnière, sidérurgique et textile, choisit de privilégier des travailleurs européens plus facilement intégrables culturellement et linguistiquement. Les élites politiques et économiques voient dans la migration européenne un moyen de renforcer les liens avec la Communauté économique européenne naissante, tout en maintenant une homogénéité culturelle.
Les conséquences sont tout aussi multiples, les travailleurs européens assurent la continuité de l’essor industriel. La Belgique devient un centre encore plus intégré à l’économie européenne, mais certains secteurs industriels connaissent un ralentissement faute de main-d’œuvre suffisante, car l’immigration extra-européenne aurait pu combler certaines pénuries. Les villes restent plus homogènes, avec des quartiers ouvriers majoritairement européens. Les tensions liées à la ségrégation raciale, fréquentes dans notre réalité historique, sont beaucoup moins présentes. Les tensions ethniques et raciales sont beaucoup moins visibles. Le pays connaît une homogénéité culturelle qui limite certains conflits sociaux mais freine la pluralité culturelle. L’enseignement et les médias restent centrés sur une culture européenne occidentale homogène. Les langues étrangères enseignées sont principalement l’italien, l’espagnol, le portugais et l’anglais. La population de la Belgique reste moins dense et moins diversifiée sur le plan ethnique. Certaines villes industrielles connaissent un vieillissement plus rapide, faute d’immigration supplémentaire pour compenser le déclin naturel de la population locale.
Voici la chronologie de cette uchronie:
En 1960, la Belgique accorde l’indépendance au Congo. Les politiques migratoires deviennent très strictes pour éviter l’arrivée de Congolais sur le territoire belge.
Entre 1961 et 1964, seule l’immigration européenne est autorisée. Des accords bilatéraux sont signés avec l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce pour fournir de la main-d’œuvre aux industries belges que ce soit dans les mines, dans la sidérurgie ou dans l’industrie du textile.
Les flux migratoires extra-européens sont interdits. Les villes industrielles accueillent des travailleurs européens, qui s’intègrent relativement facilement grâce à la proximité culturelle et linguistique.
Durant les années 70, L’économie belge connaît un pic industriel. Les tensions raciales et sociales liées à l’immigration sont quasi inexistantes.
Durant les années 80, les secteurs industriels traditionnels commencent à décliner, notamment la sidérurgie et le charbon. Faute de main-d’œuvre supplémentaire extra-européenne, certaines industries peinent à se reconvertir rapidement. La Belgique reste homogène culturellement, avec peu d’influence africaine ou asiatique dans la société. Le pays modernise ses infrastructures et se tourne vers les services et la finance. L’éducation reste centrée sur les langues européennes comme le français, et le flamand,l’anglais, l’italien et l’espagnol.
Durant les années 2000, la population commence à vieillir rapidement. Les villes industrielles connaissent un ralentissement démographique, faute d’immigration extra-européenne pour compenser le déclin naturel.
Durant les années 2010, la Belgique conserve une prospérité économique modérée. La société reste culturellement européenne et homogène. La Belgique est stable, pacifique et homogène. La Belgique reste fortement liée à l’Europe occidentale, mais ses relations avec ses anciennes colonies sont distantes et formelles.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un ouvrier italien à Liège en 1972:
« Je suis venu d’Italie pour travailler dans les usines de Liège. Ici, c’est plus facile pour nous Européens de nous intégrer, on parle souvent la même langue, on partage les mêmes traditions.”
Témoignage fictif d’un enseignant bruxellois, 1985:
« Dans mes classes, presque tous les élèves viennent de familles européennes. C’est plus simple à gérer, et il y a moins de problèmes de communication”
Témoignage fictif d’un politicien flamand en 1992:
« Notre politique a permis de garder la cohésion sociale. Les quartiers sont stables, les tensions raciales sont rares. Nous avons choisi la sécurité et l’homogénéité plutôt que la diversité. Certains critiquent ce choix, mais il a évité beaucoup de conflits sociaux que connaissent d’autres pays. »
Témoignage fictif d’un retraité liégeois en 2025:
« J’ai vécu toute ma vie dans cette Belgique homogène. C’est un pays calme, sûr, avec peu de tensions sociales, la société est stable.
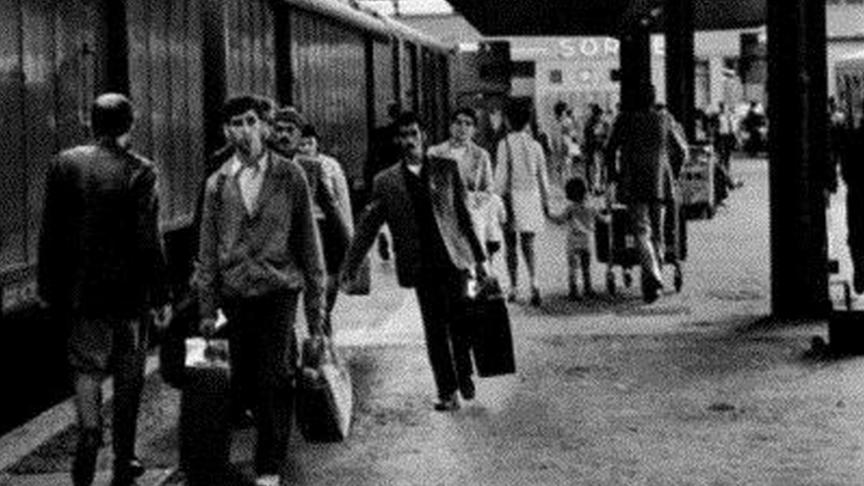
7.16) Et si la Crise de Louvain de 1968 n’avait pas eu lieu?
Dans cette uchronie, le gouvernement belge et l’épiscopat parviennent à un compromis avant que la crise n’explose. Le français et le flamand restent des langues d’enseignement parallèles à Louvain. Les tensions sont apaisées par une politique plus généreuse d’intégration linguistique en financement d’un système bilingue solide. Les manifestations étudiantes de 1968 ont lieu, mais elles portent surtout sur les réformes sociales et universitaires, pas sur la langue ni le territoire.
Voici la chronologie de l’uchronie:
En 1968, il y a le compromis « Louvain bilingue » qui devient un symbole d’unité nationale.
En 1970, au lieu d’une réforme de l’État poussée par le conflit linguistique, la Belgique adopte une décentralisation modérée, mais pas de fédéralisme strict.
En 1973, durant la Crise pétrolière, la solidarité entre la Wallonie et la Flandre est plus forte que dans notre réalité.
En 1975, il y a le développement de pôles scientifiques mixtes à Louvain et Liège, qui deviennent de véritables laboratoires bilingues.
En 1980, il n’y a pas de « première réforme de l’État » fédéralisante : la Belgique reste unitaire, avec seulement des régions administratives.
Entre 1981 et 1985, la montée du nationalisme flamand est freinée, sans le traumatisme de Louvain, la NVA n’émerge pas (ou reste marginale).
En 1989, Bruxelles devient la capitale européenne sans contestation communautaire majeure.
En 1993, au lieu de devenir un État fédéral, la Belgique reste une monarchie unitaire décentralisée.
En 1995, Louvain devient un hub universitaire européen bilingue, attirant des étudiants de toute l’UE.
En 1999, le modèle belge d’équilibre linguistique sert d’exemple à l’UE pour gérer le multilinguisme.
En 2001, lors de la crise du haut débit, la Belgique investit massivement dans la recherche et bénéficie de sa coopération interlinguistique.
En 2004, l’Université de Louvain est classée dans le top 50 mondial grâce à son modèle bilingue et interculturel.
En 2008, la crise financière frappe, mais l’absence de tensions communautaires permet un plan de sauvetage unifié.
En 2010, il n’y a pas de crise politique interminable, 541 jours sans gouvernement dans notre réalité, la Belgique reste gouvernable.
En 2014, la Belgique se présente comme une alternative au fédéralisme conflictuel contrairement à l’Espagne avec la Catalogne.
En 2016, il y a les attentats de Bruxelles, celle-ci a une réponse unie, renforçant l’identité belge.
En 2019, la Belgique est surnommée « le laboratoire du vivre-ensemble européen ».
En 2020, pendant la pandémie, la coordination nationale est efficace grâce à l’absence de structures institutionnelles éclatées.
En 2022, la Belgique propose un modèle linguistique européen pour gérer la diversité au sein de l’UE.
En 2025, Louvain est au cœur de la recherche en intelligence artificielle et en biotechnologies, fruit de décennies de coopération bilingue.
Témoignage fictif en 1968 d’un étudiant wallon à Louvain:
« On a eu peur que la ville explose, mais au final, on étudie côte à côte. Je parle flamand avec mes colocs, eux me corrigent en français. C’est ça, l’avenir. »
Témoignage fictif en 1984 d’un professeur flamand à Louvain:
« Ici, on publie en deux langues, parfois trois avec l’anglais. C’est dur, mais c’est notre force, on est au carrefour de l’Europe. »
Témoignage fictif en 2011 d’un politicien bruxellois:
« Pendant que d’autres pays s’enfoncent dans les querelles régionales, nous avons prouvé que la diversité linguistique entre le français et le flamand peut unir au lieu de diviser. »
Témoignage fictif en 2025 d’une étudiante chinoise à Louvain:
« J’ai choisi Louvain parce que c’est le seul endroit où je peux étudier la médecine en anglais, apprendre le français et le flamand et rencontrer des gens de toute l’Europe. C’est vraiment unique. »

7.17) Et si la Crise de Louvain de 1968 avait dégénéré?
En janvier 1968, au lieu de dissoudre le gouvernement et de transférer la section francophone vers Louvain-la-Neuve comme dans notre réalité, les manifestations étudiantes et ouvrières explosent en émeutes violentes. L’armée est déployée à Louvain. On compte plusieurs morts dans des affrontements. Les slogans « Walen buiten ! » (« les Wallons dehors ») se transforment en campagne nationaliste organisée, alors que les francophones dénoncent une « purification linguistique ».
Voici la chronologie de cette uchronie:
En 1968, après des semaines d’émeutes, le gouvernement tombe. La méfiance entre Flamands et Wallons atteint un point de non-retour.
En 1969, la Flandre réclame une autonomie complète en matière d’éducation et de culture. La Wallonie, outrée, réplique par la création d’un Conseil wallon provisoire.
En 1971, Bruxelles devient le principal foyer de tensions, chaque camp voulant revendiquer la ville.
En 1973,il y a des grèves générales et affrontements à Bruxelles entre milices étudiantes flamandes et wallonnes.
En 1975, la Belgique entre en crise constitutionnelle, le pays est de facto paralysé.
En 1977, les Accords d’Anvers échouent. La Flandre proclame une autonomie unilatérale, la Wallonie suit.
En 1980, la Belgique est remplacée par une confédération bancale Flandre-Wallonie, Bruxelles étant sous administration internationale comme Berlin après 1945.
En 1985, la Flandre prospère grâce à ses ports et son industrie, la Wallonie s’enfonce dans la crise économique.
En 1989, Bruxelles accueille les institutions européennes, mais devient une ville quasi coupée de ses régions voisines.
En 1992, le traité de Maastricht intègre séparément la Flandre et la Wallonie dans l’UE.
En 1995, la Flandre devient l’une des régions les plus riches d’Europe. La Wallonie se tourne vers la France, mais Paris refuse l’annexion.
En 1999, il y a la montée des populistes flamands, qui veulent rompre avec toute solidarité envers Bruxelles et les francophones.
En 2001, Bruxelles devient officiellement un district européen autonome, à la manière de Washington D.C.
En 2004, Louvain est scindée définitivement entre un campus flamand prospère et un campus francophone marginalisé.
En 2008, la crise financière frappe durement la Wallonie, provoquant une nouvelle vague d’émigration vers la France et le Luxembourg.
En 2010, la « Belgique » n’existe plus, sauf comme une fiction administrative.
En 2014, la Flandre menace de quitter l’UE si Bruxelles reçoit un statut trop francophone.
En 2020, la pandémie est gérée séparément par les deux États avec une coordination quasi impossible.
En 2023, Bruxelles est surnommée « la Jérusalem de l’Europe », une ville disputée, surpolitisée, mais aussi la capitale incontestée de l’UE.
En 2025, la Flandre est riche et puissante, et proche des Pays-Bas. La Wallonie est affaiblie, économiquement dépendante, culturellement tournée vers la France. Bruxelles est isolée, sous tutelle européenne, symbole du divorce belge.
Témoignage fictif en 1968 d’un étudiant francophone à Louvain:
« Quand j’ai vu les flamands défiler en criant qu’on devait partir, j’ai compris que ce n’était plus mon université. Ce n’était plus mon pays.
Témoignage fictif en 1981, d’un ouvrier flamand à Anvers:
« La Belgique ? Elle n’existe plus. Et je ne la regrette pas. Nous travaillons, nous prospérons. Pourquoi traîner les Wallons derrière nous ? »
Témoignage fictif en 1993 d’une militante wallonne à Charleroi:
« On croyait qu’avec la Flandre, on construirait une Europe forte. Mais au final, on nous a laissés dans la misère. »
Témoignage fictif en 2025 d’un fonctionnaire européen à Bruxelles:
« Je travaille dans la capitale de l’Europe, mais chaque fois que je sors du périmètre institutionnel, je sens les cicatrices de ce vieux pays disparu. »
Voici deux autres scénarios que j’ai imaginé pour cette uchronie:
En 1968, c’est la Crise de Louvain et il y a de violents affrontements entre étudiants flamands et francophones. Les manifestations tournent à l’émeute. Des groupes maoïstes s’infiltrent dans les cortèges.
En 1969, il y a des grèves générales en Wallonie. Il y a la Création de l’Armée Populaire Belge (APB) par des militants maoïstes et des ouvriers radicaux. Il y a eu les premiers affrontements armés à Liège.
En 1970, Bruxelles bascule dans l’insurrection. Le gouvernement se replie à Anvers. Le roi Baudouin appelle l’OTAN à intervenir, mais les États-Unis hésitent par peur de provoquer Moscou et Pékin).
En 1972, L’APB prend Bruxelles. Il y a la Proclamation de la République Populaire de Wallonie-Bruxelles. Il y a le Début des collectivisations et les Purges contre les « bourgeois », les « cléricaux » et les « révisionnistes ».
En 1973, il y a une offensive maoïste en Flandre. Les Pays-Bas et l’Allemagne de l’Ouest arment discrètement les forces flamandes.
En 1975, il y a la chute d’Anvers et la Proclamation de la République Populaire de Belgique (RPB). La monarchie est abolie. Le roi Baudouin part en exil à Londres.
En 1976, il y a des collectivisations massives. avec la Répression des syndicats « réformistes ».Il y a le Départ massif des cadres vers la France et les Pays-Bas.
En 1978, il y a des camps de rééducation dans les Ardennes pour les opposants.
En 1980, Bruxelles perd le statut de capitale européenne. Les institutions de la CEE déménagent à Strasbourg.
En 1985, Deng Xiaoping reconnaît officiellement la RPB et l’aide économiquement. Bruxelles devient une vitrine maoïste.
En 1989, avec la Chute du Mur de Berlin. La Belgique subit un isolement accru en Europe,les régimes communistes s’effondrent en Europe, mais Bruxelles reste « rouge ».
En 1992, la Belgique refuse d’adhérer à l’UE. Il y a un embargo européen partiel.
En 1994, il y a des famines dans le Hainaut et Charleroi. L’État nie les chiffres, mais des milliers de réfugiés fuient en France.
En 1999,il y a des émeutes ouvrières à Anvers et Gand qui sont violemment réprimées.
En 2001, Bruxelles accueille la « Conférence internationale des peuples révolutionnaires ». Le régime se rapproche de la Corée du Nord.
En 2005, il y a une tentative de soulèvement urbain à Liège, écrasée par l’armée populaire.
En 2008, la crise financière mondiale a peu d’effet, la Belgique maoïste étant déjà coupée des marchés.
En 2010, Bruxelles est l’une des capitales les plus fermées du monde. Le pays est surnommé le « Cuba d’Europe ».
En 2020, durant la Pandémie, il y a un confinement militaire total avec une propagande anti-occidentale renforcée.
En 2025, la République Populaire de Belgique existe toujours, pauvre et isolée, entourée par l’UE et l’OTAN, un symbole d’un maoïsme survivant.
Dans cette uchronie le leader en 1950 est Henri Glineur et en 2025 Michel Collon.
Voici les témoignages concernant ce scénario:
Témoignage fictif à Bruxelles en 1972 d’une étudiante maoïste:
« Quand nous avons hissé le drapeau rouge sur la Grand-Place, j’ai cru que l’histoire nous appartenait. Mais déjà, certains camarades disparaissaient. On disait qu’ils étaient des traîtres… »
Témoignage fictif en 1976 d’un ouvrier sidérurgiste:
« On a collectivisé l’usine. Plus de patrons, c’était nous le pouvoir ! Mais très vite, plus de pièces, plus d’acier… et toujours des portraits de Mao sur les murs. »
Témoignage fictif d’un prisonnier politique dans les ardennes en 1982:
« Ils m’ont envoyé dans un camp de rééducation parce que j’étais syndicaliste socialiste. Ici, on doit réciter les citations du Petit Livre Rouge de Mao avant chaque repas. »
Témoignage fictif d’une réfugiée belge à Londres en 1994:
> « J’ai fui Charleroi avec mes enfants. On mangeait des betteraves pour survivre. En Angleterre, ils nous appellent “les Cubains d’Europe.”
Témoignage fictif d’un jeune habitant de Bruxelles en 2020:
« Je n’ai jamais voyagé plus loin que Namur. Internet est contrôlé, mais on capte parfois les chaînes britanniques clandestinement. On voit un autre monde, riche et libre. »
Voici le dernier scénario concernant cette uchronie:
En 1968, il y a la Crise de Louvain avec des émeutes et des premières fusillades. Des groupes maoïstes armés apparaissent à Bruxelles et en Wallonie.
En 1969, le gouvernement est débordé. Des régions entières de Wallonie échappent au contrôle de l’État.
En 1970, la Belgique fait un appel officiel à l’OTAN. Les États-Unis et le Royaume-Uni interviennent. Il y a le Débarquement qui se fait à Anvers et à Ostende. Il y a des combats de rue à Bruxelles.
En 1971, les insurgés maoïstes sont écrasés. Il y a des arrestations massives, des exécutions sommaires.
En 1972, la Belgique devient un protectorat de fait de l’OTAN. Avec des bases permanentes installées à Bruxelles, Charleroi et Anvers.
En 1975, des élections sont organisées, mais strictement encadrées par les forces occidentales.
En 1976, il y a le début d’un « plan Marshall 2.0 » financé par les Américains. Il y a une croissance économique en Flandre, plus lente en Wallonie.
En 1980, Bruxelles devient capitale incontestée de l’OTAN avec une militarisation accrue.
En 1985, il y a des mouvements pacifistes et étudiants qui dénoncent la « colonisation américaine » avec des manifestations massives à Louvain et Liège.
En 1989, avec la chute du Mur de Berlin. L’URSS accuse l’OTAN d’avoir transformé la Belgique en une « colonie militaire ».
En 1992, durant le Traité de Maastricht, la Belgique y participe, mais sous contrôle direct de Washington.
En 1995, il y a des élections libres plus authentiques, mais la présence américaine est encore très forte.
En 1999, Bruxelles devient la capitale officielle de l’UE et de l’OTAN, renforçant la tutelle américaine.
En 2001, durant les attentats du 11 septembre, Bruxelles devient un hub central de la guerre contre le terrorisme. La présence militaire US s’accroît.
En 2005, il y a les premiers débats sur le départ des troupes étrangères qui sont rejetés.
En 2008, avec la crise financière, Washington impose des réformes libérales en Belgique. Il y a une montée des tensions sociales.
Durant les années 2010, il y a le débat permanent sur la souveraineté. Les nationalistes flamands et wallons critiquent la tutelle américaine.
En 2016, à cause des attentats terroristes à Bruxelles, il y a le renforcement de la présence militaire US.
En 2020, il y a la pandémie qui est gérée de façon centralisée par le commandement OTAN.
En 2025, La Belgique est prospère et intégrée à l’UE, mais reste le pays le plus dépendant des États-Unis en Europe, surnommée « la Floride de l’OTAN ».
Voici les témoignages concernant ce scénario:
Témoignage fictif d’un étudiant insurgé survivant à Bruxelles en 1971:
« J’ai vu mes camarades tomber sous les balles américaines dans les rues. On s’est battus pour un monde plus juste, et nous avons fini dans les geôles de l’OTAN. »
Témoignage fictif d’un soldat américain à Bruxelles en 1975:
« Je patrouille chaque nuit dans les rues de Bruxelles. Les Belges nous regardent comme des envahisseurs. Mais si on part, le chaos reviendra. »
Témoignage fictif d’un ouvrier flamand à Anvers en 1983:
« Le travail est revenu, les usines tournent grâce à l’argent américain. Mais je sens que ce n’est pas notre pays,Washington décide pour nous. »
Témoignage fictif d’une étudiante pacifiste en 1985:
« On manifeste contre la présence américaine. On crie “Yankee Go Home !” mais ils restent, avec leurs chars et leurs bases. C’est notre quotidien. »
Témoignage fictif d’un fonctionnaire européen en 2001:
« Travailler ici, c’est étrange, la capitale de l’Europe, mais protégée comme une zone de guerre. Les drapeaux de l’UE flottent… à côté de ceux de l’OTAN. »
Témoignage d’un retraité wallon à Bruxelles en 2025:
« La Belgique est riche, mais je n’ai jamais cessé d’avoir l’impression qu’on vit sous tutelle. Mes petits-enfants parlent anglais avec un accent américain. Est-ce encore la Belgique ?


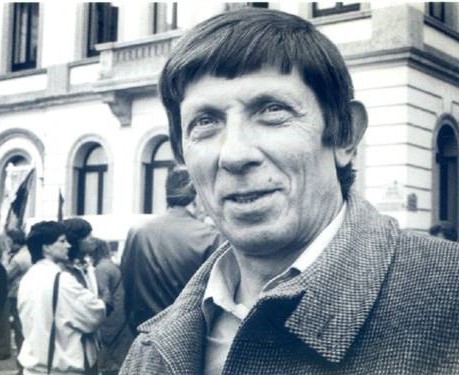

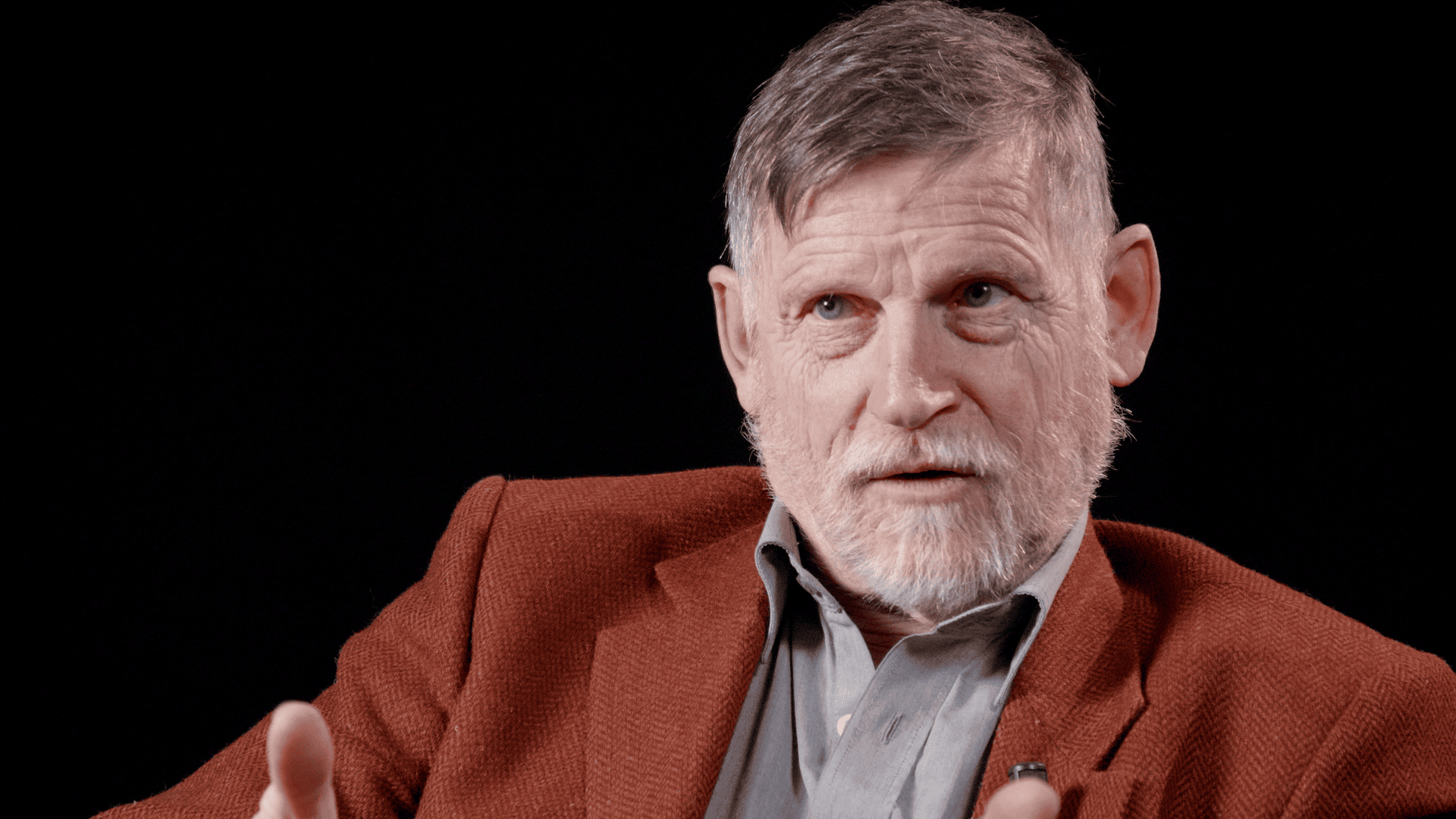
7.18) Et si la Fédéralisation de la Belgique n’avait jamais commencé à prendre forme en 1970 et que celle-ci était restée unitaire jusqu’à aujourd’hui?
La réforme de 1970 avec la création des communautés culturelles a été une première étape du fédéralisme belge, celle-ci a été un tournant, sans elle, la Belgique serait restée un État unitaire, centralisé.
Voici la chronologie de l’uchronie:
En 1970, il n’y a pas de réforme institutionnelle. Les revendications flamandes et wallonnes restent non satisfaites. Le pouvoir reste concentré à Bruxelles.
Entre 1971 et 1978, il y a des grèves et des manifestations récurrentes en Wallonie, mais aussi en Flandre, où la revendication linguistique monte.
En 1978, la « Question communautaire » atteint son apogée. Le gouvernement tente de gérer par des lois linguistiques sans céder au fédéralisme.
En 1980, en réalité, la Belgique se dote de régions. Ici, ce n’est pas le cas, la frustration est accrue. Le Mouvement flamand devient plus radical.
Entre 1981 et 1985, des partis régionalistes flamands et wallons grossissent notamment la Volksunie et le Rassemblement wallon. Certains militants évoquent même l’indépendance.
Entre 1988 et 1989, la question de Bruxelles devient explosive. Sans structures régionales, Bruxelles reste sous l’autorité directe de l’État central. Les tensions linguistiques s’enveniment.
En 1993, dans notre réalité, la Belgique devient un État fédéral. Ici, ce n’est pas le cas, il y a une énorme crise institutionnelle. Le Vlaams Blok progresse fortement.
En 1995, la monarchie joue un rôle d’arbitre, mais est accusée par certains Flamands d’être trop « francophone ».
En 1999, il y a un débat sur une possible partition. Le centralisme belge est contesté, mais le gouvernement refuse tout éclatement
Entre 2001 et 2007, les partis communautaires comme la N-VA ou le Front démocratique des francophones progressent. Ils réclament soit l’indépendance flamande, soit un fédéralisme tardif.
En 2007, dans notre réalité, la crise politique a atteint 541 jours sans gouvernement fédéral. Ici, c’est pire c’est la paralysie totale, car aucune structure régionale n’existe pour absorber le conflit.
En 2010, le pays est paralysé par les revendications flamandes. Certains leaders menacent de boycotter les institutions centrales.
Entre 2011 et 2015, Bruxelles devient un champ de bataille politique, Flamands et Wallons se disputent son statut.
En 2016, il y a eu les attentats de Bruxelles, la gestion de la crise est critiquée. Les nationalistes flamands accusent l’État unitaire d’incompétence.
En 2019, L’unité belge est préservée, mais la N-VA et d’autres partis indépendantistes flamands dépassent 40 % des voix en Flandre.
En 2020, la pandémie de COVID-19 révèle l’absence de structures régionales de santé. Bruxelles impose des mesures uniformes, mal reçues en Flandre.
En 2025, la Belgique est toujours unitaire sur le papier, mais minée par des menaces de sécession. Le système politique est bloqué entre un État central rigide et des forces régionalistes de plus en plus radicales.
Voici les témoignages concernant cette uchronie
Témoignage fictif d’un syndicaliste wallon en 1983:
« On nous dit que la Belgique est une et indivisible, mais à Bruxelles, ils ne nous écoutent jamais. Les Flamands, eux, gueulent encore plus fort. »
Témoignage fictif d’un étudiant flamand à Anvers en 1994:
« À chaque élection, on nous ignore. Bruxelles décide tout. Pourquoi rester dans cette Belgique francophone ? »
Témoignage fictif d’un fonctionnaire européen en 2008:
« Travailler ici, c’est compliqué. Le pays est officiellement unitaire, mais tout le monde se déteste. C’est comme vivre dans une cocotte-minute. »
Témoignage fictif d’un médecin
« Pendant la pandémie, j’ai vu l’État imposer les mêmes règles à la Flandre et à la Wallonie. Résultat, personne n’était content.»
Témoignage fictif à Gand en 2025 d’un militant nationaliste flamand
« Cinquante ans qu’on nous refuse le fédéralisme. Alors, assez : la Flandre doit déclarer son indépendance, unilatéralement s’il le faut. »
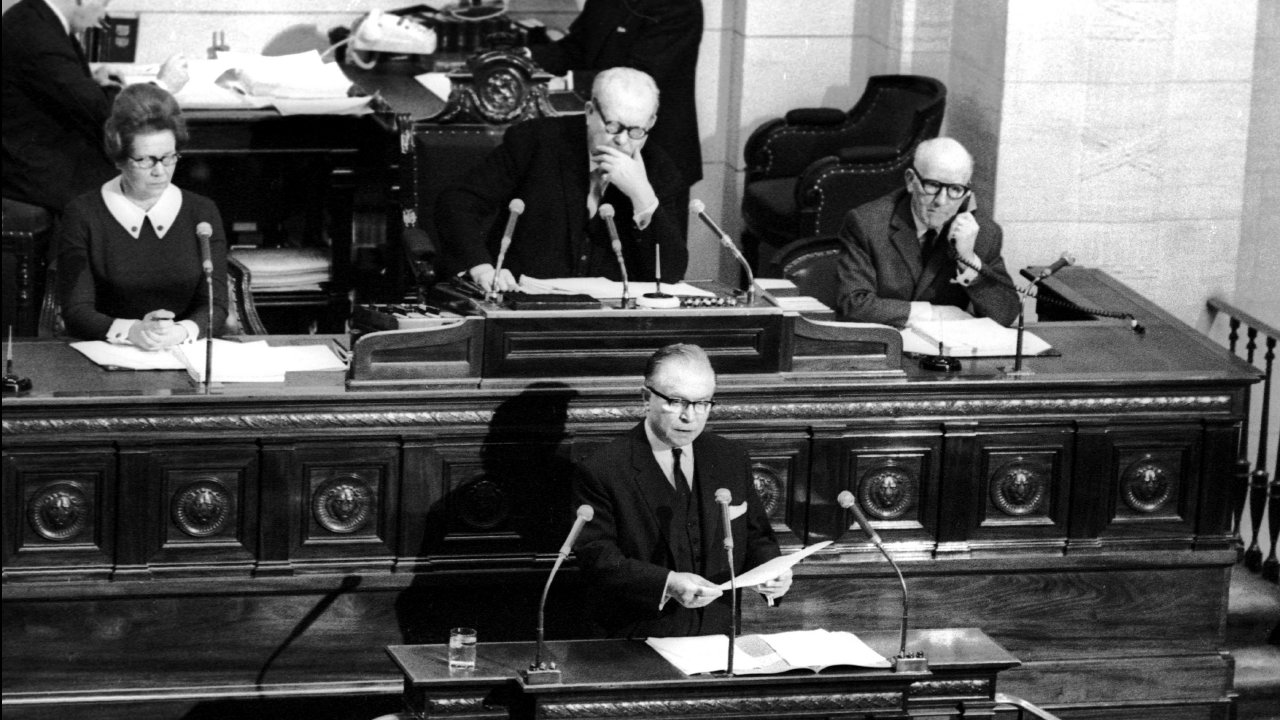
Points de divergences entre 1991 et 2025
8) Et si le cordon sanitaire n’avait jamais existé en Belgique?
Voici la chronologie:
En 1991, en réalité, le « dimanche noir » voit le Vlaams Blok devenir la deuxième force en Flandre. Ici, au lieu de l’isoler, certains partis flamands, notamment la Volksunie et une partie du CVP(ou Christelijke Volkspartij) acceptent de dialoguer avec lui.
En 1995, le Vlaams Blok participe indirectement à des coalitions locales à Anvers, Gand et Louvain. La normalisation commence.
En 1999, dans le Gouvernement flamand, le Vlaams Blok obtient pour la première fois des ministères régionaux comme la sécurité et l’immigration.
En 2001, les attentats du 11 septembre renforcent le discours anti-immigration du Blok, qui devient la première force politique en Flandre.
En 2004, en réalité, le Vlaams Blok est condamné pour racisme et se transforme en Vlaams Belang. Ici, il échappe à la condamnation grâce à des alliances politiques.
En 2007, il y a une coalition fédérale CD&V–Vlaams Blok–MR, pour la première fois, un gouvernement belge intègre ouvertement “l’extrême droite”.
En 2008, durant la Crise financière, le Vlaams Blok gagne encore du terrain avec son discours nationaliste et anti-européen.
En 2010, en réalité, il y eut la longue crise politique de 541 jours. Ici, la N-VA et le Vlaams Blok gouvernent ensemble en Flandre, poussant vers la sécession.
En 2014, il y a la victoire écrasante des nationalistes flamands avec la N-VA plus le Vlaams Blok. La Wallonie se radicalise à gauche avec une forte poussée du PTB.
En 2016, il y a les attentats de Bruxelles, le Vlaams Blok réclame l’expulsion massive d’immigrés. Bruxelles devient un champ de tensions communautaires.
En 2019, la Belgique est au bord de la rupture, en Flandre avec des discours indépendantistes, en Wallonie avec un appel à un rattachement à la France.
En 2020, la pandémie de Covid est instrumentalisée, le Vlaams Blok accuse Bruxelles et l’UE de mauvaise gestion, et renforce son autorité régionale.
En 2024, il y a une majorité absolue du Vlaams Blok en Flandre avec une déclaration unilatérale d’indépendance de la Flandre.
En 2025, deux scénarios sont possibles
soit il y a une sécession avec la Belgique éclatée, avec la Flandre indépendante, et la Wallonie proche de la France et Bruxelles sous statut international. Soit la Belgique devient un état autoritaire avec le le Vlaams Blok prend le contrôle fédéral et restreint la presse et durcit la politique migratoire.
Voici les témoignages concernant cette uchronie:
Témoignage fictif à Anvers en 1999 d’un ouvrier flamand:
« On disait qu’ils ne gouverneraient jamais… et voilà, le Vlaams Blok est à l’hôtel de ville. Les immigrés du quartier ont peur, mais beaucoup de mes collègues applaudissent. »
Témoignage fictif à Bruxelles en 2008 d’une étudiante marocaine:
« Quand je prends le train pour Anvers, je cache parfois mon voile. Les insultes sont devenues normales, comme si c’était autorisé. »
Témoignage fictif en 2014 d’un syndicaliste wallon:
« La Flandre veut partir, alors pourquoi pas nous ? Autant rejoindre la France plutôt que de vivre sous la botte des fachos flamands. »
Témoignage fictif à Gand en 2025 d’un professeur flamand:
« On nous répète que nous sommes “libres”, mais les journaux critiques disparaissent, et les collègues étrangers ne viennent plus enseigner. C’est une liberté bien étroite. »

8.1) Et si le Vlaams Blok n’avait pas été interdit?
Durant les années 1990, déjà très fort à Anvers, le Vlaams Blok capitalise sur les thèmes de l’immigration, de l’insécurité et de l’indépendantisme flamand. Dans cette uchronie il n’y a pas de procès, pas de condamnation et il n’y a pas besoin de rebranding. Le cordon sanitaire reste en place, mais plus fragile car il devient difficile de justifier l’isolement d’un parti qui attire 20 à 25 % des électeurs flamands.
Durant les années 2000, sans la « cassure » de 2004, le Vlaams Blok gagne en stabilité. Il franchit la barre des 30 % en Flandre plus tôt que dans notre réalité. Certains partis flamands notamment la N-VA émergente sont obligés de composer avec lui pour ne pas perdre leur électorat. Le cordon sanitaire s’effrite dès la fin des années 2000. Le Vlaams Blok entre dans des coalitions locales à Anvers, Gand et peut-être même en Brabant flamand. À l’échelle nationale, il devient impossible de former un gouvernement sans tenir compte de lui. Les thèmes imposés à l’agenda sont la limitation de l’immigration, l’accent sur la sécurité, l’autonomie fiscale renforcée pour la Flandre. La Belgique vit une radicalisation progressive, avec des réformes institutionnelles plus marquées en faveur de la Flandre.
En 2024, le Vlaams Blok est le premier parti de Flandre et l’un des plus puissants d’Europe occidentale, sans l’image sulfureuse du Vlaams Belang puisque il n’y a pas d’interdiction. Il participe à une coalition régionale en Flandre et influence fortement la politique migratoire nationale. Les tensions communautaires atteignent un sommet avec plusieurs gouvernements fédéraux qui tombent rapidement. Bruxelles devient un point de blocage permanent, le Vlaams Blok exige un statut limité pour la capitale.
Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un militant du Vlaams Blok en 2004:
« On nous avait promis la fin du parti par un procès politique. Finalement, la justice n’a pas osé. Aujourd’hui, nous marchons de victoire en victoire. »
Témoignage fictif d’un électeur bruxellois francophone en 2012:
« Voir le Vlaams Blok dans une majorité flamande me glace. On dirait que leurs idées sont devenues normales. »
Témoignage fictif d’un journaliste politique en 2019:
« Sans la dissolution en 2004, le Vlaams Blok n’a jamais porté la tâche d’un procès pour racisme. Cela lui a permis d’apparaître comme un parti « légitime », contrairement au Vlaams Belang. »
Témoignage fictif d’une étudiante flamande en 2025:
« Dans mon université, beaucoup de jeunes votent Vlaams Blok. Ils disent que c’est le seul parti qui ose parler vrai. Ce qui m’inquiète, c’est que ça ne choque plus personne. »
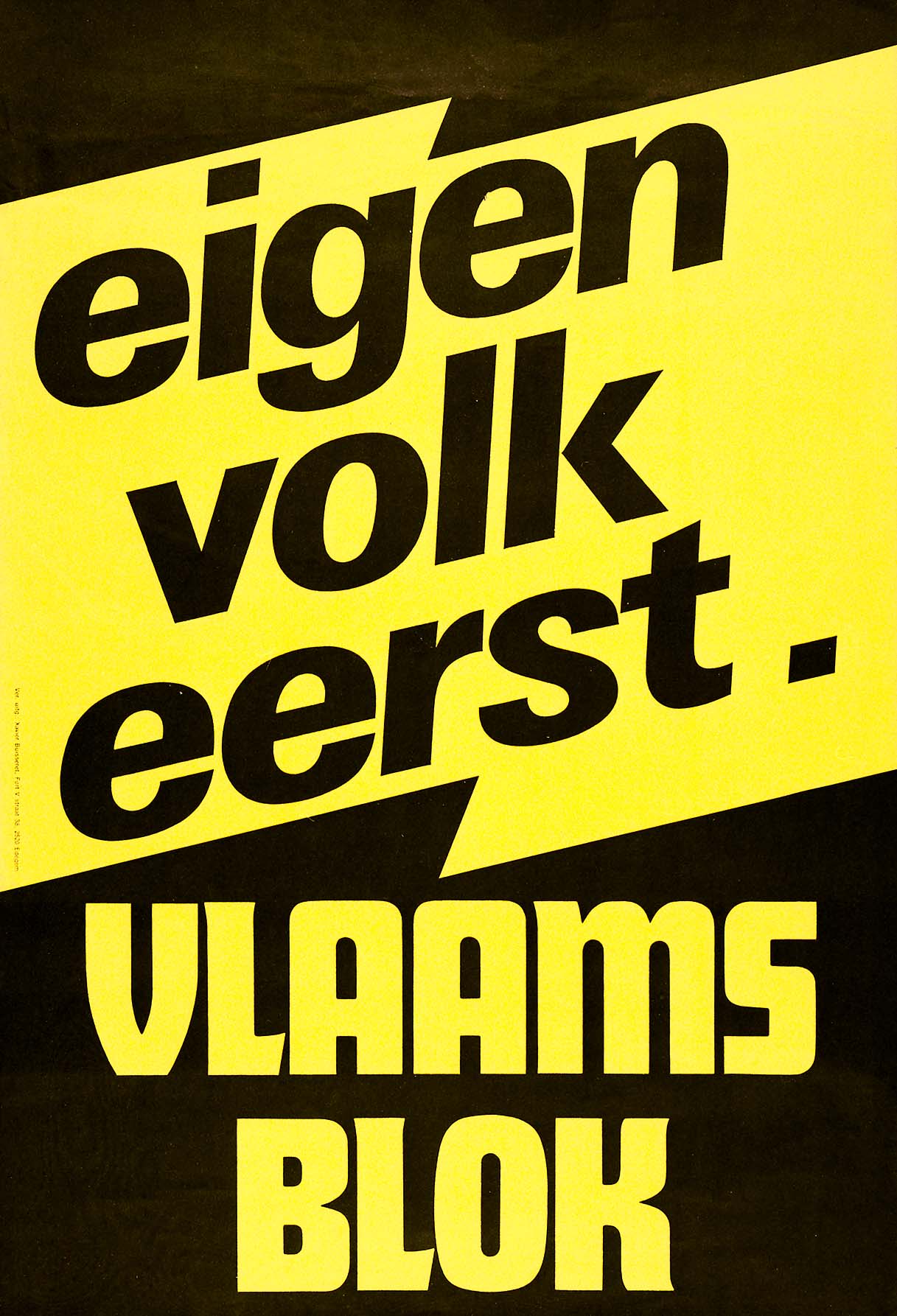
8.2) Et si la Belgique n’avait jamais adopté l’Euro?
En 1992, avec le Traité de Maastricht certains partis belges peut-être des libéraux flamands et une partie des sociaux-chrétiens craignent de perdre la souveraineté monétaire. Les tensions communautaires compliquent le consensus entre Flamands et Wallons ne veulent pas d’un projet qui pourrait fragiliser davantage les finances publiques. La Belgique choisit de ne pas rejoindre la zone euro, mais de maintenir le franc belge, arrimé au mark allemand puis à l’euro comme le Danemark avec sa couronne.
En 2002, alors que les voisins comme la France, l’Allemagne, le Luxembourg, et les Pays-Bas passent à l’euro, la Belgique garde ses billets en francs belges. Pour les Belges, le désavantage est énorme avec des frais de change et aussi une confusion pour les touristes et des difficultés dans les transactions transfrontalières. Bruxelles, est la capitale de l’UE et vit une contradiction, les institutions fonctionnent en euro, mais les habitants paient en francs.Les multinationales privilégient souvent le Luxembourg ou les Pays-Bas pour leurs sièges européens car la Belgique perd en attractivité économique.
En 2008 durant la crise mondiale, la Belgique, sans euro, doit défendre seule son franc belge. Les marchés attaquent la monnaie belge avec une faiblesse de la dette belge, et une instabilité politique avec une forte dévaluation. Les conséquences sont que les exportations belges sont boostées, mais il y a une forte inflation et il y a une perte de pouvoir d’achat et une hausse du coût des importations en énergie,en matières premières. Les Flamands accusent l’État fédéral de mauvaise gestion, les Wallons défendent la souveraineté monétaire et il y a un conflit communautaire accru.
Durant les années 2020, la Belgique devient une exception en Europe de l’Ouest, comme la Suisse, mais sans la solidité économique suisse. Le franc belge est fragile face à l’euro avec des fluctuations permanentes. Les jeunes générations, qui voyagent, étudient et travaillent dans toute l’Europe, voient le Franc belge comme un handicap.En 2025, le débat est vif, certains réclament enfin l’adhésion à l’euro pour « normaliser » le pays,d’autres notamment certains nationalistes flamands s’y opposent au nom de la souveraineté.
Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’une commerçante à Namur en 2002:
« Chaque fois que je vais en France pour acheter des marchandises, je dois changer mes francs. Je perds de l’argent à chaque opération. On se sent à part, et pas dans le bon sens. »
Témoignage fictif d’un fonctionnaire européen à Bruxelles en 2005:
« C’est ridicule, je suis payé en euros par la Commission, mais je dois les convertir en francs belges pour payer mon loyer. On a l’impression de vivre dans une enclave monétaire. »
Témoignage fictif d’un économiste à Mons en 2009:
« La crise nous a frappés de plein fouet. Avec l’euro, on aurait eu la protection de la BCE. Là, le franc belge a perdu 30 % de sa valeur en six mois. »
Témoignage fictif d’un jeune étudiant en 2020:
« Quand je pars en Erasmus, je dois tout changer en euros. Mes amis français ou allemands ne comprennent pas pourquoi on s’obstine. On a l’air ringards. »
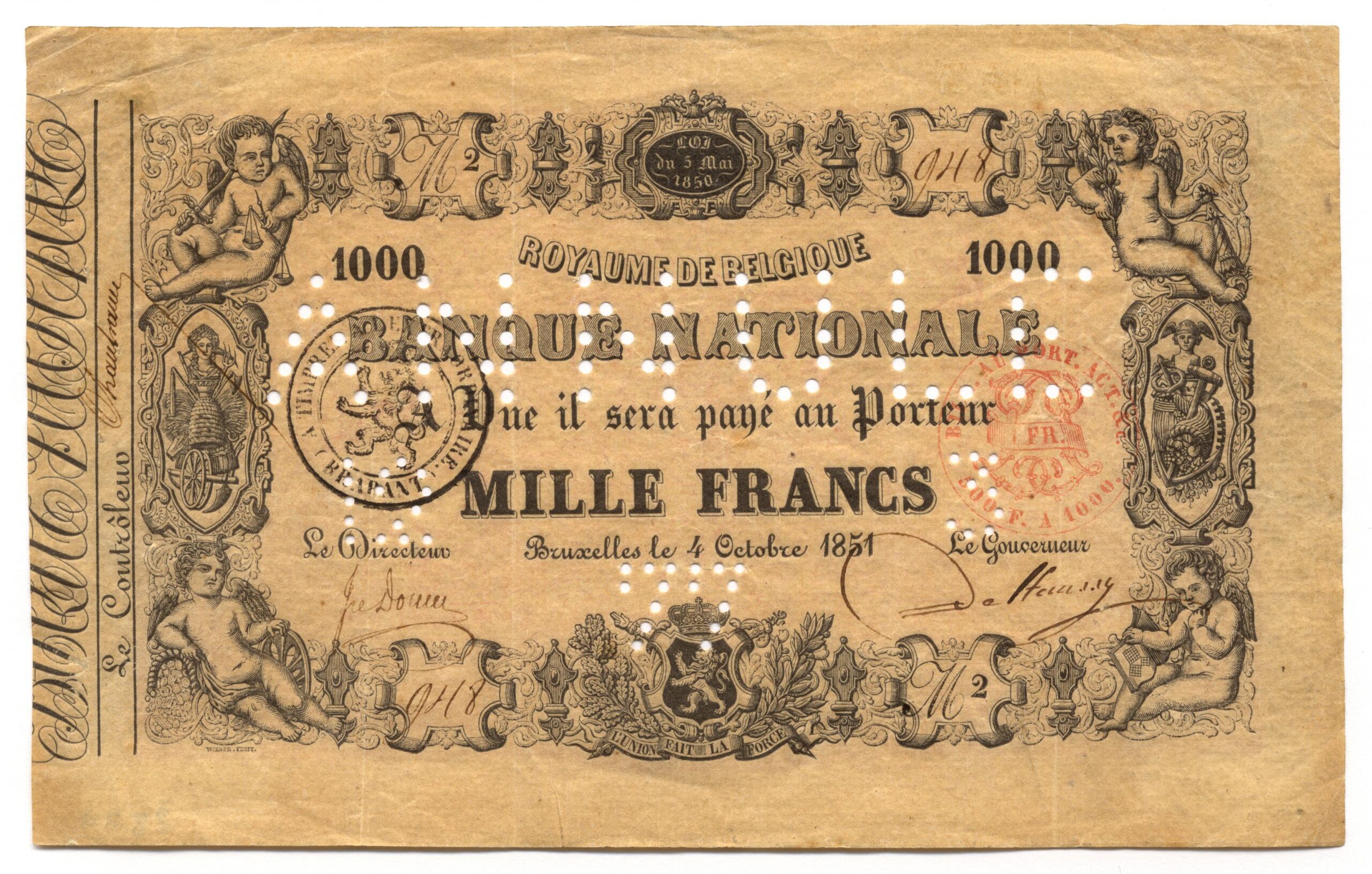

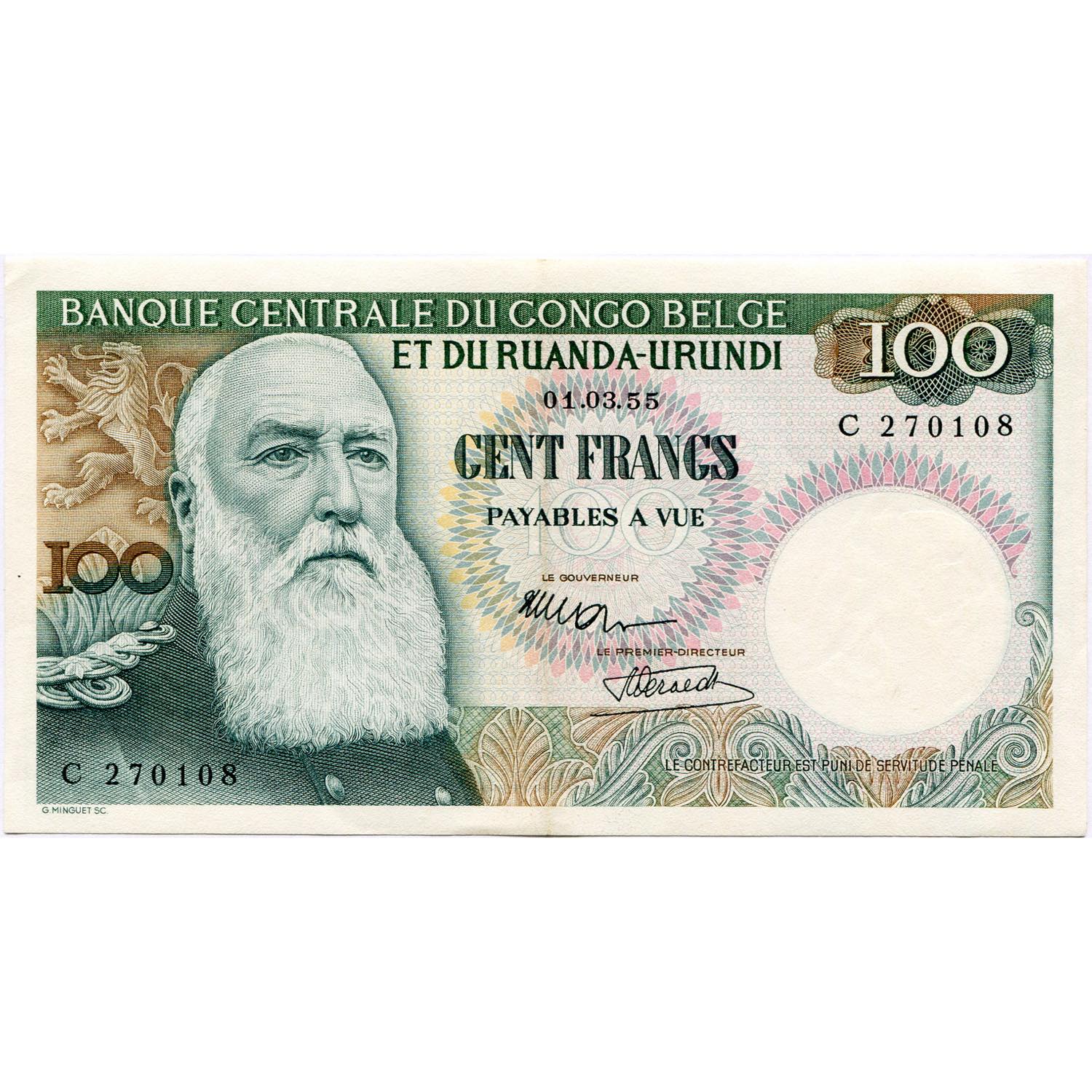
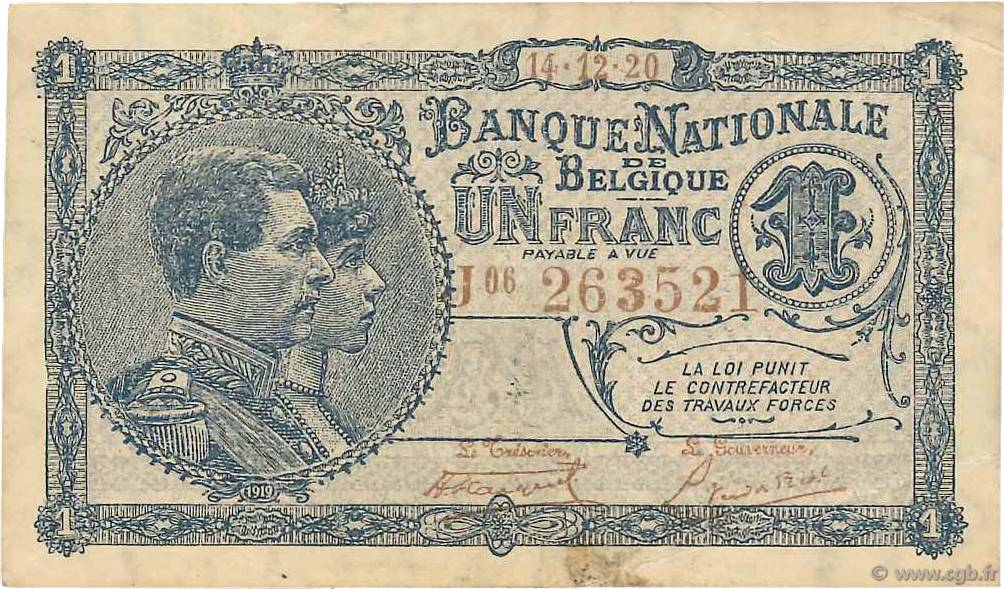






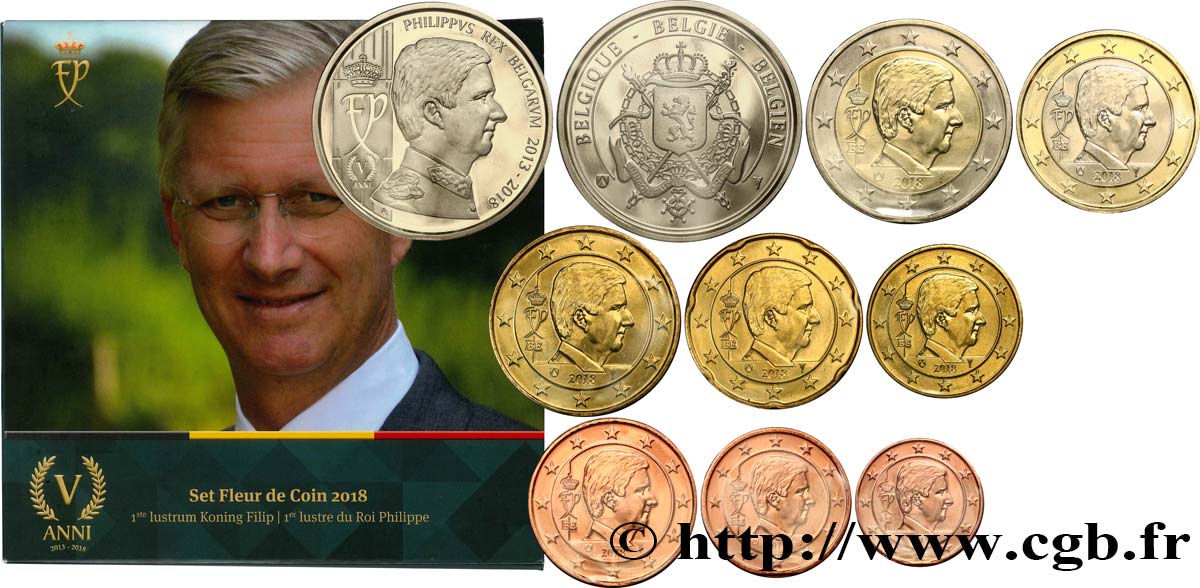
8.2) Et si le roi Baudouin au lieu de choisir son frère Albert II comme son successeur avait choisi son neveu, à l’époque le prince Philippe?
Dans la réalité, le prince Philippe était jugé trop inexpérimenté, maladroit et critiqué pour son manque de charisme, ce qui explique le choix d’Albert II. Mais si le roi Baudouin avait insisté ou manœuvré pour que son neveu lui succède directement, cela changerait beaucoup de choses. De toute façon dans notre réalité à cause de la Constitution belge, le roi Baudouin n’aurait su choisir son successeur mais dans cette uchronie imaginons que cela soit le cas.
Voici la chronologie:
En 1993, le roi Baudouin meurt, en réalité, le roi Albert II monte sur le trône. Dans cette uchronie le roi Baudouin, très pieux et soucieux de la continuité, aurait laissé entendre à ses proches et au gouvernement Dehaene qu’il voyait le prince Philippe comme son héritier naturel. Sous pression morale et politique, le Parlement modifie la ligne de succession pour le faire accéder directement au trône. Le prince Philippe devient Philippe Ier, roi des Belges, à 33 ans.
Entre 1993 et 1995, le roi Philippe est critiqué dans la presse pour sa raideur et ses maladresses. Il a du mal à incarner l’unité nationale. Sa faible maîtrise des langues, surtout le flamand, envenime la question communautaire.
En 1996, durant Affaire Dutroux, le roi Philippe peine à trouver le ton juste, contrairement à Albert II dans la réalité. La monarchie en sort affaiblie.
En 1999, le roi Philippe commet plusieurs impairs diplomatiques, accentuant les doutes.
En 2001, le roi Philippe épouse Mathilde d’Udekem d’Acoz. Le mariage redonne un peu de popularité à la couronne, mais la presse reste sceptique.
Entre 2007 et 2011, il y a des crises politiques à répétition, le rôle d’arbitre du roi est jugé incompétent. Plusieurs voix flamandes réclament la fin de la monarchie.
Entre 2010 et 2011, la longue crise gouvernementale est aggravée, le roi Philippe peine à concilier la N-VA et les partis francophones. Certains éditorialistes évoquent une « monarchie inutile ».
En 2013, en réalité, le roi Albert II abdique en faveur du prince Philippe. Ici, le roi Philippe règne déjà depuis vingt ans. Les appels à une abdication forcée se multiplient.
En 2014, la N-VA devient la première force en Flandre. Bart De Wever réclame un référendum sur la monarchie.
En 2016, durant les attentats de Bruxelles le roi Philippe fait un discours sans charisme. Les critiques explosent.
En 2019, les partis républicains comme le PTB, DéFI et certains libéraux flamands réclament une réforme constitutionnelle pour mettre fin à la monarchie.
En 2020, pendant la pandémie, le roi Philippe peine à incarner un rôle rassurant. La comparaison avec des chefs d’État élus renforce la critique du système monarchique.
En 2024, des manifestations étudiantes éclatent à Bruxelles et Gand contre « la monarchie inutile ».
En 2025, deux issues sont possibles :
Le roi Philippe abdique sous pression, sa fille la princesse Elisabeth devient reine, dans une monarchie affaiblie. Soit il y a un compromis institutionnel menant à une monarchie purement symbolique, proche des modèles scandinaves, voire à une république fédérale belge.
Voici les témoignages fictif concernant cette uchronie:
Témoignage fictif à Bruxelles en 1996 d’un manifestant de la Marche blanche:
« Le roi nous a parlé… mais on avait l’impression d’écouter un étudiant lire une rédaction. Il n’a pas su nous comprendre. »
Témoignage fictif à Anvers en 2007 d’un éditorialiste flamand:
« Un roi qui ne sait pas parler le flamand correctement ne peut pas régner sur la Flandre. Philippe n’est pas notre roi. »
Témoignage fictif à Liège en 2014 d’un Professeur de droit constitutionnel:
« Depuis 20 ans, le roi Philippe Ier accumule les maladresses. Il est temps de repenser nos institutions. Pourquoi un roi quand nous pourrions élire un président ? »
Témoignage fictif à Bruxelles en 2025 d’un étudiant francophone:
« Je respecte le roi Philippe, il a essayé. Mais il n’a jamais su être le roi de tous les Belges. Pour ma génération, la monarchie est morte. »

8.4) Et si le service militaire obligatoire n’avait jamais été aboli en Belgique?
En réalité, il a été suspendu progressivement à partir de 1994 et officiellement supprimé en 1995.
Voici la chronologie de l’uchronie:
Entre 1994 et 2000, il y a le Maintien du service. Tous les jeunes Belges, hommes et progressivement femmes, continuent à effectuer 12 à 18 mois de service militaire. L’armée reste populaire mais stricte, intégrée dans la société. Les casernes forment encore un lieu de socialisation. Les partis politiques utilisent le service militaire comme outil d’éducation civique et de patriotisme.
Entre 2000 et 2010, le service obligatoire favorise un sentiment d’unité belge, surtout entre Flamands, Wallons et Bruxellois. Les jeunes acquièrent une discipline et des compétences militaires de base. Les mouvements pacifistes et antimilitaristes existent mais ils sont minoritaires. L’armée devient un outil d’intervention civile notamment d’aide aux inondations, des catastrophes, pour les missions de sécurité intérieure.
Entre 2010 et 2020, le maintien du service obligatoire réduit le pouvoir des groupes radicaux, les jeunes sont socialisés à l’armée et ont donc plus de respect pour l’ordre. Les partis nationalistes flamands ou wallons doivent composer avec une population plus homogène, socialisée à l’échelle nationale. La Belgique participe plus facilement à des missions internationales de l’OTAN, car elle dispose toujours d’une réserve importante et d’une armée entraînée.
Entre 2020 et 2025, le service obligatoire reste un rite de passage pour les 18 à 21 ans. Les jeunes reçoivent à la fois une formation militaire et citoyenne avec des droits, des devoirs, en matière de sécurité. L’armée belge conserve une taille respectable et un rôle visible dans la vie civile avec des patrouilles, de l’aide en cas de crise, et la prévention des catastrophes. La cohésion belge est renforcée, mais certains jeunes considèrent le service comme un passage contraignant dans un monde moderne où la guerre n’est plus imminente.
Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Témoignage fictif à Anvers en 2005 d’un jeune homme:
« Douze mois dans les casernes m’ont appris le respect, la discipline et à vivre avec des jeunes de toutes les régions. »
Témoignage fictif à Liège en 2015 d’une jeune femme:
« J’ai fait mon service militaire. C’est étrange de marcher avec un fusil à l’épaule, mais j’ai rencontré des gens que je n’aurais jamais connus autrement. »
Témoignage fictif à Bruxelles en 2020 d’un enseignant:
« Les anciens conscrits racontent souvent comment cela a changé leur vision du pays. Ils sont plus conscients de leurs droits et devoirs. »
Témoignage fictif à Namur en 2025 d’un étudiant:
« Tout le monde doit passer par là. Certains râlent, mais je pense que ça nous rend plus responsables et solidaires. »

8.5) Et si l’Affaire Dutroux avait beaucoup dégénérée?
En Juin 1996, il y a l’Arrestation de Marc Dutroux, en réalité très médiatisée. Ici, les médias révèlent des détails encore plus horribles avec une complicité supposée de personnalités influentes et des réseaux occultes. La population est choquée au-delà de l’imaginable, et la méfiance envers la justice explose.
En Septembre 1996, une Marche blanche nationale est organisée. Dans notre réalité, quelques centaines de milliers de personnes participent, dans cette uchronie plusieurs millions de Belges convergent vers Bruxelles. La marche devient une manifestation quasi-insurrectionnelle, les belges réclament une justice totale et immédiate pour Dutroux, et s’en prennent aux juges et policiers jugés « laxistes ». Les slogans : « Mort à Dutroux ! » et « Les juges doivent payer ! » envahissent les rues.
En Décembre 1996, les manifestants forment des comités de contrôle qui exigent des tribunaux populaires. Les magistrats et les enquêteurs impliqués dans les négligences sont suspendus, jugés et symboliquement condamnés par des assemblées de citoyens dans certaines villes comme Liège, Charleroi et Bruxelles. Les médias internationaux assistent, stupéfaits, la Belgique est perçue comme un État où la population reprend la justice dans ses mains.
Entre 1997 et 1998, sous pression populaire, le gouvernement adopte des mesures radicales, la Justice est ouverte à un contrôle citoyen pour tous les procès criminels. Il y a les peines minimales qui sont supprimées pour les crimes graves sur des enfants. Il y a la mise en place de tribunaux mixtes avec des citoyens et des professionnels. Marc Dutroux est jugé rapidement, condamné à mort, une mesure symbolique qui choque l’Europe, car la peine de mort avait été abolie depuis longtemps en Belgique.
Entre 1998 et 2005, le pays se divise politiquement, à droite, des mouvements populistes prônent la justice extrême et la surveillance citoyenne, à gauche, des voix dénoncent la dérive autoritaire et l’emprise de la rue sur l’État. Les affaires similaires avec des enlèvements ou des crimes graves sont jugées dans des tribunaux mixtes où la population a voix au chapitre. La Belgique devient un exemple de justice populaire en Europe.
Entre 2006 et 2025, La mémoire de cette « révolte citoyenne » reste vivace, avec une marche blanche géante annuelle à Bruxelles, devenue jour de commémoration. L’opinion publique se radicalise sur les crimes sexuels et les enfants. Les magistrats sont désormais ultra-contrôlés, et la population n’hésite pas à manifester pour sanctionner ce qu’elle considère comme des failles judiciaires. La Belgique reste un pays stable politiquement, mais la peur et la vigilance citoyenne deviennent des valeurs centrales de la société.
Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Témoignage fictif à Bruxelles en 1996 d’une mère d’un enfant disparu:
« Je marchais parmi des millions. Nous avons crié, été devant les tribunaux. Les juges qui ont échoué devaient payer. Ce n’était plus seulement Dutroux, c’était tout le système. »
Témoignage fictif d’un magistrat suspendu en 1997:
« Je n’avais jamais vu ça. Les citoyens nous jugeaient, nous condamnaient… C’était humiliant, mais impossible de résister. »
Témoignage fictif à Charleroi en 2000 d’un étudiant:
« La peur de Dutroux a marqué toute ma génération. Chaque histoire d’enfant disparue fait trembler les adultes et nous forme à la vigilance citoyenne. »
Témoignage fictif d’une historienne à Bruxelles en 2025:
« La Belgique post-Dutroux est née de cette marche blanche extrême. Elle reste un pays démocratique, mais où la rue dicte la justice plus que jamais. »





8.6) Et si l’Affaire Dutroux n’avait jamais eu lieu?
Voici la chronologie de cette uchronie:
Entre 1995 et 1996, les médias n’ont pas à couvrir un scandale national. Il n’y a pas de Marche blanche et pas de débats sur la justice défaillante. La confiance dans la police et la justice reste relativement intacte, surtout à Bruxelles et en Wallonie. Les dossiers de la protection de l’enfance et de la pédocriminalité restent plus confidentiels, moins médiatisés, donc il y a moins de pression pour une réforme immédiate.
Entre 1997 et 2000, il y a moins de réformes judiciaires En réalité, l’affaire Dutroux a entraîné une refonte partielle du système judiciaire ,une meilleure coordination des services, et la création de la « cellule enfants disparus ». Ici, sans scandale, la police et la justice restent fragmentées et lentes. Les tribunaux gardent leurs pratiques bureaucratiques traditionnelles. La Belgique n’adopte pas de nouvelles lois anti-pédocriminalité aussi rapidement.
Durant les années 2000, il n’y a pas de traumatisme collectif majeur sur la sécurité des enfants. La Marche blanche, qui a symbolisé l’unité nationale et la mobilisation citoyenne, n’existe pas. Les débats sur la responsabilité des juges et la défiance envers l’État restent moins virulents. La société est moins militarisée par la peur, il y a moins de vigilance excessive, moins de propagande médiatique sur les crimes pédocriminels.
Entre 2010 et 2025, la Belgique est moins obsédée par la sécurité des enfants et les contrôles sociaux massifs. L’opinion publique reste plus confiante envers l’État et les institutions judiciaires. Sur le plan politique, les partis populistes ne peuvent pas utiliser Dutroux comme un symbole d’échec de l’État avec une montée de “l’extrême droite” plus lente. Les médias et la télévision sont moins focalisés sur le sensationnalisme, ce qui modifie le paysage médiatique belge.
Voici les Témoignages fictifs:
Témoignage fictif à Bruxelles en 1996 d’un journaliste:
« Cette année, nous n’avons pas eu à couvrir un scandale national. La Belgique semble normale, et la confiance dans les institutions restait intacte. «
Témoignage fictif à Liège en 2005 d’une mère:
« On parlait de sécurité des enfants, mais sans hystérie. Les enfants jouaient dehors, les parents faisaient confiance aux enseignants et à la police. »
Témoignage fictif à Anvers en 2020 d’un historien:
« La Belgique aurait pu éviter un traumatisme national immense. La société reste moins marquée par la peur et le soupçon. On peut parler d’une génération plus sereine. »

8.7) Et si la gendarmerie n’avait jamais été abolie en Belgique?
Voici la chronologie:
En 2001, après les scandales des années 1990, le gouvernement tente de réformer la gendarmerie mais les pressions syndicales et politiques notamment à Droite et chez certains bourgmestres bloquent le projet. La Belgique garde deux corps distincts, la gendarmerie armée à statut militaire et compétences nationales et la police communale sous l’autorité des bourgmestres.
Durant les années 2000, la gendarmerie se renforce dans ses missions avec la lutte contre le grand banditisme et la sécurisation des autoroutes et le maintien de l’ordre. Les attentats du 11 septembre 2001 et la montée des menaces terroristes servent de justification politique pour conserver un corps militarisé. Les polices communales restent fragmentées avec une coopération difficile, mais la gendarmerie compense par son efficacité dans les opérations à l’échelle de la Belgique.
Durant les années 2010, pendant les attentats de Bruxelles en 2016, la gendarmerie est en première ligne. Sa culture militaire permet une réaction rapide, ce qui améliore son image auprès de la population mais les tensions avec la police locale augmentent notamment à cause des compétences qui se chevauchent des jalousies et des luttes de pouvoir. L’Union européenne critique la dualité belge, jugée inefficace et archaïque.
En 2025, la Belgique est l’un des rares pays européens à avoir encore une gendarmerie militarisée. Le pays ressemble à la France ou à l’Italie avec une coexistence entre les polices civiles et la gendarmerie. La gendarmerie est perçue comme plus respectée et plus disciplinée, mais aussi plus dure et moins proche de la population. Les débats politiques sont vifs, certains réclament encore une police unifiée, d’autres estiment que la gendarmerie est indispensable face au terrorisme, au crime organisé et aux émeutes urbaines.
Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un Gendarme en 2005:
« On nous avait promis la fusion. Finalement, on est toujours là. Les gens savent que quand ça chauffe, c’est nous qu’on appelle. »
Témoignage fictif d’un bourgmestre de Liège en 2012:
« C’est ingérable ! La gendarmerie intervient sans me prévenir. J’ai une police communale sous mes ordres, mais elle est constamment court-circuitée. »
Témoignage fictif à Bruxelles d’une habitante de Bruxelles en 2016 après les attentats.
« Quand j’ai vu les gendarmes patrouiller dans mon quartier, j’ai eu peur au début. Mais en fait, je me suis sentie protégée. Ils étaient rapides, organisés, pas comme la police communale. »
Témoignage fictif d’un sénateur écologiste en 2023:
« La Belgique est coincée dans un système dépassé. La gendarmerie nous coûte cher, et ses méthodes militarisées ne correspondent pas à une démocratie moderne. »
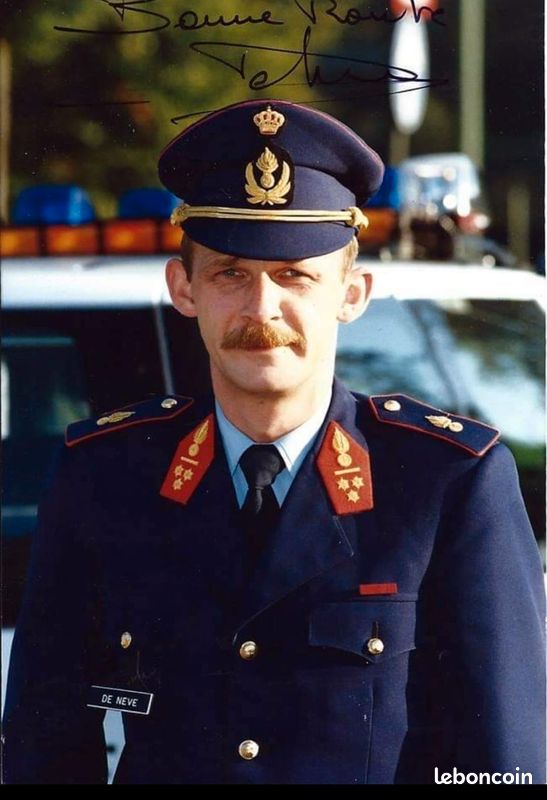
8.8) Et si la crise gouvernementale de 2007 à 2010 s’était beaucoup aggravée?
Les élections de juin 2007 donnent la victoire aux partis flamands, qui réclament plus d’autonomie fiscale et institutionnelle. Les francophones refusent avec des blocages. Après des mois de négociations, le discours de Yves Leterme échoue à calmer la situation.
En 2008, En Flandre, les médias comme la VTM, Het Laatste Nieuws se mettent à parler ouvertement de confédéralisme. Le Vlaams Belang et la N-VA exploitent la crise pour mobiliser la rue. Il y a des manifestations massives à Anvers et Gand, demandant une « Vlaamse Republiek ». La Wallonie, inquiète, se tourne de plus en plus vers la France.
En 2009 avec l’incapacité totale de former un gouvernement, le Roi Albert II apparaît impuissant. La Flandre décide unilatéralement de créer un parlement souverain en parallèle. La RTBF diffuse un reportage spécial intitulé « Belgique : la fin », inspiré directement de Bye Bye Belgium, qui provoque un effet boule de neige, il y a de la panique dans les gares avec des manifestations à Bruxelles, et une fuite de capitaux.
En 2010, la crise atteint son sommet, la Flandre déclare son autonomie fiscale, la Wallonie lance un référendum consultatif sur un rattachement à la France, Bruxelles se retrouve isolée, prise entre les deux camps. La Belgique cesse de fonctionner comme un État unitaire, les ministères fédéraux sont paralysés. L’UE, paniquée, intervient diplomatiquement pour éviter une guerre civile.
Entre 2011 et 2015, il y a trois voies, la Flandre proclame la République flamande, reconnue rapidement par les Pays-Bas et certains pays européens. La Wallonie après de longues négociations avec Paris en 2015, la Wallonie devient une région française à statut spécial comme la Corse. Bruxelles devient une Région-Capitale européenne, administrée conjointement par l’UE et l’ONU, une sorte de « Washington DC européen ».
Entre 2016 et 2025, L’ex-Belgique devient un laboratoire unique en Europe, la Flandre prospère économiquement, mais reste sous tension avec Bruxelles. La Wallonie connaît une période difficile d’adaptation, accusée de « vivre aux crochets de Paris ». Bruxelles devient une ville internationale, avec un siège officiel de l’UE et de l’OTAN, mais elle n’est plus belge.
Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un journaliste RTBF en décembre 2009:
« Quand on a diffusé le reportage Belgique : la fin, les lignes téléphoniques ont explosé. Les gens croyaient vraiment que la Flandre avait quitté le pays. On ne faisait plus la différence entre fiction et réalité. »
Témoignage fictif d’une habitante de Namur en 2010:
« On a toujours cru que la Belgique survivrait à tout. Mais là, plus de gouvernement, plus de drapeau, plus rien. J’ai voté pour rejoindre la France. »
Témoignage fictif d’un étudiant flamand à Gand en 2012:
« Enfin libres ! Mais quand je vais à Bruxelles, je me sens étranger. C’est comme si on avait perdu notre capitale. »
Témoignage fictif d’un diplomate européen en 2015:
« Bruxelles est devenue une ville hors-sol, un territoire international. Sans la Belgique, l’Union européenne a perdu un symbole, mais elle a gagné un laboratoire politique. »

8.9) Et si les attentats de Belgique en 2016 avaient été beaucoup plus terribles?
Voici la chronologie de cette uchronie:
Le 22 Mars 2016, les terroristes parviennent à placer plus d’explosifs dans l’aéroport et dans plusieurs stations de métro y compris Schuman et Arts-Loi, au cœur du quartier européen. Il y a plus de 500 morts, dont de nombreux diplomates et fonctionnaires européens. Bruxelles est décrite comme « le 11 septembre européen ».
Entre le 23 Mars et Avril 2016, la Belgique entre en état d’urgence permanent. L’armée patrouille partout dans les aéroports, les gares et les quartiers sensibles. Il y a la fermeture temporaire des institutions européennes et Bruxelles est paralysée. Un débat s’ouvre au sein de l’UE, faut-il déplacer la capitale ailleurs?
Entre 2017 et 2019
Il y a une adoption de lois antiterroristes très strictes avec un contrôle de masse dans les quartiers de Molenbeek, de Schaerbeek et d’Anderlecht. Il y a un internement préventif des suspects, il y a une déchéance de nationalité pour les binationaux impliqués. Il y a la montée en flèche du Vlaams Belang et de la N-VA en Flandre, mais aussi du PTB en Wallonie qui dénonce « l’État policier ». Bruxelles devient un symbole mondial du terrorisme avec la chute du tourisme et son isolement.
En 2020, la pandémie de Covid-19 se combine avec le traumatisme de 2016, la population accepte des mesures de surveillance numérique très strictes. La Belgique devient l’un des États européens les plus sécuritaires.
En 2025, la fracture communautaire s’aggrave, en Flandre, il y a des discours comme « il faut fermer les frontières et expulser massivement », en Wallonie, il y a la résistance contre un État jugé trop autoritaire par le PTB. L’UE renforce ses services de renseignement avec la création d’une agence antiterroriste européenne, basée à Bruxelles comme symbole de résistance. En 2025, Bruxelles est encore marquée par ces événements, avec des zones entières réaménagées avec un aéroport ultra-sécurisé, et un métro modernisé. La présence policière est permanente, le traumatisme collectif est durable.
Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’une survivante de Maelbeek en Mars 2016:
« Quand j’ai ouvert les yeux, j’étais sous les décombres. Des cris partout. J’ai cru que j’étais morte. C’était l’enfer. »
Témoignage fictif d’un fonctionnaire européen en Avril 2016:
« Dans mon service, on a perdu huit collègues. Bruxelles n’est plus la même. On travaille désormais avec la peur au ventre. »
Témoignage fictif d’un policier à Molenbeek en 2018:
« Chaque nuit, on fait des descentes. C’est devenu un quartier assiégé. Les habitants nous détestent, mais on nous ordonne de continuer. »
Témoignage fictif d’un jeune étudiant en 2025:
« Je n’avais que 8 ans en 2016. J’ai grandi avec les chars dans les rues, les contrôles permanents. Pour nous, la liberté, ça n’existe plus vraiment. »


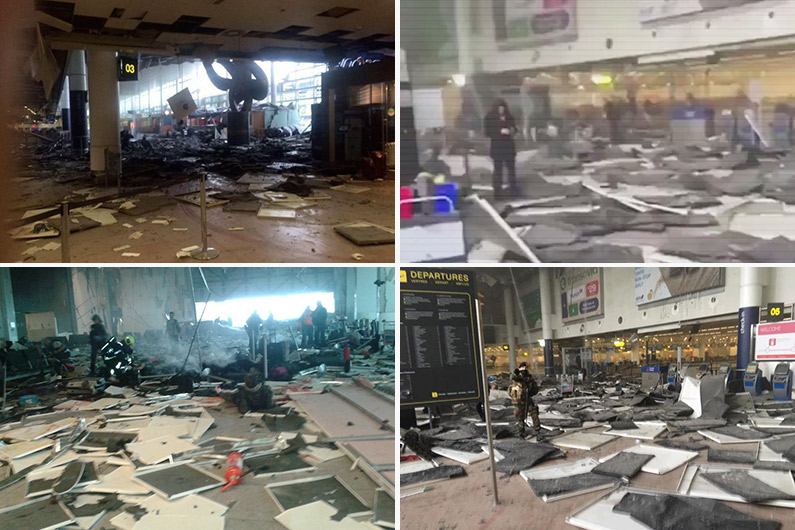
8.10) Et si les attentats en Belgique de 2016 n’avaient pas eu lieu?
Voici la chronologie:
Les attentats du 22 mars à l’aéroport de Zaventem et le métro Maelbeek n’ont pas lieu avec aucune explosion et aucun mort. Bruxelles reste une capitale européenne « normale » avec des institutions ouvertes, un métro fonctionnel et des aéroports pleins. Il n’y a aucun traumatisme collectif, le pays ne bascule pas dans l’état de choc national et international.
Entre 2016 et 2017, les autorités belges continuent à lutter contre le terrorisme, mais sans le sentiment d’urgence nationale qui avait suivi les attaques réelles. Les lois antiterroristes adoptées sont moins restrictives. La surveillance des quartiers à forte densité immigrée est limitée, ce qui réduit les tensions communautaires.
Entre 2018 et 2020, La population reste plus confiante, moins traumatisée. Molenbeek, Schaerbeek et Anderlecht ne deviennent pas des synonymes de radicalisation pour l’opinion publique internationale. Le tourisme reprend normalement, Bruxelles conserve sa réputation de capitale européenne et culturelle.
En 2025, L’Union européenne n’accélère pas immédiatement la création d’une agence antiterroriste européenne centralisée, ou du moins pas dans les mêmes conditions. La Belgique reste perçue comme un partenaire fiable, sans être associée au terrorisme international. Les politiques sécuritaires sont moins intrusives avec moins de surveillance numérique et moins de contrôles renforcés dans les transports publics.
Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un touriste français en 2017:
« Je me souviens avoir visité Maelbeek et l’aéroport sans aucune peur. Bruxelles semblait normale, accueillante, pas comme dans les journaux du monde entier. »
Témoignage fictif d’un fonctionnaire européen en 2018:
« On travaillait tranquille. Il n’y avait pas de patrouilles militaires dans les rues et pas de métros vides. Bruxelles respirait la sérénité. »
Témoignage fictif d’une habitante de Molenbeek en 2020:
« Les gens ne regardaient pas tout le monde comme des suspects. Les enfants jouaient dans la rue, tout était normal. »
Témoignage fictif d’une journaliste internationale en 2025:
« Bruxelles reste une capitale européenne vivante et sûre. On oublie parfois que cela n’a pas toujours été le cas dans l’histoire récente des villes européennes. ».
8.11) Et si la crise gouvernementale en Belgique de 652 jours entre 2019 et 2020 avait été beaucoup plus grave?
Après les élections fédérales d’octobre 2019 il y a eu un blocage complet entre les partis flamands comme la N-VA et le Vlaams Belang et francophones comme le PS et le MR sur les réformes institutionnelles et fiscales. En réalité, la Belgique fonctionna avec un gouvernement intérimaire. Dans cette uchronie, le blocage s’aggrave avec un paroxysme avec des tensions communautaires et sociales.
Voici la chronologie de cette uchronie:
Entre Novembre 2019 et Février 2020, la Flandre réclame des transferts fiscaux massifs et une autonomie totale pour certaines compétences comme la santé, la sécurité et l’éducation. La Wallonie menace d’un référendum sur le rattachement à la France pour renforcer son poids politique. La paralysie entraîne des manifestations massives dans les grandes villes comme Bruxelles, Anvers ou Liège. Le gouvernement fédéral intérimaire perd toute légitimité avec un blocage complet des décisions.
Entre Mars et Décembre 2020, les entreprises craignent l’instabilité et donc il y a une fuite de capitaux et des délocalisations massives. Le chômage augmente fortement, notamment chez les jeunes. Les services publics fonctionnent au ralenti comme les transports, les hôpitaux, les écoles, il y a une colère populaire. Des milices communautaires apparaissent dans certaines zones comme des volontaires flamands pour sécuriser la Flandre, et des comités citoyens wallons pour protéger leur autonomie.
En 2021, La Belgique, déjà fédérale, bascule dans une semi-sécession de fait, La Flandre s’autogère presque entièrement, imposant des taxes et des lois locales. La Wallonie tente de rester solidaire avec Bruxelles, mais la capitale est paralysée. Les partis extrémistes gagnent du terrain comme le Vlaams Belang et le PTB prospèrent, exploitant la peur et l’incapacité de l’État.
Entre 2022 et 2025, finalement, un gouvernement de compromis est formé en 2023, mais il a un pouvoir très limité. La Belgique est désormais un État quasi-balkanisé car la politique nationale faible, la Flandre est très autonome, la Wallonie et Bruxelles sont dans une situation d’endettement et d’isolement. Bruxelles devient un terrain de négociation international, où l’UE doit intervenir pour garantir la stabilité.
Voici les Témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un habitant de Bruxelles en 2021:
« On ne savait plus qui décidait quoi. La police flamande patrouillait dans certaines rues, la Wallonie avait ses propres forces… On se sentait comme dans un pays en guerre civile silencieuse. »
Témoignage fictif d’un chef d’entreprise à Anvers en 2022:
« Nos bureaux sont vides, nos clients fuient. Personne ne sait qui légifère sur quoi. C’est l’horreur pour le business. »
Témoignage fictif d’une étudiante universitaire à Liège en 2023:
« Les transports ne fonctionnaient plus, les cours étaient annulés… On vivait dans un pays à l’arrêt. »
Témoignage fictif d’un diplomate européen en 2024:
« Bruxelles est paralysée, mais on doit continuer à tenir l’UE ici. C’est un vrai défi de gouvernance. »

8.12) Et si le Covid avait été beaucoup plus terrible en Belgique que dans la réalité?
En réalité, la Belgique a connu plus de 35 000 morts liés au Covid-19 et un confinement sévère, mais relativement gérable. Dans cette uchronie, le virus est plus contagieux et plus létal, avec un taux de mortalité doublé entre 5 à 6 % au lieu de 2 à 3 %, et frappe plus violemment les hôpitaux belges qui sont déjà saturés.
Entre Février et Mars 2020, les premiers cas belges explosent dès février 2020. Les hôpitaux wallons et flamands sont rapidement saturés avec un manque de lits, d’oxygène et de matériel. Le gouvernement tarde à réagir, les mesures de confinement sont tardives et insuffisantes. Il y a des décès massifs dans les maisons de repos, touchant particulièrement les personnes âgées.
Entre Avril et Juin 2020, Le personnel hospitalier est débordé, il y a des burnouts massifs et des grèves sanitaires. Les morgues ne suffisent plus et il y a des recours aux camions frigorifiques à Bruxelles et à Anvers. Il y a une panique sociale avec des queues massives dans les supermarchés, il y a une fermeture totale des transports en commun. Bruxelles devient le centre symbolique du chaos européen.
Entre Juillet et Décembre 2020, la population critique sévèrement le gouvernement fédéral et régional pour inaction et désorganisation. Les tensions communautaires s’aggravent, la Flandre accuse la Wallonie de mauvaise gestion des hôpitaux. La Wallonie dénonce la lenteur flamande dans la protection des maisons de retraite. Il y a des manifestations massives et des violences urbaines ponctuelles avec certains quartiers mis sous couvre-feu.
En 2021, L’UE intervient pour soutenir la Belgique, des médecins et du matériel sont envoyés d’Allemagne, de France et des Pays-Bas. Les vaccins sont disponibles plus tard qu’ailleurs la Belgique devient un point noir européen du Covid-19. Le gouvernement adopte des mesures extrêmement strictes comme le confinement permanent, le couvre-feu à l’échelle de la Belgique et la fermeture complète des frontières.
Entre 2022 et 2025, la Belgique souffre d’une récession historique avec un chômage record, des entreprises fermées et des faillites en cascade. Le traumatisme collectif transforme la société, il y a une peur permanente de nouvelles épidémies, il y a la montée du patriotisme sanitaire avec le contrôle strict des frontières et la quarantaine obligatoire. Le système de santé est profondément réformé avec une augmentation massive des lits d’hôpitaux, de la modernisation mais il y a des tensions sociales persistantes.
Voici les Témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’un médecin à Mons, en avril 2020:
« Nous étions dépassés. Chaque jour, des dizaines de patients mouraient sans que nous puissions les sauver. C’était comme la guerre. »
Témoignage fictif d’une habitante de Bruxelles en Mai 2020:
« Les rues étaient vides, les hôpitaux saturés. La peur était partout. On ne savait plus qui survivrait. »
Témoignage fictif d’un fonctionnaire européen en juin 2020:
« Bruxelles était paralysée. L’UE a dû envoyer des médecins et du matériel, mais le chaos régnait. »
Témoignage fictif d’un jeune étudiant en 2022:
« J’ai perdu plusieurs membres de ma famille. La Belgique a changé pour toujours. On vit maintenant avec un traumatisme collectif énorme. »

8.13) Et si le Covid-19 n’avait pas eu lieu en Belgique?
En 2020, il n’y a pas de confinement, pas de couvre-feu, pas de télétravail forcé. Les écoles restent ouvertes et il n’y a pas de retard scolaire massif et pas d’isolement social pour les jeunes. Le système de santé fonctionne normalement avec aucune saturation hospitalière et aucune crise dans les maisons de repos. Il n’y a pas de récession liée au Covid au niveau des PME, les commerces,les restaurants et les bars continuent leurs activités normalement.Le tourisme belge à Bruxelles, Bruges, Gand et Anvers reste stable, voir est en légère hausse. Les transports publics et les infrastructures urbaines ne subissent pas de ralentissement ou de fermeture. Le gouvernement fédéral et régional n’est pas discrédité par une gestion de crise sanitaire. Il n’y a pas de tensions communautaires aggravées par la pandémie, la Flandre et la Wallonie restent concentrées sur les réformes institutionnelles et économiques habituelles. Les partis comme le Vlaams Belang et le PTB n’utilisent pas la crise sanitaire pour mobiliser l’opinion. La vie sociale reste normale avec des festivals, des manifestations, des événements sportifs, des concerts, des cafés. Il y a moins de stress psychologique et de troubles liés à l’isolement. Les habitants de Bruxelles et des autres grandes villes continuent à circuler et à travailler librement. La Belgique reste un partenaire solide dans l’UE, il n’y pas de perturbations majeures à Bruxelles. Les discussions sur la coordination européenne en matière de santé publique sont moins urgentes. L’UE n’a pas besoin de déployer de fonds d’urgence sanitaire massifs pour soutenir la Belgique.
Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie:
Témoignage fictif d’une commerçante à Bruxelles en mai 2020:
« Nous avons ouvert normalement. Les touristes étaient là, les cafés aussi. Il n’y a pas eu de perte de chiffre d’affaires et pas de stress lié au confinement. »
Témoignage fictif d’une étudiante à Louvain en avril 2020:
« Pas de cours en ligne, pas de solitude. On a continué nos études comme d’habitude, ça a fait une énorme différence pour notre moral. »
Témoignage fictif d’un hôtelier à Bruges en juillet 2020:
« Le tourisme a été excellent. Les Belges et les étrangers ont visité la ville sans crainte. On a évité la catastrophe économique que tout le monde craignait ailleurs. »
Témoignage fictif d’un journaliste européen en 2021:
« Bruxelles a continué à accueillir l’UE normalement. Il n’y a pas eu de patrouilles militaires et pas de tensions dans les institutions, rien n’a perturbé le fonctionnement de la capitale européenne. »
8.14) Et si la Belgique devenait féodale en 2025?
Je vous conseille avant de lire cette politique fiction de lire mes articles à ce sujet sur le Féodalisme et les corporations de métiers, ce scénario sera un résumé très rapide.
C’est plus une politique fiction qu’une uchronie car elle se passe à l’heure actuelle cependant on peut dire aussi que c’est une histoire alternative car on essaye de voir comment un pays fonctionnerait avec un système politique totalement différent. Évidemment aucun système politique n’est parfait.
C’est un scénario très improbable mais c’est drôle de se l’imaginer. Pour ma part ce serait le système idéal selon moi pour la Belgique.
En 2025, la Belgique est paralysée par une nouvelle crise institutionnelle, pire que celles de 2010 et 2019.
Face à l’impossibilité de former un gouvernement et à la montée des tensions communautaires, le roi proclame la restauration féodale.
La Belgique devient une Fédération féodale, inspirée du Saint-Empire romain germanique et des anciennes principautés du pays.
Parlons de l’organisation politique:
Tout d’abord nous avons le roi qui a comme Titre du Roi des Belges et Seigneur de Bruxelles. Son domaine direct est Bruxelles, devenue une Cité royale fédérale. Bruxelles ne dépend d’aucune principauté : elle est administrée directement par la couronne, avec l’aide d’une Corporation urbaine autonome. Le roi y conserve un château modernisé (l’ancien Palais royal de Bruxelles transformé en « Palais féodal »).
Les différentes principautés de la Fédération:
Le Comté de Flandre qui aurait la Maison van de Werve avec comme prétendant Olivier van de Werve d’Immerseel. Même si j’en avais mentionné beaucoup dans mon instant de belgitude sur le féodalisme, il faut bien en choisir un pour le scénario de même pour les prochaines principautés qui vont venir par la suite et qui ont des familles rivales.
Le Duché de Brabant plus le Marquisat d’Anvers celui-ci est en union personnelle, le prétendant est de la Maison de Hesse avec Donatus de Hesse.
Dans le Comté de Hainaut, il y aurait un prétendant de la Maison de Croÿ avec Hadrien de Croÿ-Rœulx.
Concernant le Comté de Luxembourg pour marquer une différence avec la Maison grand-ducale du Grand-Duché du Luxembourg. Trois familles ont le plus de légitimité, même si il y a beaucoup plus de familles mais selon moi elles sont les plus légitimes et je vais vous expliquer pourquoi:
La Maison de Croÿ avec la branche de Croÿ-Rœulx ou Croÿ-Dülmen: Les Croÿ ont toujours été parmi les plus puissantes familles du sud des Pays-Bas, très proches des Habsbourg. Ils ont des alliances anciennes avec les Luxembourg notamment via les Luxembourg-Saint-Pol et Luxembourg-Ligny. Aujourd’hui, un prétendant crédible serait Hadrien de Croÿ-Rœulx de la branche belge ou Rudolf von Croÿ-Dülmen de la branche allemande. Les Croÿ seraient donc les héritiers « de substitution » les plus légitimes.
Nous avons aussi la Maison de Looz-Corswarem , descendante des anciens comtes de Looz et Liège, installée historiquement dans les régions proches du Luxembourg. Cette famille a souvent été considérée comme des « princes étrangers » dans le Saint-Empire. Aujourd’hui, elle compte plusieurs membres actifs dans la noblesse belge. Par sa proximité géographique et sa tradition féodale, elle pourrait revendiquer le titre de comte de Luxembourg restauré.
Finalement nous avons la Maison de Lannoy qui est une vieille maison noble flamande, mais alliée à plusieurs reprises aux Luxembourg et aux Lamarck. Encore aujourd’hui représentée par Stéphanie de Lannoy, la grande-duchesse consort actuelle du Luxembourg). Dans un scénario féodaliste où l’on refuse les Nassau-Weilburg, la famille Lannoy pourrait apparaître comme un compromis historique et dynastique.
Dans le Duché de Bouillon on aurait la Maison de Rohan-Chabot avec Josselin de Rohan-Chabot.
Dans le Comté de Looz on aurait la Maison de Looz-Corswarem avec Olivier de Looz-Corswarem.
Concernant la Principauté ecclésiastique de Liège avec le prince-évêque élu monseigneur Monsieur Jean-Pierre Delville.
Concernant la Principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy, il pourrait s’agir de Dom François Lear.
Concernant les assemblées
Il y a tout d’abord le Parlement corporatiste avec la représentation par métiers.
Il y aurait une boulée avec un tirage au sort pour contrôler les abus.
Il y aurait le parlement des identités garantit les langues et les cultures régionales.
Il y a aussi une économie féodale mais qui est modernisée. Les nobles gèrent les terres, mais les paysans et artisans reçoivent un logement et un salaire fixe et 25 % de la production redistribuée. Les corporations régulent les métiers, organisent l’apprentissage et empêchent la concurrence sauvage. L’Église conserve un rôle central d’éducation, de santé et d’assistance. Les privilèges remplacent les décorations que cela soit des exemptions fiscales, des titres honorifiques ou des droits symboliques.
Voici la chronologie:
En 2025 il y a la Proclamation de la Fédération féodale. Bruxelles devient le Domaine royal qui est une capitale indépendante des principautés.
En 2026, les corporations sont rétablies. Les nobles reprennent leurs titres et leurs domaines historiques.
En 2028, Bruxelles se transforme en cité corporative, chaque quartier étant confié à une corporation par exemple le quartier des imprimeurs et le quartier des brasseurs.
En 2030, il y a une crise diplomatique avec l’UE, qui refuse de reconnaître la Belgique féodale.
En 2032, La Boulée impose plus de droits syndicaux corporatistes.
En 2035, Bruxelles devient une ville mondiale atypique, où gratte-ciel modernes côtoient des guildes médiévales et des cortèges de corporations en uniformes.
En 2040, la Belgique féodale est consolidée avec un mélange unique de traditionalisme et de modernité, avec un roi installé solidement dans sa capitale corporatiste.
Voici les témoignages fictifs:
Témoignage fictif d’un Bruxellois en 2030:
« Bruxelles n’est plus une ville comme les autres. Dans ma rue, les cordonniers portent leur bannière aux processions, et chaque corporation a son quartier. Le roi habite toujours au palais, mais il est plus proche du peuple : je l’ai vu assister à la messe dans notre paroisse. Certains disent que c’est du théâtre, moi j’y vois une dignité retrouvée. »
Témoignage fictif d’un Flamand du comté de Flandre en 2035:
« Notre comte nous protège, mais il faut payer en travail. Trois jours par semaine sur ses terres, en échange du logement et d’une part de la récolte. Ce n’est pas la liberté moderne, mais personne ici ne crève de faim, et les villes nous achètent nos produits via les corporations. »
Bruxelles est une cité féodale qui garantit l’équilibre entre les principautés. Les identités régionales sont protégées,les langues régionales aussi,les traditions ravivées. Il n’y a pas de chômage de masse, tout le monde est intégré dans les corporations ou travaille dans les champs
Le roi comme arbitre empêche l’éclatement des différentes principautés de la Fédération.
Et si le féodalisme était en Europe?
Les causes du retour au féodalisme auraient été les Crises des démocraties modernes avec la corruption, des partis politiques discrédités, et une abstention massive qui mène à un effondrement de la confiance.Le Covid-19 et les crises énergétiques renforcent l’idée d’un retour à l’« enracinement » local. Il y a aussi une montée des régionalismes avec la Catalogne, l’Écosse, la Corse, et la Flandre, au lieu de l’indépendance nationale, ils réclament une restauration des anciens duchés et des comtés. L’Église catholique et orthodoxe, retrouvent une place centrale en légitimant les princes et les seigneurs. Il y a une Délégitimation de l’Union européenne, remplacée par une Fédération européenne féodale, une sorte de « Saint-Empire rénové ».
Chaque pays revient à ses principautés historiques. Voici quelques exemples :
En Fédération belge, le roi est un souverain absolu mais limité par les nobles, les corporations et l’Église. Les corporations sont des acteurs économiques et politiques, remplaçant les partis.
En France, la monarchie est restaurée sous un Roi carliste avec la branche légitimiste des Bourbons, refusant les Orléans. Le royaume est fédéralisé en duchés historiques comme la Bretagne, la Bourgogne, la Normandie, la Provence… Paris redevient un domaine royal restreint. Le roi serait Louis XX.
En Allemagne, il y a la dissolution de la république fédérale. Il y a un retour à une Fédération germanique dominée par les Wittelsbach en Bavière et les Wettin en Saxe. Les Hohenzollern sont écartés car trop liés au nazisme. Pour la Bavière le prétendant le plus crédible est le Prince Ludwig de Bavière et concernant la Saxe ce sera Daniel de Saxe.
En Espagne, il y a l’abolition de la monarchie constitutionnelle.La couronne remise aux Carliste d’Espagne descendants de Carlos.L’Espagne est divisée en royaumes comme Castille, Aragon, Navarre, León et la Catalogne comtale, la Galice. Le prétendant le plus crédible sera Charles de Bourbon-Parme.
En Italie, La Monarchie fédérale est restaurée. La couronne est confiée à la Maison de Bourbon-Siciles comme légitime et catholique. Il y a le retour notamment des duchés de Toscane, Modène, Parme et du Royaume de Naples. Le prétendant est Pierre de Bourbon.
Au Portugal, il y a le Retour du roi légitime de la maison de Bragance. Le Portugal reste uni, mais avec une noblesse restaurée. Le prétendant est Duarte de Bragance.
En Pologne, la Monarchie est restaurée sous la maison de Radziwiłł ou de Czartoryski, les anciennes grandes familles princières. La noblesse de la « szlachta » retrouve son rôle politique. Le prétendant est Daniel de Saxe la même personne que nous avons vu la tout à l’heure.
En Russie, il y a le Retour de la maison Romanov, avec un tsar sacré par l’Église orthodoxe. Il y a un système féodal très hiérarchisé, proche de l’ancienne Russie médiévale. La prétendante au trône est la grande-duchesse Maria Vladimirovna.
Au Royaume-Uni, il y a le retour à une monarchie féodale avec des duchés puissants comme York, Cornwall, Lancaster…L’Écosse est restaurée sous un roi Stuart par adoption symbolique. Le prétendant serait comme nous l’avions vu la tout à l’heure le Prince-Ludwig pour le Royaume-Uni.
Voici d’autres témoignages fictifs
Témoignage fictif de Marie une boulangère à Anvers
« Je travaille pour le duc de Brabant. On dit qu’il prend 25 % de nos récoltes, mais au moins il nous assure logement et fête patronale. C’est mieux que les anciens patrons anonymes. »
Témoignage fictif de Dom François Lear, le prince-abbé de Stavelot-Malmedy:
« L’Europe est revenue à Dieu. Nous sommes redevenus les gardiens de la foi et du peuple. C’est une lourde charge, mais plus pure que les intrigues parlementaires. »
Témoignage fictif d’une étudiante à Dijon dans le Duché de Bourgogne:
« Nous avons perdu l’université nationale, mais gagné une petite académie ducale. Ici, on étudie l’histoire locale, la théologie, l’artisanat. C’est étrange, mais peut-être plus humain. »
Ces uchronies étaient à propos de la Belgique moderne du 27 Septembre 1830 à aujourd’hui mais si cela vous intéresserais je pourrai vous écrire un article de la période celte de la Belgique au 26 Septembre 1830 juste avant la Révolution belge.
En tout cas que Dieu vous bénisse et qu’il vous garde, vive la Belgique, vive l’Occident.




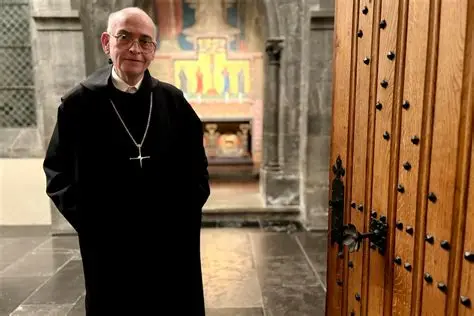



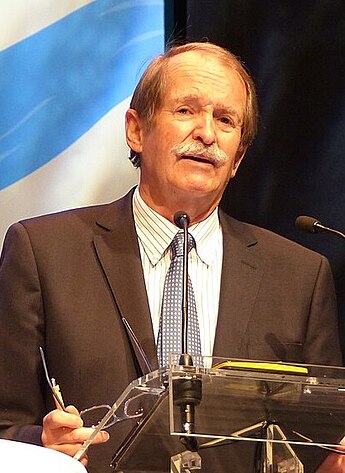

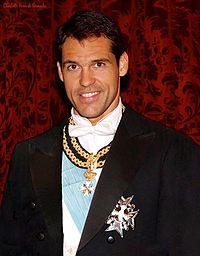

Les sources
1) Les différentes types de sources en Histoire: https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/histoire/analyse-de-documents-historiques-h1281µ
2) Hérodote le père de l’Histoire:https://www.universalis.fr/encyclopedie/herodote/
3) La Russie, le gendarme de l’Europe au XIXème siècle:http://institut-est-ouest.ens-lyon.fr/spip.php?article321#:~:text=Les%20r%C3%A9volutions%20de%201848%20le%20trouvent%20in%C3%A9branlable,sur%20place%20pour%20%C3%A9craser%20l%27insurrection%20(ao%C3%BBt%201849).
4) L’insurrection polonaise en 1830:https://fr.wikipedia.org/wiki/Insurrection_de_Novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insurrection_de_Novembre
5) La campagne des dix-jours:https://unionisme.be/livre/vankalkel-amalgame/chapitre/campagne-des-10-jours-traite-des-24-articles/
6) Pourquoi les révoltes de 1848 ne sont pas arrivées en Belgique et au Pays-Bas: https://lepassebelge.blog/2024/12/12/la-belgique-et-leopold-i-en-1848/#:~:text=Le%20%22printemps%20des%20peuples%22%20a%20vu%20les,devenu%20le%20souverain%20qu%27on%20consultait%20sur%20les
https://www.britannica.com/place/Netherlands/The-period-of-French-dominance-1795-1813
7) Les finances des Pays-Bas à l’époque: https://fr.wikisource.org/wiki/La_Hollande_depuis_1815
8)Le bombardement du port d’Anvers en 1830: https://www.histoire-des-belges.be/au-fil-du-temps/epoque-contemporaine/revolution-belge/les-hostilites
9) Et le Luxembourg:https://monarchie.lu/fr/la-monarchie/histoire-luxembourg-et-ses-dynasties
10) Si la Belgique avait reçu plus d’autonomie de la part de Guillaume Ier: https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_belge
11) Paul Van Zeeland favorable à l’UE: https://www.yerusha-search.eu/viewer/metadata/SAB-0730/?utm_
A better flag for the United Kingdom of the Netherlands : r/vexillology
12) La Sainte-alliance:Sainte-Alliance — Wikipédia
13) L’occupation danoise par les nazis:https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Danemark_pendant_la_Seconde_Guerre_mondiale
13)Pourquoi la Belgique est devenue une monarchie?:https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_monarchie_belge#:
14) Et si la Belgique était devenue une République?:https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_national_(Belgique)
https://www.alternatehistory.com/forum/threads/pc-belgium-was-founded-as-a-republic-in-1830.531608/
15) Le drapeau républicain belge en 1830:https://www.deviantart.com/politicalflags/art/Belgium-revolutionary-republican-flag-1213953299
Le président fictif de la Belgique et le chef de gouvernement:https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Constantin_de_Gerlache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Lebeau
Un roi français sur le trône de Belgique:C’est arrivé le 3 février 1831: Louis d’Orléans, élu roi des Belges
Le non-rétablissement de la principauté ecclésiastique de Liège: https://fr.wikipedia.org/wiki/Principaut%C3%A9_de_Li%C3%A8geµ
Le duché de Bouillon: https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Bouillon
Et si le Texas était devenu une colonie belge?
Le drapeau du Texas belge: https://www.reddit.com/r/vexillology/comments/79crjk/flag_of_belgiancolonial_texas/
Le documentaire fictif Bye Bye Belgium:https://youtu.be/dVpWlKHFJXQ?si=yKaqdd10g3v1ohvG
Le drapeau des Etats-unis d’Europe: https://www.reddit.com/r/vexillology/comments/g2dp86/flag_of_the_united_states_of_europe_explanation/
Le drapeau de la République soviétique belge:https://www.reddit.com/r/leftistvexillology/comments/1ap5clg/what_if_the_cold_war_was_reversed_peoples/
Le drapeau maoiste belge: https://www.reddit.com/r/leftistvexillology/comments/1ehjjls/democratic_republic_of_belgium_flags_with_its/
Henri Glineur: Belgique – Maitron
Beaucoup des sources que je ne mentionne pas ici se trouvent majoritairement dans mes autres articles.

0 commentaires